Que Font Donc Les Chaînes ? Catherine Humblot Que Font Donc Les Chaînes ?
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Les Nominés Des Gérard De La Télé
Les nominés des Gérard de la Télé La septième édition des Gérard de la télévision, un pastiche des Césars du Cinéma et des 7 d'or de Télé 7 jours, aura lieu lundi 17 décembre à 20h40 à Bobino. Une cérémonie animée par Frédéric Royer, Stéphane Rose et Arnaud Demanche. Désormais, ce qui était une blague potache à ses débuts est devenu un vrai... Programme de télé à part entière, puisque la cérémonie sera diffusée en direct sur Paris Première ! Une châine du groupe M6... dont quelques émissions, c'est vrai, sont nominées aux Gérard. Mais seront-elles pour autant sanctionnées, pardon primées ? réponses le 17 décembre... 1 / Gérard de l’émission de bonnes femmes qui donnent leur opinion Le Grand 8 avec Laurence Ferrari (D8) C'est au programme avec Sophie Davant (FR2) La Matinale avec Ariane Massenet (C+) Les Maternelles avec Julia Vignali (FR5) Comment ça va bien avec Stéphane Bern (FR2) 2 / Gérard du programme court qui ne l’est pas encore assez Soda avec Kev Adams (W9) Nos chers voisins avec Martin Lamotte (TF1) Sophie et Sophie avec Alice Belaïdi (C+) 10 minutes à perdre avec Baptiste Lorer (C+) Roumanoff et les garçons avec Anne Rounanoff (FR2) 3 / Gérard du vieux châtelain dont on se demande ce qu’il fout à la télé, vu qu’il a plus une tête à jouer du cor dans les chasses à cour, mèche au vent, galopant à bride abattue derrière des lévriers dans la rosée du petit matin le dimanche à Fontainebleau Louis Laforge dans des Racines et des ailes (FR3) Bernard de la Bernardière dans Enquêtes exclusives (M6) Patrick de Carolis dans le Grand tour -

Le Guide Des Transferts B
LeMonde Job: WMR3497--0001-0 WAS TMR3497-1 Op.: XX Rev.: 23-08-97 T.: 08:42 S.: 75,06-Cmp.:23,09, Base : LMQPAG 53Fap:99 No:0045 Lcp: 196 CMYK b TELEVISION a RADIO H MULTIMEDIA CINÉMA FRANCE-CULTURE Des centaines « Stavisky... » « L’Histoire La légende immédiate » : de solutions d’un escroc portraits de gens de jeux hors du commun de maisons. Page 29 filmée par Alain Resnais. Page 22 à télécharger. Page 28 b b b b b TF1 FR 2 Le guide des transferts b b b FR 3 bbbbb Canal + Chambardement dans toutes les grandes chaînes. Signe des temps, cette fois il a pour théâtre le secteur de Portraits l’information, ce qui situe les enjeux de l’année qui vient. d’internautes Guillaume Durand, Patrick de Carolis, Albert du Roy, Michel Field, Paul Amar, d’autres encore, changent remarquables (5) de chaîne comme de club de football. Petit guide pour La princesse Liz crée son royaume s’y retrouver. Pages2à5 sur Internet. Pages 26 et27 SEMAINE DU 25 AU 31 AOÛT 1997 LeMonde Job: WMR3497--0002-0 WAS TMR3497-2 Op.: XX Rev.: 23-08-97 T.: 08:42 S.: 75,06-Cmp.:23,09, Base : LMQPAG 53Fap:99 No:0010 Lcp: 196 CMYK RENTRÉE LE GUIDE DES TRANSFERTS La valse des stars de l’information tissement reprennent elles aussi leur ser- rédaction mécontente de sa hiérarchie et Qui aurait pensé, à la rentrée 1996, vice sur leur chaîne, à quelques « débar- pressée d’entreprendre une réforme pro- marquée par les retombées qués » près dans un désintérêt quasi fonde du JT. -
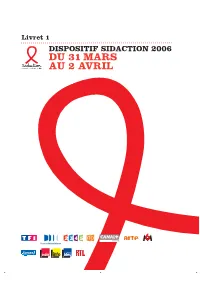
SIDACTION 2006 DU 31 MARS AU 2 AVRIL Sidaction 2006 Du 31 Mars Au 2 Avril
Livret 1 DISPOSITIF SIDACTION 2006 DU 31 MARS AU 2 AVRIL Sidaction 2006 du 31 mars au 2 avril. Faites vos dons au 110. CONTACTS PRESSE Francis Gionti : 01 53 26 45 64 - [email protected] Marie Birolini : 01 53 26 45 65 - [email protected] Karine Martin-Laprade : 01 41 41 26 04 Aurélie Ferton : 01 56 22 67 15 Anne-Laure Mosser : 01 56 22 54 51 Isabelle Delecluse : 01 56 22 46 93 Laurence Ruiu : 01 56 22 89 42 Valérie Vidal : 01 56 22 68 55 Charles-Henri Royer : 01 56 22 92 48 Laurence Zaksas-Lalande : 01 55 22 74 78 Camille Le Boulenger : 01 71 35 20 69 Martina Bangert : 01 55 00 72 90 Florence Moizan : 01 41 92 74 08 Anne Labasque : 01 47 23 19 22 Aliette Maillard : 01 56 40 37 94 Bénédicte Carrerras : 01 56 40 20 43 Jessy Daniac : 01 56 40 16 15 Christophe Imbert : 01 56 40 22 97 Clarisse Dollfus : 01 56 40 23 40 Laurence Audras : 05 34 41 70 21 Geneviève Badiou : 01 40 70 42 93 Site Internet : www.sidaction.org SOMMAIRE Livret 1 Le dispositif général p. 2 Sidaction : les chaînes à l’unisson p. 4 Tous mobilisés contre la progression de l’épidémie p. 5 Les visages de la chaîne des chaînes p. 6 Le dispositif télé hors week-end p. 8 Le dispositif des télés partenaires p. 11 Appels à dons p. 22 Le dispositif des radios partenaires p. 24 Le dispositif terrain du Sidaction 2006 p. -

The Structure and Governance of Public Service Broadcasting A
The Structure and Governance of Public Service Broadcasting A Comparative Perspective The Structure and Governance of Public Service Broadcasting Giorgia Pavani The Structure and Governance of Public Service Broadcasting A Comparative Perspective Giorgia Pavani Department of Political and Social Science Alma Mater Studiorum Università di Bologna Bologna, Italy ISBN 978-3-319-96730-1 ISBN 978-3-319-96731-8 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-319-96731-8 Library of Congress Control Number: 2018949146 © The Editor(s) (if applicable) and The Author(s) 2018 This work is subject to copyright. All rights are solely and exclusively licensed by the Publisher, whether the whole or part of the material is concerned, specifcally the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microflms or in any other physical way, and transmission or information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed. The use of general descriptive names, registered names, trademarks, service marks, etc. in this publication does not imply, even in the absence of a specifc statement, that such names are exempt from the relevant protective laws and regulations and therefore free for general use. The publisher, the authors and the editors are safe to assume that the advice and information in this book are believed to be true and accurate at the date of publication. Neither the publisher nor the authors or the editors give a warranty, express or implied, with respect to the material contained herein or for any errors or omissions that may have been made. -

Ce Soir (Ou Jamais !) » De L'objet Culturel À La
Lucie Niaré Guilloux « Ce soir (ou jamais !) » De l’objet culturel à la parole de culture Histoire et analyse du dispositif d’une émission culturelle de la télévision publique (septembre 2006 – mai 2012). Mémoire de recherche Septembre 2013 1 2 À mes parents et à ma sœur. 3 4 RÉSUMÉ - SUMMARY Ce travail de recherche a pour objet l’étude historique et analytique d’un dispositif audiovisuel de septembre 2006 à mai 2012 : l’émission culturelle de débat « Ce soir (ou jamais !) » présentée par Frédéric Taddeï et diffusée sur la chaîne France 3. Il est ici question de retracer les étapes historiques, passées et récentes, qui impulsent la création d’un programme culturel de ce type. Cet enjeu implique une rétrospective des émissions culturelles diffusées sur la télévision française ; il implique également la rétrospective ainsi que l’état des lieux des acteurs de la vie culturelle de notre société invités à débattre, dont le statut et l’image embrassent progressivement les exigences esthétiques et cognitives de la télévision. Il s’agit dès lors de définir l’héritage historique de l’émission et d’en dégager son originalité, son atmosphère et ses acteurs. Il s’agit également de retracer l’évolution de son contenu, de sa réalisation et de sa réception : quantitative comme qualitative ; médiatique comme publique. The subject of this thesis is the historical and analytical study of an audiovisual device from 2006, September to 2012, May : the cultural talkshow “Ce soir (ou jamais !)”, hosted by Frédéric Taddeï and broadcasted on France 3 channel. The aim here is to trace back the historical steps, past and recent, that encourage the creation of this kind of cultural talkshow. -

Didier Migaud, Président De La Commission Des Finances, De L’Économie Générale Et Du Plan
Compte rendu Mardi 25 septembre 2007 Commission Séance de 15 heures des affaires culturelles, Compte rendu n° 10 familiales et sociales – Audition, ouverte à la presse, commune avec la commission des finances, de M. Patrick de Carolis, président-directeur général de France Télévisions, sur le contrat d’objectifs et de SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2007-2008 moyens de France Télévisions pour 2006-2010..................... 2 Présidence de Pierre Méhaignerie, président, et de Didier Migaud, président de la commission des finances, de l’économie générale et du Plan – 2 – La commission a procédé à l’audition commune avec la commission des finances, ouverte à la presse, de M. Patrick de Carolis, président-directeur général de France Télévisions, sur le contrat d’objectifs et de moyens de France Télévisions pour 2006-2010. Le président Pierre Méhaignerie a souligné les efforts des chaînes publiques en faveur de la création et leur adaptation aux technologies nouvelles tout en rappelant qu’il convient de concilier cette réalité avec le niveau élevé des prélèvements et l’attention à porter au pouvoir d’achat des citoyens. Cette conciliation doit sans doute reposer sur une plus grande synergie entre chaînes, sur une plus grande souplesse dans la gestion de l’entreprise et sur des économies de structure, des marges de productivité pouvant être dégagées. M. Didier Migaud, président de la commission des finances, de l’économie générale et du Plan, a rappelé que la redevance versée à France Télévisions représente plus de 2 milliards d’euros, ce qui constitue un enjeu financier important. Le 11 avril dernier, la commission des finances a formulé un avis favorable au nouveau contrat d’objectifs et de moyens entre l’Etat et France Télévisions pour la période 2006-2010. -

Sarkozy Répond À Ses Détracteurs
www.lemonde.fr 58e ANNÉE – N 17961 – 1,20 ¤ – FRANCE MÉTROPOLITAINE --- JEUDI 24OCTOBRE 2002 FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY – DIRECTEUR : JEAN-MARIE COLOMBANI L’Europe des 25 Sarkozy répond à ses détracteurs f Jacques Chirac NICOLAS SARKOZY, accusé f par la gauche d’être « entré en Dans un entretien remet en question guerre contre les pauvres », répond au « Monde », le « rabais » consenti vivement dans Le Monde aux « droits-de-l’hommistes » et à il s’en prend à la Grande-Bretagne « l’arrogance » d’une certaine intelligentsia qui « a eu un effet aux « tartufes » pour les finances dévastateur sur l’équilibre de notre et aux « droits- de l’Union République ». Le ministre de l’intérieur se veut de-l’hommistes » f le défenseur de « la France des Londres refuse oubliés », « la France des ouvriers, f « Les droits toute renégociation des plus modestes, la France des banlieues, la France laborieuse », de l’homme, des accords de 1984 qui s’est, selon lui, détournée du Parti socialiste. cela vaut f Nicolas Sarkozy devait pré- aussi et d’abord Persistance senter en conseil des ministres, du différend mercredi 23 octobre, son projet de pour les victimes » franco-allemand loi sur la sécurité intérieure, qui durcit la législation sur les pros- fMendiants, squats, sur la PAC tituées, les mendiants, les squat- teurs et les gens du voyage, et qui prostitution : accorde de nouveaux moyens, f En France, le PS notamment informatiques, aux ce qui a changé policiers.Le ministre n’a que légè- ciations de défense des droits de Nantes et président du groupe tions nationales » et son comporte- dans son projet toujours divisé sur rement amendé son texte, dont le l’homme et la gauche ; il a fini par socialiste à l’Assemblée, a par ment de maire. -

La Communication Politique De Nicolas Sarkozy Du 6 Mai 2002 Au
Université Panthéon-Assas école doctorale de sciences économiques et de gestion, sciences de l’information et de la communication (ED 455) Thèse de Doctorat en Sciences de l’Information et de la Communication soutenue le 13 juin 2014 La communication politique de Nicolas 2014 Sarkozy du 6 mai 2002 au 6 mai 2012. Thèse de Doctorat / juin 1.1.1 José Antonio RODRIGUEZ RUIZ Sous la direction du Professeur Francis BALLE. Membres du jury : Professeurs Francis BALLE, Jean-Marie COTTERET, Bernard VALADE, Artan FUGA et Maître Derek ELZEIN. RODRIGUEZ RUIZ J. Antonio| Thèse de doctorat | juin 2014 Avertissement La Faculté n’entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans cette thèse ; ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur. - 2 - RODRIGUEZ RUIZ J. Antonio| Thèse de doctorat | juin 2014 Pourquoi dédier une Thèse de Doctorat à la communication politique de Nicolas Sarkozy ? On peut considérer qu’il a déjà assez fait parler de lui-même. Cependant, si de nombreux commentaires ont été faits à ce sujet et si les analyses sont également nombreuses, j’ai voulu procéder à une analyse globale me permettant de comprendre essentiellement deux choses. D’une part, comment un citoyen, qui a priori n’avait pas beaucoup de chances de devenir président de la République, a réussi à s’imposer de façon assez extraordinaire dans le paysage politique français avec un parcours si atypique. D’autre part je me suis intéressé aux méthodes et aux conséquences de ce succès sur le plan de la communication politique mais aussi sur le plan politique en lui-même. -
Discours Prononcé Par M. Hugues R. Gall Pour L'installation De M. Patrick
Discours prononcé par M. Hugues R. Gall pour l’installation de M. Patrick de Carolis à l’Académie des Beaux-Arts le mercredi 12 octobre 2011 Monsieur, C’était le matin du 8 janvier 2008. Au Palais de l’Elysée. Le président de la République, présentant ses vœux à la presse, annonce sa décision de supprimer la publicité sur les chaînes du service public. Le secret a été bien gardé : l’effet de surprise est total, pour chacun des invités, pour la ministre de la Culture et de la Communication d’abord, pour vous surtout : n’êtes-vous pas le président de France Télévisions, que cette révolution allait ébranler comme elle allait d’ailleurs chahuter tout le paysage de l’audiovisuel français ? Le danseur que vous avez failli devenir, et qui continue à faire sa barre chaque matin, est pris à contre-pied par le brillant saut présidentiel qu’en danse classique on appelle « un Royal » : Louis XIV ,le premier danseur de son temps, l’a, dit-on, inventé… L’« adage » si complexe, ce « pas de trois » toujours renouvelé que vous dansez depuis près de trois ans avec l’État, votre actionnaire, et avec votre public, l’on vient d’en bouleverser la fragile chorégraphie. Un moment de stupeur, d’étonnement, d’irritation sans doute, de découragement peut-être ? « Aujourd’hui, il est seul, de nouveau seul. Naufragé sur ce boulevard des Lices inondé de soleil Son ventre est dévoré d’angoisse Et ses jambes fauchées par le vide. » Ces vers libres trouvés dans Refuge pour temps d’orage , votre recueil de poèmes au si beau titre, ces vers vous ont-ils été inspirés par ces moments où tout a semblé vaciller pour vous ? Car le soir, chaque soir, et jusque tard dans la nuit, vous écrivez, vous retrouvez votre vrai refuge : les vers, la poésie, vitale et salvatrice. -

La Chaine D'information Internationale
LA CHAINE D’INFORMATION INTERNATIONALE POUR LA FRANCE AUX PRISES AVEC D’ANCIENNES RÉALITÉS PAR 1 GERALD ARBOIT Comme l’année précédente, il aura fallu la promesse d’un nouveau débat budgétaire de la communication pour relancer, en 2005, la question de la création de la Chaîne française d’information internationale (CFII), puisque la provision de trente millions d’euros, votée sur injonction présidentielle, n’avait pas été utilisée2. Les vicissitudes politico-médiatiques de 2005 n’ont pas permis aux deux maîtres d’œuvre du projet, les PDG de France Télévisions, Marc Tessier, et de TF1, Patrick Le Lay, d’avancer sereinement. Les conséquences fâcheuses du référendum européen ont emporté son plus fervent supporter, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, remplacé par son ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin. Presque concurremment, le mandat de Marc Tessier n’a pas été renouvelé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui lui a préféré l’animateur de «Des racines et des ailes», Patrick de Carolis. Ces changements ont fait resurgir les contradictions internes du projet de rationaliser l’audiovisuel extérieur de la France. Tout à ces querelles franco-françaises autour de personnalités qui ont miné la longue gestation de la CFII depuis ses origines les plus lointaines3, peu d’observateurs ont relevé l’accord tant attendu de l’Union européenne. Il est vrai que la bataille de France Télévisions battait son plein et que la Chaîne française d’information internationale semblait avoir cessé d’être un objet médiatique. Donnant pourtant lieu à d’acerbes commentaires, notamment dans la presse américaine, et à une exploitation internationale biaisée par la télévision publique russe – la traditionnelle utilisation de l’information mondiale pour commenter des questions intérieures –, l’embrasement social des banlieues des grandes métropoles nationales, au début de l’automne, n’a pas ramené l’attention sur la nécessité de disposer d’une telle chaîne. -

Fonds Des Directeurs Et Directeurs Adjoints De Cabinet De Frédéric Mitterrand, Ministre De La Culture Et De La Communication De 2009 À 2012
Fonds des directeurs et directeurs adjoints de cabinet de Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la communication de 2009 à 2012 Répertoire numérique détaillé n° 20170079 Isabelle Autin-Donsez, mission des archives du ministère de la Culture et de la communication Première édition électronique Archives nationales (France) Pierrefitte-sur-Seine 2017 1 https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_055851 Cet instrument de recherche a été rédigé dans le système d'information archivistique des Archives nationales. Ce document est écrit en français. Conforme à la norme ISAD(G) et aux règles d'application de la DTD EAD (version 2002) aux Archives nationales. 2 Archives nationales (France) INTRODUCTION Référence 20170079/1-20170079/193 Niveau de description sous-fonds Intitulé Fonds des directeurs et directeurs adjoints de cabinet de Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la communication de 2009 à 2012 Date(s) extrême(s) 2006-2012 Nom du producteur • Cabinet de Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication Importance matérielle et support 66 cartons de type Dimab Localisation physique Pierrefitte-sur-Seine Conditions d'accès Communicable sur autorisation de M. Frédéric Mitterrand jusqu'en 2037, conformément au protocole signé entre lui et le ministère de la Culture et de la communication (service interministériel des archives de France), représenté par M. Hervé Lemoine ; et 50 ans à compter du document le plus récent (données personnelles) pour les articles 1 à 22 et 61. Conditions d'utilisation Selon les règles de la salle de lecture DESCRIPTION Présentation du contenu Ce fonds traite des dossiers suivis par les directeurs et directeurs adjoints du cabinet de Frédéric Mitterrand. -

Zapping De Nuit Récit D’Une Insomnie Devant Le Poste
LeMonde Job: WEL0799--0001-0 WAS TEL0799-1 Op.: XX Rev.: 20-02-99 T.: 08:20 S.: 75,06-Cmp.:20,09, Base : LMQPAG 52Fap:100 No:0203 Lcp: 700 CMYK RADIO VIDEO DVD SEMAINE DU 22 AU 28 FÉVRIER 1999 LAURENT GERRA CULTURE YIDDISH SPIKE LEE TENNIS Portrait Voyage radiophonique « Nola Rentrée de l’imitateur à travers une culture Darling attendue à succès, vivante n’en fait d’Amélie qui a fait et une qu’à sa Mauresmo gagner langue tête », premier à l’Open 300 000 auditeurs à Europe 1. millénaire. film d’un cycle consacré Gaz de France, Page 6 Page 13 au cinéaste noir américain. à Paris. Page 38 Zapping de nuit Récit d’une insomnie devant le poste. Pages 4-5 LeMonde Job: WEL0799--0002-0 WAS TEL0799-2 Op.: XX Rev.: 19-02-99 T.: 18:16 S.: 75,06-Cmp.:20,09, Base : LMQPAG 52Fap:100 No:0204 Lcp: 700 CMYK Arditi sur RMC Privatisée en juin 1998, RMC présente à partir du 1er mars un style relooké. Dans un esprit de reconquête du public, la grille privilégie les « plaisirs de la vie ». Ainsi, des artistes sont invités à venir lire leurs œuvres préférées. Pierre Arditi, grand familier des médias, est déjà sur la liste. Inquiétudes Télé-police à « La Marche Par Daniel Schneidermann du siècle » UI l’a su ? Le pré- venue de Gligorov, personnalité mena- sident de la Répu- cée, jadis blessé par un attentat dans son Les douze collaborateurs blique de Macé- pays, se déroulait sous très haute protec- de « La Marche du doine, Kiro tion policière.