Rapport De Presentation
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Route Wegbeschreibung C
b Route Wegbeschreibung c Vanaf het toerismebureau van Vaison-La-Romaine, Vom Office de Tourisme in Vaison-La-Romaine VAISON-LA- 4 a rij de “avenue Général de Gaulle” op. Aan het fahren Sie die Avenue du Général de Gaulle hinauf bis ROMAINE rondpunt, ga rechtdoor, vervolgens naar links en zu dem Kreisverkehr, dort geradeaus, dann links und d a dan naar rechts de D51 op. anschließend rechts auf die D51. 1 2 3 b Op het kruispunt met de D94, ga verder rechtdoor. An der Kreuzung zur D94 geht es weiter geradeaus. 6 m’ Voor Le Palis, neem links (aanduiding “Baud”). Kurz vor Le Palis fahren Sie links (Ausschilderung CAIRANNE SAINT-MARCELLIN- c Volg de fietsroute bewegwijzering. „Baud“). Folgen Sie dem ausgeschilderten Fahrradweg. f RASTEAU ROAIX LES-VAISON p’ n’ Aan het rond punt, neem rechts richting Roaix. Am Kreisverkehr biegen Sie rechts ab in Richtung e d Rechtover de post neemt u rechts. Vervolgens Roaix. Gegenüber der Post fahren Sie rechts, dann links links. Ga verder rechtdoor tot in Rasteau. und anschließend geradeaus bis nach Rasteau. g e’ d’ In Rasteau, neem links ter hoogte van het In Rasteau fahren Sie links in Richtung Office de e toerismebureau. Daal de “rue des écoles” af. Tourisme, dann die Rue des Ecoles hinab bis zum o’ Neem rechts aan de stop. Aan het rond punt, Stoppschild, dort rechts und am Kreisverkehr wieder neem rechts en volg de fietsroute bewegwijzering. rechts entlang dem ausgeschilderten Fahrradweg. l’ Aan het kruisptun met de D51, neem links richting An der Kreuzung mit der D51 fahren Sie links bis l f Cairanne. -
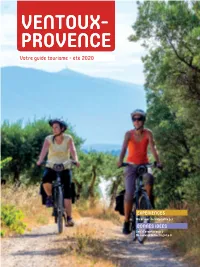
Guide 89.Indd
VENTOUX- PROVENCE Votre guide tourisme - été 2020 EXPÉRIENCES Un amour de bicyclette p.2 BONNES IDÉES Soif d’aventures p.7 Découvrez le berlingot p.8 EXPÉRIENCES Un amour de bicyclette preux chevalier servant d’une petite reine qui ne connaît d’autre couronne que celle de son pédalier. Qu’importe si mon fier destrier n’était qu’un vieux © Cailhol X. – VPA clou. Don Quichotte n’a-t-il pas conquis la littérature en chevauchant aussi pittoresque monture ? © Alain Hocquel – VPA Ventoux d’aquarelle Justement, ma première conquête, ô bien modeste, fut un simple socle ro- cheux sans l’ombre d’un moulin à vent. Mais quel piédestal pour ce village de France idéal ! Perle des Dentelles, La Roque-Alric se débusque là, lovée dans une conque de genêts et de lacets, oi- seau de paradis qui jamais ne quitte son nid pour couver sa liberté. Sitôt arrivé, un étroit collet mit le feu à mes jarrets avant de m’envoyer buter au pied de la citadelle du Barroux, balcon perché à l’aplomb d’un parterre de villages brodés sur le velours des cyprès, la soie des amandiers. Et, partout, perçant le ACCUEIL VÉLO VENTOUX Je connais un pays qui est un voyage à lui tout seul. C’est à bicyclette, la curiosité des cigales, des envolées de geais qui matin, suis-je parti décrire une grande en bandoulière, à l’allure du facteur, qu’il se révèle, qu’il s’apprécie. Prenez fusent comme la pensée vagabonde. boucle autour de mon estive, écrire Ici, le cœur est une escarcelle qui fait au fil du chemin un tour de France la poudre d’escampette, peu importe la direction, ses routes s’apprivoisent provision de bons moments avant les miniature aux parfums de lavande et comme le bonheur. -
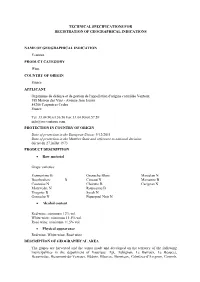
Technical Specifications for Registration of Geographical Indications
TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR REGISTRATION OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS NAME OF GEOGRAPHICAL INDICATION Ventoux PRODUCT CATEGORY Wine COUNTRY OF ORIGIN France APPLICANT Organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée Ventoux 388 Maison des Vins - Avenue Jean Jaurés 84206 Carpentras Cedex France Tel. 33.04.90.63.36.50 Fax 33.04.90.60.57.59 [email protected] PROTECTION IN COUNTRY OF ORIGIN Date of protection in the European Union: 9/12/2011 Date of protection in the Member State and reference to national decision: décret du 27 juillet 1973 PRODUCT DESCRIPTION Raw material Grape varieties: Vermentino B Grenache Blanc Marselan N Bourboulenc B Cinsaut N Marsanne B Counoise N Clairette B Carignan N Mourvedre N Roussanne B Viognier B Syrah N Grenache N Piquepoul Noir N Alcohol content Red wine: minimum 12% vol. White wine: minimum 11.5% vol. Rosé wine: minimum 11.5% vol. Physical appearance Red wine, White wine, Rosé wine DESCRIPTION OF GEOGRAPHICAL AREA The grapes are harvested and the wines made and developed on the territory of the following municipalities in the department of Vaucluse: Apt, Aubignan, Le Barroux, Le Beaucet, Beaumettes, Beaumont-du-Ventoux, Bédoin, Blauvac, Bonnieux, Cabrières-d'Avignon, Caromb, Carpentras, Caseneuve, Crestet, Crillonle-Brave, Entrechaux, Flassan, Fontaine-de-Vaucluse, Gargas, Gignac, Gordes, Goult, Joucas, Lagnes, Lioux, Loriol-du-Comtat, Malaucène, Malemort- du-Comtat, Maubec, Mazan, Méthamis, Modène, Mormoiron, Murs, Pernes, Robion, La Roque- sur-Pernes, Roussillon, Rustrel, Saignon, Saumane, Saint-Didier, Saint-Hippolyte-le-Graveron, Saint-Martin-de-Castillon, Saint-Pantaléon, Saint-Pierre-de-Vassols, Saint-Saturnin-d'Apt, Venasque, Viens, Villars and Villes-sur-Auzon. -

Le Mot Du Maire
N°19 - AVRIL 2017 LE MOT DU MAIRE Ce début d’année nous donne une charge de travail Sommaire : conséquente au vue des échéances électorales : présidentielles Editorial P. 1 et législatives ; nous comptons sur vous et votre sens du civisme. Droits civiques P. 2 à 4 Pour donner suite à l’agenda d’accessibilité, les premiers travaux seront envisagés pour la mairie avec regroupement des Municipalité P . 5 à 10 services « Mairie » et « Poste » dans un même lieu. Nous poursuivrons l’accessibilité par l’école. Vie du village P. 11 à 17 Malgré le début du printemps exceptionnel, le gel a frappé la Communiqué commune assez sévèrement. informations P. 18 à 19 Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin rempli Festivités P.20 à 21 d’informations. Etat civil P. 22 Michel JOUVE Bloc notes P. 23 PAGE 2 LE FLASSANNAIS N°19 - AVRIL 2017 DROITS CIVIQUES RECENSEMENT MILITAIRE (ou recensement citoyen) Les jeunes gens dès le jour de leurs 16 ans sont priés de venir se faire recenser en Mairie dans le trimestre qui suit leur anniversaire. Ainsi, un jeune ayant 16 ans le 15 juin 2017 doit venir se faire recenser avant le 30 juin 2017. À la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de recensement. Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée défense et citoyenneté (JDC). Le recensement permet aussi l'inscription d'office du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans. Coordonnées téléphoniques du Bureau accueil du Centre du Service National de Nîmes : 04.66.02.31.73 Centre joignable également sur l’adresse institutionnelle : http://www.defense.gouv.fr/jdc PROCHAINES ELECTIONS Les nouvelles cartes électorales vous ont été distribuées et sont à utiliser pour le prochain scrutin. -

Présentation PLH Au CRH Du 190214 170214
PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT DE LA COVE “2014---2020-2020 CRH du 19 Février 2014 1 2 3 HISTORIQUE ° Premier PLH : février 2007 –––février 2013 ° Deuxième PLH : délibération du 13 février 2012 pour lancer l'étude préalable ° 111ererer arrêt : 9 septembre 2013 ° Consultation des communes et du Syndicat du SCOT Arc Comtat Ventoux : du 20 septembre au 20 novembre 2013 ° 222ème Arrêt : 16 décembre 2013 ° Saisine du Préfet de Vaucluse : 6 janvier 2014 ° Présentation au CRH : 19 février 2014 4 DIAGNOSTIC • La CoVe est composée de 25 communes avec une population municipale de 686868362 habitants en 2012.... • Carpentras est la ville centre avec une population municipale en 2012 de 29 278 habitants. • 3 communes soumises à l’article 55 de la loi SRU (20%) : Carpentras, Aubignan et Mazan. Une prépondérance de l’individuel : • 70 % des résidences principales sont des maisons individuelles (65 % pour le Vaucluse) • Carpentras a 48 % de collectif 5 UNE POPULATION DYNAMIQUE MAIS FRAGILISÉE Un territoire attractif : + 1,2 % (1999-2009) Estimation de la population supplémentaire sur la durée du PLH : + 5 704 habitants (951 habhab/an)/an) Une croissance portée par le solde migratoire et naturel : solde naturel + 0,2 %/an et migratoire + 1%/an . Une population avec de faibles revenus : ► Revenu fiscal moyen : 16 743 € (2011) ► Part des ménages dont le revenu est inférieur au seuilseuil PLUS : 63 % ► Part des ménages dont le revenu est inférieur au seuilseuil PLAI : 36 % Un accroissement des ménages monoparentaux : taux de 9% (2009) Un vieillissement de la population : 10,3 % de personnes âgées de plus de 75 ans contre 9,3 % dans le Vaucluse 6 UN PARC A AMÉLIORER ° Un parc ancien : 56 % des logements sont antérieurs à 1975 dont 30% sont antérieurs à 1949 . -

Juillet-Août 2019 - #28 - Agenda
Juillet-Août 2019 - #28 www.monteux.fr agenda RETROUVEZ LES RENDEZ-VOUS DES ASSOCIATIONS DÉTAILLÉS EN PAGES 16 ET 17 JUILLET Jusqu’au 1er septembre Mercredi 10 Mercredi 31 Monteux cœur de ville : Instants ASL Lac de Monteux Provence : ASL Lac de Monteux Provence : Séance « Sport au Lac » tous les dimanches et Séance cinéma plein air offerte au public cinéma plein air offerte au public « La tous les mercredis de 9h30 à 10h30 au « Sur la piste du Marsupilami » à 21h45 finale » à 21h30 au théâtre de verdure Lac de Monteux (cf. p14-15) au théâtre de verdure de la dune du Lac de la dune du Lac de Monteux de Monteux (cf. p14-15) (cf. p14-15) Du 1er juillet au 31 août Traversée des Arts : Ateliers découvertes Vendredi 12 « Matinales créatives » animés par les Traversée des Arts : Vernissage de artistes du mardi au samedi de 9h à 12h l’exposition « L’Art en grand » avec (cf. p24) les œuvres de l’artiste peintre Ralau, à 19h dans le Jardin artistique (rue Porte Mercredi 3 Magalon) Soif de Culture / ACEL (Association Culture Education Laïcité) : Ciné en Samedi 13 plein air « Monsieur Link » à 22h dans la Mairie / Comité des fêtes : Monteux cour de l’école Sénateur Béraud. Séance fête la République à l’occasion de la offerte au public fête nationale, à partir de 19h sur le Boulevard Foch et la Place Sénateur Du vendredi 5 au dimanche 7 Béraud (cf. p12) Soif de Culture : Exposition estivale aux Pénitents « Rencontre avec le numérique Dimanche 14 par JABRun », peintre numérique Soif de Culture / Les Amis de l’orgue : « plasticien éclectique du réel ». -

Cahier Des Charges De L'appellation D'origine Contrôlée « GIGONDAS
Publié au BO du MAA le 10 décembre 2020 Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « GIGONDAS » homologué par arrêté du 7 décembre 2020, publié au JORF du 10 décembre 2020 CHAPITRE Ier I. - Nom de l’appellation Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Gigondas », initialement reconnue par le décret du 6 janvier 1971, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après. II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires Pas de disposition particulière. III. – Couleur et types de produit L’appellation d’origine contrôlée « Gigondas » est réservée aux vins tranquilles rouges et rosés. IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées 1°- Aire géographique La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Gigondas dans le département du Vaucluse. 2°- Aire parcellaire délimitée Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 13 mars 2008. L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de Gigondas les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées. 3°- Aire de proximité immédiate L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes -

Provence and the Rhone Valley 2015
Provence and the Rhone Valley 2015 Trip Highlights Three rich days of vineyard and winery visits including organic and biodynamic producers Experienced oenoguide who can give useful insight into all aspects of viticulture and winemaking Wine paired lunches Fantastic hotels These are our recommended hotels for your trip. The first property is located in the heart of Avignon and would be a great place to explore the town from on the evening of your arrival. The other options are our favorites for winery visits. You can view the location of the hotels HERE Hotel La Mirande - Avignon Ideally located in the heart of Avignon, this 5* property is housed within a medieval Cardinal’s palace. Affiliated with the prestigious “The Leading Hotels of the World” brand, this property conveys an elegance and charm of earlier times. Into The Vineyard – www.IntoTheVineyard.com Email: [email protected] Tel: 1 604 629 1173 | Fax: 1 604 899 9401 Suite 328 - 1085 Homer St. Vancouver, Canada, V6B 2X5 Hotel Option 1 - La Coquillade Located on a hill overlooking a winery estate, the Domaine de La Coquillade boasts exceptional views of the Luberon and Mont Ventoux. This charming hamlet contains six sumptuously furnished residences, the oldest dating back to the 11th century. Experience a blend of authenticity and ecology in the heart of the vineyards. Hotel Option 2 - Chateau Mazan Set in stunning landscaped gardens, Château de Mazan was built in 1720 and many of the original and later features are still apparent: the wonderful staircase, the 19th century tiled floors, the Franck brothers’ Enlightenment creation, the impressive Marquis’ library, the old Provencal casement windows, the Empire chimney… Into The Vineyard – www.IntoTheVineyard.com Email: [email protected] Tel: 1 604 629 1173 | Fax: 1 604 899 9401 Suite 328 - 1085 Homer St. -

Rhône Valley 2016 En Primeur Opening Offer MARCH 2018
TANNERS Rhône Valley 2016 En Primeur Opening Offer MARCH 2018 The Weather “A wonderful vintage of For the second year in a row, the vintage is being hailed as near-perfect in the concentrated, fruity and Rhône, although the South has the edge balanced wines” this time. Here the winter was mild and the spring avoided the frost and hail that other regions suffered allowing the flowering to take place in optimum conditions. There followed a fine dry summer with hot days and cool nights which allowed the grapes to ripen fully and mature quickly. The Mistral blew being hailed as near-perfect throughout the year and the rainfall was well below average which meant that there was virtually no disease nor rot. The harvest started at the end of August for Galets, the famous stones of Châteauneuf-du-Pape the whites and mid-September for the spring was generally mild but also damp blessed and the wines have wonderful reds in perfect conditions. The North which led to problems with mildew but sweet fruit with very fine and precise did not fare quite so well; hail around from June on the conditions improved tannins while also maintaining great Hermitage in April caused damage. The allowing for a good, although relatively freshness. Gigondas and surrounding late, harvest. Overall the vintage can be areas also have wines of wonderful quality characterised as having superb balance of although a bit down on quantity due to En Primeur: richness and freshness. This is definitely slightly more irregular flowering here. What does it mean? one to add to the cellar! Unusually for a top red vintage the whites have been very successful too due to the All the 2016 wines in this offer are The Wines offered ‘Lying Abroad’ or 'En Primeur'. -

ALTHEN DES PALUDS Du Ventoux Au Fil De L’Eau
MONTEUX – ALTHEN DES PALUDS Du Ventoux au Fil de l’Eau e c n e v ro P la de u A Office de Tourisme Communautaire des Sorgues du Comtat ÉDITION 2018 pictogrammes Etablissement de plain-pied / Parking privé pour cars / Draps et linge de toilette fournis Easy access establishments Private bus park / Bed linen and bathroom towel furnished 8 Animaux admis / Pets allowed Restaurant sur place BIENVENUE À MONTEUX ET À ALTHEN-DES-PALUDS ! Location de draps et de linge de Accès internet avec ordinateur Animations / Entertainment 2 toilette / Bed linen and bathroom à disposition / Computer and Club enfants / Kids Club towel rental internet access WELCOME ! Télévision / Television Piscine sécurisée privée / Wifi / WIFI access Télévision commune / Private swimming pool 9 Climatisation / Air conditioning Shared television Piscine sécurisée commune / Terrasse / Terrace Coffre-fort / Safe Shared swimming pool Jardin / Garden Sèche-cheveux / Hairdryer Piscine sécurisée chauffée / BONNES ADRESSES / RECOMMENDED ADDRESSES Heated swimming pool 5 Boulodrome / Bowling pitch Lave-linge / Washing machine P. 26 à 45 Jacuzzi - Spa 1 Aire de jeux pour les enfants / Sèche-linge / Dryer machine Playground Micro-ondes / Microwave 4 Barbecue / Grill RESTAURANTS / RESTAURANTS Parking réservé aux personnes Réfrigérateur / Refregirator Tennis / Tennis court P. 46 à 55 en situation de handicap / Disabled parking space Cuisine à disposition / Kitchen Vélos à disposition / Bicycles available HÔTELS / HOTELS Parking privé / Private car park Lave-vaisselle / Dishwasher Baignoire / Bath Garage à vélos / Bicycle shed P. 56 à 59 Parking sécurisé et fermé / 3 Secure car park Garage privé / Private garage & Douche / Shower MEUBLÉS / FURNISHED TOURIST ACCOMODATION Salle de séminaires / Equipement bébé / Capacité intérieur et extérieur / Conference room Baby equipment In doors/outside capacity P. -

Plan Local D'urbanisme
U A E T S A R DEPARTEMENT DU V AUCLUSE P IECE N ° 1 0 Plan Local D’urbanisme N OTICE DE VOIES BRUYA NTES Conçu par COMMUNE Dre ssé par HABITAT&DEVELOPPEMENT DE Vaucluse Ingénieur aménagement rural B.WIBAUX Direction animation JB.PORHEL Chargé de mission Urbanisme 07/02/2017 X. DEFOSSEUX Assistant d’études Urbanisme Notice des voies bruyantes LE CONTEXTE GENERAL Le bruit figure parmi les préoccupations majeures des citoyens. Selon une enquête de l’I.N.S.E.E. parue en 2002, 54% des habitants des agglomérations de plus de 50 .000 habitants se déclarent gênés par le bruit à leur domicile. Toujours selon une enquête menée par le centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (CREDOC) près de 40% des français se déclarent gênés par le bruit. En ce qui c oncerne plus particulièrement les transports terrestres, le développement des infrastructures, aussi bien ferroviaires que terrestres, engendre des nuisances sonores de plus en plus mal ressenties de la part des riverains. Ainsi, selon le centre d’informat ion et de documentation sur le bruit (CIDB) plus de 12% de la population française subit des nuisances lies à des niveaux sonores extérieurs élevés. Ainsi, même si les effets de ces nuisances sur la santé sont encore mal évalués, le bruit est sans contexte l’une des atteintes majeures à l’environnement et à la qualité de vie des citoyens. La lutte contre le bruit Le code de l’environnement, au travers de ses articles L.571 et L.572, a fixé comme objectifs de lutte contre les nuisances sonores : de limiter les sources d’émissions sonores ; de réglementer certaines activités bruyantes ; de définir des normes de bruit applicables aux infrastructures terrestres ; de renforcer l’isolation de certains bâtiments. -

Alain Jaume ( Grand Veneur ) France - Rhone Valley
Alain Jaume ( Grand Veneur ) France - Rhone Valley In the 14th century, during their stay in Avignon, the popes built a papal castle in Châteauneuf-du-Pape. Impressed by the area’s exceptional terroir surrounding the castle, Pope Jean XXII planted the first vines of Châteauneuf-du-Pape in 1320. Interestingly, the wine that gave Châteauneuf-du-Pape its original reputation was the white and not the red. The white wine was a favorite of Pope Innocent VI. Today the castle is now a historic monument in Avignon, and the papacy is based in Rome’s Vatican City. But still today, the pope’s coat of arms remains on the bottles of Châteauneuf-du-Pape, and the wines are still produced in a similar manner as when the popes first pressed their juice. Founded 1979 Established in the northern part of Châteauneuf-du-Pape, in the commune of Orange, the Jaume family has been dedicated to the art Location of wine growing since 1826. Founded by Mathieu Jaume, the Domaine is now run by the 5th and 6th generations of Jaumes: Alain Jaume & France his children Christophe, Sébastien, and Hélène. Wine Production Area Historically, Domaine Grand Veneur was known for its white wines, France - Rhone Valley - Chateauneuf du Pape until 1995 when the winery refocused their efforts on the reds. The AOC, Cotes du Rhone AOC, Gigondas AOC, estate now measures 225 acres and covers four appellations: Lirac AOC, Rasteau AOC, Tavel AOC, Châteauneuf-du-Pape Vacqueyras AOC, Ventoux AOC, Cairanne Côtes-du-Rhône 'Les Champauvins' & Côtes-du-Rhône (Rouge, AOC Blanc & Rosé) Lirac Owners Vacqueyras Alain Jaume and Family The Jaume family produces wines from these appellations under the Winemaker Grand Veneur, Chateau Mazane and Clos des Sixte labels.