Névache – Bardonecchia – Modane
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

COLLEGAMENTO HVDC ITALIA – FRANCIA Denominato “Piemonte - Savoia”
Codifica RVAR10001BSA00613 SINTESI NON TECNICA Rev. 00 Pag. 1 Del 27/04/2015 di 43 COLLEGAMENTO HVDC ITALIA – FRANCIA denominato “Piemonte - Savoia” Variante localizzativa tra i comuni di Bussoleno e Salbertrand al progetto autorizzato con decreto del MSE n.239/EL-177/141/2011 del 07/04/2011 SINTESI NON TECNICA Storia delle revisioni Rev. 00 Del 27.04.2015 Prima emissione Questo documento contiene informazioni di proprietà di Terna Rete Italia SpA e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E’ vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l’esplicito consenso di Terna Rete Italia SpA Codifica RVAR10001BSA00613 SINTESI NON TECNICA Rev. 00 Pag. 2 Del 10/02/2015 di 43 INDICE 1 PREMESSA .......................................................................................................................................................... 3 2 MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE LOCALIZZATIVA ......................................................................................... 8 3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE ................................................................................................................ 10 4 DESCRIZIONE DEL PROGETTO ...................................................................................................................... 12 4.1 SVILUPPO DEL TRACCIATO ....................................................................................................................... 12 4.2 FASI OPERATIVE E GESTIONE DEL CANTIERE -

Votre Guide Mobilité Your Public Transport Guide
Votre guide mobilité Your public transport guide HIVER WINTER 2019-2020 Tous les horaires : du 14 décembre 2019 au 24 avril 2020 All schedules: from 14th December 2019 to 24th April 2020 Se la rouler douce… en Haute Maurienne Vanoise Travel easy... in Haute Maurienne Vanoise Nous mettons à votre service des lignes de trans- We provide you with public transport services so port en commun, pour vous permettre de vous you can explore all of our beautiful land. déplacer sur tout notre beau territoire. All the information you need for a great stay is L’ensemble des informations nécessaires pour available in this guide. un séjour agréable est compilé dans ce guide. If you require further information, we would be Si toutefois, vous avez besoin de précisions, nous delighted to answer your questions on: serons ravis de vous répondre au 04 79 05 99 06. +33 (0)4 79 05 99 06. L’ensemble de ces informations se trouve For more informations please go on www.haute- sur le site internet www.haute-maurienne- maurienne-vanoise.com/hiver/haute-maurienne- vanoise.com/hiver/haute-maurienne-vanoise/ vanoise/destination/se-deplacer-en-hmv/ destination/se-deplacer-en-hmv/ ou en flashant or scan the QR code above. le QR Code ci-contre : Informations générales 3 Tarifs et conditions de vente 4 Saint-André - Modane 8 Le Bourget - La Norma 9 Modane - Valfréjus (le samedi) 10 Modane - La Norma (le samedi) 11 Valfréjus - Modane - La Norma 12 SUMMARY SOMMAIRE M11 Modane - Aussois (le samedi) 15 M11 Modane - Aussois - Val Cenis Lanslebourg • Le dimanche : du 22 déc. -

Ai Sensi Della DGR N° 45-6566 Del 15/07/2002 E Successive Modifiche
COMUNE DI OULX Verifiche di compatibilità idraulica delle previsioni dello strumento urbanistico (PRGC) ai sensi della D.G.R. n° 45-6566 del 15/07/2002 e successive modifiche ed integrazioni Sommario 1 PREMESSA......................................................................................................... 3 1.1 La definizione delle aree a diversa pericolosità ....................................................... 4 1.2 Riferimenti normativi .......................................................................................... 6 1.3 La documentazione esistente ............................................................................... 6 1.4 La cartografia di riferimento................................................................................. 7 2 LA RETE IDROGRAFICA PRINCIPALE (DORA DI CESANA E DORA DI BARDONECCHIA). 7 2.1 Le richieste di integrazioni ................................................................................... 8 2.2 Il modello numerico.......................................................................................... 10 2.3 Geometria impiegata ........................................................................................ 10 2.4 Condizioni al contorno e settaggi di calcolo .......................................................... 13 2.4.1 Portate di riferimento........................................................................................ 13 2.4.2 Scabrezza ....................................................................................................... 20 -

Recco® Detectors Worldwide
RECCO® DETECTORS WORLDWIDE ANDORRA Krimml, Salzburg Aflenz, ÖBRD Steiermark Krippenstein/Obertraun, Aigen im Ennstal, ÖBRD Steiermark Arcalis Oberösterreich Alpbach, ÖBRD Tirol Arinsal Kössen, Tirol Althofen-Hemmaland, ÖBRD Grau Roig Lech, Tirol Kärnten Pas de la Casa Leogang, Salzburg Altausee, ÖBRD Steiermark Soldeu Loser-Sandling, Steiermark Altenmarkt, ÖBRD Salzburg Mayrhofen (Zillertal), Tirol Axams, ÖBRD Tirol HELICOPTER BASES & SAR Mellau, Vorarlberg Bad Hofgastein, ÖBRD Salzburg BOMBERS Murau/Kreischberg, Steiermark Bischofshofen, ÖBRD Salzburg Andorra La Vella Mölltaler Gletscher, Kärnten Bludenz, ÖBRD Vorarlberg Nassfeld-Hermagor, Kärnten Eisenerz, ÖBRD Steiermark ARGENTINA Nauders am Reschenpass, Tirol Flachau, ÖBRD Salzburg Bariloche Nordkette Innsbruck, Tirol Fragant, ÖBRD Kärnten La Hoya Obergurgl/Hochgurgl, Tirol Fulpmes/Schlick, ÖBRD Tirol Las Lenas Pitztaler Gletscher-Riffelsee, Tirol Fusch, ÖBRD Salzburg Penitentes Planneralm, Steiermark Galtür, ÖBRD Tirol Präbichl, Steiermark Gaschurn, ÖBRD Vorarlberg AUSTRALIA Rauris, Salzburg Gesäuse, Admont, ÖBRD Steiermark Riesneralm, Steiermark Golling, ÖBRD Salzburg Mount Hotham, Victoria Saalbach-Hinterglemm, Salzburg Gries/Sellrain, ÖBRD Tirol Scheffau-Wilder Kaiser, Tirol Gröbming, ÖBRD Steiermark Schiarena Präbichl, Steiermark Heiligenblut, ÖBRD Kärnten AUSTRIA Schladming, Steiermark Judenburg, ÖBRD Steiermark Aberg Maria Alm, Salzburg Schoppernau, Vorarlberg Kaltenbach Hochzillertal, ÖBRD Tirol Achenkirch Christlum, Tirol Schönberg-Lachtal, Steiermark Kaprun, ÖBRD Salzburg -
Travaux Scientifiques
MINISTÈRE DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA NATURE Travaux Scientifiques du Parc National de la Vanoise Recueillis et publiés sous la direction de M. BARDEL Directeur du Parc National et P. OZENDA Correspondant de l Institut Professeur à l'Université de Grenoble Tome IV 1974 Cahiers du Pare National de la Vanoise 15, rue du Docteur-Jultiand 73000 - CHAMBÉRY - (France) COMPOSITION DU COMITÉ SCIENTIFIQUE DU PARC NATIONAL DE LA VANOISE Président ; *M, Paul VAYSSIERE, Professeur honoraire au Muséum National d'His- toire Naturelle, Vice-Président : *M. Philippe TRAYNARD, Professeur à l'Université de Grenoble, Vice- Président du C.A.F. Secrétaire : *M. Paul OZENDA, Correspondant de l'Institut, Professeur à l'Université de Grenoble. Wiembres du Comité : *M. Clément BRESSOU, Membre de l'Institut, Secrétaire général du Conseil National de la Protection de la Nature. M, Roger BUVAT, Membre de l'Institut, Professeur à l'Université de Marseille-Luminy. Mlle Camille BULARD, Professeur à l'Université de Nice. M. Paul BARRUEL, Attaché au Muséum National d'Histoire Naturelle. M. Roger BENOIST, Président de la Société d'Histoire Naturelle de la Savoie. M. Jean BOURGOGNE, Sous-Direcfeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. M:. Louis de CRECY, Ingénieur en Chef du Génie Rural des Eaux et des Forêts, Grenoble. M. Charles DEGRANGE, Professeur à l'Université de Grenoble. M. Philippe DREUX, Professeur à l'Université de Paris. M. François ELLENBERGER, Professeur à l'Université de Paris-Orsay. M. Pierre GENSAC, Maître de Conférences au Centre Universitaire de Savoie (Chambéry). M. Paul GIDON, Professeur au Centre Universitaire de Savoie (Chambéry) . -

Fiche Technique
Compagnie des Guides de Chamonix 190 place de l’église - 74400 Chamonix – France - Tél : + 33 (0)4 50 53 00 88 www.chamonix-guides.com - e-mail : [email protected] RANDONNÉE - TOUR DES CERCES KID Durée : 6 jours Difficulté : À partir de : 750 € Sac au dos, nous marcherons autour des Cerces. Le nom de ce massif ne vous dit certainement pas grand-chose. C’est pourtant une « Mecque » de la randonnée. Si je vous parle de la Clarée, de Névache... Vous situez ? Nous serons juste à côté de Briançon, si près de l’Italie que nous y ferons quelques pas, juste pour goûter la salsiccia alla polenta. Au programme : des lacs de montagne presque tous les jours, des panoramas incroyables sur la Meije, le massif des Ecrins, et bien d’autres sommets prestigieux. En cadeau bonus, nous nous offrirons le Mont Thabor, culminant à 3178 m, et en traversée s’il vous plaît. Un support minibus proposé tout au long de la randonnée assure le transport de leurs bagages, (sauf les 3 nuits où nous dormons dans les refuges), et leur permet ainsi de ne porter qu’un petit sac léger avec leurs affaires de la journée. ITINÉRAIRE Jour 1 : Nevache - Chalets de Buffre Ce premier jour nous permettra de découvrir la vallée de la Clarée, qui se dévoilera sous nos yeux pendant la montée. Nous longerons ce joli torrent qu’est la Clarée avant de monter 400 mètres pour atteindre notre premier refuge, les chalets de Buffère à 2076 m. Pas d’accès aux bagages. Dénivelé positif : 400m - Jour 2 : Chalets de Buffère - Porte de Cristol - Nevache Nous voici vraiment dans le massif des Cerces. -

Plan De Prévention Des Risques Inondation De L'arc De Bramans À Bonneval Sur Arc (Plan Annexé À L'arrêté Préfectoral De Prescription)
MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE Direction départementale des Territoires de la Savoie Service Sécurité Risques Unité Risques Plan de Prévention des Risques Inondation de l’Arc Tronçon de Bramans à Bonneval sur Arc (7 communes) I.1 – Note de présentation Direction Départementale des Territoires de la Savoie - L'Adret - 1 rue des Cévennes - 73011 CHAMBERY Cedex Standard : 04 .79.71.73.73 - Télécopie : 04.79.71.73.00 - [email protected] www.savoie.gouv.fr Sommaire Sommaire .................................................................................................................. 1 Chapitre 1. Les plans de préventions des risques naturels : contexte règlementaire et doctrine ............................................................................................................... 3 1.1. POURQUOI DES PPRI EN FRANCE ? .......................................................................... 3 1.2. UN CONTEXTE JURIDIQUE ........................................................................................ 4 1.3. LA DOCTRINE RELATIVE AU RISQUE INONDATION .................................................. 6 1.4. OBJECTIFS DU PPRI ................................................................................................... 7 1.5. CONTENU DU DOSSIER DE PPRI ............................................................................... 8 1.6. LA PROCEDURE ......................................................................................................... 9 1.7. INCIDENCES DU PPRI ............................................................................................. -

Étude Géologique Des Massifs Du Grand Galibier Et Des Cerces (Zone Bkiançonmise, Hautes-Alpes Et Savoie)
ÉTUDE GÉOLOGIQUE DES MASSIFS DU GRAND GALIBIER ET DES CERCES (ZONE BKIANÇONMISE, HAUTES-ALPES ET SAVOIE) par Bernard TISSOT La région étudiée comprend la partie axiale et la bordure occi dentale de la zone briançonnaise, au niveau du Galibier. Elle est limitée à l'Est par la Clarée, à l'Ouest par la Guisane. Elle s'arrête, au Nord, non loin de la trouée des Rochilles et au Sud sur une ligne Le Lauzct - Grande Manche. Cette région est essentiellement constituée par le massif des Gerces, à l'Est, drainé par la Clarée, et par le massif du Grand Galibier, à l'Ouest, dont les eaux s'écoulent au Nord vers la Valloi- rette (Savoie), au Sud vers la Guisane (Hautes-Alpes). Je n'ai pas effectué d'étude de la zone subbriançonnaise qui sort du cadre de ce travail. J'ai seulement fait quelques coupes de référence et levers rapides dans la région du Pont de l'Alpe du Lauzet, décrite par M. GIGNOUX et L. MORET, et de la Madeleine. Ces courses étaient destinées à me permettre de préciser les rela tions avec le subbriançonnais des klippes briançonnaises situées plus au Nord au col du Galibier. Ce secteur a déjà fait l'objet de quatre travaux importants auxquels nous aurons souvent l'occasion de nous référer : ceux de Ch. LORY (1864), puis de W. KILIAN (1904, 1908, 1912) et plus ré cemment de D. SCHNEEGANS (1931). Ces deux derniers auteurs ont fourni respectivement les contours des première et deuxième édi tions de la feuille Briançon au 1/8.0 000e pour la région correspon dante. -

Hannibal's March Through the Alps
HANNIBAL'S MARCH SPENSER WILKINSON / Price Seven SUlUngs and Sixpence net / \\ OXFORD AT THE CLARENDON PRESS 1911 vtf HANNIBAL'S MARCH THROUGH THE ALPS BY SPENSER WILKINSON CHICHELE PROFESSOR OF MILITARY HISTORy WITH TWO FIGURES AND FOUR MAPS OXFORD AT THE CLARENDON PRESS 1911 HENRY FROWDE, M.A. PTJBLISHEE TO THE UNIVEESITY OF OXFORD LONDON, EDINBTIEIGH, NEW YORK TORONTO AND MELBOURNE HANNIBAL'S MARCH THROUGH THE ALPS THE PROBLEM AND THE CLUE TO ITS SOLUTION From the age of Augustus until the present day historians have been unable to agree with one another concerning the route which was followed by Hannibal in the year 218 B.C., in his march from the P3n['enees through Southern France and the Alps to the plain of the Po. The purpose of this essay is to show that, chiefly in consequence of the researches of a group of French officers, that route can now be traced as regards its main points with reasonable certainty, and as regards the incidents of the march, with a fair degree of probability. The sources of our information are the third book of the History of Polybius and the twenty-first book of that of Livy. Polybius was born at Megalopolis in Arcadia between 208 and 198 B. c.^ In 166 or 167 b. c. he was taken as a hos- tage to Rome, where he remained continuously for seventeen years. He was then at liberty to return to Greece and to travel, but it was in Roman rather than in Greek society that he was thence- forth at home. -

Territoire De Maurienne Du Patrimoine Naturel
Mémento du patrimoine naturel Territoire de Maurienne Utilisez le sommaire ci-après pour naviguer dans le document ! Cliquez sur le numéro de page pour revenir au sommaire. Édito p. 1 Les clés p. 2 à 15 du patrimoine naturel Le patrimoine p. 16 à 86 naturel par commune Le patrimoine naturel p. 87 à 111 en chiff res Bibliographie p. 112 Édito Annexes p. 114 Précisions sur les zonages du patrimoine naturel Des sources glaciaires de l’Arc à sa confl uence avec l’Isère, en passant par les diff érentes vallées latérales qui s’enfoncent dans la montagne, le Pays de Maurienne dévoile la richesse de ses paysages, assise sur la diversité et la complexité de ses patrimoines naturel et géologique. Avec ses 150 000 ha de zones à forte valeur biologique, véritable atout pour les habitants et les visiteurs, le territoire représente 24 % de zones reconnues d’intérêt pour le département, dont un parc national, 4 sites classés en protection de biotope et 8 sites Natura 2000. Cet ouvrage vous off re de parcourir ce vaste territoire en vous contant l’essentiel du patrimoine naturel mauriennais. Un “essentiel” qui parfois se traduit par la présence d’espèces remarquables qui se trouvent à vos portes, à vos pieds. Mais un “essentiel” qui va au-delà, parce que la nature et l’homme dans la nature, ont un destin lié. Les grands enjeux mondiaux en matière de changements climatiques, de perte de biodiversité ou de ressources en eau peuvent se retrouver en modèle réduit, comme un échan- tillon représentatif, au niveau de nos bassins de vie. -
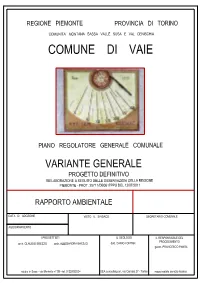
Elab. Rapporto Ambientale.Pdf
RAPPORTO AMBIENTALE QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE IN CUI SI INSERISCE LA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE DI VAIE ITER DI APPROVAZIONE DEL PIANO: • Adozione Progetto Preliminare – D.C.C. n. 6 del 23-01-2008 • Approvazione Progetto Definitivo – D.C.C. n. 27 del 30-06-2008 • Integrazione alla documentazione - D.C.C. n. 46 del 19-12-2008 • Integrazione alla documentazione - D.C.C. n. 57 del 30-11-2009 QUADRO NORMATIVO • Direttiva 2001/42/CE – 27-06-2001 – introduzione della Valutazione Ambientale Strategica nella normativa europea. Termine di adeguamento 21/07/2004 ( Italia inadempiente) • Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 – procedure per la predisposizione della VAS, della VIA e della Autorizzazione Integrata Ambientale ( i processi avviati posteriormente al 31/07/2007 entrano nella diretta applicazione del Decreto) • D.Lgs. 4/2006 del 16/01/2008 – correzione al D.Lgs. 152/2006 con la sostituzione della parte seconda e modifica del regime transitorio ( in cui rientra il piano di Vaie) • D.G.R. n. 12-8931 del 19/06/2008 - indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure VAS nei piani e nei programmi Il D.Lgs. 152/2006, così come integrato dal D.Lgs. 4/2008, è lo strumento legislativo su cui si basa la programmazione in materia ambientale, in ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa comunitaria; in esso sono contenuti i criteri e le procedure per il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Con D.G.R. n. 12-8931 del 19/06/2008. La Regione Piemonte conferma gli indirizzi per l’elaborazione del Rapporto Ambientale, identificandoli con i punti dell’allegato f all’art. -

Pdf-Arpa-Games.Pdf
Editorial and publishing coordination Elisa Bianchi Arpa Piemonte, Institutional Communication Images extracted from Arpa Piemonte archives Graphic concept and design La Réclame, Torino Translation Global Target, Torino Printed in December 2006 by Stargrafica, Torino Printed on 100% recycled paper which has been awarded the European Ecolabel ecological quality mark; manufactured by paper mills registered in compliance with EMAS, the EU eco-management and audit system. ISBN 88-7479-047-3 Copyright © 2006 Arpa Piemonte Via della Rocca, 49 – 10123 Torino Arpa Piemonte is not responsible for the use made of the information contained in this document. Reproduction is authorised when the source is indicated. Editorial and publishing coordination Elisa Bianchi Arpa Piemonte, Institutional Communication Images extracted from Arpa Piemonte archives Graphic concept and design La Réclame, Torino Translation Global Target, Torino Printed in December 2006 by Stargrafica, Torino Printed on 100% recycled paper which has been awarded the European Ecolabel ecological quality mark; manufactured by paper mills registered in compliance with EMAS, the EU eco-management and audit system. ISBN 88-7479-041-4 Copyright © 2006 Arpa Piemonte Via della Rocca, 49 – 10123 Torino Arpa Piemonte is not responsible for the use made of the information contained in this document. Reproduction is authorised when the source is indicated. CONTENTS Presentation 9 Preface 11 Contributions 13 Introduction 17 1 Instruments for planning and assessing the impacts 23 1.1 Introduction