19. 05. 2020*009889 REPUBLIQUE DU SE EGAL Un Peuple
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Concours Direct Cycle a Option "Diplomatie Arabisant"
N° de Date de Prénom(s) Nom Lieu de naissance table naissance 1 Abdel Kader AGNE 01/03/1989 Diourbel 2 Dieng AIDA 01/01/1991 Pattar 3 Adjaratou Sira AIDARA 02/01/1988 Dakar 4 Alimatou Sadiya AIDARA 06/01/1992 Thiès 5 Marieme AIDARA 06/02/1991 Nioro Du Rip 6 Mouhamadou Moustapha AIDARA 28/09/1991 Touba 7 Ndeye Maguette Laye ANE 10/06/1995 Dakar 8 Sileye ANNE 10/06/1993 Boinadji Roumbe 9 Tafsir Baba ANNE 19/12/1993 Rufisque 10 Gerard Siabito ASSINE 03/10/1991 Samatite 11 Tamba ATHIE 19/08/1988 Colibantan 12 Papa Ousseynou Samba AW 02/11/1992 Thiès Laobe 13 Ababacar BA 02/09/1991 Pikine 14 Abdou Aziz BA 08/02/1992 Rufisque 15 Abdoul BA 02/02/1992 Keur Birane Dia 16 Abdoul Aziz BA 22/11/1994 Ourossogui 17 Abdoul Mamadou BA 30/08/1992 Thiaroye Gare 18 Abdrahmane Baidy BA 10/02/1991 Sinthiou Bamambe 19 Abibatou BA 08/08/1992 Dakar 20 Aboubacry BA 01/01/1995 Dakar 21 Adama Daouda BA 08/04/1995 Matam 22 Ahmet Tidiane BA 22/02/1991 Mbour 23 Aliou Abdoul BA 26/05/1993 Goudoude Ndouetbe 24 Aly BA 20/01/1988 Saint-Louis 25 Amadou BA 01/12/1996 Ngothie 26 Amidou BA 06/12/1991 Pikine 27 Arona BA 02/10/1989 Fandane 28 Asmaou BA 03/10/1991 Dakar 29 Awa BA 01/03/1990 Dakar 30 Babacar BA 01/06/1990 Ngokare Ka 2 31 Cheikh Ahmed Tidiane BA 03/06/1990 Nioro Du Rip 32 Daouda BA 23/08/1990 Kolda 33 Demba Alhousseynou BA 06/12/1990 Thille -Boubacar 34 Dieynaba BA 01/01/1995 Dakar 35 Dior BA 17/07/1995 Dakar 36 El Hadji Salif BA 04/11/1988 Diamaguene 37 Fatimata BA 20/06/1993 Tivaouane 38 Fatma BA 12/01/1988 Dakar 39 Fatou BA 02/02/1996 Guediawaye 40 Fatou Bintou -

Les Resultats Aux Examens
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Université Cheikh Anta DIOP de Dakar OFFICE DU BACCALAUREAT B.P. 5005 - Dakar-Fann – Sénégal Tél. : (221) 338593660 - (221) 338249592 - (221) 338246581 - Fax (221) 338646739 Serveur vocal : 886281212 RESULTATS DU BACCALAUREAT SESSION 2017 Janvier 2018 Babou DIAHAM Directeur de l’Office du Baccalauréat 1 REMERCIEMENTS Le baccalauréat constitue un maillon important du système éducatif et un enjeu capital pour les candidats. Il doit faire l’objet d’une réflexion soutenue en vue d’améliorer constamment son organisation. Ainsi, dans le souci de mettre à la disposition du monde de l’Education des outils d’évaluation, l’Office du Baccalauréat a réalisé ce fascicule. Ce fascicule représente le dix-septième du genre. Certaines rubriques sont toujours enrichies avec des statistiques par type de série et par secteur et sous - secteur. De même pour mieux coller à la carte universitaire, les résultats sont présentés en cinq zones. Le fascicule n’est certes pas exhaustif mais les utilisateurs y puiseront sans nul doute des informations utiles à leur recherche. Le Classement des établissements est destiné à satisfaire une demande notamment celle de parents d'élèves. Nous tenons à témoigner notre sincère gratitude aux autorités ministérielles, rectorales, académiques et à l’ensemble des acteurs qui ont contribué à la réussite de cette session du Baccalauréat. Vos critiques et suggestions sont toujours les bienvenues et nous aident -

Omvg Energy Project Countries
AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP PROJECT : OMVG ENERGY PROJECT COUNTRIES : MULTINATIONAL GAMBIA - GUINEA- GUINEA BISSAU - SENEGAL SUMMARY OF ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT (ESIA) Team Members: Mr. A.B. DIALLO, Chief Energy Engineer, ONEC.1 Mr. P. DJAIGBE, Principal Financial Analyst, ONEC.1/SNFO Mr. K. HASSAMAL, Economist, ONEC.1 Mrs. S.MAHIEU, Socio-Economist, ONEC.1 Mrs. S.MAIGA, Procurement Officer, ORPF.1/SNFO Mr. O. OUATTARA, Financial Management Expert, ORPF.2/SNFO Mr. A.AYASI SALAWOU, Legal Consultant, GECL.1 Project Team Mr. M.L. KINANE, Principal Environmentalist ONEC.3 Mr. S. BAIOD, Environmentalist, ONEC.3 Mr. H.P. SANON, Socio-Economist, ONEC.3 Sector Director: Mr. A.RUGUMBA, Director, ONEC Regional Director: Mr. J.K. LITSE, Acting Director, ORWA Division Manager: Mr. A.ZAKOU, Division Manager, ONEC.1, 1 OMVG ENERGY PROJECT Summary of ESIA Project Name : OMVG ENERGY PROJECT Country : MULTINATIONAL GAMBIA - GUINEA- GUINEA BISSAU - SENEGAL Project Ref. Number : PZ1-FAO-018 Department : ONEC Division: ONEC 1 1. INTRODUCTION This paper is the summary of the Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) of the OMVG Project, which was prepared in July 2014. This summary was drafted in accordance with the environmental requirements of the four OMVG countries and the African Development Bank’s Integrated Safeguards System for Category 1 projects. It starts with a presentation of the project description and rationale, followed by the legal and institutional frameworks of the four countries. Next, a description of the main environmental conditions of the project is presented along with project options which are compared in terms of technical, economic and social feasibility. -

Report on Language Mapping in the Regions of Fatick, Kaffrine and Kaolack Lecture Pour Tous
REPORT ON LANGUAGE MAPPING IN THE REGIONS OF FATICK, KAFFRINE AND KAOLACK LECTURE POUR TOUS Submitted: November 15, 2017 Revised: February 14, 2018 Contract Number: AID-OAA-I-14-00055/AID-685-TO-16-00003 Activity Start and End Date: October 26, 2016 to July 10, 2021 Total Award Amount: $71,097,573.00 Contract Officer’s Representative: Kadiatou Cisse Abbassi Submitted by: Chemonics International Sacre Coeur Pyrotechnie Lot No. 73, Cite Keur Gorgui Tel: 221 78585 66 51 Email: [email protected] Lecture Pour Tous - Report on Language Mapping – February 2018 1 REPORT ON LANGUAGE MAPPING IN THE REGIONS OF FATICK, KAFFRINE AND KAOLACK Contracted under AID-OAA-I-14-00055/AID-685-TO-16-00003 Lecture Pour Tous DISCLAIMER The author’s views expressed in this publicapublicationtion do not necessarily reflect the views of the United States AgenAgencycy for International Development or the United States Government. Lecture Pour Tous - Report on Language Mapping – February 2018 2 TABLE OF CONTENTS 1. EXECUTIVE SUMMARY ................................................................................................................. 5 2. INTRODUCTION ........................................................................................................................ 12 3. STUDY OVERVIEW ...................................................................................................................... 14 3.1. Context of the study ............................................................................................................. 14 3.2. -
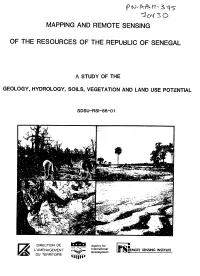
Mapping and Remote Sensing of the Resources of the Republic of Senegal
MAPPING AND REMOTE SENSING OF THE RESOURCES OF THE REPUBLIC OF SENEGAL A STUDY OF THE GEOLOGY, HYDROLOGY, SOILS, VEGETATION AND LAND USE POTENTIAL SDSU-RSI-86-O 1 -Al DIRECTION DE __ Agency for International REMOTE SENSING INSTITUTE L'AMENAGEMENT Development DU TERRITOIRE ..i..... MAPPING AND REMOTE SENSING OF THE RESOURCES OF THE REPUBLIC OF SENEGAL A STUDY OF THE GEOLOGY, HYDROLOGY, SOILS, VEGETATION AND LAND USE POTENTIAL For THE REPUBLIC OF SENEGAL LE MINISTERE DE L'INTERIEUP SECRETARIAT D'ETAT A LA DECENTRALISATION Prepared by THE REMOTE SENSING INSTITUTE SOUTH DAKOTA STATE UNIVERSITY BROOKINGS, SOUTH DAKOTA 57007, USA Project Director - Victor I. Myers Chief of Party - Andrew S. Stancioff Authors Geology and Hydrology - Andrew Stancioff Soils/Land Capability - Marc Staljanssens Vegetation/Land Use - Gray Tappan Under Contract To THE UNITED STATED AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT MAPPING AND REMOTE SENSING PROJECT CONTRACT N0 -AID/afr-685-0233-C-00-2013-00 Cover Photographs Top Left: A pasture among baobabs on the Bargny Plateau. Top Right: Rice fields and swamp priairesof Basse Casamance. Bottom Left: A portion of a Landsat image of Basse Casamance taken on February 21, 1973 (dry season). Bottom Right: A low altitude, oblique aerial photograph of a series of niayes northeast of Fas Boye. Altitude: 700 m; Date: April 27, 1984. PREFACE Science's only hope of escaping a Tower of Babel calamity is the preparationfrom time to time of works which sumarize and which popularize the endless series of disconnected technical contributions. Carl L. Hubbs 1935 This report contains the results of a 1982-1985 survey of the resources of Senegal for the National Plan for Land Use and Development. -

Dossier De Presse
DOSSIER DE PRESSE TOURNEE ECONOMIQUE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE MACKY SALL DANS LA REGION DE KAOLACK DIMANCHE 20 JANVIER 2019 C’était le 14 juin 2012. Kaolack a été la deuxième région à accueillir un Conseil des ministres délocalisé après Saint-Louis. Au total une enveloppe de 254,8 milliards de FCFA avait été annoncée pour la région. A l’arrivée, les réalisations livrées, celles en cours et les perspectives dépassent de loin les engagements du Gouvernement au début de la seconde alternance de Mars 2012. Aujourd’hui avec le dragage du bras de mer, la relance du Port et des activités économiques, Kaolack, région nourricière, capi- tale du bassin arachidier, vit un souffle nouveau pour retrouver son essor au temps de la splendeur. En plus de l’Université Sine Saloum, le Projet Port sec de Mbadakhoune, d’importants investissements stratégiques ont été consentis dans la région, qui ont abouti à de très grandes réalisations réparties dans les départements de Kaolack, Nioro du Rip et Guinguinéo. La revue des secteurs de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Santé et de la Nutrition, des Infrastructures, de l’Education et de la Formation et de la Protection Sociale montre un tableau des plus satisfaisants. A titre d’illustration : pour le Programme National de Bourses de Sécurité Familiale (PNBSF) la région a bénéficié d’une enveloppe d’1 791 152 000 FCFA ; 9 0 77 Ménages bénéficiaires en 2016 ; 27 251 Ménages bénéficiaires pour 4 générations de 2013 à 2017. PORT DE KAOLACK : - Réception officielle de la batterie de dragage ce dimanche 20 janvier 2019 : 5 navires (1 drague, 2 remorqueurs et 2 barges) - Lancement officiel des travaux de dragage - Port sec de Kaolack d’une superficie de 70 ha (30 ha pour le port et 40 ha) à Mbadakhoune AEROPORT : Le Programme de Réhabilitation des Aéroports du Sénégal (PRAS) lancé à Saint-Louis le 21 Décembre 2018 concerne Kaolack avec la mise aux normes de l’aérodrome de Kahone. -

Calendrier Historique De La Region De Kaolack
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un peuple ‐ Un but ‐ Une foi …………………. MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES …………………. AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE ANSD RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L’HABITAT, DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE CALENDRIER HISTORIQUE DE LA REGION DE KAOLACK Version mai 2013 REGION DE KAOLACK AGES EN ANNEES EVENEMENTS MARQUANTS 2012 1900 Création des cantons. 112 1902 Retour d’exil de Serigne Touba 110 1904 Dakar devient capitale de l’Afrique Occidentale Française 108 1905 Pluie en saison sèche (grand « eugue ») 107 1907 Serigne Touba s’installe à Diourbel 105 1912 Recrutement massif des tirailleurs pour la conquête du Maroc 100 1913 2e Dragage du fleuve Casamance. Grand froid « Eugue » (plusieurs décès) Déclaration de la 1ère guerre Mondiale 1914 98 Le quintal d’arachide vendu à 5 francs "barigo deureum" Election Blaise DIAGNE contre CARPOT, Blaise élu le 10 Mai 1916 Peste bovine 96 Fin 1ère Guerre mondiale Peste – Famine – Rafle 1918 94 Recrutement massif de tirailleurs et engagement volontaire des fils de Chef par Blaise DIAGNE 1919 Démobilisation et retour des tirailleurs dans leur foyer. 93 Election DIAGNE contre NGALANDOU Epidémie de Peste 1920 Famine (année de semoule) 92 Première émission du 1er billet de banque Quintal d’arachide à 100 F 1921 Grand froid « eugue » 91 Décès de El Hadj Malick SY à Tivaouane (21 juin) 1922 90 Installation du 1er Khalife de Tivaouane (Ababacar SY) 1926 Epidémie de fièvre jaune 86 Décès de Serigne Touba (Mercredi 27 juillet) 1927 Epidémie de fièvre jaune 85 Grand vent de la tabaski 1928 Elections Blaise DIAGNE et Ngalandou DIOUF 84 Décès de Cheikh Ibra FALL, fondateur de la confrérie Baye Fall 1930 Nomination de serigne Moustapha FALL comme Khalife des Baye 82 Fall 1932 Epidémie de Variole. -

Repertoire Structures Privees.Pdf
REPERTOIRE STRUCTURES PRIVEES EN SANTE LOCALISATION Nom de la structure TYPE Adresse Fatick FATICK DEPOT DE DIAOULE Dépôt COMMUNE DE DIAOULE Kolda VELINGARA DEPOT PHARMACIE BISSABOR Dépôt BALLANA PAKOUR PRES DU NOUVEAU MARCHE Kolda VELINGARA DEPOT BISSABOR /WASSADOU Dépôt CENTRE EN FACE SONADIS Ziguinchor ZIGUINCHOR DEPOT ADJAMAAT Dépôt NIAGUIS PRES DE LA PHARMACIE Kédougou SALEMATA DEPOT SALEMATA Dépôt KOULOUBA SALEMATA Dakar DAKAR CENTRE PHARMACIE DE L'EMMANUEL Pharmacie GRAND DAKAR A COTE GARAGE CASAMANCE OU ECOLE XALIMA Ziguinchor ZIGUINCHOR PHARMACIE NEMA Pharmacie GRAND DAKAR PRES DU MARCHE NGUELAW Dakar DAKAR CENTRE PHARMACIE NOUROU DAREYNI Pharmacie RUE 1 CASTOR DERKHELE N 25 Kédougou KEDOUGOU PHARMACIE YA SALAM Pharmacie MOSQUE KEDOUGOU PRES DU MARCHE CENTRAL Dakar DAKAR SUD PHARMACIE DU BOULEVARD Pharmacie RUE 22 X 45 MEDINA QUARTIER DAGOUANE PIKINE TALLY BOUMACK N545_547 PRES DE Dakar PIKINE PHARMACIE PRINCIPALE Pharmacie LA POLICE Dakar GUEDIAWAYE PHARMACIE DABAKH MALICK Pharmacie DAROU RAKHMANE N 1981 GUEDIAWAYE SOR SAINT LOUIS MARCHE TENDJIGUENE AVENUE GENERALE DE Saint-Louis SAINT-LOUIS PHARMACIE MAME MADIA Pharmacie GAULLE BP 390 Dakar DAKAR CENTRE PHARMACIE NDOSS Pharmacie AVENUE CHEIKH ANTA DIOP RUE 41 DAKAR FANN RANDOULENE NORD AVENUE EL HADJI MALICK SY PRES PLACE DE Thies THIES PHARMACIE SERIGNE SALIOU MBACKE Pharmacie FRANCE Dakar DAKAR SUD PHARMACIE LAT DIOR Pharmacie ALLES PAPE GUEYE FALL Dakar DAKAR SUD PHARMACIE GAMBETTA Pharmacie 114 LAMINE GUEYE PLATEAU PRES DE LOFNAC Louga KEBEMER PHARMACIE DE LA PAIX Pharmacie -

Carto Tortues Version 3 F2
NkhaïlaDara Chat Tboul Chat Tboul Bneïnaya Bneïnadji Ndialar MAURITANIE Keur MacèneNdegue Kheun Diadiam Senegal Parc National du Diawling Ziré Bouhoubbeyni Parc National des Oiseaux du Djoudj Ziré TaghrédientParc National des Oiseaux du Djoudj Ziré Sbeikha Gorom Khaya PN du Diawling RISQUES ET PRIORITES POUR LA PRESERVATION Sbeikha Bariel Dar es Salam NjemerArafat DES SITES DE PONTE DES TORTUES MARINES Meftah el Kheir Ross Béthio Moedina Afdiadjer Djeuss Dar Rahmane Birette Ghara Reserve de Faune du Ndiael EN AFRIQUE OCCIDENTALE Diama Foret Classee de Tilene Ebden Barrage de Diama Foret Classee de Maka Diama Foret Classee Massara de Foulane N'Diago'! Lampsar SENEGAL Mboyo 1 Dios 1 Mboyo 2Dios 2 Mouhamedya Gued Mhareke Thiong ! w Site peu menacé et/ou inclus dans une aire protégée Saint-Louis Site en zone naturelle peu menacé mais devant être l'objet de mesures de suivi Gandon w Foret Classee de Mpal Reserve speciale de faune de Guembeul Foret Classee de Rao Mpal w Site potentiellement menacé, mesures de suivi nécessaires Reserve Speciale de Faune de Guembeul Ndiébène w Site menacé, mesures de conservation prioritaires LANGUE DE BARBARIE PN de la Langue de Barbarie w Degou Niaye w Site très menacé Ngiling Mbaw Potou 1 - Littoral globalement non artificialisé, présence humaine faible à très faible, dispersée et/ou temporaire Louga 2 - Artificalisation limitée du trait de côte, présence humaine permanente localisée sur moins de 20% du linéaire côtier. 3 - Littoral localement artificialisé (>20 % et <40% du linéaire côtier), associé à des établissements humains permanents ou d’occupation temporaire. 4 - Alternance de littoraux fortement artificialisés et de coupures Lompoul Sur Mer naturelles, présence humaine modérée. -

Task Order Under the Biodiversity & Sustainable Forestry IQC (BIOFOR
SENEGAL: ISSUES FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCE MANAGEMENT Task Order under the Biodiversity & Sustainable Forestry IQC (BIOFOR) USAID Contract Number: LAG-I-01-99-00014-00 Task Order 804 Volume Two Report Submitted to: USAID/Senegal Submitted by: Chemonics International Inc. Pact, Inc. November 2000 Acknowledgements This prospective study is a reflection on the effect of technical assistance programs on Senegal’s agriculture and natural resources. It is part two of a two-part study requested by the USAID mission in Senegal, under Contract Number LAG-I-00-99-00014-00, Task Order number 804. This presentation is based on a review of documents and a series of interviews with key informants and practitioners, both past and present, in Dakar and in the field. A ten-day field visit to former and present project sites in the Fleuve, Ferlo, Dior, Saloum, Tambacounda, and Kolda zones of the country enabled the study team to see first-hand the current state of Senegal’s resource base. The study team received extraordinarily helpful and well-informed counsel and input from USAID/Senegal staff, and especially the Technical and Contract Working Group for Task Order 804. We extend our genuine thanks to each of the members of that group for their guidance: François Faye, coordinator of the Group and Agriculture/Natural Resources Management Specialist, SO2; Abdoulaye Barro, Strategy Objective Specialist, SO2; Abdrahmane Diallo, Sociologist, Analysis, Monitoring and Evaluation branch; Moribodjan Keita, Monitoring and Evaluation Specialist, SO2; Marie Claire Sow, Acquisition Specialist, SO2; and, Alpha Wade, Data Monitor, Analysis, Monitoring and Evaluation branch. The opinions and perspectives expressed in this document exclusively represent the views of the individual authors. -

Les Premiers Recensements Au Sénégal Et L'évolution Démographique
Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique Partie I : Présentation des documents Charles Becker et Victor Martin, CNRS Jean Schmitz et Monique Chastanet, ORSTOM Avec la collaboration de Jean-François Maurel et Saliou Mbaye, archivistes Ce document représente la mise en format électronique du document publié sous le même titre en 1983, qui est reproduit ici avec une pagination différente, mais en signa- lant les débuts des pages de la première version qui est à citer sour le titre : Charles Becker, Victor Martin, Jean Schmitz, Monique Chastanet, avec la collabora- tion de Jean-François Maurel et Saliou Mbaye, Les premiers recensements au Sé- négal et l’évolution démographique. Présentation de documents. Dakar, ORSTOM, 1983, 230 p. La présente version peut donc être citée soit selon la pagination de l’ouvrage originel, soit selon la pagination de cette version électronique, en mentionnant : Charles Becker, Victor Martin, Jean Schmitz, Monique Chastanet, avec la collabora- tion de Jean-François Maurel et Saliou Mbaye, Les premiers recensements au Sé- négal et l’évolution démographique. Présentation de documents. Dakar, 2008, 1 + 219 p. Dakar septembre 2008 Les premiers recensements au Sénégal et l’évolution démographique Partie I : Présentation des documents 1 Charles Becker et Victor Martin, CNRS Jean Schmitz et Monique Chastanet, ORSTOM Avec la collaboration de Jean-François Maurel et Saliou Mbaye, archivistes Kaolack - Dakar janvier 1983 1 La partie II (Commentaire des documents et étude sur l’évolution démographique) est en cours de préparation. Elle sera rédigée par les auteurs de cette première partie et par d’autres collaborateurs. Elle traitera surtout des données relatives aux effectifs de population et aux mouvements migratoires qui ont modifié profondément la configuration démographique du Sénégal depuis le milieu du 19ème siècle. -

Projet D'appui À La Promotion De L'emploi Des Jeunes Et Des Femmes
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple-Un But-Une Foi Ministère de l’Economie et des Finances Ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Promotion des Valeurs civiques Ministère de la Femme, de l’Enfant et de l’Entreprenariat féminin Projet d’Appui à la Promotion de l’Emploi des Jeunes et des Femmes (PAPEJF) Entité de supervision : Banque Africaine de Développement Evaluation environnementale stratégique (EES) et Plan de Gestion environnementale et sociale (PCGES) M.Birame Diouf Consultant Juillet 2013 SIGLES ET ABREVIATIONS ADEPME Agence Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises ANA Agence nationale d’Aquaculture ANEJ Agence nationale pour l’Emploi des jeunes ANIDA Agence nationale d’Insertion et de Développement agricole ANSD Agence nationale de la Statistique et de la Démographie APCD Acteur porteur de Dynamique communautaire ARD Agence régionale de Développement BAD Banque africaine de Développement BNDE Banque nationale de Développement économique BIT Bureau International du Travail BRS Banque régionale de Solidarité CDEPS Centre départemental d’éducation populaire et sportive CNCAS Crédit national agricole du Sénégal CNEE Convention national Etat/ Employeurs CPP Comité de pilotage du projet CSO/PLP Cellule de suivi opérationnel du programme de lutte contre la pauvreté CTIM Comité technique interministériel DAC Domaines agricoles communautaires DAP Domaines agricoles partagés DRDR Direction régionale du Développement rural DRM Direction de la Micro finance et de la Réglementation DSP Document de Stratégie Pays