Michel Rocard, Un Homme Moderne
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
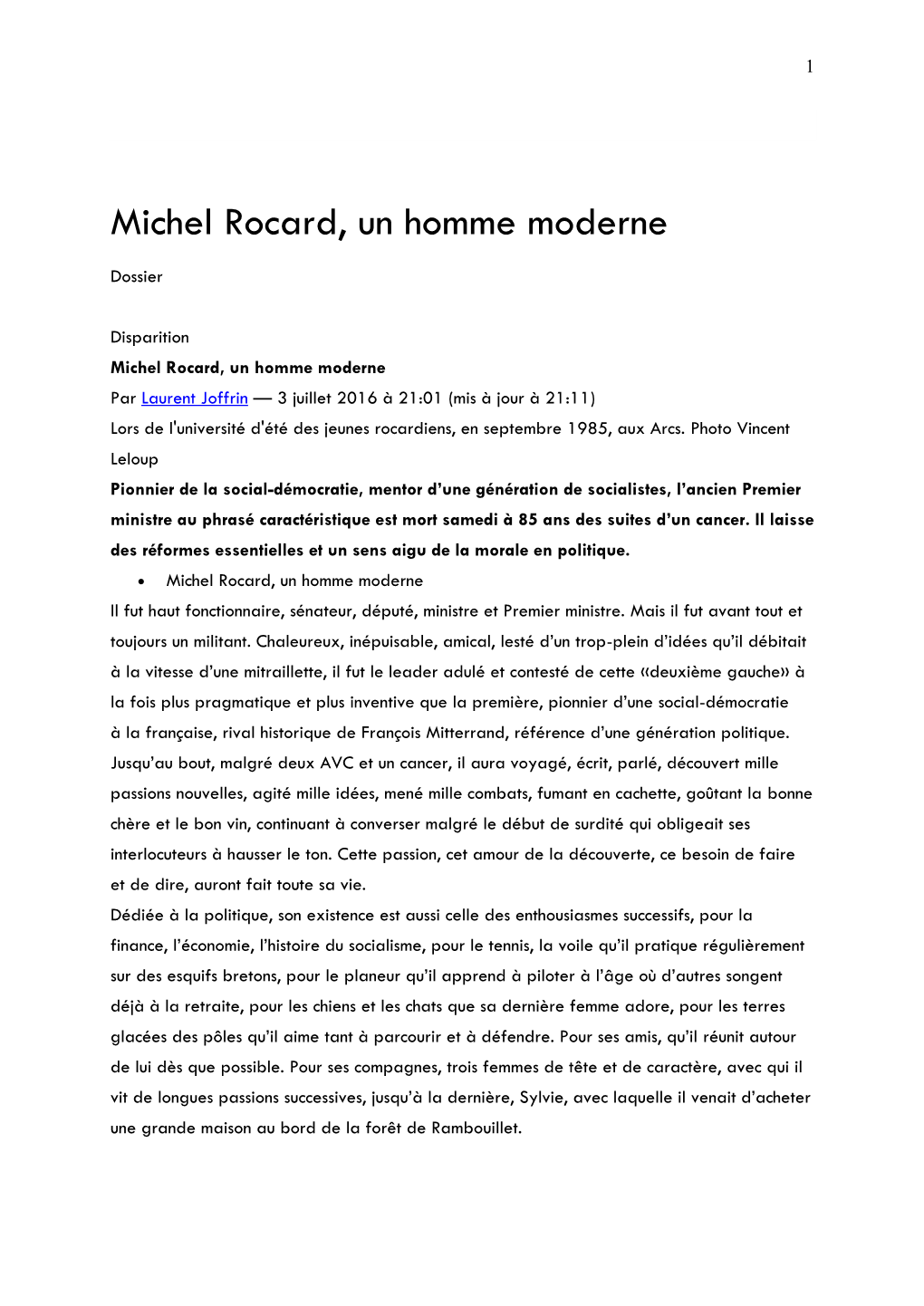
Load more
Recommended publications
-

The Algerian War, European Integration and the Decolonization of French Socialism
Brian Shaev, University Lecturer, Institute for History, Leiden University The Algerian War, European Integration, and the Decolonization of French Socialism Published in: French Historical Studies 41, 1 (February 2018): 63-94 (Copyright French Historical Studies) Available at: https://read.dukeupress.edu/french-historical-studies/article/41/1/63/133066/The-Algerian- War-European-Integration-and-the https://doi.org/10.1215/00161071-4254619 Note: This post-print is slightly different from the published version. Abstract: This article takes up Todd Shepard’s call to “write together the history of the Algerian War and European integration” by examining the French Socialist Party. Socialist internationalism, built around an analysis of European history, abhorred nationalism and exalted supranational organization. Its principles were durable and firm. Socialist visions for French colonies, on the other hand, were fluid. The asymmetry of the party’s European and colonial visions encouraged socialist leaders to apply their European doctrine to France’s colonies during the Algerian War. The war split socialists who favored the European communities into multiple parties, in which they cooperated with allies who did not support European integration. French socialist internationalism became a casualty of the Algerian War. In the decolonization of the French Socialist Party, support for European integration declined and internationalism largely vanished as a guiding principle of French socialism. Cet article adresse l’appel de Todd Shepard à «écrire à la fois l’histoire de la guerre d’Algérie et l’histoire de l'intégration européenne» en examinant le Parti socialiste. L’internationalisme socialiste, basé sur une analyse de l’histoire européenne, dénonça le nationalisme et exalta le supranationalisme. -

Xifaras, Theory of Legal Characters
THE THEORY OF LEGAL CHARACTERS MIKHAIL XIFARAS* INTRODUCTION ........................................................................ 1190 I. THE LEGAL STAGE (INTERLOCUTORY SPACE) ............... 1194 A. The Legality of the Situation .................................. 1194 B. Many Audiences, a Unique Legal Stage ................ 1195 C. Discourses Relevant for the TLC ............................ 1196 II. THE LEGAL CHARACTERS .............................................. 1197 A. The Theater Metaphor Applied to the Judicial Genre of Discourse .................................................. 1197 B. Daniel Mayer’s Inaugural Speech .......................... 1199 C. The Repertoire of Available Characters ................. 1200 D. Self-presentation and/or Narrative Syntax .......... 1201 E. Using the Actantial Model to Interpret the Deliberations of the CC ........................................... 1201 F. Repertoire of Available Characters for the Members of the CC .................................................. 1204 G. Beyond the “Actantial Model” ................................ 1208 III. THE PERFORMANCE OF LEGAL CHARACTERS ................ 1209 A. The Play of the Structure: The Life and Death of Legal Characters ..................................................... 1210 *Professor of Law, Sciences Po Law School. Multiple versions of the paper have been presented on various occasions: the Faculty Seminar of Sciences Po Law School (twice); the seminar Critical Analysis of Law of Toronto School of Law, led by M. Dubber and S. Stern; the Seminars Series of Glasgow’s Law School, led by A. Razulov and Ch. Tams; a colloquium led by M. Rosenfeld and P. Goodrich at The Cardozo School of Law; the QsQ6 Event at the Faculty of Law of the University of Toulouse, led by S. Mouton and X. Magnon; and the Seminar of the Laboratoire de Théorie du Droit at the Faculty of Law of the University of Aix, led by J.-Y. Cherot and F. Rouvière. I wish to thank all of the organizers and participants of these events for their great feedback and rich discussion. -

The British Left Intelligentsia and France Perceptions and Interactions 1930-1944
ROYAL HOLLOWAY UNIVERSITY OF LONDON DEPARTMENT OF HISTORY The British Left Intelligentsia and France Perceptions and Interactions 1930-1944 Alison Eleanor Appleby September 2013 Thesis for the degree of Doctor of Philosophy 1 Declaration of Authorship I, Alison Appleby, confirm that this is my own work and the use of all material from other sources has been properly and fully acknowledged. Signed________________________________ Date__________________________________ 2 ABSTRACT This thesis is concerned with the ways in which the non-communist British left interacted with their French counterparts during the 1930s and the Second World War and described France in their writings and broadcasts. It challenges existing accounts that have described British attitudes to France as characterised by suspicion, ill-feeling or even contempt. It draws on a range of sources, including reportage, private papers, records of left-wing societies and other publications from the period, as well as relevant articles and books. The thesis explores the attitudes of British left-wing intellectuals, trade unionists and politicians and investigates their attempts to find common ground and formulate shared aspirations. The thesis takes a broadly chronological approach, looking first at the pre-1939 period, then at three phases of war and finally at British accounts of the Liberation of France. In the 1930s, British left-wing commentators sought to explain events in France and to work with French socialists and trade unionists in international forums in their search for an appropriate response to both fascism and Soviet communism. Following the defeat of France, networks that included figures from the British left and French socialists living in London in exile developed. -

Laden Der Druckdatei
I S K (Militant Socialist International) 24 Mandeville Rise, W.G. Eichler Welwyn Garden City, Herts E U R O P E s p e a k s [Heft 39,] September 23rd, 1944 [Seite: - 1 -] France and Germany The following extract from a manifesto of the French Socialist Party published in the "Populaire" of July 1943 and stating their attitude to the German problem showed that the French Socialists at least had not become submerged in nationalistic feelings and had, in spite of all they had suffered, remained true to the spirit of international Socialism. "The German Problem On the subject of the German problem the Socialist Party specially emphasises the ideological nature of the present war and will never agree to a peace of revenge being inflicted on the German people who have been oppressed by Hitler and the Nazis. It is, however, a fact that the influence of Prussianism has aroused amongst a considerable number of Germans a taste and admiration for the use of force. Democratic education has always been very inadequate in Germany. Nazism - for the emergence of which the Western Powers bear a large share of the responsibility - has produced a generation of young monsters who must be re-educated. Germany must be made to feel the reality of victory of the democracies; she must be made to realise that aggression does not pay. The German military machine must be destroyed; we must support the people's revolution and see to it that a solution is found for the agricultural problem, that the power of heavy industry is destroyed, that the property of the Junkers is socialised, etc. -

Historical Dictionary of World War II France Historical Dictionaries of French History
Historical Dictionary of World War II France Historical Dictionaries of French History Historical Dictionary of the French Revolution, 1789–1799 Samuel F. Scott and Barry Rothaus, editors Historical Dictionary of Napoleonic France, 1799–1815 Owen Connelly, editor Historical Dictionary of France from the 1815 Restoration to the Second Empire Edgar Leon Newman, editor Historical Dictionary of the French Second Empire, 1852–1870 William E. Echard, editor Historical Dictionary of the Third French Republic, 1870–1940 Patrick H. Hutton, editor-in-chief Historical Dictionary of the French Fourth and Fifth Republics, 1946–1991 Wayne Northcutt, editor-in-chief Historical Dictionary of World War II France The Occupation, Vichy, and the Resistance, 1938–1946 Edited by BERTRAM M. GORDON Greenwood Press Westport, Connecticut Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Historical dictionary of World War II France : the Occupation, Vichy, and the Resistance, 1938–1946 / edited by Bertram M. Gordon. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 0–313–29421–6 (alk. paper) 1. France—History—German occupation, 1940–1945—Dictionaries. 2. World War, 1939–1945—Underground movements—France— Dictionaries. 3. World War, 1939–1945—France—Colonies— Dictionaries. I. Gordon, Bertram M., 1943– . DC397.H58 1998 940.53'44—dc21 97–18190 British Library Cataloguing in Publication Data is available. Copyright ᭧ 1998 by Bertram M. Gordon All rights reserved. No portion of this book may be reproduced, by any process or technique, without the express written consent of the publisher. Library of Congress Catalog Card Number: 97–18190 ISBN: 0–313–29421–6 First published in 1998 Greenwood Press, 88 Post Road West, Westport, CT 06881 An imprint of Greenwood Publishing Group, Inc. -

Download and Use the Publication for Personal Purposes
https://openaccess.leidenuniv.nl License: Article 25fa pilot End User Agreement This publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act (Auteurswet) with explicit consent by the author. Dutch law entitles the maker of a short scientific work funded either wholly or partially by Dutch public funds to make that work publicly available for no consideration following a reasonable period of time after the work was first published, provided that clear reference is made to the source of the first publication of the work. This publication is distributed under The Association of Universities in the Netherlands (VSNU) ‘Article 25fa implementation’ pilot project. In this pilot research outputs of researchers employed by Dutch Universities that comply with the legal requirements of Article 25fa of the Dutch Copyright Act are distributed online and free of cost or other barriers in institutional repositories. Research outputs are distributed six months after their first online publication in the original published version and with proper attribution to the source of the original publication. You are permitted to download and use the publication for personal purposes. All rights remain with the author(s) and/or copyrights owner(s) of this work. Any use of the publication other than authorised under this licence or copyright law is prohibited. If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. -

Address Given by Jacques Duclos (Strasbourg, 25–28 June 1947)
Address given by Jacques Duclos (Strasbourg, 25–28 June 1947) Caption: On the occasion of the 11th Congress of the French Communist Party (PCF) held in Strasbourg from 25 to 28 June 1947, Jacques Duclos, former Resistance fighter and Communist Vice-President of the French National Assembly, condemns the political instability and strikes affecting the country while emphasising the key role played by the Communists in the reconstruction of post-war France. Source: DUCLOS, Jacques. La voie du salut, Discours prononcé par Jacques Duclos. Paris: Editions du Parti communiste français, 1947. 19 p. p. 5-19. Copyright: (c) Translation CVCE.EU by UNI.LU All rights of reproduction, of public communication, of adaptation, of distribution or of dissemination via Internet, internal network or any other means are strictly reserved in all countries. Consult the legal notice and the terms and conditions of use regarding this site. URL: http://www.cvce.eu/obj/address_given_by_jacques_duclos_strasbourg_25_28_june_ 1947-en-b915e7a1-8e66-4db4-b627-ec8cbd43a2ba.html Last updated: 05/07/2016 1/12 Address given by Jacques Duclos to the XIth Congress of the French Communist Party (Strasbourg, 25–28 June 1947) Following this splendid report by the General Secretary of the French Communist Party, Maurice Thorez, none of our Party delegates present here today can fail to be convinced of the grave and serious nature of the current political situation. Each of you will appreciate that we are witnessing a ferocious battle between the forces of reaction and the forces of democracy. Each of you will appreciate, too, that the difficulty for us and for the people of France lies in guessing which way the scales will tip in the end. -

University of London Thesis
2809076477 REFERENCE ONLY UNIVERSITY OF LONDON THESIS Name of Author COPYRIGHT This is a thesis accepted for a Higher Degree of the University of London. It is an unpublished typescript and the copyright is held by the author. All persons consulting the thesis must read and abide by the Copyright Declaration below. COPYRIGHT DECLARATION I recognise that the copyright of the above-described thesis rests with the author and that no quotation from it or information derived from it may be published without the prior written consent of the author. LOAN Theses may not be lent to individuals, but the University Library may lend a copy to approved libraries within the United Kingdom, for consultation solely on the premises of those libraries. Application should be made to: The Theses Section, University of London Library, Senate House, Malet Street, London WC1E 7HU. REPRODUCTION University of London theses may not be reproduced without explicit written perjnission from the University of London Library. Enquiries should be addressed to the Theses Section of the Library. Regulations concerning reproduction vary according to the date of acceptance of the thesis and are listed below as guidelines. A. Before 1962. Permission granted only upon the prior written consent of the author. (The University Library will provide addresses where possible). B. 1962 - 1974. In many cases the author has agreed to permit copying upon completion of a Copyright Declaration. C. 1975 - 1988. Most theses may be copied upon completion of a Copyright Declaration. D. 1989 onwards. Most theses may be copied. This thesis comes within category D. This copy has been deposited in the Library______ of £A..C* ^ This copy has been deposited in the University of London Library, Senate House, Malet Street, London WC1E 7HU. -

811R. CONTENTS
AUGUST 1968 NO. 115 811r. CONTENTS 3 Community Solidarity and National Interests 7 Christian Democratic Parties in the Community Paul van Ypersele de Strihou 9 Social Democratic Parties Roger Morgan Index: Issues 100-108 12 Liberal Parties in the Community Murray Forsyth 14 Council Reaches Compromise on Transport Policy 15 Criteria Outlined for Cooperative Agreements 17 Luxembourg Agreements Repudiated by Rey 18 Investment Declining in ECSC Industries 19 Strikes, Inflation SweU U.S. Imports From Common Market The views expressed by contributors do not necessarily reflect the policies of the European Community. Europe went on vacation this month, but not before dealing with one of EUROPEAN COMMUNITY is published monthly in English, French, Italian, German, and the heaviest work loads the Community has faced since its inception. Dutch by the offices of the European Com While rushing through important decisions to meet the July 1 deadline munity Information Service. Subscriptions for customs union, it was faced with a new challenge to European unity: can be obtained from the European Commu the economic crisis in France. EUROPEAN coMMUNITY this month con nity Information Service. tains a summary and chronology of the events between June 25 and Washington, D.C.: 808 Farragut Building, 20006 July 23 which illustrate the complexities of the political process which New York, N.Y.: 155 East 44th Street, 10017 led to a joint Community effort to assist France in its current difficulties. London: 23 Chesham Street, SW1 Paris: 61, rue des Belles-Feuilles As in the United States, Europe this fall faces the trauma of elections. Rome: Via Poli 29 In this issue, EUROPEAN COMMUNITY surveys the major political parties Bonn: Zitelmannstrasse 11 in the Six. -
'Brave Little Israel' To
From ‘Brave Little Israel’ to ‘an Elite and Domineering People’: The Image of Israel in France, 1944-1974 by Robert B. Isaacson B.A. in Jewish Studies, May 2011, The Pennsylvania State University M.A. in History, May 2015, The George Washington University A Dissertation submitted to The Faculty of The Columbian College of Arts and Sciences of The George Washington University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy May 21, 2017 Daniel B. Schwartz Associate Professor of History The Columbian College of Arts and Sciences of The George Washington University certifies that Robert Brant Isaacson has passed the Final Examination for the degree of Doctor of Philosophy as of March 2, 2017. This is the final and approved form of the dissertation. From ‘Brave Little Israel’ to ‘an Elite and Domineering People’: The Image of Israel in France, 1944-1974 Robert B. Isaacson Dissertation Research Committee: Daniel B. Schwartz, Associate Professor of History, Dissertation Director Katrin Schultheiss, Associate Professor of History, Committee Member Jeffrey Herf, Distinguished University Professor, The University of Maryland, Committee Member ii © Copyright 2017 by Robert B. Isaacson All rights reserved iii Dedication This work is dedicated to my family, whose unflagging love, patience, and support made this dissertation possible in a myriad ways. iv Acknowledgments I wish to acknowledge the many individuals and organizations that have helped to make this dissertation possible. I wish to extend my gratitude to the American Academy for Jewish Research for providing an AAJR Graduate Student Travel Grant (2015), and to the Society for French Historical Studies for its Marjorie M. -
Souvenirs Épars Sur Guy Mollet
PORTRAITS ET SOUVENIRS JULES MOCH Souvenirs épars sur Guy Mollet a mort soudaine de Guy Mollet est douloureusement ressentie non L seulement par ses amis politiques, mais aussi par nombre de Fran• çais non socialistes. Celui qui fut secrétaire général du parti socialiste pendant un quart de siècle (alors que son prédécesseur, Daniel Mayer, et son successeur, Alain Savary, n'occupèrent ce poste qu'une couple d'an• nées chacun) s'était imposé à l'estime de tous, amis et adversaires. Il possédait en effet au plus haut degré quelques-unes des qualités nécessaires à un grand leader politique ; ce n'est pas diminuer ses mérites que d'écrire : « quelques-unes », car, en un demi-siècle d'action militante, je n'ai connu, dans le monde politique, qu'un homme les possédant toutes, et au plus haut degré, Léon Blum. Ces qualités sont au nombre d'une demi-douzaine : conviction profonde de la justesse de sa doctrine ; volonté de la répandre en la servant, non de se servir d'elle pour s"élever ; cou• rage et persévérance ; intelligence ; pénétration d'analyse et puissance de synthèse ; enfin, et surtout, honnêteté intransigeante non seulement dans la vie publique, mais aussi dans la vie privée. « Marxiste » Guy Mollet était un « marxiste » convaincu. Régîonalement et poli• tiquement, il voisinait avec la puissante fédération socialiste du Nord, où J.-B. Lebas et Bracke étaient les derniers représentants du « parti ouvrier », le plus marxiste des divers rameaux socialistes dont l'union permit, en 1905, la création du parti socialiste S.F.I.O. Ces quatre lettres, disparues depuis la récente conquête du vieux parti par des formations socialistes de fraîche date, signifiaient : « Section française de l'Interna• tionale ouvrière ». -

Is It Time for the Jews to Leave Europe? for Half a Century, Memories of the Holocaust Limited Anti-Semitism on the Continent
Is It Time for the Jews to Leave Europe? For half a century, memories of the Holocaust limited anti-Semitism on the Continent. That period has ended—the recent fatal attacks in Paris and Copenhagen are merely the latest examples of rising violence against Jews. Renewed vitriol among right-wing fascists and new threats from radicalized Islamists have created a crisis, confronting Jews with an agonizing choice. Jeffrey Goldberg Photos by Davide Monteleone APRIL 2015 “All comes from the Jew; all returns to the Jew.” — Édouard Drumont (1844–1917), founder of the Anti-Semitic League of France I. The Scourge of Our Time The French philosopher Alain Finkielkraut, the son of Holocaust survivors, is an accomplished, even gifted, pessimist. To his disciples, he is a Jewish Zola, accusing France’s bien-pensant intellectual class of complicity in its own suicide. To his foes, he is a reactionary whose nostalgia for a fairy-tale French past is induced by an irrational fear of Muslims. Finkielkraut’s cast of mind is generally dark, but when we met in Paris in early January, two days after the Charlie Hebdo massacre, he was positively grim. “My French identity is reinforced by the very large number of people who openly declare, often now with violence, their hostility to French values and culture,” he said. “I live in a strange place. There is so much guilt and so much worry.” We were seated at a table in his apartment, near the Luxembourg Gardens. I had come to discuss with him the precarious future of French Jewry, but, as the hunt for the Charlie Hebdo killers seemed to be reaching its conclusion, we had become fixated on the television.