Les Nations Celtiques Et Le Monde Contemporain
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
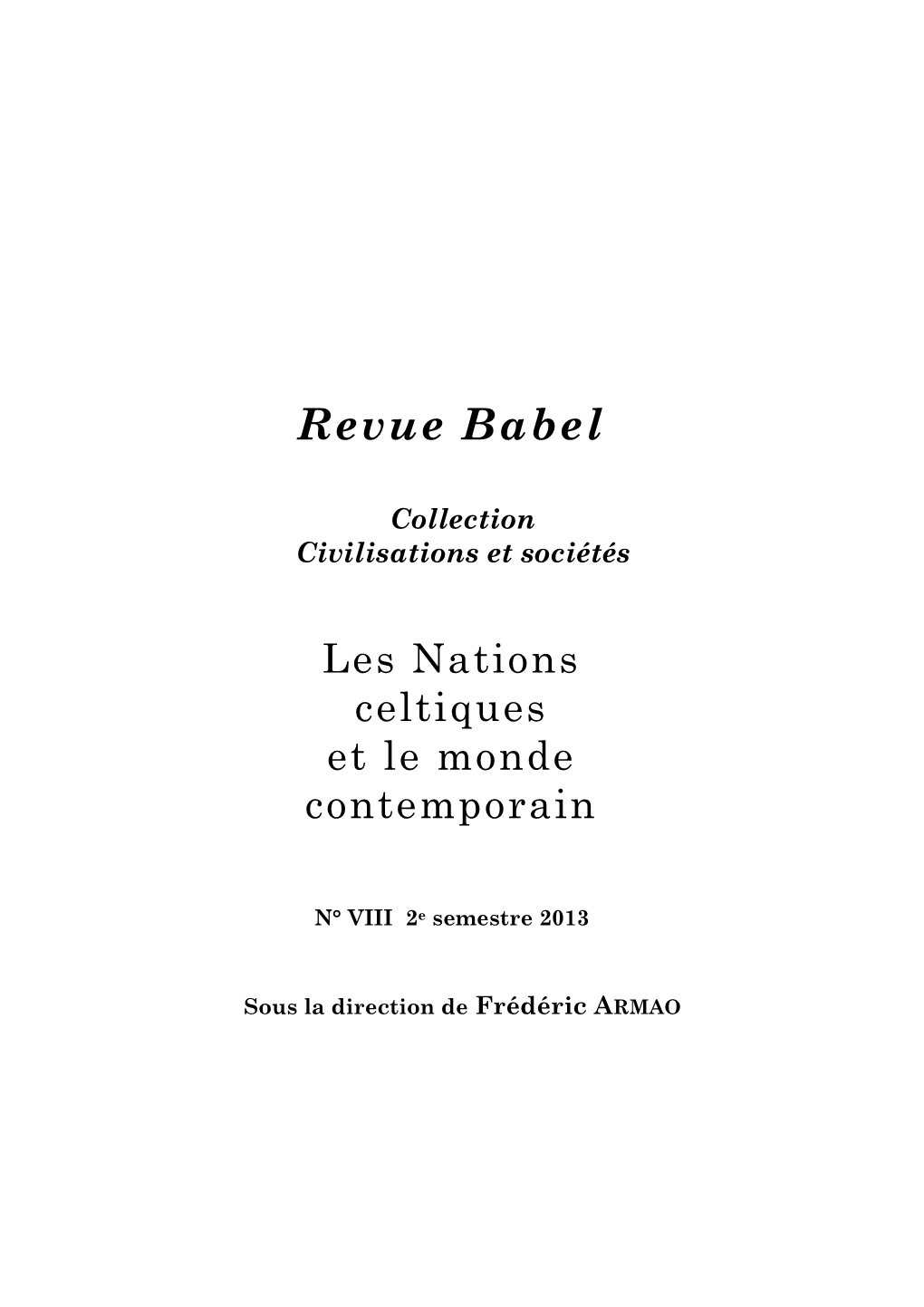
Load more
Recommended publications
-
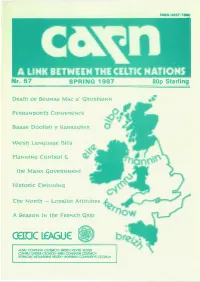
Irish Language in Meals Will Also Be Available on Reservation
ISSN 0257-7860 Nr. 57 SPRING 1987 80p Sterling D eatp o f S gum äs Mac a’ QpobpaiNN PGRRaNpORtb CONfGRGNCC Baase Doolisl) y KaRRaqpeR Welsb LaNquaqc Bills PlaNNiNQ CONtROl Q tpc MaNX QOVGRNMCNt HistORic OwiNNiNG TTpe NoRtp — Loyalist Attituöes A ScaSON iN tl7G FRGNCb CgRip Q0DC l£AGU€ -4LBA: COVIUNN CEIUWCH * BREIZH: KEl/RE KEU1EK Cy/VIRU: UNDEB CELMIDO *ElRE:CONR4DH CfllTHCH KERN O W KE SU NW NS KELTEK • /VWNNIN1COV1MEEY5 CELM GH ALBA striipag bha turadh ann. Dh'fhäs am boireannach na b'lheärr. Sgtiir a deöir. AN DIOGHALTAS AICE "Gun teagamh. fliuair sibh droch naidheachd an diugh. Pheigi." arsa Murchadh Thormaid, "mur eil sibh deönach mise doras na garaids a chäradh innsibh dhomh agus di- 'Seinn iribh o. hiüraibh o. hiigaibh o hi. chuimhnichidh mi c. Theid mi air eeann- Seo agaibh an obair bheir togail fo m'chridh. gnothaich (job) eite. Bhi stiuradh nio chasan do m'dhachaidh bhig fhin. "O cäraichidh sinn doras na garaids. Ma Air criochnacbadh saothair an lä dhomh." tha sibh deiseil tägaidh sinn an drasda agus seallaidh mi dhuibh doras na garaids. Tha Sin mar a sheinn Murchadh Thormaid chitheadh duine gun robh Murchadh 'na turadh ann." "nuair a thill e dhachaidh. "Nuair a bha c dhuine deannta 'na shcacaid dhubh-ghorm Agus leis a sin choisich an triuir a-mach a' stiiiireadh a’ chäir dhachaidh. bha eagail agus na dhungairidhe (dungarees), Bha baga dhan gharaids, an saor ’na shcacaid dhubh- air nach maircadh an ehr bochd air an rarhad uainc aige le chuid inncaian saoir. Bha e mu gorm is dungairidhc , . -

Al Liamm Dastumadenn Sevenadurel Daouviziek Kerzu2002
Al Liamm Dastumadenn sevenadurel daouviziek Kerzu2002 Nedeleg laouen ha Bloavezh mat d’an holl Niverenn 3355 57vet bloavezh Postel [email protected] www.alliamm.com Pep skrivagner zo kiriek d’e skridoù TAOLENN BARZHONEGOÙ : Kroashent , gant Youenn Gwernig . .3 Maenhir, gant Jean-Yves Broudic . .4 O terriñ kleuz , gant Jakez Konan . .5 DANEVELLOÙ : Un endervezhiad hir, gant Ronan Huon . .7 N’eo ket mat ar gontadenn, gant Dominique Allain . .15 Breur ha c’hoar, gant Maguy Kerisit . .28 STUDIADENNOÙ : E koun Richard Jenkin, gant Per Denez . .55 Francesco Redi hag ar ganadur diwar netra, gant Yann gerven . .63 Soñjomp ervat : ur sell ouzh embannadurioù Buhez ar Sent, gant Jacqueline Gibson . .68 Renan hag a brezhoneg, gant Reun ar C’halan . .83 2 BEAJ : Un devezh e Gernevez, gant Per ar Bihan . .90 LEVRIOÙ, gant Eflamm gKervilio . .95 NOTENNOÙ : . .103 Youenn GWERNIG Kroashent Daou Hon-daou War hentoù hor bro Ker kalet o mein A gave din, Met e c’hoarzh va c’heneil E teuze o c’hrizder Un tammig. Daou Hon daou Ha tizhet ganeomp kalon ar c’hroashent. Steredenn o skignañ bannoù diniver War ar bed, Mont a reas va c’heneil hep kimiadiñ Gant ur seizhenn n’helle ket heuliañ 3 Marteze gant aon leskiñ e dreid, Mont a reas va c’heneil hag e c’hoarzh... Ha me, neuze, a raio Gant ur seizhenn n’hellen ket heuliañ kennebeut, Marteze gant aon koll an hent Ar c’hleuz, ar c’harzh hag Ar brouskoad pelloc’h – E ouiemp mat – (Ha soñj ‘peus, va c’heneil, va breur ? E oa eno soudarded kozh o c’hedal c’hoazh). -

Dossier Ijin 6
Certains vous diront que l’imagination est un don, pour d’autres ce sera un art, pour d’autres encore, une forme d’évasion et un préliminaire à toutes formes de création. En pays Bigouden, danseurs et musiciens ont fait de l’imagination une priorité pour orchestrer leur nouveau spectacle : IJIN. Tout en respectant les styles et répertoires issus de leur culture traditionnelle, le Bagad CAP CAVAL et le cercle cel- tique AR VRO VIGOUDENN, deux ensembles à forte identité et aux savoir-faire reconnus se sont unis pour laisser courir leur imagina- tion par-delà les horizons de leur terroir. Au-delà de cette même passion pour la musique et la danse traditionnelles, ils partagent également une même approche de la scène et une vision identique du spectacle, tant dans l’écriture musicale et chorégraphique que dans la création et la reconstitu- tion de costumes. IJIN, c’est aussi l’imaginaire d'une rencontre avec d’autres univers musicaux comme celui du chanteur kabyle Farid Aït Sia- meur ou ceux de Yann Guirec Le Bars et Julien Le Mentec ou en- core celui des percussions de Dominique Molard. De toutes ces sources d’inspiration est né IJIN. Ouvrez gran- des les ailes de votre propre imagination et laissez vous porter… La musique et la danse feront le reste. Bagad Cap Caval « Cap Caval », ancien nom du Pays Bigouden, contrée de l’extrême sud-ouest de la Cor- nouaille, voilà le nom quelque peu sorti des mémoires, que Denis Daniel avait retenu en 1984 pour le bagad qu’il venait de créer sur PLOMEUR. -

Consultez L'article En
Dan ar Braz Retour sur soixante ans de guitare ll a sorti l’album Dans ar dañs en début d’année : une Mon père était carrossier à Quim- belle manière de fêter cinquante ans de carrière (et soixante per. Ma mère travaillait au secré- Kejadenn de guitare) qui l’ont vu porter haut les couleurs d’un folk tariat. C’est plutôt par devoir filial rock interceltique et en ont fait un des artistes majeurs de qu’il a repris l’affaire familiale mais la musique bretonne. Avec humilité et sincérité, Dan ar ce n’était pas ce à quoi il se desti- nait. Cela a joué un rôle, plus tard, Braz nous raconte son parcours. quand j’ai voulu faire de la musique en professionnel. Ma mère, qui e suis né dans un milieu où essayaient de copier) les Anglo- voulait m’en dissuader, a essayé on écoutait beaucoup de mu- saxons, la musique venant de la de convaincre mon père de m’en Jsiques, toutes sortes de mu- chambre de mon grand frère a empêcher mais il a dit : « Moi, j’ai siques. Mes parents n’étaient commencé à prendre sa place dans fait toute ma vie un métier qui ne pas musiciens à proprement dit, mon univers. Comme lui, je me suis me plaisait pas. Mes enfants feront mais mon père chantait extrême- mis à écouter Radio Luxembourg ce qu’ils veulent. » ment bien et on l’appelait Tino à qui était allemande le jour et an- J’ai donc commencé à étudier la cause de ses interprétations des glaise le soir. -

Dossier De Presse Rentrée 2003
Association An Tour Tan 4 rue Bernard Guillemot 29000 QUIMPER Tél. 02.98.10.21.16 Fax 02.98.10.19.21 e-mail : [email protected] http://www.antourtan.org DOSSIER DE PRESSE RENTRÉE 2003 AN TOUR TAN FAIT SA RENTRÉE ! Le site An Tour Tan fait sa rentrée ! Au programme, l’incontournable Cyber Fest Noz, cinquième anniversaire, mais également la poursuite des différents projets menés depuis la création de l’association en juillet 1998. Les émissions Skinwel-Web L’émission de web-tv, lancée le 1er mars 2003, a connu dès son premier numéro un franc succès auprès des internautes : en moyenne 22.000 personnes visionnent intégralement chacune d’entre elles. 8 émissions ont été tournées jusqu’à présent : • 1er mars 2003 (53 minutes) : à l’hôtel de ville de Quimper, avec Goulwena An Henaff, de France 3 Ouest, et Michel Marest, des faïenceries HB-Henriot. • 15 mars 2003 (51 minutes) : émission spéciale, interview d’Alan Stivell • 19 avril 2003 (55 minutes) : au Chapeau-Rouge à l’occasion de la Kemp’Arena de la Ville de Quimper. Invités : Maryvonne Magaud et Yannick Hascoët, de la ville, mais aussi Gweltaz d’EV, Jean-Michel Moal des Red Cardell et Jean-Claude Tallec du Printemps de Châteauneuf • 30 avril 2003 (60 minutes) : au Pavillon de Penvillers à l’occasion du Festival fait son Printemps. Invités : Alex et Gwen du groupe Armens, Jean-Philippe Mauras et Guy Riou du Festival de Cornouaille • 9 juin 2003 (68 minutes) : au CAC de Concarneau à l’occasion du Festival de Théâtre en Breton. Invités : Jos Goapper, Nolwenn Korbel, Robert Omnès, Marijanig Le Floc’h, la troupe Barzhanoff, Goulc'han Kervella, Stéphane Riou (Bagad du Moulin-Vert) et Yann Bougio. -

Pdf Shop 'Celtic Gold' in Peel
No. 129 Spring 2004/5 €3.00 Stg£2.50 • SNP Election Campaign • ‘Property Fever’ on Breizh • The Declarationof the Bro Gymraeg • Istor ar C ’herneveg • Irish Language News • Strategy for Cornish • Police Bug Scandal in Mann • EU Constitution - Vote No! ALBA: COM.ANN CEILTFACH * BREIZH: KFVTCF KELT1EK * CYMRU: UNDEB CELTA DD * EIRE: CON RAD H GEILTE AC H * KERNOW: KtBUNYANS KELTEK * MANNIN: COMlVbtYS CELTIAGH tre na Gàidhlig gus an robh e no I a’ dol don sgoil.. An sin bhiodh a’ huile teasgag tre na Gàidhlig air son gach pàiste ann an Alba- Mur eil sinn fhaighinn sin bidh am Alba Bile Gàidhlig gun fheum. Thuig Iain Trevisa gun robh e feumail sin a dhèanamh. Seo mar a sgrìohh e sa bhli adhna 1365, “...dh’atharraich Iain à Còm, maighstir gramair, ionnsachadh is tuigsinn gramair sna sgoiltean o’n Fhraingis gu TEACASG TRE NA GÀIDHLIG Beurla agus dh’ionnsaich Richard Pencrych an aon scòrsa theagaisg agus Abajr gun robh sinn toilichte cluinntinn Inbhirnis/Inverness B IVI 1DR... fon feadhainn eile à Pencrych; leis a sin, sa gun bidh faclan Gaidhlig ar na ceadan- 01463-225 469 e-mail [email protected] bhliadhna don Thjgheama Againn” 1385, siubhail no passports again nuair a thig ... tha cobhair is fiosrachadh ri fhaighinn a an naodhamh bliadhna do’n Righ Richard ceann na bliadhna seo no a dh’ aithgheor thaobh cluich sa Gàidhlig ro aois dol do an dèidh a’Cheannsachaidh anns a h-uile 2000. Direach mar a tha sinn a’ dol thairis sgoil, Bithidh an t-ughdar is ionadail no sgoil gràmair feadh Sasunn, tha na leana- air Caulas na Frainge le bata no le trean -

So Breizh ! Talec Noguet Quartet / Barba Loutig / Fleuves
REPRÉSENTATION MUSIQUE 3h30 (entractes) 19 OCT. 19:30 - 23:00 Théâtre de Cornouaille BILLET So Breizh ! Talec Noguet quartet / Barba Loutig / Fleuves Présentation NOUVEAU ! Une soirée festive, trois groupes différents et le plaisir d’être rassemblés autour des musiques bretonnes. Pour cette première édition de So Breizh ! co-organisée avec le Festival de Cornouaille, 11 jeunes artistes et toute notre équipe montée sur le pont vont faire du Théâtre de Cornouaille un lieu de vie pour célébrer la vitalité et l’effervescence musicale de notre région. Place des femmes, sons électro, saveurs de jazz nouveau, métissage, énergie de la danse, les ressources instrumentales et vocales qui nous ont été transmises sont sans cesse revisitées. Pour aller au-devant du monde et de notre présent. Rien ne leur résiste, pas même les frontières de la Bretagne. So Breizh ! Talec / Noguet Quartet DINDAN DILHAD DINDAN* La chanteuse Rozenn Talec et l’accordéoniste Yannig Noguet dévoilent leur nouveau répertoire sur scène avec l’organiste Julien Padovani et le saxophoniste Timothée Le Bour. Issue de la troisième promotion de la Kreiz Breizh Akademi, Rozenn Talec explore la langue et le chant breton depuis de nombreuses années aux côtés de son complice Yannig Noguet, musicien de Dan ar Braz, Denez Prigent ou Gilles Servat. Pour cette soirée exceptionnelle, les deux artistes se déploient en quartet pour partager l’énergie et la puissance de la musique, la richesse des chants bretons traditionnels et universels. — * Les dessous des dessous Barba Loutig Saflikad* Envoûtantes et audacieuses, les quatre chanteuses de Barba Loutig donnent de la voix et du coeur ! Ancré dans la tradition populaire et vivante de Bretagne, ce quatuor féminin fait dialoguer les territoires au-delà des frontières de la péninsule. -

Standard Breton, Neo-Breton and Traditional Dialects Mélanie Jouitteau
Children Prefer Natives; A study on the transmission of a heritage language; Standard Breton, Neo-Breton and traditional dialects Mélanie Jouitteau To cite this version: Mélanie Jouitteau. Children Prefer Natives; A study on the transmission of a heritage language; Standard Breton, Neo-Breton and traditional dialects. Maria Bloch-Trojnar and Mark Ó Fionnáin. Centres and Peripheries in Celtic Linguistics, Peter Lang, pp.75, 2018, Sounds - Meaning - Commu- nication, 9783631770825. hal-02023362 HAL Id: hal-02023362 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02023362 Submitted on 27 Feb 2019 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Children Prefer Natives A study on the transmission of a heritage language; Standard Breton, 1 Neo-Breton and traditional dialects Mélanie Jouitteau IKER, CNRS, UMR 5478 Abstract I present a linguistic effect by which heritage language speakers over- represent traditional input in their acquisition system. I propose that native young adults children of the missing link generation disqualify the input of insecure L2 speakers of Standard and prefer the input of linguistically secure speakers in the making of their own generational variety. Given the socio-linguistics of Breton, this effect goes both against statistical and sociological models of acquisition because speakers disregard features of Standard Breton, which is the socially valorised variety accessible to them and valued by school and media. -

Planet Magazine
plpalanet 1n40 et The Welsh Internationalist April/May 2000 3 In the Screen’s Glow 66 Making Good Boundaries John Barnie Joshua A. Fishman Interviewed by Xabier Erize 6 In Steel and Stone Jonathan Adams and the Wales 76 The Shadow in the Woods Millennium Centre America and Hallowe’en Stephen Evans Ozi Rhys Osmond 14 The Key to Annie’s Room 83 The Counter-Productive Critic Rugby Mania A Reply to John Lovering’s Robert Minhinnick Critique of Objective One Kevin Morgan 19 The Planet Cartoon Peter Roberts 89 How to be Conscious The Latest Theories about Human 20 The Artisan-Translator and the Consciousness Artist-Translator Roger Caldwell John Rutherford 96 † Baroness White 27 Beyond Our Ken What Does London Mean for 98 † Tudor David Wales? Ned Thomas 99 Attitude 33 Innocent Eyes 100 Reviews Naive Realism in Wales Peter Wakelin 120 Scene Music • IT • Theatre • Internet • 42 Seconding the Motion Sport The Poetry of Owen Sheers Claire Powell Poems Billie Livingston (31) Dewi Stephen 47 Vennerberg’s Ghost Jones (60) Anne Stevenson (61) A Short Story Emyr Humphreys Covers: Computer generated images of the Wales Millennium Centre plpalanet 1n41 et The Welsh Internationalist June/July 2000 3 The Arts Council of Wales 56 A Way of Talking to People John Barnie The Debate About High Art Hugh Macpherson 7 Devolution and the Crisis of Representation 62 Creeping Jesus Tony Benn Interviewed by A Short Story Ian Rappel David Callard 16 Inclusivepolitics.con? 65 Revisiting the Athens of Wales The National Assembly Aberdare, Theatre and Disenfranchisement -

Festival De Cornouaille
FESTIVAL DE CORNOUAILLE Espace Saint-Corentin L’Espace Saint-Corentin vivra au rythme des festoù-noz toute la semaine, célébrant comme il se doit ce patrimoine mondial de l’UNESCO. Pour le confort des danseurs, ce lieu ce sera, encore cette année, LA PLACE des danseurs, avec un espace plus grand, plus aéré. C’est aussi le lieu des initiations à la Danse bretonne (gratuites) et des concours. Les + : Petite restauration avec des produits locaux et un bar sur place. LE VILLAGE GRADLON Toute la journée, AU VILLAGE GRADLON, des animations et concerts gratuits seront proposés ainsi qu’un pôle de restauration où les petits et les plus grands éveilleront leurs papilles grâce aux produits de notre terroir. LE CORNOUAILLE GOURMAND, prendra place sur ce village, et valorisera à nouveau la filière aliment en mêlant animations, démonstrations de chefs et entreprises locales, à travers un événement gourmand, ludique et pédagogique à destination du grand public. NOUVEAUTÉ : DES FORFAITS « PARCOURS » EN VENTE ! 3 CONCERTS À TARIFS RÉDUITS PARCOURS DE FEMMES (45€) : Colline Hill / Gabriella / Duo Lagadic – Rivière PARCOURS VOYAGES (45€) : Bagad Cap Caval / Doolin’ / Ars’ys PARCOURS HARPE (47€) : Lina Bellard / Dremmwel / Alan Stivell MARDI 19 JUILLET – 21H Théâtre de Cornouaille – De 23 à 28€ RONAN LE BARS Concert unique « (RE) GROUPE » Ronan Le Bars, explore de nouveaux horizons de la musique bretonne et d’autres cultures du monde avec son instrument de prédilection, la cornemuse, à travers un répertoire issu du répertoire traditionnel mais aussi de ses propres compositions. Ses albums confirment la place unique de ce musicien breton sur la planète celtique mondiale. -

Dossier Ijin 8
Certains vous diront que l’imagination est un don, pour d’autres ce sera un art, pour d’autres encore, une forme d’éva- sion et un préliminaire à toutes formes de création. En pays Bigouden, danseurs et musiciens ont fait de l’i- magination une priorité pour orchestrer leur nouveau spectacle : IJIN.IJIN. ToutTout enen respectantrespectant lesles stylesstyles etet répertoiresrépertoires issusissus dede leurleur culture traditionnelle, le Bagad CAP CAVAL et le cercle celtique AR VRO VIGOUDENN, deux ensembles à forte identité et aux sa- voir--faire reconnus se sont unis pour laisserlaisser courircourir leurleur imagina-imagina- tion par--delà les horizons de leur terroir. Au --delà de cette même passion pour la musique et la danse traditionnelles, ils partagent également une même appro- che de la scène et une vision identique du spectacle, tant dans l’écriturel’écriture musicalemusicale etet chorégraphiqchorégraphique que dans la création et la reconstitution de costumes. IJIN, IJIN, c’estc’est aussiaussi l’imaginairel’imaginaire d'uned'une rencontrerencontre avecavec d’au-d’au- tres univers musicaux comme celuii dudu chanteurchanteur kabylekabyle FaridFarid AïtAït Siameur ou ceux de Yann Guirec Le BarsBars etet JulienJulien LeLe MentecMentec ouou encore celui des percussions de Dominique Molard. De toutes ces sources d’inspiration est né IJIN. Ouvrez grandes les ailes de votre propre imagination et laissez vous por- ter… La musique et la danse feront le reste. BagadBagad CapCap CavalCaval « Cap Caval », ancien nom du Pays Bigouden, contrée de l’extrême sud--ouest de la Cornouaille, voilà le nom quelque peu sorti des mémoires, que Denis Daniel avait retenu en 1984 pour le bagad qu’il venait de créer sur PLOMEUR. -

Sound Diplomacy Is the Leading Global Music Export Agency
SOUND DIPLOMACY IS THE LEADING GLOBAL MUSIC EXPORT AGENCY Sound Diplomacy is a multi‑lingual export, research and event production consultancy based in CONSULTING London, Barcelona and Berlin. Export Strategizing We draw on over thirty years of Planning & Development creative industries experience Brand Management to deliver event and conference Workshop Coordination coordination, world‑class research, Market Research export strategy and market & Analysis intelligence to both the public and Teaching & Strategic private sector. Consulting We have over 30 clients in 4 continents, including government ministries, music and cultural EVENT export offices, music festivals and SERVICES conferences, universities and more. Conference We work simultaneously in seven Management languages (English, Spanish, Event Production Catalan, German, French, Greek, Coordination Danish). & Logistics SOUND DIPLOMACY ACTIVE EVENTS FRENCH STUDY 1. INTRODUCTION The French music market has both French and Breton: traditional music with a modern twist. decreased in the last decade: Tangui Le Cras (Les Vieilles Charrues, Krismenn) states from €662 million in 2007 down to there is a small market for folk music in France though €363.7 in 2012. this is very much anchored in Breton, and therefore very competitive due to the amount of domestic content from the region. According to him, Folk music from Northern According to SNEP (Syndicat National de l’Edition Europe is more difficult to work in a world music context Phonographique), the digital music market has been where