Echantillonnage Piscicole Des Lacs Des Plagnes Et Vallon Dans Le Chablais
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
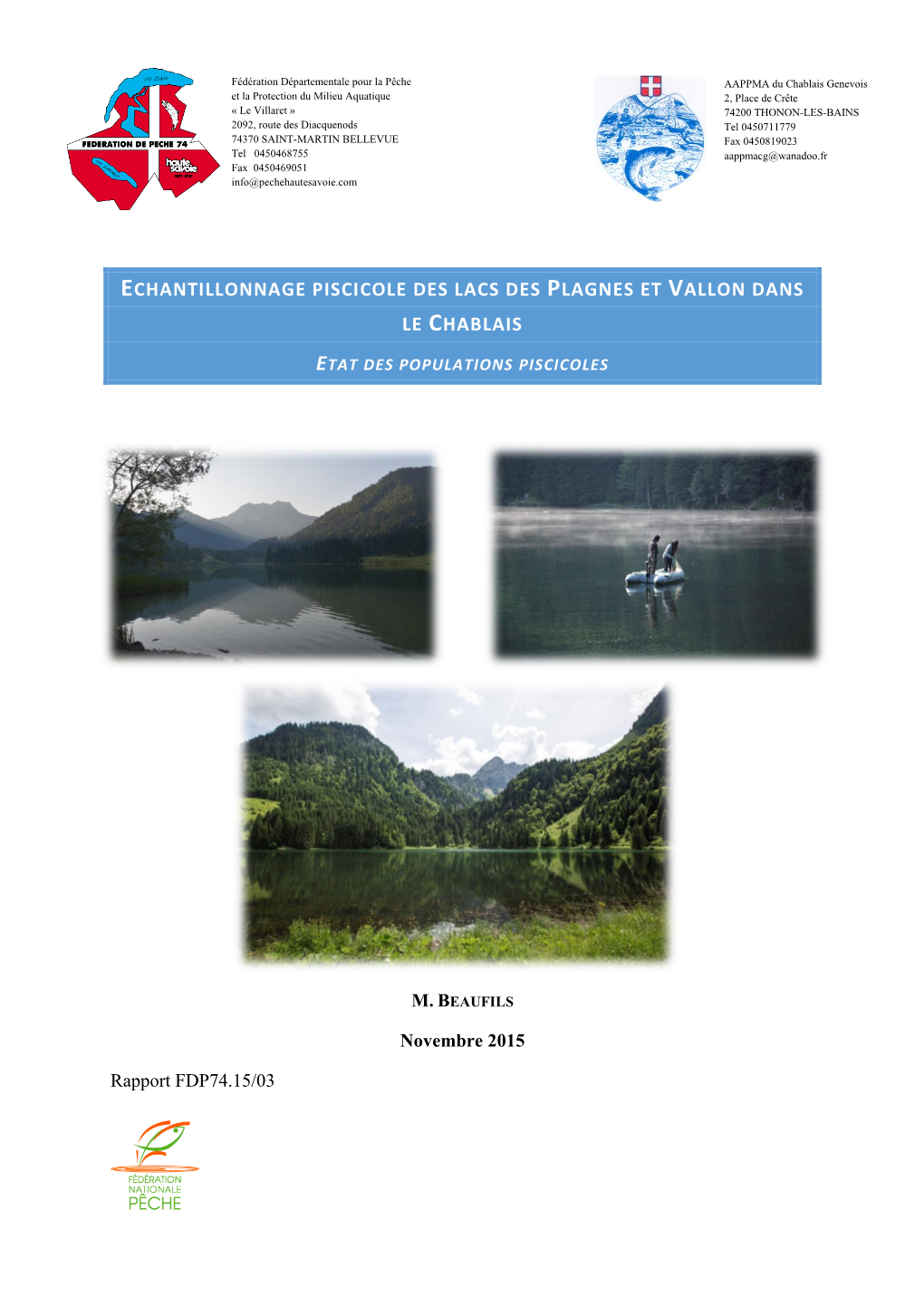
Load more
Recommended publications
-

Note Sur Les Terrains De Transport
NOTE SUR LES TERRAINS DE TRANSPORT DES ENVIRONS DE THONON-LES-BA1NS (HAUTE-SAVOIE) Avec une planche et une carte Par M. Ch. JACOB, Préparateur de Géologie à la Faculté des Sciences. Les collines et les plateaux qui s'élèvent près de Thonon et d'Évian- Ies-Bains, du lac de Genève aux premiers chaînons des montagnes du Ghablais, sont presque exclusivement constitués par des formations de transport, dont le beau développement et la complexité ont depuis longtemps attiré l'attention des géologues suisses et français. En ne citant que les principales recherches dont ces terrains ont fait l'objet, on peut mentionner les travaux d'Alphonse Favre4, qui ont apporté à leur connaissance la plus importante contribution, les notes de MM. Renevier 2, Delebecque3, Schardt 4 et tout récemment encore 1 Rech. géol. dans les parties de la Savoie, du Piémont et de la Saisse voisines du Mont-Blanc, Genève, 1867, t. I. ch. 1 à ix. 2 Notice delà feuille géologique Thonon au . Paris, i884- 80.000 3 Arch. des se. phys. et nat. de Genève, t. XXXIII, i8g5, p. 98, et Les lacs français, Paris, 1898, p. 352 et suiv. 4 Arch. des se. pays, et nat. de Genève, t. XXXIII, 1890, p. 280, et feuille géol. n° XVI de la carte suisse au 100.000 116 — de M. H. Douxami*. Les différents auteurs ont formulé diverses hypothèses au sujet du groupement à adopter pour les terrasses des environs de Thonon et de l'âge qu'il faut leur attribuer. Nous n'avons pas l'intention d'étudier ici toutes les opinions émises. -

Discovery Centre of the Valley D’Aulps
Réserve naturelle du Delta Jardins de l’eau du Maxilly-sur-Léman i n D I B MO . ais BL CHA K- eopar WWW.G a de la Dranse / Delta de la Dranse The Water 10 Pré Curieux / 5 Meillerie 0 m D 100 5 Canton de Vaud é Nature Reserve Gardens of the Pré Curieux Lugrin D 24 Saint-Gingolph com . ais BL CHA K- eopar WWW.G L (Switzerland) M i Le Bouveret e Thollon-les-Mémises k i Évian-les-Bains 1 i eopark G Chablais Chablais 2 Publier D Neuvecelle e M D 24 a s Usine d’embouteillage 19 n a NYON r 1 des eaux d’Evian / D 6 11 Château de Ripaille / D D L a L Bottling plant for Evian water Château of Ripaille M D 21 nature. Marin Direction D Saint-Paul-en-Chablais 5 Novel the link between man and and man between link the 2 Monthey - Martigny THONON-LES-BAINS 1 Mont Bénand examples of the strength of of strength the of examples Champanges D 52 18 Lac de la Beunaz / Waters are just some of the the of some just are Waters Écomusée de la pêche et du lac i M Beunaz Lake Conception Larringes Marais the Evian and Thonon Mineral Mineral Thonon and Evian the Yvoire et Musée du Chablais / The Ecomuseum of du Maravant / Maravant Marsh Bernex legends, the natural riches of of riches natural the legends, i Fishing and the Lake and the Museum of Chablais D graphique : graphique 9 e i 0 in “alpages”, the stories and the the and stories the “alpages”, g 2 L’U Nernier Anthy-sur-Léman life in the high alpine farms farms alpine high the in life 5 Féternes 00 L 1 21 Vinzier Atelier Duo I www.atelierduo.fr - e D the use of the mountains, the the mountains, the of use the D D P 23 8 Lac de Darbon Excenevex 33 a m 6 tors. -

Fascicule B Du Contrat De Rivières Des Dranses Et De L'est Lémanique
FASCICULE B CONTRAT DE RIVIÈRES Des Dranses et Est Lémanique ÉTAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC 2017-2022 SIAC Documents constitutifs du Dossier Définitif Le Dossier définitif du Contrat de Rivières du bassin versant des Dranses et de l’Est Lémanique est constitué de 3 documents : - Fascicule A : Document contractuel - Fascicule B : Etat des lieux et Diagnostic - Fascicule C : Recueil des fiches-Actions Le présent document constitue le Fascicule B : Etat des lieux et Diagnostic. Etat des lieux - Diagnostic Projet de Contrat de Rivières des Dranses / Est lémanique Mars 2017 Page 3 sur 126 SIAC Etat des lieux - Diagnostic Projet de Contrat de Rivières des Dranses / Est lémanique Mars 2017 Page 4 sur 126 SIAC Sommaire Sommaire ................................................................................................................................. 5 Préambule ................................................................................................................................ 7 CONTEXTE et motivations ......................................................................................................... 8 1.1 Contexte naturel et humain : territoire et usages ................................................................... 8 1.1.1 Situation géographique ................................................................................................... 8 1.1.2 Présentation générale du bassin versant ........................................................................ 8 1.1.3 Masses d’eau définies dans le SDAGE 2016 – 2021 -

Hydrology in Mountainous Regions I
mm Hydrology in Mountainous Regions I HYDROLOGICAL MEASUREMENTS THE WATER CYCLE Edited by H. LANG Geographisches Institut ETH, Abteilung Hydrologie, Winterthurerstrasse 190, CH-8057 Zurich, Switzerland A. MUSY Institut d'Aménagement des Terres et des Eaux, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, GR Ecublens, CH-101S Lausanne, Switzerland Proceedings of two international symposia, the Symposium on Improved Methods of Hydrological Measurements in Mountain Areas (SI) and the Symposium on Quantitative and Qualitative Water Cycle Aspects in Heterogeneous Basins (S2), held at Lausanne, Switzerland, 27 August- 1 September 1990. The symposia were part of the International Conference on Water Resources in Mountainous Regions jointly convened by the International Association of Hydrological Sciences (IAHS) and the International Association of Hydrogeologists (IAH). IAHS Publication No. 193 Published by the International Association of Hydrological Sciences 1990. IAHS Press, Institute of Hydrology, Wallingford, Oxfordshire OX10 8BB, UK. IAHS Publication No. 193. ISBN 0-947571-57-4. The designations employed and the presentation of material throughout the publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IAHS concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. The use of trade, firm, or corporate names in the publication is for the information and convenience of the reader. Such use does not constitute an official endorsement or approval by IAHS of any product or service to the exclusion of others that may be suitable. The camera-ready copy for the papers was prepared by the authors and assembled/finished at IAHS Press. -

Responses to Comments from Anonymous Referee 2
Responses to comments from anonymous Referee 2 On “Should altitudinal gradients of temperature and precipitation inputs be inferred from key parameters in snow-hydrological models?” by D. Ruelland (HESS-2019-556) Referee’s comment The article analyzes the sensitivity of a snow accounting procedure and hydrological modeling results to the evaluation of temperature and precipitation in space and time in mountainous catchments. The study is based on a set of 20 catchments in the French Alps and two hydrological models. The author evaluates the interplay between the lapse rate, snow routine and hydrological model parameters. I found this is a clear and interesting paper. I have a few suggestions for improvement detailed below, some of which are quite major and requiring new calculations. I suggest considering the paper for possible publication in HESS after major revision. Authors’ response I would like to thank the referee for the time spent in reviewing the initial paper and making interesting suggestions. Most of them were judged useful even though I did not agree with all comments. In any cases, I provided a point-by-point response to the reviewer’s comments and tried to bring modifications to the manuscript accordingly. Detailed comments Referee’s comment 1. I found that the literature review could have been more exhaustive, to better stress the originality of the work compared to existing studies on similar or close topics. Some recent works could be discussed, for example the work by Le Moine et al. (2015) on the link between snow and hydrological sub-models in model parameterization, some studies on using snow data to calibrate hydrological models (Besic et al. -

Comite De Rivieres Des Dranses Et De L'est Lemanique
COMITE DE RIVIERES DES DRANSES ET DE L'EST LEMANIQUE 17 juillet 2014– 10h30 heures - espace Tully Date de la convocation du Comité de rivières : 10juillet 2014 Membres présents Collège des membres représentant les élus Jean Paul MOILLE – Conseiller Régional ; George CONSTANTIN – Conseiller Général Gaston LACROIX – Conseiller général ; Paul GIRARD-DEPRAULEX – ABONDANCE ;Daniel CHAUSEE – ARMOY ; André FELIZAZ – BELLEVAUX ; Henri-Victor TOURNIER – LE BIOT ; Renato GOBBER – CHAMPANGES ; Bernard MAXIT – LA CHAPELLED’ABONDANCE ; Nicolas RUBIN – CHATEL ; Pierre MERCIER-GALLAY – CHEVENOZ ; Sophie MUFFAT – COTE D’ARBROZ ; Alain CAPPAI – FETERNES ; Gilbert GALLAY – LA FORCLAZ ; Jean René BOURRON – LARRINGES ;Jacques BURNET– LUGRIN ; Pascal CHESSEL – MARIN ; Jean Michel JULLIARD – MAXILLY SUR LEMAN ; Georges LAGRANGE – MONTRIOND André PEERSMAN – MONTRIOND ;Gérard BERGER – MORZINE ; Philippe DRAGO – NEUVECELLE ; André LAPERROUZAZ – PUBLIER ;Gérard LOMBARD – REYVROZ ; Eric DUPONT – SEYTROUX ; Max MICHOUD – SAINT PAUL EN CHABLAIS ;Jean DENAIS – THONON LES BAINS ;Jacqueline GARIN – LA VERNAZ ; Yannick TRABICHET – VAILLY ; Jean Yves MORACCHINI – SIAC ; Josiane LEI - CCPE Collège des membres représentant de l’état et les établissements publics David PROUTEAU– Préfecture de Haute-Savoie ; Mathieu DELILLE – DDT 74 ; Frédéric BRUNET - ONF Collège des membres représentant les organisations professionnelles et les usagers des rivières Philippe EROLA – AAPPMA ; Alain GAGNAIRE – ASL ;Alain LEVRAY – FDC ; Guy VULLIEZ – SPFS ; I.J BELEY – SAEME- LPO ; Martial -

PPRN De Bellevaux (Révision) Document PPRN Bellevaux Presentation V5.Odt Référence Proposition N° D1408097 Référence Commande Adresse Maître D’Ouvrage DDT74 - SAR/CPR
9 1 0 2 - s e u q s i r o é G ’ p Préfet de Haute-Savoie l A PPRN de la commune de Bellevaux Révision du PPRN Note de présentation Maître d’ouvrage DDT74 - SAR/CPR Date Mars 2019 Alp’Géorisques Z.I. – 52 rue du Moirond - 38420 DOMENE - FRANCE Tél. 04-76-77-92-00 Fax : 04-76-77-55-90 Courriel : contact@alpgeo risques.com sarl au capital de 18 300 € - Siret : 380 934 216 00025 - Code A.P.E. 7112B Référence 19031373 – (devis D1408097) Version 5 Rev. 2 Date Mars 2019 Édition du 18/03/2019 Identification du document Projet Note de présentation Titre PPRN de Bellevaux (révision) Document PPRN_Bellevaux_presentation_v5.odt Référence Proposition n° D1408097 Référence commande Adresse Maître d’ouvrage DDT74 - SAR/CPR Maître d’œuvre Adresse - ou AMO Modifications Version Date Description Auteur Vérifié par 5 (rév. 2) 18/03/2019 Première version JPR - Diffusion Chargé Jean-Pierre Rossetti 04 76 77 92 00 [email protected] d’études Papier Diffusion Numérique P DDT74 Archivage N° d’archivage (référence) Titre Note de présentation Département Haute-Savoie Commune(s) concernée(s) Bellevaux Cours d’eau concerné(s) - Région naturelle Alpes du Nord, Chablais Thème Mots-clefs PPRN, mouvements de terrain, avalanches, crue torrentielles SOMMAIRE I. PRÉAMBULE...............................................................................................................................1 II. CONTEXTE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE......................................................................1 II.1. Rappel de l’objet du PPRN................................................................................................1 -

The Dissolved Loads of Rivers: a Global Overview
Dissolved Loads of Rivers and Surface Water Quantity/Quality Relationships (Proceedings of the Hamburg Symposium, August 1983). IAHS Publ. no. 141. The dissolved loads of rivers: a global overview D. E, WALLING & B, W. WEBB University of Exeter, Exeter EX4 4RJ, Devon, UK ABSTRACT Values of mean annual total dissolved load have been assembled from 490 rivers located throughout the world and these data have been used to review the general characteristics of dissolved load transport. Attention is given to the magnitude of dissolved loads and their spatial variation, the temporal variation of dissolved load transport and the relationship between the magnitude of the dissolved and particulate components of total load. Transport en solution par les rivières: examen sur le plan mondial RESUME Les valeurs de transport en solution ont été rassemblées pour 490 rivières réparties dans le monde entier. Ces données ont été utilisées pour définir les caractéristiques générales de transport en solution, y compris l'ampleur des transports spécifiques en solution et leur variation dans l'espace, la variation temporelle des transport en solution, et l'importance relative du transport en solution et du transport solide en suspension. INTRODUCTION Interest in the transport of material in solution by rivers can be traced back for over 100 years. Amongst the earliest studies are those undertaken by Popp and by Letheby on the River Nile in Egypt in 1870 and 1874-1875 respectively (Popp, 1875; Baker, 1880). In most cases this early work focussed on chemical analyses of individual water samples rather than attempting to document the loads transported during specific periods of time, since records of water discharge were generally lacking. -

Should Altitudinal Gradients of Temperature and Precipitation Inputs Be Inferred from Key Parameters in Snow-Hydrological Models?
https://doi.org/10.5194/hess-2019-556 Preprint. Discussion started: 12 November 2019 c Author(s) 2019. CC BY 4.0 License. Should altitudinal gradients of temperature and precipitation inputs be inferred from key parameters in snow-hydrological models? Denis Ruelland CNRS, HydroSciences Montpellier, University of Montpellier, Place E. Bataillon, 34395 Montpellier Cedex 5, France 5 Correspondence to: [email protected] Abstract. This paper evaluates whether snow-covered area and streamflow measurements can help assess altitudinal gradients of temperature and precipitation in data-scarce mountainous areas more realistically than using the usual interpolation procedures. An extensive dataset covering 20 Alpine catchments is used to investigate this issue. Elevation dependency in the meteorological fields is accounted for using two approaches: (i) by estimating the local and time-varying 10 altitudinal gradients from the available gauge network based on deterministic and geostatistical interpolation methods with an external drift; and (ii) by calibrating the local gradients using an inverse snow-hydrological modelling framework. For the second approach, a simple 2-parameter model is proposed to target the temperature/precipitation-elevation relationship and to regionalise air temperature and precipitation from the sparse meteorological network. The coherence of the two approaches is evaluated by benchmarking several hydrological variables (snow-covered area, streamflow and water balance) 15 computed with snow-hydrological models fed with the interpolated datasets and checked against available measurements. Results show that accounting for elevation dependency from scattered observations when interpolating air temperature and precipitation cannot provide sufficiently accurate inputs for models. The lack of high-elevation stations seriously limits correct estimation of lapse rates of temperature and precipitation, which, in turn, affects the performance of the snow- hydrological simulations due to imprecise estimates of temperature and precipitation volumes. -

Synthese Bibliographique Bv Dr
RAPPORT D’ETUDE SIAC Rédacteur : Gaëtan Loubaresse Relecture : Vivian Visini Etude piscicole des cours d’eau du bassin versant des Dranses et de l’est lémanique S YNTHESE BIBLIOGRAPHI QUE E T RESULTATS BRUTS 2012 - 2013 Etude réalisée avec le concours financier de : Dossier n°: 2012062 Version : 2012062-1-3 Date : 29/11/2013 G ESTION DES E S P A C E S N A T U R E L S - TEREO G ESTION DES E S P A C E S N A T U R E L S - TEREO SOMMAIRE 1 - Objectif du rapport ............................................................................................................................................. 1 2 - Synthèse bibliographique ................................................................................................................................... 2 2.1 - Contexte géographique .......................................................................................................................................... 2 2.2 - Occupation du sol .................................................................................................................................................... 3 2.3 - Réseau hydrographique et masses d’eau DCE .................................................................................................. 6 2.3.1 - Réseau hydrographique ..................................................................................................................... 6 2.3.2 - Masse d’eau DCE ............................................................................................................................... -

Article Is Available Online Chen, C.-T
Biogeosciences, 13, 3573–3584, 2016 www.biogeosciences.net/13/3573/2016/ doi:10.5194/bg-13-3573-2016 © Author(s) 2016. CC Attribution 3.0 License. Are flood-driven turbidity currents hot spots for priming effect in lakes? Damien Bouffard1 and Marie-Elodie Perga2 1Physics of Aquatic Systems Laboratory, Margaretha Kamprad Chair, EPFL-ENAC-IEE-APHYS, 1015 Lausanne, Switzerland 2INRA-Université Savoie Mont Blanc, UMR042 CARRTEL, Thonon-les-Bains, France Correspondence to: Marie-Elodie Perga ([email protected]) Received: 15 December 2015 – Published in Biogeosciences Discuss.: 18 January 2016 Revised: 20 May 2016 – Accepted: 27 May 2016 – Published: 20 June 2016 Abstract. In deep stratified lakes, such as Lake Geneva, 1 Introduction flood-driven turbidity currents are thought to contribute to the replenishment of deep oxygen by significant transport In thermally stratified lakes, river water inflow occurs un- of river waters saturated with oxygen into the hypolimnion. der two different modes. Under normal (i.e dry-weather) flow The overarching aim of this study was to test this long- conditions, the river water is injected at the interface between standing hypothesis directly. It combines direct observational the warm, upper layer (epilimnion) and the cold, lower layer data collected during an extreme flooding event that occurred (hypolimnion), forming an interflow in the upper thermocline in May 2015 with dark bioassays designed to evaluate the (Fischer, 1979) or at the surface. Particularly during flood consequences of river-borne inputs for the hypolimnetic res- events, high concentrations of suspended sediments in rivers piration. The exceptional precipitation events of May 2015 increase the density of inflowing waters and therefore gen- caused floods with an annual return time for the Rhône River, erate turbid density currents following the slope and flow- the dominant tributary of Lake Geneva, and with 50-year ing into the hypolimnion (i.e. -

Nautique CÔTÉ THONON-LES-BAINS
LÉMAN nautique CÔTÉ THONON-LES-BAINS 2021/2022 NAUTISME JETEZ-VOUS À L’EAU ET EMBARQUEZ À LA DÉCOUVERTE DES RIVES DU LÉMAN 2 LÉMAN nautique GUIDE NAUTIQUE 2021 | 2022 3 EditoLE MOT DU PRÉSIDENT DE LA STATION NAUTIQUE Sur les rives du Léman, Thonon-les-Bains avait déjà fait le pari fou d’intégrer le club très fermé des stations nautiques en 2004. Depuis, la station n’a eu de cesse que d’améliorer ses infrastructures, son accueil, sa promotion et son organisation afin d’offrir à ses usagers les meilleurs services pour une pratique optimale des sports et loisirs nautiques. Un effort récompensé dès 2010 par l’attribution du plus haut niveau du label : 4 étoiles ! Notre station se distingue par la richesse de son offre nautique aussi variée que depuis ses plages, nombreuses et aménagées vous pourrez profiter d’une journée baignade et farnienté ou aussi bien vous opterez pour des activités plus sportives tels que ski nautique, la planche à voile ou la plongée. Plaisancier ou adepte de croisière, bienvenue dans le plus grand port de la rive française lémanique, 800 anneaux d’où évoluent les écoles de voiles, de plongée, d’aviron ou de sauvetage. Un peu plus loin vous affronterez les Dranses et vous pourrez vous adonner à des sports d’eaux vives tels que le rafting, l’hydrospeed ou le canyoning. Le littoral lémanique ce sont enfin des dizaines de kilomètres organisées autour de la pêche du côté du port de Rives, de la natation plus loin au cœur de la plage municipale en passant par le point plage et ses excursions en paddle, kayak ou pedal’eau.