Tchad) : 1635-2012
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC and Small Arms Survey by Eric G
SMALL ARMS: A REGIONAL TINDERBOX A REGIONAL ARMS: SMALL AND REPUBLIC AFRICAN THE CENTRAL Small Arms Survey By Eric G. Berman with Louisa N. Lombard Graduate Institute of International and Development Studies 47 Avenue Blanc, 1202 Geneva, Switzerland p +41 22 908 5777 f +41 22 732 2738 e [email protected] w www.smallarmssurvey.org THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC AND SMALL ARMS A REGIONAL TINDERBOX ‘ The Central African Republic and Small Arms is the most thorough and carefully researched G. Eric By Berman with Louisa N. Lombard report on the volume, origins, and distribution of small arms in any African state. But it goes beyond the focus on small arms. It also provides a much-needed backdrop to the complicated political convulsions that have transformed CAR into a regional tinderbox. There is no better source for anyone interested in putting the ongoing crisis in its proper context.’ —Dr René Lemarchand Emeritus Professor, University of Florida and author of The Dynamics of Violence in Central Africa ’The Central African Republic, surrounded by warring parties in Sudan, Chad, and the Democratic Republic of the Congo, lies on the fault line between the international community’s commitment to disarmament and the tendency for African conflicts to draw in their neighbours. The Central African Republic and Small Arms unlocks the secrets of the breakdown of state capacity in a little-known but pivotal state in the heart of Africa. It also offers important new insight to options for policy-makers and concerned organizations to promote peace in complex situations.’ —Professor William Reno Associate Professor and Director of Graduate Studies, Department of Political Science, Northwestern University Photo: A mutineer during the military unrest of May 1996. -

Paper Submitted for Presentation at UNU-WIDER’S Conference, Held in Maputo on 5-6 July 2017
DRAFT WIDER Development Conference Public economics for development 5-6 July 2017 | Maputo, Mozambique This is a draft version of a conference paper submitted for presentation at UNU-WIDER’s conference, held in Maputo on 5-6 July 2017. This is not a formal publication of UNU-WIDER and may refl ect work-in-progress. THIS DRAFT IS NOT TO BE CITED, QUOTED OR ATTRIBUTED WITHOUT PERMISSION FROM AUTHOR(S). The impact of oil exploitation on wellbeing in Chad Abstract This study assesses the impact of oil revenues on wellbeing in Chad. Data used come from the two last Chad Household Consumption and Informal Sector Surveys ECOSIT 2 & 3 conducted in 2003 and 2011 by the National Institute of Statistics and Demographic Studies. A synthetic index of multidimensional wellbeing (MDW) is first estimated using a multiple components analysis based on a large set of welfare indicators. The Difference-in-Difference approach is then employed to assess the impact of oil revenues on the average MDW at departmental level. Results show that departments receiving intense oil transfers increased their MDW about 35% more than those disadvantaged by the oil revenues redistribution policy. Also, the farther a department is from the capital city N’Djamena, the lower its average MDW. Economic inclusion may be better promoted in Chad if oil revenues fit local development needs and are effectively directed to the poorest departments. Keys words: Poverty, Multidimensional wellbeing, Oil exploitation, Chad, Redistribution policy. JEL Codes: I32, D63, O13, O15 Authors Gadom -

The Maban Languages and Their Place Within Nilo-Saharan
The Maban languages and their place within Nilo-Saharan DRAFT CIRCUALTED FOR DISCUSSION NOT TO BE QUOTED WITHOUT PERMISSION Roger Blench McDonald Institute for Archaeological Research University of Cambridge Department of History, University of Jos Kay Williamson Educational Foundation 8, Guest Road Cambridge CB1 2AL United Kingdom Voice/ Ans (00-44)-(0)1223-560687 Mobile worldwide (00-44)-(0)7847-495590 E-mail [email protected] http://www.rogerblench.info/RBOP.htm This version: Cambridge, 10 January, 2021 The Maban languages Roger Blench Draft for comment TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS.........................................................................................................................................i ACRONYMS AND CONVENTIONS...................................................................................................................ii 1. Introduction.........................................................................................................................................................3 2. The Maban languages .........................................................................................................................................3 2.1 Documented languages................................................................................................................................3 2.2 Locations .....................................................................................................................................................5 2.3 Existing literature -

« Réseaux Sociaux : Impact Sur La Gouvernance Électorale Au Tchad »
UNIVERSITE DE PARIS - SORBONNE (PA R I S I V ) ENA Ecole des hautes études en sciences de l'information et de la communication Ecole nationale d’administration Master Professionnel 2e année Option : COMMUNICATION DES INSTITUTIONS PUBLIQUES « Réseaux sociaux : impact sur la gouvernance électorale au Tchad » Sous la direction de Madame Françoise Boursin, Professeur émérite des Universités, CELSA Paris-Sorbonne et Monsieur Jean-Emmanuel Paillon, Directeur général délégué à l’administration, INRIA Nom et Prénom(s) : Iyakba Serge Ouambi Promotion : Louise Weiss (2016-2017) Option : Communication des Institutions Publiques Soutenu le : Mention : Note du mémoire : 1 Remerciements Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la bonne réalisation de ce mémoire : - Madame Françoise Boursin, Professeur des Universités au CELSA Paris- Sorbonne, pour le temps précieux qu’elle m’a consacré ; - Monsieur Jean-Emmanuel Paillon, Directeur général délégué à l’administration (INRIA), qui m’a pleinement fait profiter de son dynamisme et de ses qualités professionnelles ; - Madame Kim Griffin, Responsable pédagogique des Masters à l’ENA, qui me fait l’honneur de participer au jury de soutenance ; - Madame Sandrine Blaison, Responsable de la mise en œuvre des Masters à l’ENA, pour son appui multiforme ; - Madame Sarah Viguier, pour ses conseils, sa contribution et ses précieuses orientations tout au long de ce travail ; - Monsieur Matthieu Le Hello, mon camarade de promotion, qui a accepté de relire ce travail ; - Mon épouse Te-iabé Naoura et mes trois enfants Liliah, Eliel et Elsa pour leur amour et leur patience tout au long de mon absence scolaire ; - Toute ma grande famille Ouambi pour son soutien permanent et ses mots d’encouragement. -
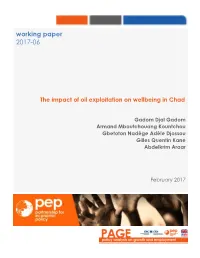
Working Paper 2017-06
worki! ownng pap er 2017-06 Universite Laval The impact of oil exploitation on wellbeing in Chad Gadom Djal Gadom Armand Mboutchouang Kountchou Gbetoton Nadège Adèle Djossou Gilles Quentin Kane Abdelkrim Araar February 2017 i The impact of oil exploitation on wellbeing in Chad Abstract This study assesses the impact of oil revenues on wellbeing in Chad using data from the two last Chad Household Consumption and Informal Sector Surveys (ECOSIT 2 & 3), conducted in 2003 and 2011, respectively, by the National Institute of Statistics for Economics and Demographic Studies (INSEED) and, from the College for Control and monitoring of Oil Revenues (CCSRP). To achieve the research objective, we first estimate a synthetic index of multidimensional wellbeing (MDW) based on a large set of welfare indicators. Then, the Difference-in-Difference (DID) approach is used to assess the impact of oil revenues on the average MDW at departmental level. We find evidence that departments receiving intense oil transfers increased their MDW about 35% more than those disadvantaged by the oil revenues redistribution policy. Moreover, the further a department is from the capital city N’Djamena, the lower its average MDW. We conclude that to better promote economic inclusion in Chad, the government should implement a specific policy to better direct the oil revenue investment in the poorest departments. Keys words: Poverty, Multidimensional wellbeing, Oil exploitation, Chad, Redistribution policy. JEL Codes: I32, D63, O13, O15 Authors Gadom Djal Gadom Mboutchouang -

The Chad–Sudan Proxy War and the 'Darfurization' of Chad: Myths and Reality
12 The Chad–Sudan Proxy War and the ‘Darfurization’ of Chad: Myths and Reality By Jérôme Tubiana Copyright The Small Arms Survey Published in Switzerland by the Small Arms Survey The Small Arms Survey is an independent research project located at the Grad- uate Institute of International Studies in Geneva, Switzerland. It serves as the © Small Arms Survey, Graduate Institute of International Studies, Geneva 2008 principal source of public information on all aspects of small arms and as a First published in April 2008 resource centre for governments, policy-makers, researchers, and activists. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a Established in 1999, the project is supported by the Swiss Federal Department retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior of Foreign Affairs, and by contributions from the Governments of Belgium, permission in writing of the Small Arms Survey, or as expressly permitted by Canada, Finland, France, the Netherlands, Norway, Sweden, and the UK. The law, or under terms agreed with the appropriate reprographics rights organi- Survey is also grateful for past and current project-specific support received zation. Enquiries concerning reproduction outside the scope of the above should from Australia, Denmark, and New Zealand. Further funding has been pro- be sent to the Publications Manager, Small Arms Survey, at the address below. vided by the United Nations Development Programme, the United Nations Institute for Disarmament Research, the Geneva International Academic Net- Small Arms Survey work, and the Geneva International Centre for Humanitarian Demining. The Graduate Institute of International Studies Small Arms Survey collaborates with research institutes and NGOs in many 47 Avenue Blanc, 1202 Geneva, Switzerland countries, including Brazil, Canada, Georgia, Germany, India, Israel, Jordan, Copyedited by Emily Walmsley Norway, the Russian Federation, South Africa, Sri Lanka, Sudan, Sweden, Thailand, the United Kingdom, and the United States. -

Draft 2E Trimestre Présence Des Partenaires Fsc 5
Présence opérationnelle des partenaires Avril - Juin 2021 La présence opérationnelle des partenaires du cluster sécurité alimentaire est établie pour montrer où sont les acteurs (niveau départemental) et les types d’activités (assistance alimentaire, appui aux moyens d’existence) mis en œuvre. Elle permettra aux différents partenaires de se coordonner. Légende LIBYE Limites Cette carte est dite opérationnelle et seuls sont représentés les acteurs mettant Province en œuvre des activités pendant la période de publication. Une mise à jour sera faite Tibesti chaque trois mois. Département . Nombre de partenaires par province PARTENAIRES Pas de partenaires Ennedi Ouest 1 - 5 partenaires 36 Bailleurs 65 Partenaires Ennedi 6 - 10 partenaires Est sont engagés aux côtés des ONG nationales, internationales, mouvement de la Croix partenaires pour financer Rouge et des agences UN sont en train d’apporter l’assistance Borkou l’assistance aux populations nécessaire aux populaions dans les zones identifiées par le + 10 partenaires affectées par l’insécurité cluster. Ce nombre n’implique pas les structures étatiques qui alimentaire. sont aussi acteurs de l’activité humanitaire, en partenariat avec les agences et ONG. Le nombre de partenaires augmentera Kanem surêment avec les a ctivités de soudure quis’approchent 0 300 Km et qui impliquent beaucoup d’acteurs. Barh-El Wadi Fira -Gazel PARTENAIRES PAR ACTIVITES PARTENAIRES PAR TYPE NIGER Batha Lac Ouaddaï 37 56 SOUDAN 27 17 19 20 Hadjer-Lamis Sila 1623 Guéra N'Djamena 5 Chari- Baguirmi Salamat 3 Appui au Soutien aux moyens Assistance Agences développement d’existence d’urgence alimentaire ONG ONG Mouvements de NIGERIA Mayo-Kebbi Est Nationale Internationale UN la Croix-Rouge PARTENAIRES PAR PROVINCE Tandjilé Moyen-Chari Mayo-Kebbi Ouest 25 REPUBLIQUE Mandoul 17 Logone Occidental CENTRAFRICAINE Logone 16 CAMEROUN Oriental 8 7 7 7 6 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 4 Lac Log. -

The Contribution of the Catholic Church to Post-Civil War Conflict Resolution in Chad
Santa Clara University Scholar Commons Jesuit School of Theology Dissertations Student Scholarship 5-2020 The Contribution of the Catholic Church to Post-Civil War Conflict Resolution in Chad Rimasbé Dionbo Jean Claude Follow this and additional works at: https://scholarcommons.scu.edu/jst_dissertations Part of the Religion Commons THE CONTRIBUTION OF THE CATHOLIC CHURCH TO POST-CIVIL WAR CONFLICT RESOLUTION IN CHAD A Thesis by Rimasbé Dionbo Jean Claude presented to The Faculty of the Jesuit School of Theology of Santa Clara University in Partial Fulfillment of the requirements for the Degree of the Licentiate in Sacred Theology Berkeley, California May 2020 Committee Signatures Julie Hanlon Rubio, PHD, Director Date Prof. Paul Thissen, PHD, Reader Date i Contents Contents ........................................................................................................................................... i Abstract ............................................................................................................................................ v Acknowledgments ........................................................................................................................... vi Dedication ..................................................................................................................................... vii Abbreviations ............................................................................................................................... viii General Introduction ..................................................................................................................... -

Chad: a New Conflict Resolution Framework
CHAD: A NEW CONFLICT RESOLUTION FRAMEWORK Africa Report N°144 – 24 September 2008 TABLE OF CONTENTS EXECUTIVE SUMMARY AND RECOMMENDATIONS.................................................I I. INTRODUCTION .......................................................................................................... 1 II. A CRISIS OF THE STATE ........................................................................................... 2 A. 1990-2000: MISSED OPPORTUNITIES FOR RECONCILIATION......................................................2 B. OIL, CLIENTELISM AND CORRUPTION........................................................................................3 1. Clientelism and generalised corruption ..............................................................................3 2. The oil curse .......................................................................................................................4 C. MILITARISATION OF THE ADMINISTRATION AND POPULATION ..................................................5 D. NATIONAL AND RELIGIOUS DIVIDES .........................................................................................6 III. THE ACTORS IN THE CRISIS................................................................................... 8 A. THE POLITICAL OPPOSITION .....................................................................................................8 1. Repression and co-option ...................................................................................................8 2. The political platform of -

GFD/FFA) Et Nutritionnel (Bfs) Dans La Bande Sahélien – 2014
Operations d’assistance alimentaire (GFD/FFA) et nutritionnel (BFs) dans la bande sahélien – 2014 Meeting WFP/Partners 04/04/2014 Food Insecure Population (ENSA nov. 2013/CH mars 2014) Food insecure population (as per Food insecure population (as per CH Region ENSA projection - Nov.2013) projection - Mar.2014) Barh El gazel 78,910 88,542 Barh EL Gazel Nord 33,443 Barh El gazel Sud 45,467 Batha 63,981 39,939 Batha Est 24,248 Batha Ouest 20,854 Fitri 18,879 Guera 91,706 114,312 Abtouyour 21,696 Barh Signaka 19,445 Guera 34,276 Mangalme 16,289 Kanem 83,175 116,764 Kanem 37,763 Nord Kanem 24,557 Wadi-Bissam 20,855 Lac 49,052 20,762 Mamdi 19,235 Wayi 29,817 Ouaddaï 76,777 34,686 Abdi 10,242 Assoungha 22,682 Ouara 43,854 Sila 53,318 9,210 Djourouf Al Amar 14,039 Kimiti 39,279 Wadi Fira 130,095 158,459 Biltine 47,709 Dar-Tama 44,866 Kobe 37,521 Grand Total 627,014 582,674 Food Insecure Population &WFP Response Plan Food insecure population (as per Food insecure population (as per CH WFP Targeted Region ENSA projection - Nov.2013) projection - Mar.2014) Beneficiaries (GFD+FFA) GFD BF FFA Barh El gazel 78,910 88,542 83,188 60,000 11,739 4,636HH Barh EL Gazel Nord 33,443 20,000 20,000 11,739 On going Barh El gazel Sud 45,467 63,188 40,000 Batha 63,981 39,939 43,750 35,000 13,715 8,750 Batha Est 24,248 25,000 20,000 8,488 5,000 Batha Ouest 20,854 Fitri 18,879 18,750 15,000 5,227 3,750 Guera 91,706 114,312 60,750 52,000 8,082 8,750 Abtouyour 21,696 Barh Signaka 19,445 Guera 34,276 35,000 22,000 8,082 5,000 Mangalme 16,289 25,750 30,000 3,750 Kanem -

COUNTRY Food Security Update
WEST AFRICA Food Security Outlook October 2014 to March 2015 Atypical rainfall conditions, conflict, and the Ebola outbreak increase food insecurity across West Africa KEY MESSAGES Figure 1. Most likely estimated food security outcomes for October through December 2014 Ongoing harvests are improving household and market stock levels. Despite the late start to the season in several areas, overall crop production levels are expected to be average to above average throughout the region. However, below-average production is expected in Mauritania, Senegal, Gambia, northeastern Nigeria, the Central African Republic, and localized areas of other Sahelian countries. Overall, the pastoral situation in the Sahel is satisfactory. However, livestock production could be below average for the second year in a row in several pastoral zones, particularly in eastern Niger, Source: FEWS NET Mauritania, and Senegal. This will cause transhumant livestock in these areas to migrate earlier than usual. Figure 2. Most likely estimated food security outcomes for January through March 2015 With lower production levels and delayed harvests, food insecurity will remain at Stressed (IPC Phase 2) levels until January 2015 in southeastern Niger, as well as the Senegal River Valley and the agropastoral zone of Mauritania. In Mauritania, the 2015 lean season will also arrive early, contributing to Crisis (IPC Phase 3) food insecurity between February and March 2015. Stressed (IPC Phase 2) and Crisis (IPC Phase 3) levels of food insecurity will persist in northeastern Nigeria and the Central African Republic through March 2015 due to the effects of the conflict and poor crop production Source: FEWS NET in these areas. -

Chad: Defusing Tensions in the Sahel
Chad: Defusing Tensions in the Sahel $IULFD5HSRUW1 _ 'HFHPEHU 7UDQVODWLRQIURP)UHQFK +HDGTXDUWHUV ,QWHUQDWLRQDO&ULVLV*URXS $YHQXH/RXLVH %UXVVHOV%HOJLXP 7HO )D[ EUXVVHOV#FULVLVJURXSRUJ Preventing War. Shaping Peace. Table of Contents Executive Summary ................................................................................................................... i I. Introduction ..................................................................................................................... 1 II. Ambivalent Relations with N’Djamena ............................................................................ 3 A. Relations between the Sahel Regions and Central Government since the 1990s ..... 3 1. Kanem ................................................................................................................... 3 2. Bahr el-Ghazal (BEG) ........................................................................................... 5 B. C0-option: A Flawed Strategy .................................................................................... 6 III. Mounting Tensions in the Region .................................................................................... 8 A. Abuses against BEG and Kanem Citizens .................................................................. 8 B. A Regional Economy in the Red ................................................................................ 9 C. Intra-religious Divides ............................................................................................... 11 IV. The