Université François - Rabelais
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
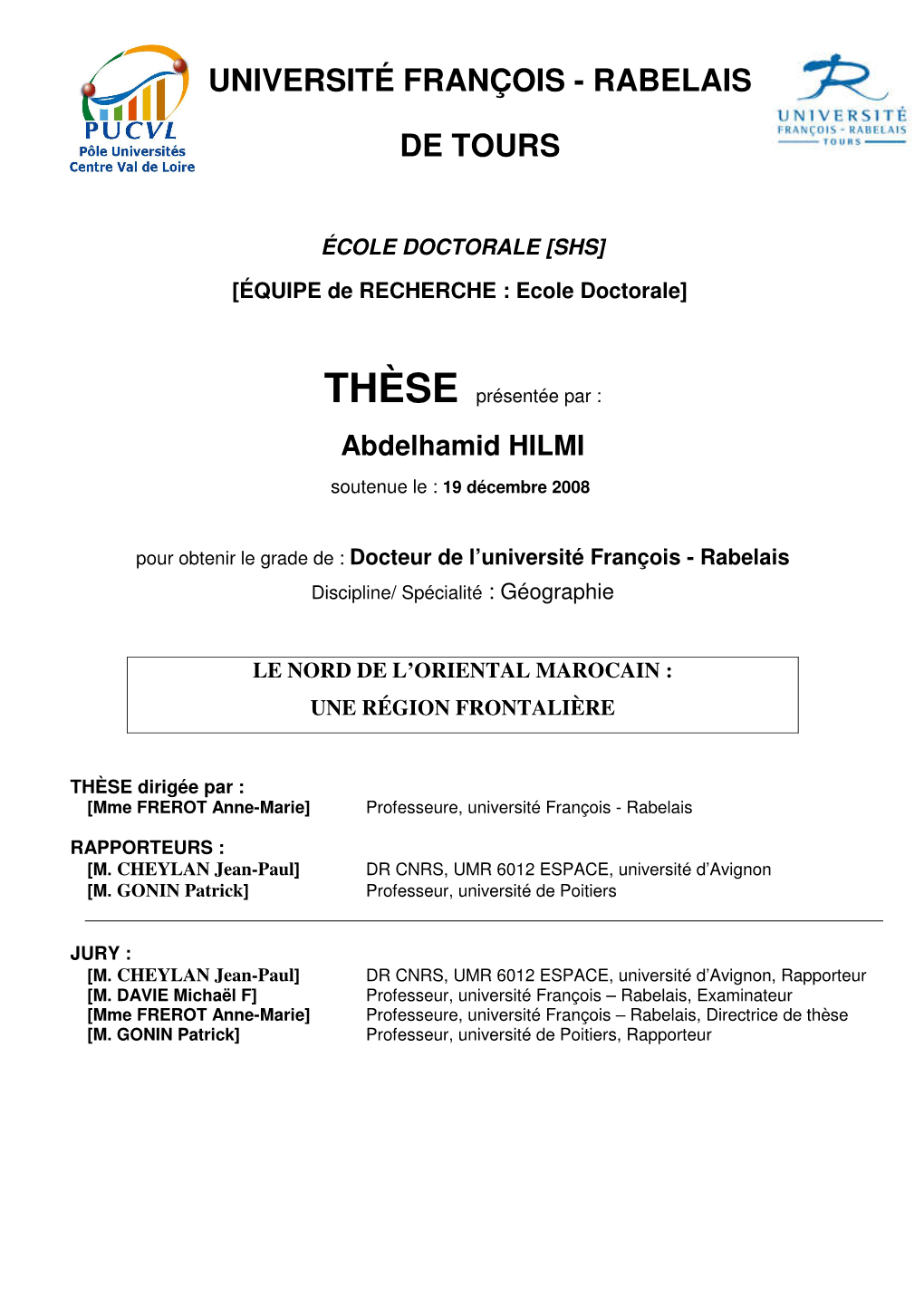
Load more
Recommended publications
-

Etude D'impact Sur L'environnement Du
ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT DU PROJET DE LA CENTRALE THERMO- SOLAIRE D’AIN BENI MATHAR VOLUME II LIGNES ELECTRIQUES HAUTE TENSION (Rapport final) SEPTEMBRE 2006 PREAMBULE L’étude définissant l’impact du projet de la centrale thermo solaire à cycle combiné intégré de Ain Beni Mathar est composée de trois rapports : Volume I : étude d’impact environnemental de la centrale thermo solaire, de la bretelle d’amenée des gaz et de la route d’accès Volume II : étude d’impact environnemental pour la réalisation des lignes à haute tension pour l’évacuation et l’acheminement de l’électricité produite, Volume III : étude de risques et de dangers des installations. Cependant pour des raisons de présentation globale du projet, le résumé non technique et le plan de gestion de l’environnement couvrent la centrale thermo solaire, la bretelle d’amenée des gaz, la route d’accès et les lignes à hautes tensions. Le présent rapport (Volume II) traite de l’impact sur l’environnement des lignes à haute tension pour l’évacuation et l’acheminement de l’électricité. Les points spécifiques liés aux dangers et risques induits par les activités propres des installations sont développés spécifiquement dans le volume III de cette étude. Dans les termes de référence l’évacuation de l’énergie électrique produite est prévue vers les postes de Jerada et de Bourdim. Des modifications dans le projet survenues après avoir fait l’investigation de terrain et l’étude du milieu naturel, concernant la ligne de Bourdim. Celle-ci à été remplacée par une ligne de même tension qui achemine l’électricité vers le poste de Oujda. -

Morocco: an Emerging Economic Force
Morocco: An Emerging Economic Force The kingdom is rapidly developing as a manufacturing export base, renewable energy hotspot and regional business hub OPPORTUNITIES SERIES NO.3 | DECEMBER 2019 TABLE OF CONTENTS SUMMARY 3 I. ECONOMIC FORECAST 4-10 1. An investment and export-led growth model 5-6 2. Industrial blueprint targets modernisation. 6-7 3. Reforms seek to attract foreign investment 7-9 3.1 Improvements to the business environment 8 3.2 Specific incentives 8 3.3 Infrastructure improvements 9 4. Limits to attractiveness 10 II. SECTOR OPPORTUNITIES 11-19 1. Export-orientated manufacturing 13-15 1.1 Established and emerging high-value-added industries 14 2. Renewable energy 15-16 3. Tourism 16-18 4. Logistics services 18-19 III. FOREIGN ECONOMIC RELATIONS 20-25 1. Africa strategy 20-23 1.1 Greater export opportunities on the continent 21 1.2 Securing raw material supplies 21-22 1.3 Facilitating trade between Africa and the rest of the world 22 1.4 Keeping Africa opportunities in perspective 22-23 2. China ties deepening 23-24 2.1 Potential influx of Chinese firms 23-24 2.2 Moroccan infrastructure to benefit 24 3 Qatar helping to mitigate reduction in gulf investment 24-25 IV. KEY RISKS 26-29 1. Social unrest and protest 26-28 1.1 2020 elections and risk of upsurge in protest 27-28 1.2 But risks should remain contained 28 2. Other important risks 29 2.1 Export demand disappoints 29 2.2 Exposure to bad loans in SSA 29 2.3 Upsurge in terrorism 29 SUMMARY Morocco will be a bright spot for investment in the MENA region over the next five years. -

State and Future of the Environment in the Oriental Region
Kingdom of Morocco Ministry of Energy, Mines, Ministry of Interior Water and Environment Region of Oriental Department of Environment Regional Observatory of Environment and Sustainable Development STATE AND FUTURE OF THE ENVIRONMENT IN THE ORIENTAL REGION Ministry of Energy, Mines, Water and Environment Department of Environment National Environmental Observatory of Morocco Adress : 9, Al Araar street, Sector 16, Hay Riyad, Rabat Phone : +212 (0) 5 37 57 66 41 Fax : +212 (0) 5 37 57 66 42 www.environnement.gov.ma Regional Observatory of Environment and Sustainable Development of the Oriental Region Adress : Siège du Conseil Régional, Bd, le Prince Héritier Moulay El Hassan , Oujda Phone : +212 (0) 5 36 52 48 70 SYNTHESIS REPORT FOR DECISION MAKERS Fax : +212 (0) 5 36 52 48 64 2013 Table of Contents THE ENVIRONMENTAL INTEGRATED ASSESSMENT, 06 01 A DECISION-MAKING TOOL 1.1 WHY THE NEED FOR A REGIONAL ENVIRONMENTAL INTEGRATED 06 ASSESSMENT? 1.2 A CONSULTATIVE AND PARTICIPATIVE APPROACH 06 A REGION WITH STRONG POTENTIAL, BUT WITH SIGNIFICANT 07 02 SOCIAL AND ENVIRONMENTAL ISSUES 2.1 A PREDOMINANTLY URBAN REGION 07 2.2 AN EMERGING ECONOMIC REGION 08 2.2.1 INDUSTRY 08 2.2.2 TRADING 09 2.2.3 AGRICULTURE AND LIVESTOCK 09 2.2.4 TOURISM 09 2.2.5 CRAFTMANSHIP 10 2.2.6 MINNING AND QUARRYING ACTIVITIES 10 2.2.7 SEA FISHING 11 2.2.8 TRANSPORTATION 11 03 ENVIRONMENTAL STATE AND TRENDS OF THE REGION 12 3.1 THE WORRYING FATE OF WATER RESSOURCES 12 3.1.1 QUANTITATIVE TERMS 12 3.1.2 QUALITATIVE TERMS 13 3.2 WASTEWATER SANITATION, AN ONGOING MANAGEMENT -

Cadastre Des Autorisations TPV Page 1 De
Cadastre des autorisations TPV N° N° DATE DE ORIGINE BENEFICIAIRE AUTORISATIO CATEGORIE SERIE ITINERAIRE POINT DEPART POINT DESTINATION DOSSIER SEANCE CT D'AGREMENT N Casablanca - Beni Mellal et retour par Ben Ahmed - Kouribga - Oued Les Héritiers de feu FATHI Mohamed et FATHI Casablanca Beni Mellal 1 V 161 27/04/2006 Transaction 2 A Zem - Boujad Kasbah Tadla Rabia Boujad Casablanca Lundi : Boujaad - Casablanca 1- Oujda - Ahfir - Berkane - Saf Saf - Mellilia Mellilia 2- Oujda - Les Mines de Sidi Sidi Boubker 13 V Les Héritiers de feu MOUMEN Hadj Hmida 902 18/09/2003 Succession 2 A Oujda Boubker Saidia 3- Oujda La plage de Saidia Nador 4- Oujda - Nador 19 V MM. EL IDRISSI Omar et Driss 868 06/07/2005 Transaction 2 et 3 B Casablanca - Souks Casablanca 23 V M. EL HADAD Brahim Ben Mohamed 517 03/07/1974 Succession 2 et 3 A Safi - Souks Safi Mme. Khaddouj Bent Salah 2/24, SALEK Mina 26 V 8/24, et SALEK Jamal Eddine 2/24, EL 55 08/06/1983 Transaction 2 A Casablanca - Settat Casablanca Settat MOUTTAKI Bouchaib et Mustapha 12/24 29 V MM. Les Héritiers de feu EL KAICH Abdelkrim 173 16/02/1988 Succession 3 A Casablanca - Souks Casablanca Fès - Meknès Meknès - Mernissa Meknès - Ghafsai Aouicha Bent Mohamed - LAMBRABET née Fès 30 V 219 27/07/1995 Attribution 2 A Meknès - Sefrou Meknès LABBACI Fatiha et LABBACI Yamina Meknès Meknès - Taza Meknès - Tétouan Meknès - Oujda 31 V M. EL HILALI Abdelahak Ben Mohamed 136 19/09/1972 Attribution A Casablanca - Souks Casablanca 31 V M. -

Eindhoven University of Technology MASTER Sun, Sea, Leisure, And
Eindhoven University of Technology MASTER Sun, sea, leisure, and energy the knowledge of experts used for the decison making of renewable energies in urban development areas in the North-Eastern part of Morocco, using AHP Chaïbi, U. Award date: 2015 Link to publication Disclaimer This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required minimum study period may vary in duration. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain SUN, SEA, LEISURE, AND ENERGY The knowledge of experts used for the decision making of renewable energies in urban development areas in the North-Eastern part of Morocco, using AHP. Colophon Final presentation date June 8th, 2015 Personal information Name U. (Uasima) Chaïbi Student number s098250 E‐mail Address [email protected] Telephone number +31 6 16 817 112 Graduation committee Prof. -

Inventory of Municipal Wastewater Treatment Plants of Coastal Mediterranean Cities with More Than 2,000 Inhabitants (2010)
UNEP(DEPI)/MED WG.357/Inf.7 29 March 2011 ENGLISH MEDITERRANEAN ACTION PLAN Meeting of MED POL Focal Points Rhodes (Greece), 25-27 May 2011 INVENTORY OF MUNICIPAL WASTEWATER TREATMENT PLANTS OF COASTAL MEDITERRANEAN CITIES WITH MORE THAN 2,000 INHABITANTS (2010) In cooperation with WHO UNEP/MAP Athens, 2011 TABLE OF CONTENTS PREFACE .........................................................................................................................1 PART I .........................................................................................................................3 1. ABOUT THE STUDY ..............................................................................................3 1.1 Historical Background of the Study..................................................................3 1.2 Report on the Municipal Wastewater Treatment Plants in the Mediterranean Coastal Cities: Methodology and Procedures .........................4 2. MUNICIPAL WASTEWATER IN THE MEDITERRANEAN ....................................6 2.1 Characteristics of Municipal Wastewater in the Mediterranean.......................6 2.2 Impact of Wastewater Discharges to the Marine Environment........................6 2.3 Municipal Wasteater Treatment.......................................................................9 3. RESULTS ACHIEVED ............................................................................................12 3.1 Brief Summary of Data Collection – Constraints and Assumptions.................12 3.2 General Considerations on the Contents -

Pauvrete, Developpement Humain
ROYAUME DU MAROC HAUT COMMISSARIAT AU PLAN PAUVRETE, DEVELOPPEMENT HUMAIN ET DEVELOPPEMENT SOCIAL AU MAROC Données cartographiques et statistiques Septembre 2004 Remerciements La présente cartographie de la pauvreté, du développement humain et du développement social est le résultat d’un travail d’équipe. Elle a été élaborée par un groupe de spécialistes du Haut Commissariat au Plan (Observatoire des conditions de vie de la population), formé de Mme Ikira D . (Statisticienne) et MM. Douidich M. (Statisticien-économiste), Ezzrari J. (Economiste), Nekrache H. (Statisticien- démographe) et Soudi K. (Statisticien-démographe). Qu’ils en soient vivement remerciés. Mes remerciements vont aussi à MM. Benkasmi M. et Teto A. d’avoir participé aux travaux préparatoires de cette étude, et à Mr Peter Lanjouw, fondateur de la cartographie de la pauvreté, d’avoir été en contact permanent avec l’ensemble de ces spécialistes. SOMMAIRE Ahmed LAHLIMI ALAMI Haut Commissaire au Plan 2 SOMMAIRE Page Partie I : PRESENTATION GENERALE I. Approche de la pauvreté, de la vulnérabilité et de l’inégalité 1.1. Concepts et mesures 1.2. Indicateurs de la pauvreté et de la vulnérabilité au Maroc II. Objectifs et consistance des indices communaux de développement humain et de développement social 2.1. Objectifs 2.2. Consistance et mesure de l’indice communal de développement humain 2.3. Consistance et mesure de l’indice communal de développement social III. Cartographie de la pauvreté, du développement humain et du développement social IV. Niveaux et évolution de la pauvreté, du développement humain et du développement social 4.1. Niveaux et évolution de la pauvreté 4.2. -

Zoned Sulphur Isotope Signatures at the Mississippi Valley-Type Touissit
In: C.J. Stanley et al. (eds. 1999), Mineral deposits: processes to processing, Balkema, Amsterdam, p. 821-824. Zoned sulphur isotope signatures at the Mississippi Valley-type Touissit - Bou Beker - El Abed District (Morocco-Algeria) - Evidence for thermochemical sulphate reduction and mixing of sulphur sources M. Bouabdellah*, L. Fontboté, Y. Haeberlin & L. Llinares Département de Minéralogie, Université de Genève, Switzerland *presently: Laboratoire de Pétrologie, Minéralogie et Géologie Economique, B.P 524 Oujda 60000, Morocco D. Leach United States Geological Survey, P.O. Box 25046 Federal Center, Denver, Colorado 80225, USA J. Spangenberg Institut de Minéralogie et Pétrographie, Université de Lausanne, Switzerland ABSTRACT: In the Touissit - Bou Beker - El Abed MVT district the distribution of d34S values of the main stage mineralization can be essentially interpreted as the result of mixing between a heavy and a light d34S reservoir. The results suggest that thermochemical reduction of Triassic sulphate and, possibly, pyrites dis- seminated in the sedimentary sequence (and/or leaching of basement sulphides) constitute the sources of the two sulphur types. A zonation with d34S values for main stage sphalerite and galena increasing systematically eastwards has been recognized at the district scale. Temperatures calculated from coexisting sphalerite-galena pairs range from 70 ºC to 135 ºC and are in good agreement with geological and fluid inclusion data. 1 INTRODUCTION Horsts’ within the Meseto-Atlasic domain of north- eastern Morocco and adjacent Algeria (Fig.1). The In the northeastern part of Morocco and adjacent TBE district represents one of the world’s great Algeria occurs probably the largest Mississippi Pb/Zn concentrations in carbonate strata and pro- Valley-type (MVT) district documented in Africa duced between 1926 and 1997 about 67 million met- known as the Touissit - Bou Beker - El Abed (TBE) ric tons of ore averaging 7 % Pb and 3 % Zn. -
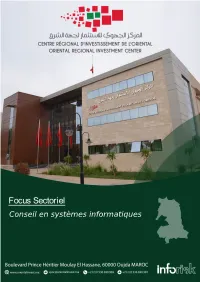
Conseil En Systèmes Informatiques 2 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ
Conseil en systèmes informatiques 2 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ NOMBRE TOTAL D'ENTREPRISES (ACTIVES/ CRÉATIONS ANNUELLES INACTIVES) Année Maroc Orientale Nombre d’entreprises Maroc Orientale 2015 1 254 39 Global 16 679 523 2016 1 297 31 Statut actif 14 433 395 2017 1 215 29 Statut non actif 2 246 128 2018 1 404 43 2019 1 491 50 2020 799 22 128 Entreprises Inactives Maroc 1254 395 799 Entreprises Actives Oriental 39 22 2015 2016 2017 2018 2019 2020 RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES DE LA RÉGION L'ORIENTAL Province Ville Entreprises Berkane 41 Berkane Ahfir (M) 2 Berkane Aklim (M) 1 (4) Driouch (147) Nador (41) Berkane Berkane (M) 39 Berkane (305) Berkane Saidia (M) 2 Oujda Driouch 4 Driouch Driouch 4 (13) (5) Guercif Taourirt (6) Figuig 5 Jerada Figuig Bouarfa (M) 5 Guercif 13 Guercif Guercif (M) 13 Jerada 6 Jerada Bni Mathar 1 (5) Jerada Jerada (M) 5 Figuig Nador 147 Nador Al Aaroui (M) 2 Nador Bni Ansar (M) 5 Nador Hassi Berkane 1 Nador Ihaddadene 1 Nador Nador (M) 132 Nador Selouane 5 Nador Zaio (M) 4 Nador Zeghanghane (M) 3 Oujda-Angad 305 Oujda-Angad Oujda (M) 309 Oujda-Angad Sidi Moussa Lemhaya 1 Taourirt 5 Taourirt Taourirt (M) 6 3 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ 21.81 MMDH 7.61% 22.24% Maroc total chiffre d'affaires évolution chiffre d'affaires part des transferts étranger dans le CA Région 67.09 MDH 67.04% 31.06% total chiffre d'affaires évolution chiffre d'affaires part des transferts étranger Orientale dans le CA RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE LA RÉGION ORIENTALE CHIFFRE D'AFFAIRES ÂGE < à 5Mdh 5 à 100 Mdh > à 100Mdh < 2 ans 2 -

Construction.Pdf
Construction 2 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ NOMBRE TOTAL D'ENTREPRISES (ACTIVES/ CRÉATIONS ANNUELLES INACTIVES) Année Maroc Orientale Nombre d’entreprises Maroc Orientale 2015 7 714 419 Global 119 007 7 119 2016 8 445 430 Statut actif 107 880 5 923 2017 8 196 391 Statut non actif 11 127 1 196 2018 9 585 435 2019 10 279 459 2020 6 616 336 1196 Entreprises Inactives Maroc 7714 6616 5923 Entreprises Actives Oriental 419 336 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES DE LA RÉGION L'ORIENTAL Province Ville Entreprises Berkane 757 Berkane Ahfir (M) 40 Berkane Aklim (M) 12 Berkane Berkane (M) 616 Berkane Boughriba 1 Berkane Chouihia 1 Berkane Fezouane 2 Berkane Laatamna 11 Berkane Madagh 18 Berkane Saidia (M) 71 Berkane Sidi Bouhria 1 Berkane Sidi Slimane Echcharraa (M) 6 Berkane Tafoughalt 1 Berkane Zegzel 5 Driouch 103 Driouch Ain Zohra 2 Driouch Azlaf 1 Driouch Ben Taieb 3 Driouch Dar El Kebdani 1 Driouch Driouch 80 Driouch Midar 8 Driouch Tafersit 1 Driouch Temsamane 6 Driouch Tsaft 1 Figuig 208 Figuig Bni Guil 3 Figuig Bni Tadjite 22 Figuig Bouanane 7 Figuig Bouarfa (M) 111 Figuig Figuig (M) 41 Figuig Talsint 22 Figuig Tendrara 3 Guercif 343 Guercif Guercif (M) 326 Guercif Houara Oulad Raho 4 Guercif Lamrija 2 Guercif Mazguitam 2 Guercif Ras Laksar 3 Guercif Saka 1 Guercif Taddart 8 Jerada 206 Jerada Ain Bni Mathar (M) 20 Jerada Gafait 4 Jerada Guenfouda 5 Jerada Jerada (M) 170 Jerada Lebkhata 1 Jerada Mrija 1 Jerada Touissit (M) 5 Nador 1 838 Nador Afsou 1 Nador Al Aaroui (M) -

Télécharger Le Document
CARTOGRAPHIE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL MULTIDIMENSIONNEL NIVEAU ET DÉFICITS www.ondh.ma SOMMAIRE Résumé 6 Présentation 7 1. Approche méthodologique 8 1.1. Portée et lecture de l’IDLM 8 1.2. Fiabilité de l’IDLM 9 2. Développement, niveaux et sources de déficit 10 2.1. Cartographie du développement régional 11 2.2. Cartographie du développement provincial 13 2.3. Développement communal, état de lieux et disparité 16 3. L’IDLM, un outil de ciblage des programmes sociaux 19 3.1 Causes du déficit en développement, l’éducation et le niveau de vie en tête 20 3.2. Profil des communes à développement local faible 24 Conclusion 26 Annexes 27 Annexe 1 : Fiabilité de l’indice de développement local multidimensionnel (IDLM) 29 Annexe 2 : Consistance et méthode de calcul de l’indice de développement local 30 multidimensionnel Annexe 3 : Cartographie des niveaux de développement local 35 Annexes Communal 38 Cartographie du développement communal-2014 41 5 RÉSUMÉ La résorption ciblée des déficits socio-économiques à l’échelle locale (province et commune) requiert, à l’instar de l’intégration et la cohésion des territoires, le recours à une cartographie du développement au sens multidimensionnel du terme, conjuguée à celle des causes structurelles de son éventuel retard. Cette étude livre à cet effet une cartographie communale du développement et de ses sources assimilées à l’éducation, la santé, le niveau de vie, l’activité économique, l’habitat et les services sociaux, à partir de la base de données «Indicateurs du RGPH 2014» (HCP, 2017). Cette cartographie du développement et de ses dimensions montre clairement que : - La pauvreté matérielle voire monétaire est certes associée au développement humain, mais elle ne permet pas, à elle seule, d’identifier les communes sous l’emprise d’autres facettes de pauvreté. -

Diapositiva 1
Table de matière Présentation du projet ACCMA Les scénarios d’émission du GIEC Milieu biophysique du Littoral Méditerranéen Oriental L’élévation du niveau de la mer et les événements (LMO) climatiques extrêmes Analyse et cartographie de la végétation dans les Downscaling des scénarios du GIEC au niveau de Littoral communes rurales de Beni Chiker et de Boudinar Méditerranéen Oriental Analyse et cartographie de la végétation dans le Modélisation météomarine pourtour de la lagune de Nador Analyse et cartographie de la végétation dans le Erosion côtière au niveau de la lagune de Nador et de littoral de Saidia-Ras El Ma Saidia Milieu socioéconomique du Littoral Méditerranéen Vulnérabilité des écosystèmes du LMO { l’Elévation du Oriental (LMO) Niveau de la Mer Milieu socioéconomique de la commune rurale de Beni Vulnérabilité de la végétation du littoral Saidia-Ras El Ma Chiker { l’élévation de niveau de la mer Milieu socioéconomique de la commune rurale de Vulnérabilité de la végétation de Sebkha Bouareg à Boudinar l’élévation du niveau de la mer Milieu socioéconomique des communes du pourtour Vulnérabilité socioéconomique du littoral de la lagune de de la lagune de Nador Nador et de la commune rurale de Beni Chiker à l’élévation du niveau de la mer Milieu socioéconomique du littoral Saidia-Ras El Ma Vulnérabilité socioéconomique du littoral de Saidia-Ras El Ma et de la commune rurale de Boudinar { l’élévation du niveau de la mer Aspects socio-économique de la pêche artisanale dans Vulnérabilité des communes rurales de Boudinar et de le littoral