Accompagnateur Moyenne Montagne
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
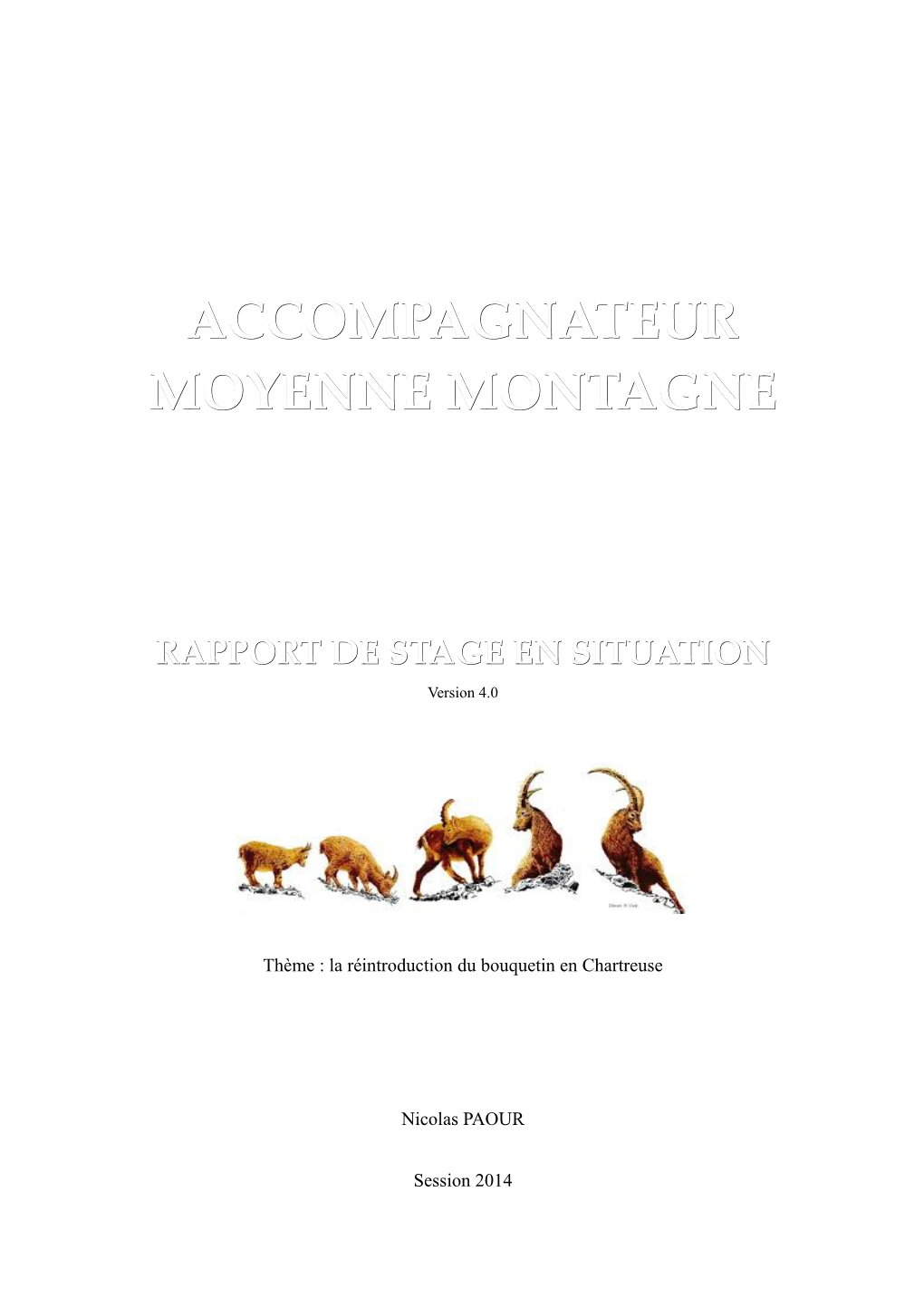
Load more
Recommended publications
-

Marc JOUBERT Né Le 14 Juillet 1927 Guide De Haute Montagne À Rive De Gier 42
MJMAMONTAGNE.doc MA MONTAGNE CRE 2001 / MAJ 18072015 Marc JOUBERT Né le 14 juillet 1927 Guide de Haute Montagne à Rive de Gier 42 Pourquoi j’aime gravir les sommets ! <><> 31/05/19 110 1 MJMAMONTAGNE.doc MA MONTAGNE CRE 2001 / MAJ 18072015 Pour mes enfants et mes petits enfants, et mes ami(e)s de la montagne. SOMMAIRE Chapitre I : Comment j’ai eu la révélation du rocher ? (Le déclic !). Chapitre II : Mon armée aux Chasseurs Alpins. (Les camarades, l’Autriche, les manœuvres …). Chapitre III : Mon Brevet de Guide de Haute Montagne. Chapitre IV : Description de quelques-unes de mes plus belles courses. (La Bérarde, le Chardonnet, la Traversée Nonne-Evêque, le Dru face ouest, L’arête sud de la Noire, le tour du Mont Blanc, …). Chapitre V : Le ski de raid. (Chamonix-Zermatt…) Chapitre VI : Randonnées pédestres. (Les Calanques…) Chapitre VII : Expéditions à l’étranger. <><> 31/05/19 110 2 MJMAMONTAGNE.doc MA MONTAGNE CRE 2001 / MAJ 18072015 Marc JOUBERT Guide de Haute Montagne Chapitre I : COMMENT J’AI EU LA REVELATION DU ROCHER ? <><> 31/05/19 110 3 MJMAMONTAGNE.doc MA MONTAGNE CRE 2001 / MAJ 18072015 MA DECOUVERTE DE LA MONTAGNE. Je me souviens, c’était en 1943 que j’ai connu l’escalade dans la carrière du Mouillon à RIVE DE GIER. J’avais 16 ans. C’était un amoncellement de blocs de grès qui ont écorché pas mal mes genoux. Une corde, qui était plus une corde à faire des bottes de foin, que j’avais achetée chez le quincaillier du coin, a été mon premier accessoire de grimpeur avec des espadrilles de corde. -

Hôtel Des Ventes Henri ADAM Commissaire-Priseur Habilité - Agrément 2002200 Du 23-05-02
Hôtel des Ventes Henri ADAM Commissaire-priseur habilité - Agrément 2002200 du 23-05-02 22 Rue du Docteur Roux 65000 TARBES Tél. : 05 62 36 19 85 * Internet : www.interencheres.com/65001 Fax : 05 62 36 18 27 * e-mail : [email protected] Samedi 25 mars 2017 14h30 (Vente en Live) PYRÉNÉISME PYRÉNÉES de FRANCE et d’ESPAGNE (5 des XX plus rares - Andorre - Catalogne) AUDE - ROUSSILLON - ALPES Nombreux lots Hors Catalogue en Fin de Vente EXPOSITIONS PUBLIQUES Vendredi 24 mars de 14h30 à 18h30 Samedi matin de la vente 9h15-12h00 Assisté par l’Expert Michel CONVERT B.P. 55 - 64270 Salies de Béarn Tél. : 06 30 36 96 13 - [email protected] 2 Sommaire ○ Pyrénéisme (n°1 à 114) Arlaud (4) - Beraldi (10 à 14) - Brulle (24) - Chaussenque (33) - Franqueville (41) - Frossard (42) Moreau (63) - Parrot (66) - Ramond (69 à75) - Russell (80 à 102) - Shrader (104 à 109) - Tonnellé (111) ○ Divers Pyrénées (n°115 à 130) ○ Andorre - Ariège - Pyrénées de l'Est - Aude - Roussillon (n°131 à 155) Boucoiran (135) - Ducup de Saint Paul (140 à 144) - Gourdon (148) ○ Livres en anglais sur les Pyrénées et les Alpes (n°156 à 170) Hardy (163), Murray (164),Packe (165), Russell (166) ○ Massif Alpestre et Vosges (n°171 à 197) Saussure (190 et 191), Simler (193), Osenbrüggen (187) 3 PYRÉNÉISME photographiques) - 1 grand cliché portrait d'Arlaud avec son bonnet de sherpa (Himalaya, 1936) signé M. Grillet (reproduit inversé au revers du titre du tome 1) - B/ (tome II) : - 1 lettre de 2 1 - [ABADIE (Arnaud)] pages dactylographiées adressée à Roger Parant établissant le Itinéraire Topographique et Historique des Hautes- bilan des frais et ventes des "Carnets" (signée de Jean Prunet et de Pyrénées, principalement des Etablissemens Thermaux A. -

Studijní Texty K Předmětu Geografie Francie
Jozef Mečiar STUDIJNÍ TEXTY K PŘEDMĚTU GEOGRAFIE FRANCIE Masarykova univerzita Brno, 2014 ANOTACE Následující text je určen jako studijní podpora předmětu Geografie Francie. Je určen nejen studentům, ovládající francouzský jazyk. Při své značné podrobnosti je text graficky strukturován tak, aby umožnil i méně podrobné studium. Jednotlivé kapitoly jsou postupně doplňovány podle tzv. hettnerova schématu, tj. jednotlivé přírodní a sociální geosféry Francie jsou pojednávány z hlediska územní diferenciace a integrace zhruba v tom pořadí, jak se postupně vyvíjely na naší planetě. Materiál není definitivní, ale umožňuje neustálou aktualizaci, modifikaci a doplňování adekvátně rozpracovanosti předmětu a zpětné vazbě z výuky a potřeb praxe. (Perspektivně má na něj navázat i studijní text, související s předmětem Geografie frankofonních zemí.) Cílem studijního materiálu je, aby si student na základě všeobecného poznání a pochopení geografie Francie osvojil schopnost samostatného cíleného získávání nových konkrétních poznatků o probírané oblasti a schopnost syntézy těchto poznatků v komplexním rámci vývojové souvztažnosti dílčích geografických sfér – s důrazem na problém aplikace v hospodářské a společenské aktivitě nejen z hlediska individuální úspěšnosti, ale i z hlediska celospolečenského. Z tohoto důvodu je v podrobnějším textu časté porovnávání s Českou republikou, různé analogie a možnosti vzájemné spolupráce s Francií. 10 KLÍČOVÝCH SLOV Francie, geografie příroda obyvatelstvo ekonomika společnost kultura politika historie regiony AKTUÁLNÍ -

Klettersteige
Eugen E. Hüsler Klettersteige Alle Klettersteige der Südalpen 11 Törlkopfsteig 35 8 Planjava 56 Inhalt 12 Mürztaler Steig 35 9 Turska gora 57 13 Friedrichskopf-Steig 36 10 Rinke 57 14 Alpinsteig 36 11 Mrzla gora 58 15 Wangenitzsee-Steig 37 12 Skuta 58 Himmelsleitern 11 16 Glödis-Klettersteig 37 13 Vellacher Turm 58 Einführung 13 17 Schleinitz-Klettersteig 37 14 Kranjska koca 59 »Eiserne Historie« 13 18 Blauspitz-Klettersteig 38 15 Velika Baba 59 Sicher ist sicher - die Ausrüstung 15 19 Saazerweg 38 16 Ceska koca - Kranjska koca 60 Klettersteigsets 15 20 Kristallwand-Steig 39 17 Jezerska Kocna 61 Anseilgurte 17 21 Türml-Nordgrat 39 18 Grintovec 61 Alpine und andere Gefahren 19 22 Klettersteig Wilde Wasser 39 19 Kokroska Kocna 61 Eine Vier-Klassen-»Gesellschaft« 22 23 Rote Säule 40 20 Kaiski greben 62 Objektiv - subjektiv 22 24 Kreuzspitze 41 21 Konj 62 Die objektiven Anforderungen 24 25 Roßhornscharte 41 22 Stegovnik 63 Hüslers Klettersteigkreuz (HKK) 24 26 BGV-Klettersteig 41 23 »Durch den Schlund« 63 Die Hüsler-Schwierigkeitsskala 26 27 Extrem-Klettersteig 41 24 Psica-Steig 63 Zur Erläuterung 27 28 Touristensteig 42 25 Pogacnik-Klettersteig 64 29 Norbert-Schluga-Steig 42 26 Krainer Steig 64 30 Reißkofel 42 27 ÖTK-Steig 64 Der Südosten Österreichs 29 31 Pirknerklamm-Steig 43 28 Koschuta-Kammweg 65 1 Lukas-Max-Klettersteig 30 32 Kofiwand-Klettersteig 43 29 Lärchenturm-Klettersteig 65 2 Predigtstuhl 30 33 Zabarot-Jägersteig 43 30 Hochturm 66 3 Mosermandl 31 34 Hochstadel 44 31 Loibler Baba 66 4 Falken-Klettersteig 31 35 Kranewitsteig 44 -

Feuille1 Page 1
Feuille1 RANDO LIEU MASSIF DÉPART / RÉG MÉT DATE ANNÉE 2017 LA BALME CHARETTE PARMILLIEU Lagnieu ISÈRE / NORD S 19/03/17 LA MONTAGNE DE PARVES Massigneu de Rives MONT TOURNIER AIN / BUGEY S 26/03/17 MEILLONAS Meillonas REVERMONT AIN / JURA P 02/04/17 LE CIRCUIT DES ÉCUREUILS Le Poizat JURA AIN / JURA S 09/04/17 LES COLLINES DE LA DRÔME Erôme VALLÉE DU RHÔNE DRÔME S 17/04/17 AUTOUR DE FORT L'ÉCLUSE Léaz JURA AIN / JURA S 23/04/17 LES CINQ TERRES (Week End) RIVIERA ITALIENNE ITALIE / LIGURIE P 29/04-05/05-17 LE LAC GENIN Oyonnax JURA AIN / Ht BUGEY F 08/05/17 LES SENTIERS DU VAL DE BUENC Hautecourt BRESSE REVERMONT AIN / BUGEY S 14/05/17 1 MASSIF des MAURES l (Week End) Lalonde les Maures MASSIF des MAURES VAR S 20/21//05/2017 2 SENTIER du LITTORAL P CHARVIEUX - CALVAIRE DE PORTE Ordonnaz JURA AIN / BUGEY s 28/05/17 LA PRAILLE Hauteville JURA AIN / BUGEY S 05/06/17 SERRE COCU St André en Royan MASSIF DU VERCORS ISÈRE S 25/06/17 LA POiNTE DE CHAURIONDE Pont en Royan MASSIF DES BAUGES SAVOIE S 02/07/17 LE GRAND COLOMBIER (Tour de Fce) JURA AIN / BUGEY S 09/07/17 LE LAC DE LA PLAGNE Peissey Nancrois VANOISE SAVOIE S 23/07/17 LE GRAND CROISSE BAULET La Giettaz CHAîNE des ARAVIS Hte SAVOIE P 30/07/17 LE PETIT CROISSE BAULET LES VAURIENS Vaux en Bugey JURA AIN / JURA S 06/08/17 LA POINTE DE TALAMARCHE CHAîNE des ARAVIS Hte SAVOIE S 13/08/17 REFUGE DE LARRIEUX Montremont COL DE LA PORTETTE Praz Couttant CHAÎNE DES FIZ Hte SAVOIE Nu/S 20/08/17 DÉSERT DE PLATÉ MASSIF DU GIFFRE LE MONT THABOR (Week End) Valfrejus (le Lavoir) MASSIF DES CERCES SAVOIE S 26-27/08/17 VALLÉE de LA CLARÉE (Week End) Névache VALLÉE DE LA CLARÉE Htes ALPES S 02-03/09/17 LE MONT TRÉLOD (a) Doucy (Les Cornes) LES BAUGES SAVOIE P 10/09/17 LA MONTAGNE DE SULENS Plan Bois MASSIF des BORNES Hte SAVOIE Nu 17/09/17 LE RALLYE DU BUIZIN Le Vorgey JURA AIN / BUGEY S 24/09/17 UNE BALLADE A COISIA Coisia park. -

1. Country, Author, Title 2. Theme 3. Accepted Serbia 4. Accepted
1. Country, author, title Dickson Ken : Punk Rocker D x Pascoe Keith R : Paris Approaching Storm A x Pichler Thomas : Safari with a difference A x x 2. Theme Foster Neville H W : Soldierbird Feeding 7259 D x x Pascoe Keith R : Dressing Up B x Pichler Thomas : Shocked A x x x x 3. Accepted Serbia Foster Neville H W : Spring Is On The Way 5930 D x x Pascoe Keith R : Give me a Sign B x Pichler Thomas : Enchanted B x x 4. Accepted Russia Foster Neville H W : Taking Off 0370 D x Pascoe Keith R : Harpist B x Pichler Thomas : Painful B x 5. Accepted South Africa Gillie Mark : An apple a day A x x Pascoe Keith R : Alaskan Mountains C x Pichler Thomas : Flying C x 6. Accepted Austria Gillie Mark : Dog vs Drone A x Pascoe Keith R : Mountain Hideaway C x x Pichler Thomas : My Booty D x 1 2 3 4 5 6 Gillie Mark : Flower and water A x x x Pascoe Keith R : Swiss Mountain Lake C x x x Pichler Thomas : Pelican D x Argentina A x x x x Gillie Mark : Perth Skyshow A x x Pascoe Keith R : Figuring it Out D x Stuefler Wolfgang : Beauty A x x Muller Hans : Cabellera de fuego Gillie Mark : Peak hour traffic B x x Pascoe Keith R : Togetherness D x Stuefler Wolfgang : Glamorous A x Muller Hans : Encuentro de amor A x x x x Gillie Mark : Racing through the rapids B x x Sharples Jan : Posed and painted A x Stuefler Wolfgang : Maria A x Muller Hans : La nostalgia de la abuela A x Gillie Mark : See you on the dark side B x x Sharples Jan : El Chaten C x x Stuefler Wolfgang : Sandra A x Muller Hans : Vieja estacion A x x x Gillie Mark : Cecil D x x x x Sharples Jan -

Programme Numéro
Programme Numéro 59 Association loi 1901 BP 8403 69359 LYON CEDEX 08 [email protected] SMS / Téléphone : 06 24 79 94 58 de 20h à 22h Site Internet : www.randos-rhone-alpes.org Date Type Région Titre Niveau er Dimanche 1 mai Rando Savoie Le Mont Clergeon Très Difficile Dimanche 8 mai Rando Chartreuse Dôme de Bellefont et source de Guiers Très Difficile Vendredi 13 mai au Week-end Rando Lozère Week-end Pentecôte Très Difficile lundi 16 mai Dimanche 15 mai Rando Devoluy Le Châtel Difficile Samedi 21 mai Rando Belledone Le Lac Achard Moyen Dimanche 22 mai Rando Bugey Les hauts de Lhuis Difficile Dimanche 29 mai Rando Massif des Bauges Le Mont Revard Difficile Rando Taillefer Grande boucle du Taillefer Très Difficile Dimanche 5 juin Rando Vercors But Saint-Genix Moyen Dimanche 12 juin Rando Vercors Tour et ascension du Grand Veymont Très Difficile Dimanche 19 juin Rando Drôme des collines Un patrimoine religieux et historique Moyen Rando Vercors Le Roc Cornafion Difficile Dimanche 26 Juin Rando Chartreuse Nord Lac d'Aiguebelette et Mont l'Epine Moyen Samedi 02 juillet Rando Rhône Quartier de la Confluence et de Gerland Moyen Dimanche 3 juillet Rando Ecrins Vallon de la Selle Très Difficile Rando Monts du Forez Marols Difficile Dimanche 10 juillet Rando Chartreuse Chamechaude par le "Jardin" Très Difficile Jeudi 14 juillet Rando Les Ecrins Le Neyrard Très Difficile Samedi juillet 16 au Week-end Rando Les Ecrins Entre Ecrins et Combeynot Très Difficile dimanche 17 juillet Dimanche 17 juillet Rando Vallée de l'Ain Boucle Merpuis -
Monographische Studien Über Die Gattung Saxifraga
© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at ^ 3-3» DUPLICATA DE LA BD3LIOTHEQtTE DU CONSERVATOIRE BOTANTQUE DE GENE Dr. A. v. Hayek. vendu en 1922 MONOGRAPHISCHE STUDIEN ÜBER DIE GATTUNG SAXIFRAGA I. DIE SEKTION PORPHYRION tausch. VON Med. et Phil. Dr. AUGUST v. HAYEK. Mit 2 Tafeln und 2 Karten. BESONDERS ABGEDRUCKT AUS DEM LXXVII. BANDE DER DENKSCHRIFTEN DER MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHEN KLASSE DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. WIEN 1905. AUS DER KAISERLICH-KÖNIGLICHEN HOF- UND STAATSDRUCKEREI. IN KOMMISSION BEI ALFRED HOLDER BUCHHÄNDLER DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER mSSONSOHAETEN WIEN, I., Rntenturmstrrulo 18. © Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at © Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at MONOGRAPHISCHE STUDIEN ÜBER DIE GATTUNG SAXIFRAGA I. DIE SEKTION PORPHYRION tausch. von Med. et Phil. Dr. AUGUST v. HAYEK. Mit 2 Tafeln %md 2 Karten. BESONDERS ABGEDRUCKT AUS DEM LXXVII. BANDE DER DENKSCHRIFTEN DER MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHEN KLASSE DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. NEW \0'.'K ROTANtCAl, WIEN 1905. AUS DER KAISERLICH-KÖNIGLICHEN HOF- UND STAATSDRUCKEREI. IN KOMMISSION BEI ALFRED HOLDER BUCHHÄNDLER I)ER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN WIEN, I., Rotunturinstraßa IS. © Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at #3? © Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at r u MONOGRAPHISCHE STUDIEN ÜBER DIE GATTUNG SAXIFRAGA I. DIE SEKTION PORPHYRION tausch. VON Med. et Phil. D^ AUGUST v. HAYEK. Mit 2 Tafeln und 2 Karten. VORGELEGT IN DER SITZUNG AM 15. DEZEMBER 1904. - Einleitung . Die Veranlassung zu nachfolgender Arbeit war eine ganz zufällige. Im Sommer des Jahres 1901 sammelte ich nämlich in den Alpen Obersteiermarks zwei Saxifragen aus der Sectio Porphyrion Tausch, welche auf den ersten Blick als zwei verschiedene Arten zu erkennen waren. -

Etude Tourisme
Le tourisme dans les espaces protégés alpins Recensement de l’infrastructure et de la fréquentation touristiques afin d’évaluer les retombées sur l’économie régionale Edité par Les dossiers du Réseau Alpin I dossiers della Rete Alpina Die Dossiers des Alpinen Netzwerks Dosjeji alpske mreže N°2 / 2000 Chargés d’étude : Doris Wiederwald, Mascha Chodziesner – Bonne Coordination : Dr. Thomas Scheurer, Dr. Guido Plassmann N°ISSN EN COURS 2 Réseau Alpin des Espaces Protégés Le tourisme dans les espaces protégés des Alpes – Recensement de l’infrastructure et de la fréquentation touristiques afin d’évaluer les retombées sur l’économie régionale RESUME L'objet de la présente étude se fonde sur un recensement des données concernant la fréquentation, l'offre et l'infrastructure touristiques ainsi que des données significatives pour l'économie régionale. Cette étude sur le thème du management touristique regroupe des informations de trente-cinq espaces protégés alpins. La première partie traite, de façon plus détaillée, de la problématique et des objectifs de cette étude. Dans la seconde partie, sont présentés à l'aide de fiches signalétiques : la situation géographique (supports cartographiques), les caractéristiques et les concentrations de visiteurs de chaque espace protégé ayant participé à cette enquête. En outre, la troisième et plus grande partie de cette enquête repose sur une analyse thématique. L'élaboration de ce document en quatre chapitres a permis une structuration synthétique des résultats. Ces derniers ont été commentés et illustrés à l'aide de cartes et diagrammes. Une série de corrélations et de typologies semblables, ainsi que des déficits de recensements de données ont ainsi pu être relevés. -

Hungary 1 2 3 4 5 Argentina Gustavo Herman
1 – Theme Laki Anagnostis, in mud B x x Marg Huxtable, down on the corner B x x x Keith Pascoe, 1 call of the wild A x 2 – Serbia Laki Anagnostis, the fiddler B x x x Marg Huxtable, blue hills C x Keith Pascoe, birds eye view C x 3 – Russia 1 2 3 4 5 4 - South Africa Laki Anagnostis, three directions D x x Marg Huxtable, hydrotherapy in the snow D x x x x Keith Pascoe, mountain monastery C x x 5 - Hungary John Chapman, bryce red hoodoos A x Marg Huxtable, double trouble D x x x Keith Pascoe, take away dinner 1 D x x x Argentina A x x John Chapman, tsenda peak C x x x Marg Huxtable, searching for prey D x x x Ian Robertson, aaargh A x x Gustavo Herman Schneider, india 175 Gustavo Herman Schneider, india 816 A x John Chapman, castor cloud C x x x x Marg Huxtable, i'm a wide mouthed frog D x x x x Ian Robertson, church in the mist A x Gustavo Herman Schneider, three brothers B x x x John Chapman, dragon massif C x x x Elizabeth Kodela, monument valley lone rider C x Ian Robertson, silvereye 209 B x Gustavo Herman Schneider, menonita 219 B x John Chapman, red mountain C x x Elizabeth Kodela, mt nemrut panorama C x x Ian Robertson, oast house B x Gustavo Herman Schneider, india 713 B x John Chapman, twisted garter snake D x Elizabeth Kodela, bighorn feeding D x x Ian Robertson, black rock B x Gustavo Herman Schneider, salt and silence 2 D x x Mark Charteris, waiting to live 2 A x Elizabeth Kodela, coyote in winter D x Ian Robertson, adventure bay gums B x x Gustavo Herman Schneider, the sounds of wind D x x x Mark Charteris, the look B x x -
De Noordelijke Franse Alpen
De Noordelijke Franse Alpen GG_Alpen-Noord_2014.indb 1 13-02-14 18:58 Vertaling Ido de Jonge en Karin Snoep Eindredactie Karin Evers Opmaak Jan Bos, Asterisk*, Amsterdam Omslagfoto Shutterstock – L F File Oorspronkelijke titel Alpes du Nord Oorspronkelijke uitgever Michelin, Parijs Uitgevers Anne Teffo (Michelin, Parijs) Lieven Defour (Lannoo, Tielt) Eindredactie Catherine Guégan Redactie Guylaine Idoux, Fabienne Darmostoupe, Laurence Michel, Christine Gil, Amaury de Valroger, Isabelle Bruno, Anath Klipper Grafisch ontwerp Christelle Le Déan Omslagontwerp Keppie&Keppie, Varsenare Cartografie Stéphane Anton, Michèle Cana, Anthony di Rocco Met dank aan Savoie Mont-Blanc Tourisme, Isère Tourisme, CDT Hautes-Alpes, Hélène Bouchoucha, Didier Broussard, Marion Desvignes-Cannone, Louise Druet, Maria Gaspar, Florence Picquot © Michelin, Nederlandse tekst Uitgeverij Lannoo, nv, Tielt, 2014 © Cartografie: Michelin Het redactieteam heeft de grootste zorg besteed aan de samenstelling en de controle van deze gids. Maar omdat de gegevens voortdurend gewijzigd worden, moet de praktische in- formatie (prijzen, adressen, bezoekuren, telefoonnummers, bezienswaardigheden, internet- adressen) worden beschouwd als een aanwijzing. Het is dan ook best mogelijk dat bepaalde info bij het verschijnen van deze gids niet helemaal correct of volledig is. Wij kunnen daar niet verantwoordelijk voor worden gesteld. Deze gids bestaat voor en door u; u bewijst ons dan ook een grote dienst door eventuele te- kortkomingen of vergissingen te melden. Aarzel niet om ons uw -

ALPBIONET2030 Integrative Alpine Wildlife and Habitat Management for the Next Generation
ALPBIONET2030 Integrative Alpine wildlife and habitat management for the next generation Super Strategic Connectivity Areas in and around the Alps Integrative Alpine wildlife and habitat management for the next generation The ´Super-SACA´ approach – very important areas for [ecological] connectivity in the Alps 1) Strategic Alpine Connectivity Areas - a basis for the Super SACA identification The ALPBIONET2030 project tried to bring together, analyse and combine a series of different indicators influencing ecological connectivity at different levels in order to illustrate the current situation of connectivity in the alpine and EUSALP territory and to elaborate, through a collection of the maps, a concrete foundation for planning a sustainable strategy of land use in the Alpine Space. The project integrated essential factors of such a strategy by defining Strategic Alpine Connectivity Areas (SACA) with an especially dedicated tool (JECAMI 2.0), evaluating wildlife management and human-nature conflict management aspects and generating recommendations. The extent of the project encompassed, for the first time in this thematic field, the whole area of the European Strategy of the Alpine Region (EUSALP). Map1: Strategic Alpine Connectivity Areas in the Alps and EUSALP 2 Integrative Alpine wildlife and habitat management for the next generation Map N°1 displays all three of the different types of Strategic Alpine Connectivity Areas at once. The map clearly illustrates that the Ecological Intervention Areas (EIA) constitute the largest percentage of the Strategic Alpine Connectivity Areas. The EIA act as linkages between Ecological Conservation Areas (ECA) as well as buffer zones. Looking at the Alpine and EUSALP picture, it appears that the ECA, mostly located in the higher Alpine areas, are, to a large extent, already benefiting from an existing protection measure (some category of protected area) and therefore need commitment to long term preservation of this status without any degradation of ecological functioning.