La Cuvette D'andapa (Madagascar)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
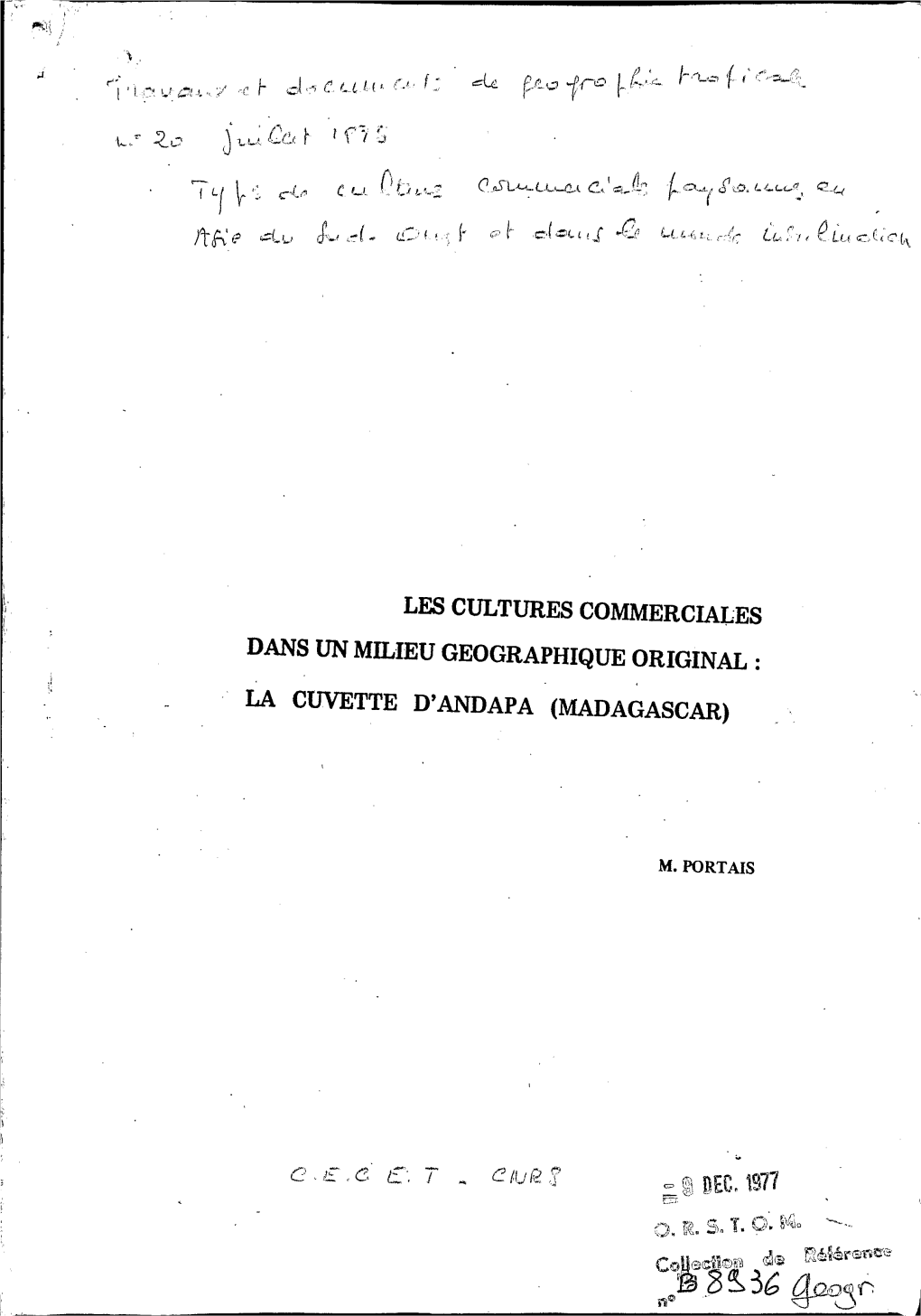
Load more
Recommended publications
-

Strengthening Protection of Marojejy National Park
SPECIAL POINTS DECEMBER 2016 OF INTEREST: Vol. 5, No. 2 ñ Workshop for Forest GuiDes ñ Brief but Meaningful Conservaton news from the Sambava-Andapa-Vohemar-Antalaha region of NE Madagascar ñ WorlD Lemur Festival Strengthening Protecton of Marojejy Natonal Park INSIDE THIS by Charlie Welch ISSUE: Earlier this year DLC- Strengthening Protec- 1 tion of Marojejy Na- SAVA was fortunate to tional Park receive a grant from Workshop for Forest 3 Save Our Species (SOS) Guides to increase the Brief but Meaningful 4 protecton of Marojejy Natonal Park, in World Lemur Festival 8 collaboraton with “Climate Change and 9 Madagascar Natonal Lemurs” Workshop Parks (MNP). The grant Environmental Educa- 12 supports clearly tion Teacher Training establishing and marking DLC-SAVA “Lamba” 13 the boundary with Now Available! metallic signs to prevent First CURSA Gradua- 14 both intentonal and unintentonal intrusion into the park. Although DLC-SAVA had already tion includes Sylvio sponsored delineaton of certain priority sectons of the park boundary, extensive areas in Exploring Human and 15 remote parts of Marojejy remained unmarked. There was no way for local people to know Environmental Health exactly where the boundary was supposed to be. Agricultural land ofen extends right up to in the SAVA Region the boundary around much of the park, and if Duke Engineers in 18 the limit is not clear, burning and cultvaton SAVA can actually extend into the park. A clear Closing Comments 20 boundary also discourages other illegal actvites in the park, such as wood collecton and huntng. Teams of local people, organized by MNP, installed the signs, which were made in Andapa. -

Ecosystem Profile Madagascar and Indian
ECOSYSTEM PROFILE MADAGASCAR AND INDIAN OCEAN ISLANDS FINAL VERSION DECEMBER 2014 This version of the Ecosystem Profile, based on the draft approved by the Donor Council of CEPF was finalized in December 2014 to include clearer maps and correct minor errors in Chapter 12 and Annexes Page i Prepared by: Conservation International - Madagascar Under the supervision of: Pierre Carret (CEPF) With technical support from: Moore Center for Science and Oceans - Conservation International Missouri Botanical Garden And support from the Regional Advisory Committee Léon Rajaobelina, Conservation International - Madagascar Richard Hughes, WWF – Western Indian Ocean Edmond Roger, Université d‘Antananarivo, Département de Biologie et Ecologie Végétales Christopher Holmes, WCS – Wildlife Conservation Society Steve Goodman, Vahatra Will Turner, Moore Center for Science and Oceans, Conservation International Ali Mohamed Soilihi, Point focal du FEM, Comores Xavier Luc Duval, Point focal du FEM, Maurice Maurice Loustau-Lalanne, Point focal du FEM, Seychelles Edmée Ralalaharisoa, Point focal du FEM, Madagascar Vikash Tatayah, Mauritian Wildlife Foundation Nirmal Jivan Shah, Nature Seychelles Andry Ralamboson Andriamanga, Alliance Voahary Gasy Idaroussi Hamadi, CNDD- Comores Luc Gigord - Conservatoire botanique du Mascarin, Réunion Claude-Anne Gauthier, Muséum National d‘Histoire Naturelle, Paris Jean-Paul Gaudechoux, Commission de l‘Océan Indien Drafted by the Ecosystem Profiling Team: Pierre Carret (CEPF) Harison Rabarison, Nirhy Rabibisoa, Setra Andriamanaitra, -

Universite D'antananarivo
UNIVERSITE D’ANTANANARIVO ECOLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE D’ANTANANARIVO DOMAINE : SCIENCE DE L’INGENIEUR Mention : Ingénierie Minière Mémoire de fin d’études pour l’obtention du diplôme de MASTER EN INGENIERIE MINIERE Parcours : Sciences et Techniques Minières Intitulé : Présenté par ANDRIANARIVONY Andoniaina Devant les membres du jury composés de : Président : Mr RANAIVOSON Léon Felix, Responsable de Mention Ingénierie Minière, ESPA Rapporteur : Mr RALAIMARO Joseph, Maître de Conférences, ESPA Examinateurs : Mr RAZAFINDRAKOTO Boni Gauthier, Maître de Conférences, ESPA Mr ANDRIAMBOAVONJY Mamy Rija, Enseignant-Chercheur, ESPA Le 09 Septembre 2016 Promotion : 2014-2015 UNIVERSITE D’ANTANANARIVO ECOLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE D’ANTANANARIVO DOMAINE : SCIENCE DE L’INGENIEUR Mention : Ingénierie Minière Mémoire de fin d’études pour l’obtention du diplôme de MASTER EN INGENIERIE MINIERE Parcours : Sciences et Techniques Minières Intitulé : Présenté par ANDRIANARIVONY Andoniaina Devant les membres du jury composés de : Président : Mr RANAIVOSON Léon Felix, Responsable de Mention Ingénierie Minière, ESPA Rapporteur : Mr RALAIMARO Joseph, Maître de Conférences, ESPA Examinateurs : Mr RAZAFINDRAKOTO Boni Gauthier, Maître de Conférences, ESPA Mr ANDRIAMBOAVONJY Mamy Rija, Enseignant-Chercheur, ESPA Le 09 Septembre 2016 Promotion : 2014-2015 REMERCIEMENTS Tout d’abord, je remercie Dieu tout puissant de m’avoir donné la santé et le courage durant la réalisation de ce mémoire. Grâce au soutien et à la collaboration de plusieurs personnes ressources, -

Boissiera 71
Taxonomic treatment of Abrahamia Randrian. & Lowry, a new genus of Anacardiaceae BOISSIERA from Madagascar Armand RANDRIANASOLO, Porter P. LOWRY II & George E. SCHATZ 71 BOISSIERA vol.71 Director Pierre-André Loizeau Editor-in-chief Martin W. Callmander Guest editor of Patrick Perret this volume Graphic Design Matthieu Berthod Author instructions for www.ville-ge.ch/cjb/publications_boissiera.php manuscript submissions Boissiera 71 was published on 27 December 2017 © CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES DE LA VILLE DE GENÈVE BOISSIERA Systematic Botany Monographs vol.71 Boissiera is indexed in: BIOSIS ® ISSN 0373-2975 / ISBN 978-2-8277-0087-5 Taxonomic treatment of Abrahamia Randrian. & Lowry, a new genus of Anacardiaceae from Madagascar Armand Randrianasolo Porter P. Lowry II George E. Schatz Addresses of the authors AR William L. Brown Center, Missouri Botanical Garden, P.O. Box 299, St. Louis, MO, 63166-0299, U.S.A. [email protected] PPL Africa and Madagascar Program, Missouri Botanical Garden, P.O. Box 299, St. Louis, MO, 63166-0299, U.S.A. Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité (ISYEB), UMR 7205, Centre national de la Recherche scientifique/Muséum national d’Histoire naturelle/École pratique des Hautes Etudes, Université Pierre et Marie Curie, Sorbonne Universités, C.P. 39, 57 rue Cuvier, 75231 Paris CEDEX 05, France. GES Africa and Madagascar Program, Missouri Botanical Garden, P.O. Box 299, St. Louis, MO, 63166-0299, U.S.A. Taxonomic treatment of Abrahamia (Anacardiaceae) 7 Abstract he Malagasy endemic genus Abrahamia Randrian. & Lowry (Anacardiaceae) is T described and a taxonomic revision is presented in which 34 species are recog- nized, including 19 that are described as new. -

Madagascar Cyclone Enawo
Ambilobe Vohemar ! ! MA002_1 Ambato ! Antindra ! Antsavokabe ! Amboahangibe ! ! Antindra Bealampona Ambohipoana ! Antsahabe II Bevonotra Amborangy ! Manambato Amboangibe ! Ampasimandroatra ! Antafiambe Ambalamahogo ! ANJIALAVABE ! Anahidrano MAROGAONA ! ! Mahadera ! ! ! Andapabe Andrembona Anjial!avabe Ambatoafo ! Ankiakabe Marogaona ! Antsakia Antanambao I Sambava ! Anjingo Andrembona ! Andantony Ambodiampana ! ! Antsahabetanimena ! Bekatseko ! Andrasaha Analamaho ! Sarahandrano Mangindrano ! Ambohimanarivo ! Ambohimitsinjo Tananambo Antongodriha ! ! Andrahanjo Anjialavahely ! ! Andranoroa ! Soahitra II ! Ambodizavy Andrahanjo Ambovonomby Doany! ! Antsahaberoaka Andranomilolo Ambalihabe ! Ambodimanga ! ! Analampontsy ! Befamatra ! ! DOANY ! Andratamarina Andatsakala ! Androfiabe ! Anjozoromadosy Antsahonjo ! Mandena ! Maroambihy Manantenina ! Antanimbaribe MAROAMBIHY ! ! Amboahangibe ! Ambohim!anarina Maroambihy II ! ! Ambalamanasy II ! Ambavala Antanamarina Ambinaninantsahabe ! ! Anjozoromadosy ! Andranomifototra ! Ambod!imanga II AMBALAMANASY II Ambatobe Ambodiampana ! Belambo ! Ambodivohitr!a ! ! Manakana Ambatoharanana Lokoho ! Maherivaratra ! ! Ankazotokana ! Andongona Marovato Betsakotsako ! Andasibe Bealanana Mazavahely Belaoka ! Tanambao ! Kobahina Andranotsara ! Lokoho Ambodiampana Andranotsara ! ! Antsahameloka Lokoho Belambo ! BETSAKOT! SAKO ! ! ! ! Ambodiala Ambalavoanio Antanambe ! Belaoka Andapa Lokoho ! AMBODIANGEZOKA Ambodimangasoa Ambodiangezoka Antanambaohely MAROVATO Ambahinkarabo ! ! Andranomena ! ! Ambodihasina ! -

Analyse Institutionnelle Et Contextuelle Des Structures Paysannes Dans La Filiere Vanille
ANALYSE INSTITUTIONNELLE ET CONTEXTUELLE DES STRUCTURES PAYSANNES DANS LA FILIERE VANILLE PROJET: UPSCALING SUSTAINABILITY INITIATIVES TOWARDS IMPROVED LIVELIHOODS IN VANILLA FARMING COMMUNITIES OF SAVA REGION JUILLET – AOUT 2017 Contact: Narcisse Kalisa Directeur Pays Sedera Rajoelison Search for Common Ground Madagascar Chargé du suivi et évaluation Search for Common Ground Madagascar LOT II K 50 M Mahatony Ivandry (261) 20 22 493 40 LOT II K 50 M Mahatony Ivandry [email protected] (261) 20 22 493 40 [email protected] Analyse institutionnelle et contextuelle | Fandriaka – aout 2017 Les opinions exprimées dans ce document sont celles des auteurs, et ne reflètent pas forcément les vues de la GIZ Mandaté par: Projet Alliance Stratégique Symrise-unilever-GIZ Développement de partenariat avec le Secteur privé – develoPPP.de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Immeuble Ramanandraibe Ankevaheva - Andapa Equipe de recherche de SFCG Madagascar ● Koloina Randriamiary ● Sedera Rajoelison ● Benjamin Beaud ● Emma Ridings ● Aina Ramanantsiarovana ● Dominique Ralambotiana ● Kevin Charles ● Berthe Rahitasoa ● Antoine Rajarison ● Ando Ralandison Et 4 enquêteurs L’équipe est appuyée par l’Institutional Learning Team de SFCG Antananarivo / Madagascar – Aout 2017 2 | P a g e Analyse institutionnelle et contextuelle | Fandriaka – aout 2017 Table des matières Liste des abréviations ................................................................................................................................. 4 Liste des -

MADAGASCAR (! ANALANJIROFO Anove Manompana! !
M A D A G A S C A R - N o r t h e r n A r e a fh General Logistics Planning Map International Primary Road \! National Capital International (!o Airport Boundary Secondary Road !! Major Town Domestic Airport Region Boundary o Antsisikala ! o Tertiary Road ! Intermediate Airstrip Town District Boundary Track/Trail h h ! ! ! Port Small Town Water Body Antsahampano ! ! ( River crossing Antsiranana ( ! ANTSIRANANA I ĥ Main bridge (ferry) Village River o Date Created: 07 March 2017 Prepared by: OSEP GIS Data Sources: UNGIWG, GeoNames, GAUL, LC, © OpenStreetMap Contributors Contact: [email protected] Map Reference: The boundaries and names and the designations used on this map do not ANTSIRANANA II Website: www.logcluster.org MDG_GLPM_North_A2P imply official endorsement or acceptance by the United Nations. Anivorano Avaratra! ! Ambovonaomby ĥ Antsohimbondrona ! !h ! Antanambao ! Isesy Ampanakana ! o Ambilobe ! ! ĥ NOSY-BE Sangaloka Fasenina-Ampasy ĥ ! Beramanja ! Iharana o o (! ! ĥ !h !h! Hell-Ville Ampampamena o! ! VOHEMAR ĥ! Ambaliha AMBILOBE Fanambana ! Madirofolo ! Ambanja DIANA AMBANJA ! Masomamangy o Amboahangibe ! ! Bemanevika ! Ankasetra ĥ SAMBAVA ! Nosivolo h Sambava SAVA !o! o ! Doany ! Farahalana ! Marojala ( ( ĥ ! o Bealanana Analalava ! ! Ambatosia ! BEALANANA o Andapa ANDAPA ! Antsohihy ĥ ! Antsahanoro ! Manandriana ĥAntalaha !h ! o ! Andilambe !h Antsirabato ! Anjajavy o Matsoandakana ! ! Antsakabary ! ! o Anahidrano ! ! Marofinaritra Ambararata ANTSOHIHY BEFANDRIANA o NORD (Ambohitralanana ! ANALALAVA ! Befandriana ANTALAHA -

Madagascar Cyclone Enawo
Ambilobe Vohemar ! ! MA002_9 Amparibe Ambakirano Ankaramibe Bobakindro ! Anjavibe ! Rangovato ! Milanoa Androtra Ambodivoanio ! ! Fanambana Analovana Andrafainkona Antsahafotsy ! ! Ambodiriana ! Ambalasatrana Andrafialava Ambodimandresy ! ! ! Ambatojoby Antsohihy Ambodimanga ! ! Andrafainkona Ambalasatrana ! ! ! Morafeno Tsarabaria Manakana ! ! Ambinaniandravory Amboditsoha !Tsarabaria Ambodisakoana ! Antsivolanana ! Analanana ! Antohomaro Andravory ! ! Antanandava ! ! Andrafialava Ambodimanga ! ! Marotongotra ! Ambatojoby Antsambalahy ! Antsahanandriana ! Ambararatabe ! Manambato Andravory ! Antsahavaribe Ampanefena Beramanja ! ! Antsirabe Ambodisambalahy ! Ampanefena ! Ambotomandry Ambodisaina ! ! Amboriala Anjanana Fotsialanana ! ! Befontsy Ambodimanga II ! Ambatomalaza ! Manasamody ! Antsahamahanara ! ! Tanambao Ambinanin'andravory Daoud Antafiambe Antanandava ! ! Antsahanonoka ! Antsirabe Mosorokely Avaratra Ankiabe Ambodibonara ! ! ! Ambinanindrano Befamelona ! ! Ambalihabe ! ! Tanambao ! Belambo Ambodimandrorofo S ° Ambavala ! 4 ! 1 Ambodimanga Antsahav!aribe Ambalamanasy Betsirebika ! Bevato Marovitsika ! ! Belambo Bemahogo ! ! ! Antsirabe ANTSAHAVARIBE! ! Andilampotaka ! Angodrogodro ! Ambodimanga Ambalamanga ! ! ! Nord Antsahapolisy ! Antanananivo Ampanakana Beanantsindrana ! ! Bealampon!a Bemapaza Marojala! Amparihy ! Ambohitsara Tanambao ! ! Antsahabe Maha!soa Bekambo ! ! ! Antanifotsy ! Ambatojoby Bevonotra Anjialava ! ! ! ! Ambodimadiro ! Antanambao ! ! Andranomadio ! Besahoana Anti!ndra Antsakamantsavana Antsiatsiaka Doanihely! -

PETIT GUIDE DE TOPONYMIE MALGACHE Etc., Renvoient À Des Mots Dont L'initiale Est P...• K...• Etc
INSTITUT DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE DE MADAGASCAR SECTION DES SCIENCES HUMAINES PETIT GUIDE DE TOPONY MIE MALGACHE PAR L. MOLET PUBLICATIONS DE L'INSTITUT DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE TANANARIVE· TSIMBAZAZA 1957 En hommage à Monsieur Ch. Robequain professeur de Géographie Coloniale · IlGRAHDE COHOR~ "Qroni~ C' O~~A'liOClQ" ~O MoJteJi ~. ~ Dzaoudzi ~ V· HOyotte: '" .·.'......L .... T et ro ... •Cc" c 100 1 L. Molet. Bull. Acad. ma/go XXXI. 1953. p. 41 AVERTISSEMEN7 Ce petit livre n'est ni un dictionnaire, ni même un vo. cabùlaire simplifié. II n'est qu'un guide succinct donnant uniquement l'acception géographique des mots malgaches qui figurent le plus souvent sur les cartes de Madagascar. Ainsi le mot VOID qui signifie dans le langage courant: cheveux, ne correspond sur les cartes qu'au mot bambou, accessoire. ment mousses ou lichens, et n'est donné qu'avec ces der niers sens. Beaucoup de noms de lieux ont une origine légendaire ou historique, tels Ampefy ou Ariuonimamo dans l'Ltasy, et ne donnent que peu d'indications géographiques. Les traductions approchées ou hypothétiques ont été écartées, ainsi que celles prêtant à controverse, par exemple Majunga, que l'on écrivait autrefois Manzangay (1), que l'on prononce dans la région Modzangà - aur la tradition sakalaua explique par le mot du roi Andrinntsouli : c Mahajanga ahy, qui me guérit» , qui vient peut- être du Swahili: Mutsanga : sable, ou encore de l'Antalaotra : Moudza-n-gayeh, lieux de choix, terre d'élection. (2) De nombreux noms des dialectes côtiers ont été profon dément modifiés sur les cartes. Ils ont parfois été francisés, tels Fénérive, pour Fenoariuo, Vohémar pour Vohimaro. -

RALAISABOTSY Volahanta Marie Irinah ECO M2 16 N°
UNIVERSITÉ D’ANTANANARIVO ---------------------oo0oo-----------------------------------oo0oooo0oooo0oo------------------------------------------------------------ FACULTÉ DE DROIT, D’ÉCONOMIE, DE GESTION ET DE SOCIOLOGIE DÉPARTEMENT ÉCONOMIE aaabbb 3ème Cycle, DEA-Option " Économie publique et Environnement " LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE FACE A LA PRODUCTION RIZICOLE. Cas du district d’ANDAPA, région SAVA Mémoire pour l’obtention du Diplôme d’Études Approfondies Présenté par : RALAISABOTSY Volahanta Marie Irinah Encadreur pédagogique : Monsieur RAZAFINDRAVONONA Jean Professeur en économie Soutenu : le 04 mars 2016 UNIVERSITÉ D’ANTANANARIVO --------------------------------------------------------oo0oooo0oooo0oooo0oo------------------------------------------------------------ FACULTÉ DE DROIT, D’ÉCONOMIE, DE GESTION ET DE SOCIOLOGIE DÉPARTEMENT ÉCONOMIE aaabbb 3ème Cycle, DEA-Option " Économie publique et Environnement " LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE FACE A LA PRODUCTION RIZICOLE. Cas du district d’ANDAPA, région SAVA Mémoire pour l’obtention du Diplôme d’Études Approfondies Présenté par : RALAISABOTSY Volahanta Marie Irinah Encadreur pédagogique Monsieur RAZAFINDRAVONONA Jean Professeur en économie Soutenu : le 04 mars 2016 SOMMAIRE LISTE DES TABLEAUX STATISTIQUES .............................................................................ii LISTE DES FIGURES ...............................................................................................................ii LISTES DES GRAPHIQUES ........................................................ -

Total Population in Antalaha, Maroantsetra, Andapa and Sambava Districts
MA005 Anaborano Tsarabaria Ifasy Ambinanin'andravory 0 16,418 Andravory 11,276 Ambodimanga 4,616 Ampanefena Amboriala Ambodisambalahy 19,962 Ramena 9,800 Tanambao Manambato 12,649 10,418 Daoud Ambohitrandriana 5,237 9,106 5,358 Antananarivo Antsirabe Antsahavaribe Belambo Nord 13,390 7,632 40,146 Bevonotra Anjialava 7,716 Antindra Marotolana 12,653 16,706 11,734 Anjangoveratra Amboangibe 16,539 Ambatoafo 12,940 Marogaona Bemanevika Anjialavabe 10,453 6,813 10,447 6,621 Analamaho Nosiarina Andrembona 4,789 4,959 Mangindrano 4,930 Antananivo Anjinjaomby Sambava Cu 8,488 41,672 Haut Ambohimitsinjo 5,942 2,063 6,327 Ambohimalaza Ambovonomby Doany Andrahanjo Ambodivoara 8,208 Ambararatabe 7,364 15,569 0 9,703 Andratamarina Nord Morafeno 6,885 4,196 10,482 Farahalana Anjozoromadosy Ambodiampana 21,232 Analila 6,013 Maroambihy 11,530 Marojala 7,505 Ambalamanasy II 11,941 14,847 Bealanana 14,515 Marovato 18,603 Ambatoriha Antsambaharo Betsakotsako 4,787 Est Ankazotokana 3,593 Andranotsara Belaoka 12,737 3,978 7,472Andranomena Belaoka Lokoho Lanjarivo Ambodiangezoka 5,862 Ambinanifaho Marovato 5,828 14,813 26,294 10,451 Ambatosia Matsohely 5,662 12,796 Marotolana 5,841 Andapa Andrakata Ambodiadabo M Ankiakabe 8,133 Ambalaromba 21,952 6,750 7,851 Bealampona Nord Ambararata 5,271 13,425 7,478 Antsambalahy Ampahana Sofia 8,597 19,424 3,144 Anoviara Ambodimanga I 12,033 9,326 Tanandava 8,065 Antsahanoro Sarahandrano 12,446 Ambodisikidy 5,574 7,188 Antananambo Antalaha Ambonivohitra Matsondakana Antsahamena 13,423 Andampy 34,994 42,264 4,793 -

DISTRICT COMMUNE NOMBRE CANDIDATS ENTITE NOM ET PRENOM(S) CANDIDATS ANDAPA AMBALAMANASY II 1 INDEPENDANT RAMANANKEVITRA (Ramanan
NOMBRE DISTRICT COMMUNE ENTITE NOM ET PRENOM(S) CANDIDATS CANDIDATS INDEPENDANT RAMANANKEVITRA ANDAPA AMBALAMANASY II 1 RAMANANKEVITRA (Ramanankevitra) IRK (Isika Rehetra Miaraka Amin'ny Andry ANDAPA AMBALAMANASY II 1 RANDRIAMINO Rajoelina) INDEPENDANT A.T.M (Ambodiangezoka ANDAPA AMBODIANGEZOKA 1 TOMBOZANANY Raziliarivony Jolin Mandroso no Tanjogno) IRK (Isika Rehetra Miaraka Amin'ny Andry ANDAPA AMBODIANGEZOKA 1 RAHARIMANANA James Willy Rajoelina) INDEPENDANT RAZAFIMANDIANINA ANDAPA AMBODIANGEZOKA 1 RAZAFIMANDIANINA (Razafimandianina) ANDAPA AMBODIMANGA I 1 AHI (Hiaraka Isika) RAZAKA Philibert IRK (Isika Rehetra Miaraka Amin'ny Andry ANDAPA AMBODIMANGA I 1 ZARASON Eric Rajoelina) ANDAPA AMBODIMANGA I 1 MMM (Malagasy Miara - Miainga) CLEMENT Théophile INDEPENDANT ANDAPA ANDAPA 1 ANDRIANAIVOMANAMANDIMBY BIEN AIME ANDRIANAIVOMANAMANDIMBY Bien Aimé (Andrianaivomanamandimby Bien Aime) INDEPENDANT MIMARA DOSY FRANCO ANDAPA ANDAPA 1 MIMARA Dosy Franco (Mimara Dosy Franco) INDEPENDANT MEVA JEAN CLAUDE (Meva Jean ANDAPA ANDAPA 1 MEVA Jean Claude Claude) IRK (Isika Rehetra Miaraka Amin'ny Andry ANDAPA ANDAPA 1 TSIMIBO Achille Rajoelina) INDEPENDANT RAMAHAVITA HENRI BRUNO ANDAPA ANDAPA 1 RAMAHAVITA Henri Bruno (Ramahavita Henri Bruno) ANDAPA ANDRAKATA 1 LEADER FANILO (Leader Fanilo) LEONG Anita IRK (Isika Rehetra Miaraka Amin'ny Andry ANDAPA ANDRAKATA 1 RAHELISON Alexandre Rajoelina) ANDAPA ANDRAKATA 1 INDEPENDANT F.H.F (STANISLAS Eniole) STANISLAS Eniole IRK (Isika Rehetra Miaraka Amin'ny Andry ANDAPA ANDRANOMENA 1 RANDRIAMANANTENA Fidelin Gitorix