Plandolit Frances
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
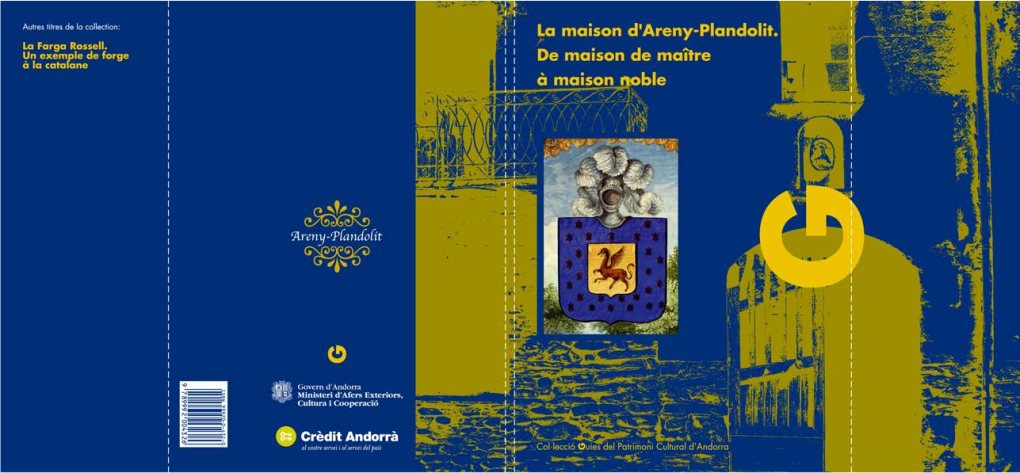
Load more
Recommended publications
-

Mapa De Camins
www.ordino.ad · www.lamassana.ad · www.vallnord.com · www.lamassana.ad · www.ordino.ad 250 m de desnivell 2,5 km de distància 500 m de desnivell 5 km de distància 750 m de desnivell 8 km de distància Camins a Ordino km 1 El Port del Rat S 1,17 km 179 m+ 179 m- 1h45 Túnel de Port del Rat 2 El Pic de Peyreguils S 2,92 km 75 m+ 470 m- 2h Telecadira Creussans La Coma 3 Els Estanys de Tristaina S 3,4 km 163 m+ 163 m- 2h15 La Coma 4 L’Estany Esbalçat M 4,9 km 445 m+ 445 m- 2h45 El Castellar 5 Els Planells de Besalí S 3,8 km 283 m+ 283 m- 1h45 Pàrquing de Sorteny 6 La Font Freda S 4 km 226 m+ 226 m- 2h Pàrquing de Sorteny 7 El Pas del Bestiar S 3,7 km 252 m+ 252 m- 2h Mapa de camins Parking de Sorteny 8 Estany de l’Estanyó M 8 km 557 m+ 557 m- 3h30 ORDINO - LA MASSANA Parking de Sorteny Edició revisada juny 2014 9 El Pont de la Rebollissa S 3,3 km 261 m+ 261 m- 1h30 El Serrat 10 Sant Pere pel Pont de l’Estarell S 5,26 km 190 m+ 190 m- 2h00 Mina de Llorts 11 El Camí del Ferro M 7,8 km 238 m+ 238 m- 2h30 Mina de Llorts Farga Rosell 12 El Roc del Castell M 7,72 km 614 m+ 614 m- 3h40 Llorts 13 Les Bordes de l’Ensegur M 7,8 km 510 m+ 510 m- 3h30 Arans 14 Camí anul·lat 15 El Remugar M 6,9 km 534 m+ 534 m- 3h15 Oficina de turisme d’Ordino 16 Camí del Turer S 3,3 km 220 m+ 220 m- 1h30 1€ Oficina de turisme d’Ordino 17 La Creu de Noral S 4,8 km 330 m+ 330 m- 2h Oficina de turisme d’Ordino 18 De Sant Cornel·li a Santa Bàrbara XS 1,86 km 83 m+ 83 m- 0h45 Oficina de turisme d’Ordino 19 El Pic de Casamanya M 7,4 km 760 m+ 760 m- 4h00 Coll d’Ordino 20 El Tomb de les Neres M 8,2 km 198 m+ 198 m- 3h00 Coll d’Ordino Camins a la Massana 21 Coll de l’Estall M 7,69 km 600 m+ 600 m- 3h30 Urbanització El Cortalet 22 El Serrat dels Planells Grans S 3,6 km 356 m+ 356 m- 1h15 Sant Cristòfol d’Anyós 23 Borda Fenerols M 9 km 500 m+ 500 m- 3h30 Cortals de Sispony 24 La Collada de Montaner M 5,97 km 620 m+ 620 m- 2h45 Cortals de Sispony. -

Càlida Rebuda Al Copríncep Francès
núm. 43 desembre 2019, gener i febrer 2020 Sumari pàgina 7 Esports Noves vies per a la iniciació al roc dels Palinquerons pàgines 8 Medi ambient Recuperat el camí Ral amb el nou tram d’Ansalonga Càlida rebuda al copríncep francès pàgina 17 La vall camina cap al reconeixement de la Unesco com a ‘Territori Biosfera’ Tema / pàgines 3-4 pàgina 10 L’ambaixadora d’Andorra a França Martí Boada, expert i coneixedor de i delegada de la Unesco va lliurar l’experiència al Montseny, explica Activitats el dossier a final de setembre les implicacions de la candidatura Representació de l’Ossa pàgina 11 Viure Ordino / pàgines 14-15 Ansalonga tindrà una nova àrea de repòs i farà difusió Gent gran de la història de l’electricitat a l’antic transformador Núria Solsona pàgines 22-23 No et perdis... / pàgines 12-13 Entrevista Més parades i pista Jordi Serracanta: de cúrling a la Fira de Nadal «Tenim molt camí turístic per recórrer si aprofitem la tecnologia» pàgina 24 «Cal que tots ens sentim ambaixadors L’Ordino de... de la parròquia d’Ordino» Andreu Gaspà Picart 2 ordinoésviu editorial Editorial A les portes d’unes noves elec- objectius prioritaris que s’han decisió que coneixerem l’estiu cions comunals, és un bon mo- fet realitat en aquest mandat que ve. La participació de la po- ment per reflexionar sobre la que acaba. L’endeutament co- blació per aconseguir aquesta feina feta i la traça oberta d’un munal s’ha reduït gairebé un candidatura ha estat clau i ha futur immediat. -

Af-En-Guia General 2016-Web
Index Index Identity card 04 Historical summary 08 Geography, climate and nature 10 02 Leisure, sports and health 12 03 Culture 20 Tourist bus 24 Festivities 25 Shopping 26 Gastronomy 28 Accommodation 32 Transport 34 Business tourism 38 Special thanks Photos kindly provided by the Tourism parishes 40 Andorra National Library and Practical information 48 the Comuns de Andorra (Paris- hes of Andorra). Brochures 54 Moscow Oslo 3.592 km 2.385 km FRANCE Dublin Copenhagen 1.709 km 2.028 km Canillo London Ordino 1.257 km La Haye El Pas de la Casa Berlin 1.328 km La Massana Encamp 1.866 km Bruxelles 1.180 km Escaldes-Engordany Paris Andorra la Vella 861 km Zurich Sant Julià 1.053 km de Lòria Toulouse ESPAÑA 04 185 km 05 Madrid 613 km Andorra Lisboa Barcelona Roma 1.239 km 208 km 1.362 km We invite you to visit the Prin- Andorra is nature par excellence, Andorra is also a millenary country: live together in perfect harmony cipality of Andorra, the smallest a space of incomparable beauty, Romanesque art, museums and with comfort, modernity and the state in Europe in the heart of ideal for open-air sports activi- monuments, culture trails, festiv- latest technologies. the Pyrenees. ties both in the summer and in ities and celebrations... are just a Over 2,000 stores with the prod- the winter. Trekking and skiing small sample of its rich historical On a stage of 468 km2, you will ucts of the best trademarks, an ex- are two examples of the activi- legacy. -
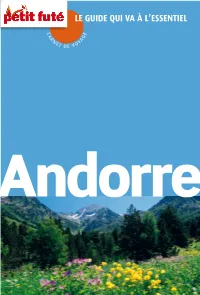
Le Guide Qui Va À L'essentiel
LE GUIDE QUI VA À L’ESSENTIEL C A E R G N A E Y T D E V O Andorre Les bonnes adresses du bout de la chambre d’hôtes chambre en Provence ? en Provence rue au bout du Seychelles ? Seychelles resort aux resort monde .com © OLEG TSCHELTZOFF - FOTOLIA © YVES LEFEVRE - FOTOLIA Benvinguts a Andorra ! E RR O « Tout un monde dans un petit pays. » Cette phrase, qui s’affiche sous nos d’And T N yeux lorsqu’on s’aventure sur le site Web EME RN de la Principauté, en dit long. Coincée E V OU entre la France et l’Espagne, la petite G U D perle catalane est simplement unique. ME Contrairement à ce que l’on peut ima- RIS OU T giner, ni française, ni espagnole, juste U D E elle, naturelle et authentique, andorrane ÈR T finalement. La vallée du Madriu classée MINIS © au patrimoine mondial de l’Unesco, le col d’Ordino avec ses pics enneigés surplombant des vallons verdoyants, les petits villages tout en pierres sur les hauteurs des paroisses, ne peuvent lais- ser le voyageur le plus rôdé indifférent. Les amoureux du grand air montagnard y pratiquent allègrement entre autres ski et randonnée, vélo et escalade. Maintenant, l’interaction homme-nature se concrétise-t-elle seulement par cette relation de loisirs ? Loin de là. Ce serait ignorer un héritage du passé omniprésent, à travers les nombreuses petites églises romanes aux tour-clochers, les maisons traditionnelles, les cabanes de berger qui se dressent fièrement dans tout le pays, au détour d’un chemin ou au cœur d’un village. -

Andorra. Anuari Socioeconòmic 2005
Fotografia coberta: Santuari de Ntra. Sra. de Meritxell. Autor: Jaume Riba Sabaté Andorra.Anuari2005 socioeconòmic ANDORRA. ANUARI SOCIOECONÒMIC 2005 Edita: Banca Privada d’Andorra Av. Carlemany, 119 ad700 Escaldes-Engordany Principat d’Andorra Direcció: Dr. Joan Vilà-Valentí Informe sobre l’economia andorrana. 2004: Dr. Xavier Sáez i Bárcena Els condicionaments del desenvolupament parroquial: Dra. Maria Jesús Lluelles i Larrosa L’administració menor local a Andorra: els quarts (ii): Pere Cavero Muñoz Deu anys de publicació d’aquest «Anuari socioeconòmic» (1996-2005): Dr. Joan Vilà-Valentí Fotografies: Jaume Riba Sabaté Disseny gràfic original: Jordi Salvany Disseny gràfic: Estudi Juste Calduch Impressió: Agpograf, s.a. ISBN: 99920-1-580-2 Dipòsit legal: B-XXXXX-05 Agraïments: BPA vol agrair de manera molt especial la col·laboració del Quart d’Ordino, per haver-nos permès reproduir en aquest Anuari la foto de l’Hotel Casamanya, alhora que la dels quarts d’Anyós i de Pal, per haver-nos permès reproduir en aquest Anuari les fotos de les seves respectives cases del Quart. Andorra. Anuari socioeconòmic 2005 – Escaldes-Engordany: Banca Privada d’Andorra, 2005. - 208 p.: il.; 28cm. Conté: Informe sobre l’economia andorrana 2004 / Xavier Sáez ; Els condicionaments del desenvolupament parroquial / M. Jesús Lluelles ; L’administració menor local a Andorra: els quarts (ii) / Pere Cavero Muñoz; Deu anys de publicació d’aquest Anuari socioeconòmic (1996-2005) / Joan Vilà-Valentí; – isbn 99920-1-580-2 1. Andorra – Condicions econòmiques – Anuaris 2. Llibres – Ressenyes. 3. Andorra –Condicions econòmiques – Història. 4. Quarts* 5. Administració local – Andorra - Història I. Banca Privada d’Andorra II. Vilà-Valentí, Joan 33(467.2)“2004”(058) Índex 5 Presentació 7 Al lector 9 Informe sobre l’economia andorrana. -

Butlletí Del Consell General
Butlletí del Consell General Núm. 64/2015 Casa de la Vall, 10 de desembre del 2015 SUMARI 2- PROCEDIMENT LEGISLATIU COMÚ 2.1 Projectes de llei Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de designació de carreteres i gestió de la xarxa viària, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2 3- PROCEDIMENTS ESPECIALS 3.2.1 Projectes de llei qualificada Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada de la Justícia, del 3 de setembre de 1993. pàg. 12 5- ALTRA INFORMACIÓ 5.2 Convocatòries Convocatòria de la Sessió Tradicional de Sant Tomàs pel dia 21 de desembre del 2015. pàg. 12 2 Butlletí del Consell General – núm. 64/2015 – Casa de la Vall, 10 de desembre del 2015 2- PROCEDIMENT LEGISLATIU L’actual Llei pretén actualitzar el text legal de l’any COMÚ 2005 i millorar-lo en diversos aspectes. En primer lloc, el títol primer de la Llei precisa 2.1 Projectes de llei conceptualment el que s’entén per vies de comunicació i, dins d’aquestes, les que tenen la Edicte consideració de carreteres o carrers i, conseqüentment, queden regulades per la Llei; es La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 10 de precisa igualment el règim aplicable a la titularitat i desembre del 2015, ha examinat el document que li les competències sobre els diferents vials, ha tramès el M. I. Sr. Cap de Govern, registrat en diferenciant clarament el règim jurídic aplicable a les data 2 de desembre del 2015, sota el títol Projecte carreteres generals i a les carreteres secundàries; i es de llei de designació de carreteres i gestió de la regulen les modalitats de traspàs de titularitat de les xarxa viària i, exercint les competències que li vies de circulació, així com les amplades, en tots els atribueix el Reglament del Consell General en els casos. -

Organisation
Organisation Km point Height Landmark Description 0 km 1.280 m We set off from the town center along with lovely music and surrounded by a crowd admiring our courage (or silliness). A kilometer-long uphill walk on asphalt takes us around Ordino and loosens up the group. We take a narrow uphill path to reach a 1,620 Ordino m height. A woodland path will take us down to a road we follow uphill. We leave the road again after 100 m to take a steep climb... we have managed the first 370 m of vertical climb. 4 km 1.650 m We can have a look at the village d'Ordino. We follow a wavy path until we come to a level area (the Sornàs ledge). We veer right into a steep woodland path that will take Camp del Remugat us to a 1,990 m pass. We are rewarded with a pleasant descent out of the ambush area and to l'Ensegur. 10 km 1.835 m The way follows a succession of level areas and arduous climbs to reach the Coll Ensegur d´Arenes, offering magnificent views on both sides. We follow the ridge for about 800 m until Ferreroles. We enjoy the view on the Estanyó lake below. 17 km 2.532 m Collada de Steep and demanding downhill climb around the lake, a small level area and we enter Ferreroles the woods. We follow the way, cross the river and take the short climb to the refuge. 21 Km 1.962 m Refreshment point. -

MUNTANYA 02 Natura 05 Sorprenent 06
ca MUNTANYA 02 Natura 05 sorprenent 06. Ordino, Reserva de la Biosfera per la Unesco Index 07. Parc Natural de la Vall de Sorteny 08. Vall del Madriu-Perafita-Claror 09. Parc Natural del Comapedrosa Activitats 10. Miradors 77 amb nens 13. Turisme accessible 78. Fent camí... 14. Circuit de les Fonts - Engolasters, 80. Descobrir la flora, la fauna i altres Escaldes-Engordany camins històrics 15. Naturlandia, Sant Julià de Lòria 80. A sobre d’un cavall les coses es veuen 16. Camí dels antics oficis diferents... 81. Diversió assegurada en plena natura I encara tenim més... Activitats 81. 17 en plena natura Estacions d’esquí 18. Senderisme 83 i altres activitats 19. Els GR 84. Ski Parador Canaro 21. Els refugis 85. Grandvalira 24. Rutes ecoturístiques 88. Ordino Arcalís 31. Llacs 89. Vallnord - Pal Arinsal 35. Manual de convivència a la muntanya 92. Naturlandia 37. Rutes a cavall 40. Cicloturisme i BTT 41. Pesca Altres activitats 43. Golf i Pitch & Putt 95 que no et pots perdre 45. Vies d’escalada 96. Palau de gel 49. Rocòdroms 98. Caldea 51. Vies ferrades 100. 360º Extrem 57. Barranquisme 60. Circuits d’Aventura i Parc de tirolines Llistat empreses 62. Rutes a la neu 63. Zones de pícnics 101 d’activitats 102. Empreses i entitats Allotjaments per a Informació 71 senderistes i pescadors 115 general 72. Llistat allotjaments 03 04 05 Natura sorprenent ANDORRA, DESTÍ DE NATURA Andorra és un país especial, amb personalitat pròpia i paisatges de bellesa singular, en què la muntanya és la protagonista tant per als amants de l’esport com per als qui gaudeixen submergint-se en la naturalesa i observant els animals i les plantes. -

ANDORRA LA VELLA Massana Erts Sant Juliàdelòria Estanys De Coloma L’Angonella Tristaina Estanys De Santa (2300M) La Arans Ordino ANDORRA LA VELLA Aixirivall Sispony
© Lonely Planet Publications 396 lonelyplanet.com ANDORRA •• History 397 Andorra ANDORRA ANDORRA ANDORRA 0 5 km Andorra 0 3 miles ANDORRA ANDORRA Estanys de F R A N C E Tristaina To Aix-les-Thermes (21km); ORDINO Estany de l’Estany Toulouse (155km) Borda de (2339m) Sorteny Pic de la Serrera Ordino-Arcalís (2913m) Ski Area El Serrat Collada dels Meners Slip Andorra into the conversation and people may tell you, with horror or joy, that it’s all Estanys de CG3 (2713m) l’Angonella CANILLO Port de Pic de Coma Pedrosa (2300m) Llorts Pic de l’Estany skiing and shopping. They might add that it’s a one-road, one-town ministate. Riu Estany de Baiau Bordes de (2915m) N20 (2942m) Juclar Valira l'Ensegur (2756m) Refugi de Arans (2180m) L'Hospitalet They’re right to some degree, but also very wrong. Shake yourself free of the capital Coma Pedrosa El Tarter Estany de La Cortinada Soldeu del Pic de Casamanya les Truites Arinsal (2740m) Valira d’Orient Arinsal Nord Riu Andorra la Vella’s tawdry embrace to purr along one of the state’s only three secondary (2260m) Ski Area Port Canillo Segudet CG2 d’Envalira Ordino roads and you’ll discover villages as unspoilt as any in the Pyrenees. LA MASSANA Erts Soldeu-El Tarter (2408m) Coll d’Ordino Ski Area Les Bordes La (1980m) Port de Pal Massana d'Envalira A warning though: it may not be the same a few years from now. Greed and uncontrolled Cabús Col de Sispony Pas de la Casa Puymorens S P A I N Pal Ski Area Encamp CG3 CG2 Grau Roig development risk spoiling the side valleys. -

Disposició Final Primera Disposició Final Segona Llei 9/2003, Del 12 De
Núm. 55 - any 15 - 16.7.2003 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra 1887 hi siguin contràries. En especial, queda El Principat d’Andorra disposa ja de le- tableix una regulació específica de l’Ar- derogat el Decret sobre el contracte de gislació de protecció del patrimoni cul- xiu Nacional i la Biblioteca Nacional. treball de 15 de gener de 1974, i els títols tural. Les ordinacions del 13 de juliol de El capítol cinquè regula les mesures de II, III, IV, V, VI, VII i IX, així com els apar- 1964, del 4 de juny de 1970 i del 5 de ju- foment i difusió. Les mesures de foment tats a) i b) de l’article 56 del Reglament liol de 1988, i la Llei de protecció del pa- pretenen, d’una banda, incentivar la con- laboral, de 22 de desembre de 1978, i les trimoni cultural-natural, del 9 de tribució de la societat en la preservació seves modificacions successives. novembre de 1983, han contribuït a la del patrimoni cultural, donant suport a conservació dels béns culturals d’Andor- les associacions especialitzades, millo- Disposició final primera ra. No obstant això, el nou marc jurídic rant la formació i la competència de pro- La present Llei entrarà en vigor als sis que va comportar l’aprovació, l’any fessionals i empreses i, de l’altra, 1993, de la Constitució del Principat mesos de la seva publicació al Butlletí compensar els titulars de béns culturals Oficial del Principat d’Andorra. d’Andorra fa convenient la promulgació de les càrregues i obligacions que la Llei d’aquesta nova Llei del patrimoni cultu- els imposa. -

Llei 18/2016, Del 30 De Novembre, De Designació De Carreteres I Gestió De La Xarxa Viària
1/14 Llei 18/2016, del 30 de novembre, de designació de carreteres i gestió de la xarxa viària Llei 18/2016, del 30 de novembre, de designació de carreteres i gestió de la xarxa viària Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 30 de novembre del 2016 ha aprovat la següent: LLei 18/2016, del 30 de novembre, de designació de carreteres i gestió de la xarxa viària Exposició de motius Mitjançant la Llei 7/2005, del 21 de febrer, de designació de carreteres, el Consell General va promulgar un text legal que, per primera vegada, regulava la circulació viària del Principat des d’un punt de vista global, substituint en bona part les antigues ordinacions adoptades des de finals de la dècada de 1960 i fins als inicis dels anys 1990. D’aquesta manera, s’aportaren solucions uniformes a la nomenclatura viària, designant amb claredat les carreteres generals i definint titularitats. Tanmateix, es creà la xarxa bàsica de vials i es definí la seva gestió als efectes d’ordenar el trànsit rodat des d’un punt de vista general, millorant la circulació rodada entre les parròquies i l’entrada i sortida de vehicles del Principat, especialment en aquells moments de màxima afluència. Finalment, la Llei introduí en annex el Directori de carreteres generals i el llistat de vials inclosos dins de la xarxa bàsica de vials. L’actual Llei pretén actualitzar el text legal de l’any 2005 i millorar-lo en diversos aspectes. En primer lloc, el capítol primer de la Llei precisa conceptualment el que s’entén per vies de comunicació i, dins d’aquestes, les que tenen la consideració de carreteres o carrers i, conseqüentment, queden regula- des per la Llei; es precisa igualment el règim aplicable a la titularitat, diferenciant clarament el règim jurídic aplicable a les carreteres generals i a les carreteres secundàries; i es regulen les modalitats de traspàs de titularitat de les vies de circulació, així com les amplades, en tots els casos. -

Landscapes That Might Be Considered Outstanding As Well As Every Day Or Degraded Landscapes
COUNCIL OF EUROPE EUROPEAN LANDSCAPE CONVENTION SIXTEENTH COUNCIL OF EUROPE MEETING OF THE WORKSHOPS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN LANDSCAPE CONVENTION Landscape and transfrontier cooperation The landscape knows no boundary ___ Andorra la Vella, Andorra 1-2 October 2015 Study Visit, 30 September 2015 – DRAFT PROGRAMME – 4 September 2015 Document prepared by the Directorate of Democratic Governance Secretariat of the European Landscape Convention, Council of Europe The 16th Council of Europe Meeting of the Workshops for the implementation of the European Landscape Convention on “Landscape and transfrontier cooperation: the landscape knows no boundary”, is being organised by the Council of Europe – Directorate of Democratic Governance, Secretariat of the European Landscape Convention – in cooperation with the Ministry of Environment, Agriculture and Sustainable development of Andorra, within the context of the Work Programme of the European Landscape Convention of the Council of Europe. The Meeting will take place in the Congress Centre of Andorra la Vella, Plaça del Poble, s/núm, AD500 – Andorra – Tel.: (+376) 730 005, Fax: (+376) 874 501. E-mail: [email protected] http://www.andorralavella.ad/ciutat-congressos http://www.comuandorra.ad/opencms/export/sites/wca/contents/_docs/Triptic_CentreCongressos_xfrax. pdf An optional study visit for the official delegates of the member States of the Council of Europe, speakers in the Programme and other participants, subject to their availability, will be organised on 30