L'escalade En Région Paloise
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
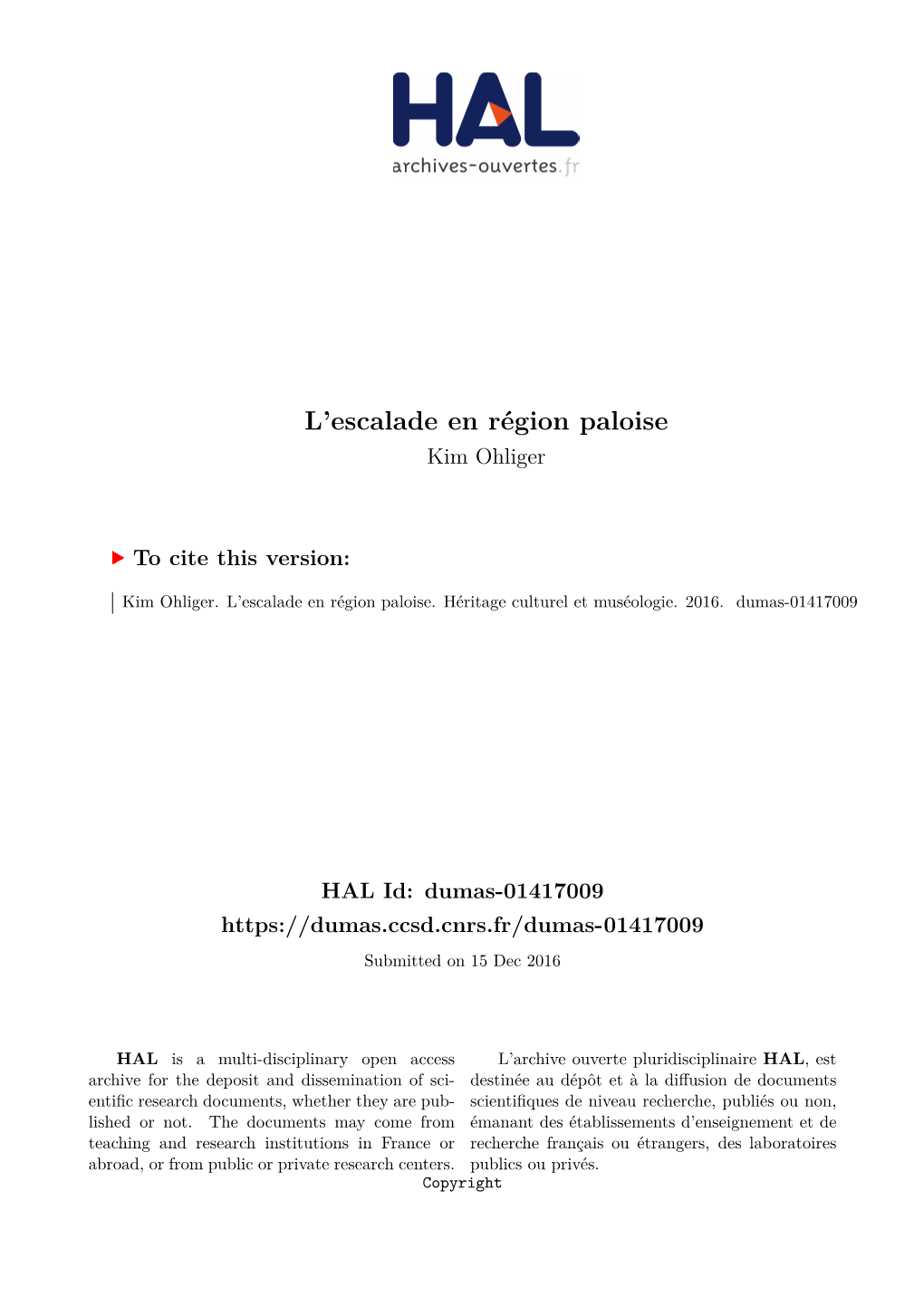
Load more
Recommended publications
-

Stevie Haston Aleš Česen Malcolm Bass Tom Ballard Steve Skelton F.Lli Franchini Korra Pesce
# 33 Stile Alpino Luoghi & Montagne MONTE BIANCO BHAGIRATHI III CIVETTA KISHTWAR SHIVLING GASHERBRUM IV HIMALAYA MALTA TAULLIRAJU Protagonisti STEVIE HASTON ALEš ČESEN MALCOLM BASS TOM BALLARD STEVE SKELTON F.LLI FRANCHINI KORRA PESCE Speciale PILASTRO ROSSO DEL BROUILLARD In collaborazione con: ALPINE STUDIO EDITORE Trimestrale anno VIII n° 33 settembre 2016 (n. 3/2016) € 4,90 La giacca più leggera e impermeabile del momento LIGHTWEIGHT WITHOUT COMPROMISE MINIMUS 777 JACKET Con un peso di soli 139g, la Minimus 777 è una giacca per Alpinismo e da Trail di una leggerezza estrema, con 3 strati impermeabili, una traspirabilità elevata e una comprimibilità senza precedenti. Pertex® Shield + exclusive technology: 7 denier face, 7 micron membrane, 7 denier tricot backer montane.eu La giacca più leggera e EDITORIAL # 33 impermeabile del momento • Firstly I would like to openly admit that I do not really like to write about or com- ment on other peoples mountaineering endeavors, because it is impossible to comple- tely understand an experience in the mountains unless you have lived it yourself. Ten years after my predecessor I will have the difficult task to replace Fabio Palma in writing the editorials of Stile Alpino. Certainly he is better skilled than me in writing and has been one of the creators of this magazine founded by the Ragni di Lecco group. Nonetheless, I will try to be up to the job helping to select the last ascents around the world and to suggest new places but always taking care to include ascents in the Alps and close to home. The objective of Stile Alpino is to improve and steadily grow in order to publish ar- ticles, that might not have been published before, on ascents in unknown or known areas. -

For the Reh~ of the Day
for the reh~ of the day. Setting o~tt at three A.M. on May 30, they evacuated Camp II and dcsccndcd to Camp I at seven A.M. and to Base Camp at ~cn A.M. Camp I was evacuated on May 3 I and Base Camp on June I WC got 10 La&en on J~tnc 2. We ~tsetl no fixed ropes. WC had 1‘0~11.8tnm ropes only (two for cad1 party) and so the ascent was semi-alpine-style. Our route was the same as that of the previous parIies. S’i/t/o/c/~l/ Attrnrpt. Our expedition wa\ composed of Sen Hiraiami, Atau\hi Koyama. Ryouke Wakuuwa and I as lea&r. On May 8. we reached only 3X00 meter\ aticl had to turn bath beca~i~ of bad weather and a tight schedule. We established Baw Camp at Yabuk at 3978 meter< on May 3. Advance Base at 4570 meters on May 5 and after closing the Zctnu Glacter. Camp I at 4600 meter\ on the Siniolchu Glacier on May 7. This wa\ really a reconnaissance for 1995. M,zG\~o NOV. M.D., 7i,lroX~r U/tr~~/.\it\, SC/too/ c~fMdic,ir7c, h/m Ktrhu, Sr~tl7. An Indian Army expedition led by Colonel H.S. Chaukan, former head of the Hitnalaynn Mountaineering Institute in Manali claitns to have climbed Kabru South (7.3 17 meters, 24.096 feet) for the first time. It is reported that I.3 mcmbcrs reached the top led by Captain S.P. -

The Alps 2008
Area Notes 181. Simon Pierse, Ciarforon from Rifugio Vittorio Emanuele II, 2006, watercolour, 42 x 59cm 245 Area Notes COMPILED AND EDITED BY PAUL KNOTT Alps 2008 Lindsay Griffin Greenland 2008 Derek Fordham Scottish Winter 2008-2009 Simon Richardson Morocco 2005-9 Mike Mortimer India 2008 Harish Kapadia Nepal 2008 Dick Isherwood Pakistan 2007 Lindsay Griffin and Dick Isherwood China and Tibet John Town New Zealand 2008-9 Kester Brown Cordillera Blanca Antonio Gómez Bohórquez Argentine Andes 2008 Marcelo Scanu 246 LINDSAY GRIFFIN The Alps 2008 This selection of ascents in 2008 could not have been written without the help of Jonathan Griffith, Andrej Grmovsek, Tomaz Jakofcic, Rolando Larcher, Tony Penning, Claude Rémy, Hilary Sharp, Luca Signorelli and Ueli Steck. tarting in late June, Diego Giovannini and Franco ‘Franz’ Nicolini took S60 days to complete the first non-mechanised link-up of all 82 Alpine 4000m summits that appear on the UIAA’s official list. The pair opted to track from west to east, ending with Piz Bernina. Until the early 1990s there was no definitive list; some opting for as low as 52 (the number of completely separate mountains), others adding more, with alpine specialist Richard Goedecke listing a staggering 150 individual tops and bumps. At the end of 1993, in an attempt to put an end to the debate, a joint UIAA and Italian Alpine Club committee came up with an ‘official’ list of 82, which they hoped would be used as the benchmark for future attempts. This list came too late for Simon Jenkins and Martin Moran, who in the same year made the first non-mechanised traverse of 74 summits from the Piz Bernina to the Barre des Ecrins. -

1 L'éthique DE L'escalade LIBRE Dimension Dogmatique Des Conflits
L'ÉTHIQUE DE L'ESCALADE LIBRE dimension dogmatique des conflits normatifs Jean Pierre MALRIEU Docteur en Sciences Politiques et Sociales [email protected] Nous voudrions éclairer d'un point d'histoire – la transition d'une éthique californienne vers une éthique française en escalade libre – les mécanismes par lesquels certains signes de la modernité triomphent de certains autres. Immergés dans ces signes et ces images, nous en connaissons les mutations de masse. Pour ce qui concerne l’escalade, la concomitance de ces mutations affectant les représentations a même été bien étudiée (Pociello 91, Corneloup 93). La thèse centrale de ces travaux est que l’escalade moderne, sport “californien”, est née d’une rupture avec l’alpinisme classique. S’appuyant sur une enquête de terrain menée sur les grimpeurs de Fontainebleau, leurs auteurs ont proposé une typologie des grimpeurs (Pociello & Corneloup 93) reflétant la fracture entre escalade californienne et alpinisme classique, mais aussi les différenciations successives de l’escalade californienne en ses tendances “aventure”, “hédoniste” et “sportive”. A l’intérieur de ces approches d’ordre structuraliste, où chaque pratique ne prend son sens que rapportée à la position des acteurs au sein d’un système, on met à jour des rapports d’homologie entre les distinctions observées dans le champ de l’escalade et celles observées dans la société. Enfin, une étude sémiotique du champ de communication symbolique (média à diverses échelles) qui double le champ des pratiques, a pu établir que l’escalade reflète l’air du temps, ici conceptualisé comme post-modernité (Corneloup 93). Bien qu’il représente une avancée considérable dans le domaine de la sociologie de l’escalade, on pourrait faire trois critiques à cet ensemble de travaux. -

Dom & Täschhorn
DOM & TÄSCHHORN KRONE DER MISCHABEL Herausgegeben von Daniel Anker, Caroline Fink und Marco Volken Texte: Daniel Anker, Caroline Fink, Martin Rickenbacher, Marco Volken, Emil Zopfi Historische Texte: John Llewelyn Davies, Josef Imseng,Arnold Lunn, Mary Mummery, Geoffrey Winthrop Young Fotos: Marco Volken, Daniel Anker, Caroline Fink, Gabriel Voide und andere Illustrationen: Esther Angst BERGMONOGRAFIE 17 Josef Anton Berchtold und seine Kathedralen Dom und Domherr Eine Recherche von Martin Rickenbacher Stellen wir uns vor: Ein Domherr, in we- Der Berg und sein Namens- hender Soutane, das Birett auf dem Kopf, geber: Dom, mit der Kamera steht auf einem Berg und misst mit einem angepeilt von der Belalp aus (linke Seite). Domherr Theodolit die Winkel zwischen den um- Josef Anton Berchtold liegenden Gipfeln.Welch‘ herrliches Bild! (1780–1859), gemalt von Kein Wunder also, dass Josef Anton seinem Freund Lorenz Justin Berchtolds Leben – um ihn handelt es sich Ritz im Jahre 1847. Das beim Mann in der Soutane – denn auch Bild – es ist das dritte Porträt von Ritz – hängt im schon gut dokumentiert ist. In erster Linie Rathaus von Sitten (oben). durch zahlreiche Beiträge des Historikers Anton Gattlen. Im Rhonetal ist die Erin- Eine solch klare Sicht, wie auf der Foto der vor- nerung an diese ausserordentliche Persön- angehenden Doppelseite, lichkeit auch heute noch lebendig, wovon hat Berchtold bei der Ver- nicht zuletzt die Rue du Chanoine messung des Wallis jeweils Berchtold in Sitten zeugt. sehr geschätzt: Blick vom Josef Anton Berchtold erblickte am 27. Juni Klein Matterhorn über den 1780 als viertes Kind einer Bauernfamilie in nach einem Theologiestudium an einer Rücken des Gornergrates (unten) hinweg auf die Greich ob Mörel das Licht derWelt. -

Aventure Et Littérature 2016 Aventure Etlittérature 2016 Édito
éditions Paulsen Aventure et littérature 2016 Aventure etlittérature Aventure 2016 édito L’amour des livres J’ai toujours aimé les livres. Pour ce qu’ils nous transmettent, pour ce qu’ils nous inspirent et pour ce temps de la lecture, temps privilégié qui libère l’imaginaire. Lorsque j’ai souhaité créer une maison d’édition, en 2006, Christian de Marliave m’a présenté son ami Michel Guérin qui avait fondé les éditions Guérin à Chamonix. J’ai immédiatement ressenti beaucoup d’admiration pour cet homme de lettres qui était aussi un entrepreneur courageux. Sa disparition brutale en 2007 aurait pu remettre en question l’avenir des éditions Guérin, mais son épouse, Marie-Christine Guérin, a poursuivi son œuvre avec une admirable opiniâtreté. En 2011, les éditions Guérin et les éditions Paulsen se sont associées pour unir leurs forces et publier des livres autour d’une ligne commune associant aventure et littérature. Cette année, les éditions Guérin fêtent leurs 20 ans et nos maisons sont désormais réunies autour de trois collections phares. La collection Guérin et ses fameux livres rouges plébiscités par les montagnards, la collection Exploration, qui présente de grandes biographies d’explorateurs avec une prédilection pour les mondes polaires, enfin la collection Démarches, initiée en 2013 par Jean-Christophe Rufin avec Immortelle randonnée, et dans laquelle nous souhaitons inviter des écrivains à vivre une grande aventure et à la raconter. Cette année est donc à la fois un anniversaire important et un renouveau pour nos livres. Dans la continuité de l’œuvre de Michel Guérin, je suis très fier de vous présenter ce catalogue, fruit de la passion de nos équipes et de notre amour partagé pour le livre. -

Travel Update for Nepal, Spring 2005. Tourism Arrivals in Nepal Continue
382 THE AMERICAN ALPINE JOURNAL, 2005 Nepal Travel update for Nepal, spring 2005. Tourism arrivals in Nepal continue to plummet due to increasing violence surrounding the growing Maoist insurgency, and the February 1st royal takeover of political control of the country. According to the Nepal Tourism Board, tourist arrivals during the spring climbing season are down 34 percent from last year. The country continues to be crippled by frequent transportation strikes and blockades of urban areas by Maoist guerillas. In a bold move that brought intense scrutiny from the international community, Nepal’s King Gyanendra seized control of country and the Royal Nepal Army in what has been equated to a “bloodless coup.” The King cited great domestic instability and the inability of the demo- cratic government to properly address the Maoist insurgency as justification for his actions. He vowed to quickly restore peace to the country and to put an end to the civil war, which has now claimed over 11,000 lives. Since his takeover, scores of human rights activists and protesters have been arrested, and Nepal now tops the list for the highest number of kidnappings and disappearances in the world. Despite the growing conflict, tourists have not been deliberately harmed by either Maoist insurgents or security forces thus far. A well-publicized exception to this occurred when a Russ- ian expedition was attacked by Maoists armed with homemade grenades as they traveled toward Tibet for an attempt on Everest from the north. Two climbers were injured, and the attack was credited to the fact that the group was traveling unaccompanied during a known national transportation strike. -

Di Roccia, Di Ghiaccio, Di Vento, Di Luce: Etnografia Dei Paesaggi Verticali
Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex D.M. 270/2004) in: Antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica Tesi di Laurea Di roccia, di ghiaccio, di vento, di luce: etnografia dei paesaggi verticali. Pratiche del rischio nell‟alpinismo. Relatore Correlatori Ch. Prof. Gianluca Ligi Ch. Prof. Francesco Vallerani Ch. Prof. Antonio Paolillo Laureando Lucia Montefiori Matricola 834152 Anno Accademico 2011 / 2012 2 A Chiara e Irene: sorelle non per nascita, ma per scelta. 3 4 INDICE INTRODUZIONE 11 L’ALPINISMO È... 11 L’ESPERIENZA DI RICERCA 12 INSEGNANTI, MENTORI ED INTERLOCUTORI 26 TEMI E STRUTTURA DELLA RICERCA 28 1 – ELEMENTI DI STORIA DELL’ARRAMPICATA 39 1.1 – NASCITA DELL’ALPINISMO: IL MODO NUOVO DI SALIRE LE MONTAGNE 39 1.2 – LA STAGIONE DEGLI EROI. L’EPICA DELL’ALPINISMO 44 1.2.1 – OCCIDENTALISTI E ORIENTALISTI: LE DUE SCUOLE DELLE ALPI 48 1.4 – GLI ULTIMI TRE PROBLEMI DELLE ALPI 50 1.4.1 – IL CERVINO (4478 M) 50 1.4.2 – L‟EIGER (3970 M) 51 1.4.3 – LE GRANDES JORASSES (4208 M) 52 1.5 – NUOVE SFIDE E CRESCITA DELLE DIFFICOLTÀ: DIRETTISSIME, INVERNALI E SOLITARIE. 54 1.6 – LE POLEMICHE SULLA FERRAGLIA. L’ETICA DELL’ALPINISMO 57 1.7 – TERRITORÎ NUOVI: HIMALAYA E KARAKORUM, ANDE, MONTAGNE ROCCIOSE 60 1.8 – YOSEMITE: LA STAGIONE HIPPIE DELL’ARRAMPICATA 63 1.9 – ANNI ’80 E ’90: LA NASCITA DELL’ARRAMPICATA SPORTIVA E LA RIBALTA DELLO SPIT 66 1.10 – SPAZÎ ED ETICHE DEL NUOVO MILLENNIO: BOULDERING, BUILDERING, FREESOLO, DEEPWATERSOLO, FREEBASE, VELOCISTI. 69 2 – L’ALPINISMO COME COMMENTO E CRITICA SOCIALE 73 2.1 – ACCENNI DI STORIA DEL PENSIERO ALPINISTICO 74 2.2 – CONVERSANDO CON GLI ALPINISTI 82 2.3 – I PERCHÉ DELL’ALPINISMO 89 5 3 – PAESAGGI VERTICALI: L’IMMENSO E LA PAURA 93 3.1 – TIPI DI PARETE E CONFORMAZIONI 94 3.2 – ARRAMPICATA E ALPINISMO 110 3.3 – NOTE DI GEOMORFOLOGIA 113 3.4 – CAMMINO, QUINDI ARRAMPICO 129 3.4.1 – PRESE E APPOGGI 132 3.4.2 – TECNICHE DI PROGRESSIONE 136 3.4.3 – SLACKLINING E ROPEJUMPING 141 3.5 – LANDSCAPE E TASKSCAPE 143 3.6 – MAPPE: DISTANZE, TEMPO E DISLIVELLI 148 3.7 – LINEE 152 3.8 – L’IMMENSO E LA PAURA 158 4 – ALPINISMO. -

A History of Passion
International Alliance for Mountain Film A HISTORY OF PASSION 2000-2020 SANDRA TAFNER International Alliance for Mountain Film edited the text A history of passion based on the memories of ALDO AUDISIO, ANTONIO CEMBRAN, MIREILLE CHIOccA, JOAN SALARICH with testimonies by JAVIER BARAYAZARRA, DANIEL BURLAC, BILLY CHOI, ROBERTO DE MARTIN, MARCELLA FRATTA, TOON HEZEMANS, THIJS HORBACH, GABRIELA KÜHN, BERNADETTE MCDONALD, ANGELICA NATTA-SOLERI, MICHAEL PAUSE, MARCO RIBETTI, VALERIANA ROSSO, ANGELO SCHENA, PIERRE SIMONI, BASANTA THAPA and the archive documentation of the INTERNATIONAL ALLIANCE FOR MOUNTAIN FILM PAGE 7 ALDO AUDISIO has compiled the tables in the section IAMF Portrait with data from the minutes from the assemblies, working meetings, discussions and charters of the INTERNATIONAL ALLIANCE FOR MOUNTAIN FILM A HISTORY OF PASSION PAGE 29 2000-2020 Editorial coordination by ALDO AUDISIO Translation from Italian to English GABRIELA KÜHN Editing for English version BERNADETTE MCDONALD © INTERNATIONAL ALLIANCE FOR MOUNTAIN FILM Published by: THE INTERNATIONAL ALLIANCE FOR MOUNTAIN FILM TURIN, 2020 The International Alliance for Mountain Film is over twenty years old. Many years have passed since it was founded in the Hall of Emblems at the Mountain Museum in Turin, Italy. There is a photo of that meeting showing the nine representatives who first roped up together as a smiling team. Year after year, many others joined; now there are twenty-eight members. Though the number has tripled, the common goal remains the same as it was back then: to promote, enhance, and preserve mountain cinema. In twenty years, cinema has changed completely, passing from analog to digital systems. Television has also changed, with the growth of thematic channels accessible through smart TVs, computers, tablets, and smartphones, greatly increasing the audience of the works dedicated to the mountains. -

NAC 2003/04 Season Roundup in the Height of Winter, You Know What’S Going in Your Local Mountains
THE A Publication of the American Avalanche Association REVIEW US $4.95 VOLUME 23, NO. 1 • OCTOBER 2004 Web site: www.AmericanAvalancheAssociation.org NAC 2003/04 Season Roundup In the height of winter, you know what’s going in your local mountains. But keeping up with what’s happening elsewhere is not easy. You might hear vague stories about snow droughts or big storm cycles well after the fact. Sometimes you might hear conflicting rumors about the same event. This issue’s feature article is your chance to catch up before the upcoming season gets started. As it is has for the past two years, The Avalanche Review is starting its season by featuring reports from the Forest Service Regional Avalanche Centers—the centers that issue avalanche advisories for backcountry skiers, snowmobilers, snowboarders, and other winter recreationists. These reports summarize weather and avalanche conditions, any notable incidents or accidents, and center activities and growth. We’re also featuring an analysis of off-piste accidents in France last season. Take a look; find out what happened in the backcountry last season. —story starts on page 14 In This Issue From the President. .2 Correspondence . .3 Metamorphism . .3 AAA News . .4 What’s New . .5 Media License to Learn . .6 Snow Science France 2003/04 . .7 COVER FEATURE NAC 2003/2004 Season Roundup Utah Avalanche Center . 14 Southeast Alaska Avalanche Center. 14 Sawtooth National Forest Avalanche Center . 14 US Forest Service Mt Shasta Avalanche Center . 15 Northwest Weather and Avalanche Center . 15 Payette National Forest Avalanche Center. 16 Idaho Panhandle National Forest Avalanche Center . -

Les Documentaires De Jean-Paul Janssen, Esthétique Et Médiatisation De L'escalade De Patrick Edlinger
Diplôme national de master Domaine - sciences humaines et sociales Mention - sciences de l’information et des bibliothèques Spécialité - cultures de l’écrit et de l’image Septembre 2014 Septembre / Les documentaires de Jean-Paul aster 2 aster Janssen, esthétique et médiatisation de l’escalade de Patrick Edlinger émoire deM émoire M Anne Turpin-Hutter Sous la direction de Madame Evelyne Cohen Professeure d’Histoire et d’Anthropologie culturelles du XXe siècle – Enssib REMERCIEMENTS Je tiens tout d’abord à remercier ma directrice de mémoire, Madame Evelyne Cohen, pour l’aide et les conseils qu’elle m’a procurés pour ce travail, mais aussi l’écoute qu’elle m’a apportée durant ces deux années de Master à l’Enssib. Un grand merci à Jean-Michel Asselin qui m’a guidé dans l’air libre de Patrick. Je remercie très chaleureusement Laurent Chevallier et Antoine Le Menestrel qui se sont montrés tout disposés à m’accorder leur sympathie et leur temps pour répondre à mes nombreuses interrogations et me parler de l’époque Edlinger. Merci à Albane, binôme d’escalade et infaillible relectrice, pour ton enthousiasme et tes encouragements si bénéfiques ! Enfin, merci à Patrick Edlinger, pour le rêve que tu nous as inspiré, pour toutes les passions que tu as fait naître. TURPIN-HUTTER Anne | Master 2 Cultures de l’Écrit et de l’Image | Mémoire | Septembre 2014 3 Droits d’auteur réservés. RÉSUMÉ En France, pour beaucoup l’escalade libre est associée à une figure, celle de Patrick Edlinger en solitaire dans les gorges du Verdon. Cette image immortalisée au début des années 1980 par les documentaires de Jean-Paul Janssen, La vie au bout des doigts et Opéra vertical, a fondé la naissance médiatique de cette pratique encore inédite. -

L'alpinismo in Cina: Aspetti Storici E Analisi Dell'attrezzatura Alpinistica
Corso di Laurea Magistrale in Lingue, economie e istituzioni dell’Asia e dell’Africa Mediterranea Tesi di Laurea L’alpinismo in Cina: aspetti storici e analisi dell’attrezzatura alpinistica nel mercato cinese, con repertorio terminografico italiano-cinese Relatore Ch. Prof. Franco Gatti Correlatore Ch. Prof. Magda Abbiati Laureando Stefano Pandolfo Matricola 849355 Anno Accademico 2017 / 2018 Il vero nucleo dello spirito vitale di una persona è la passione per l'avventura. La gioia di vivere deriva dall'incontro con nuove esperienze, e quindi non esiste gioia più grande dell'avere un orizzonte in costante cambiamento, del trovarsi ogni giorno sotto un sole nuovo e diverso. Christopher McCandless 前言 这篇论文的题目是《中国登山的历史发展与中国登山工具市场的分析》。 这篇论文分为三个部分:第一个是登山与登山工具的描写,第二个包含关于登山的一项意汉 专业术语的调查,第三个包括意/汉词典与汉/意词典。最后,有参考书目、参考互联网站。 第一个部分也分为四章:第一章是关于国际登山发展的历史回顾的。第二章特别注意中国的 登山活动。第三章介绍登山和攀岩领域上最常用的工具。第四章分析这些工具在中国市场的 流通。 我觉得深入地分析全球登山的发展非常重要,因为这有助于理解中国登山的特点。但是,国 际登山有很长的历史,所以我决定主要分别十一个时期:在第一个时期,我介绍登山的来源 。第二个时期,从一七八六年到一八六五年,是登山的诞生,被称为登山的黄金时期。第三 个时期,到一九零零年,介绍所谓“运动登山”的特点。然后,我分析“自由攀岩”的时期 ,也就是说从一九零零年到第一次世界大战开始。第一次世界大战的时候,登山活动放缓了 ,但是人们发明了很多更安全的、更轻便的新工具。这些发明让攀岩者避免很多的忧虑,这 就造成了登山难度等级的提高,比如说世界上第一个6°难度等级(一九二五年)。然后, 第六个是意大利登山者的压倒性优势的时期(从一九三零年到第二次世界大战开始)。第二 次世界大战以后的登山涉及到“机械攀岩”的诞生、Bonatti的优势和在喜马拉雅的活动。 第八个时期,从一九六零年到一九八零年,是关于登山大革命的;这次革命是在美国开始的 。一些加利福尼亚的攀岩者拒绝登山的严格原则了,所以他们开始发展自己的原则,这就造 成了所谓“Free climbing”。这个现象的全球推广导致登山活动的分别。这些分别是第九 个时期的主要特点:登山继续自己的发展,反而攀岩成为一场独立的体育运动,被称为“运 动攀岩”。第十个时期,从一九八零年到一九九零年,主要分析运动攀岩在全球范围之内的 爆炸与难度等级的提高。这个时期的登山活动的记录也很重要。第十一个时期是从二零零零 年到现在的:登山,攀岩都是大众的体育运动,获得越来越人的兴趣,越来越人的参加。