L'élection De 1997
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
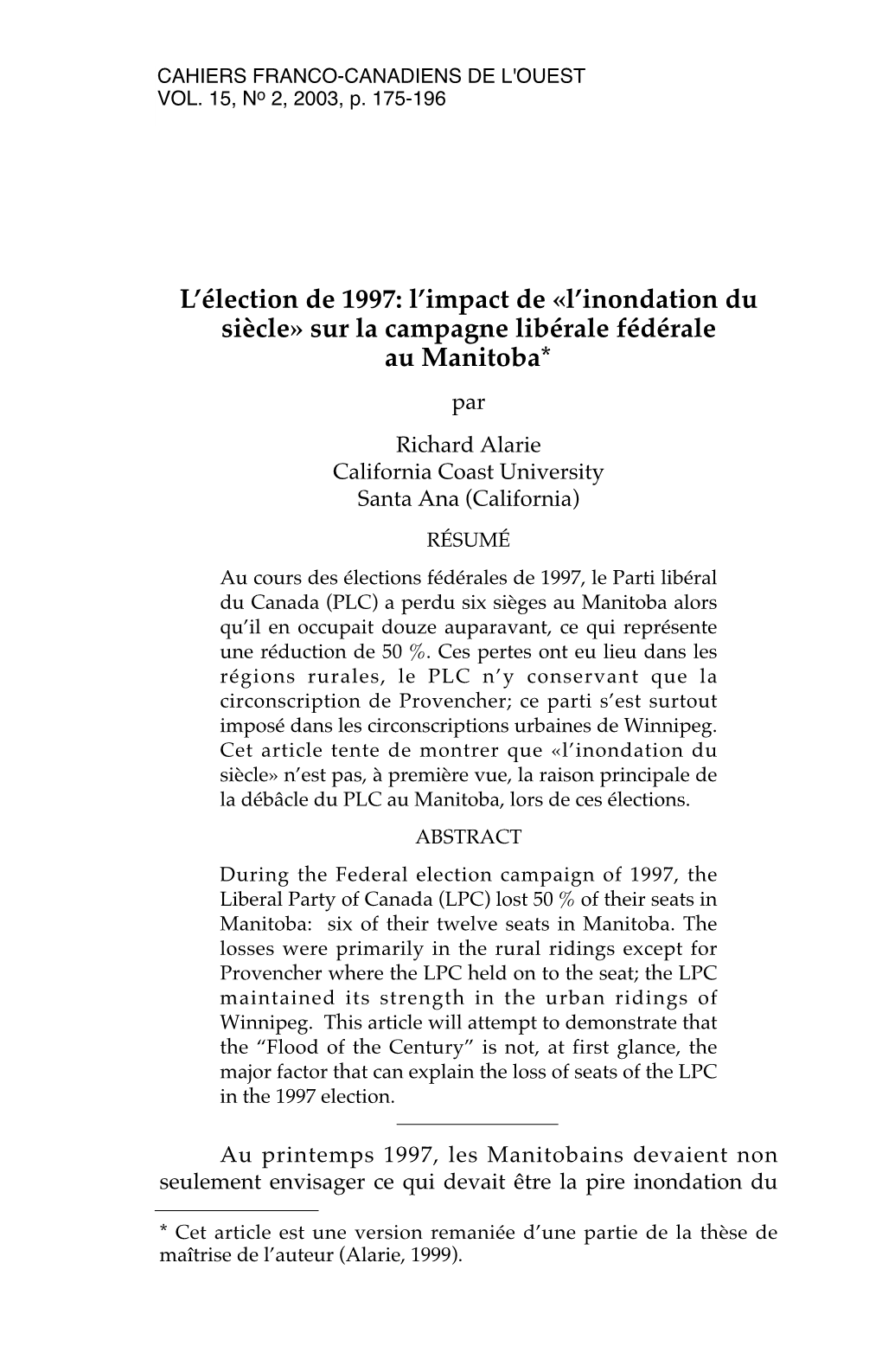
Load more
Recommended publications
-

Mennonite Institutions
-being the Magazine/Journal of the Hanover Steinbach Historical Society Inc. Preservings $10.00 No. 18, June, 2001 “A people who have not the pride to record their own history will not long have the virtues to make their history worth recording; and no people who are indifferent to their past need hope to make their future great.” — Jan Gleysteen Mennonite Institutions The Mennonite people have always been richly Friesen (1782-1849), Ohrloff, Aeltester Heinrich portant essay on the historical and cultural origins endowed with gifted thinkers and writers. The Wiens (1800-72), Gnadenheim, and theologian of Mennonite institutions. The personal reflections seminal leaders in Reformation-times compiled Heinrich Balzer (1800-42) of Tiege, Molotschna, of Ted Friesen, Altona, who worked closely with treatises, polemics and learned discourses while continued in their footsteps, leaving a rich literary Francis during his decade long study, add a per- the martyrs wrote hymns, poetic elegies and in- corpus. sonal perspective to this important contribution to spirational epistles. During the second half of the The tradition was brought along to Manitoba the Mennonite people. The B. J. Hamm housebarn in the village of Neu-Bergthal, four miles southeast of Altona, West Reserve, Manitoba, as reproduced on the cover of the second edition of E. K. Francis, In Search of Utopia, republished by Crossway Publications Inc., Box 1960, Steinbach, Manitoba, R0A 2A0. The house was built in 1891 by Bernhard Klippenstein (1836-1910), village Schulze, and the barn dates to the founding of the village in 1879, and perhaps even earlier to the village of Bergthal in the East Reserve. -

Friday, October 2, 1998
CANADA VOLUME 135 S NUMBER 131 S 1st SESSION S 36th PARLIAMENT OFFICIAL REPORT (HANSARD) Friday, October 2, 1998 Speaker: The Honourable Gilbert Parent CONTENTS (Table of Contents appears at back of this issue.) All parliamentary publications are available on the ``Parliamentary Internet Parlementaire'' at the following address: http://www.parl.gc.ca 8689 HOUSE OF COMMONS Friday, October 2, 1998 The House met at 10 a.m. An hon. member: Let us not exaggerate. _______________ Hon. Don Boudria: —in its supposed wisdom, to resort to a procedural mechanism so as to prevent the bill from going forward. Prayers The opposition has asked that consideration of the bill to help small businesses be postponed for six months. _______________ Hon. Lucienne Robillard: What a contradiction! GOVERNMENT ORDERS Hon. Don Boudria: The Minister of Citizenship and Immigra- tion points out how contradictory this is. She is, as usual, right on the mark. D (1005) It is important that this bill to help small businesses go ahead. [English] [English] CANADA SMALL BUSINESS FINANCING ACT It is important that the opposition not cause delays on this bill by The House resumed from September 29 consideration of the moving dilatory motions, hoist motions or other procedural tricks motion that Bill C-53, an act to increase the availability of to stop this bill from going ahead. I do not think procedural tricks financing for the establishment, expansion, modernization and should be going on. Therefore I move: improvement of small businesses, be read the second time and That the question be now put. referred to a committee. -

Wednesday, June 1, 1994
VOLUME 133 NUMBER 076 1st SESSION 35th PARLIAMENT OFFICIAL REPORT (HANSARD) Wednesday, June 1, 1994 Speaker: The Honourable Gilbert Parent HOUSE OF COMMONS Wednesday, June 1, 1994 The House met at 2 p.m. and not merely wishful thinking, and urge the CBC to provide adequate television coverage of our disabled athletes at the next _______________ Summer Games. Prayers In doing so, we will express the admiration and respect which their exceptional achievements deserve. _______________ * * * STATEMENTS BY MEMBERS [English] [English] BILLS C–33 AND C–34 LAW OF THE SEA Mr. John Duncan (North Island—Powell River): Mr. Speaker, yesterday we had the introduction of Bills C–33 and Hon. Charles Caccia (Davenport): Mr. Speaker, straddling C–34 which would ratify land claims and self–government the 200 nautical mile limit there is a fish stock which is of great agreements in Yukon. Last week we were told the government importance to the existence and well–being of many coastal wished to have these bills introduced later in June with the communities in Atlantic Canada. understanding that MPs would have time to prepare properly. Designed to avoid crisis in the fisheries, the law of the sea These bills represent the culmination of 21 years of mostly affirms the responsibility of all nations to co–operate in con- behind closed doors work without the involvement of federal serving and managing fish in the high seas. It is in the interests parliamentarians. Today, 24 hours after tabling, Parliament is of Canadians that the Government of Canada ratify the law of being asked to debate these bills at second reading. -

Wednesday, April 24, 1996
CANADA VOLUME 134 S NUMBER 032 S 2nd SESSION S 35th PARLIAMENT OFFICIAL REPORT (HANSARD) Wednesday, April 24, 1996 Speaker: The Honourable Gilbert Parent CONTENTS (Table of Contents appears at back of this issue.) The House of Commons Debates are also available on the Parliamentary Internet Parlementaire at the following address: http://www.parl.gc.ca 1883 HOUSE OF COMMONS Wednesday, April 24, 1996 The House met at 2 p.m. [English] _______________ LIBERAL PARTY OF CANADA Prayers Mr. Ken Epp (Elk Island, Ref.): Mr. Speaker, voters need accurate information to make wise decisions at election time. With _______________ one vote they are asked to choose their member of Parliament, select the government for the term, indirectly choose the Prime The Speaker: As is our practice on Wednesdays, we will now Minister and give their approval to a complete all or nothing list of sing O Canada, which will be led by the hon. member for agenda items. Vancouver East. During an election campaign it is not acceptable to say that the [Editor’s Note: Whereupon members sang the national anthem.] GST will be axed with pledges to resign if it is not, to write in small print that it will be harmonized, but to keep it and hide it once the _____________________________________________ election has been won. It is not acceptable to promise more free votes if all this means is that the status quo of free votes on private members’ bills will be maintained. It is not acceptable to say that STATEMENTS BY MEMBERS MPs will be given more authority to represent their constituents if it means nothing and that MPs will still be whipped into submis- [English] sion by threats and actions of expulsion. -

Friday, April 30, 1999
CANADA VOLUME 135 S NUMBER 219 S 1st SESSION S 36th PARLIAMENT OFFICIAL REPORT (HANSARD) Friday, April 30, 1999 Speaker: The Honourable Gilbert Parent CONTENTS (Table of Contents appears at back of this issue.) All parliamentary publications are available on the ``Parliamentary Internet Parlementaire'' at the following address: http://www.parl.gc.ca 14527 HOUSE OF COMMONS Friday, April 30, 1999 The House met at 10 a.m. [Translation] _______________ This year is the fourth anniversary of the Open Skies Agreement and the 25th anniversary of the 1974 Air Transport Preclearance Agreement. Prayers These two agreements have worked hand in glove to transform _______________ air passenger travel between Canada and the United States. [English] In the past, travelling from Canada to the United States was long GOVERNMENT ORDERS and arduous because the airlines were often prevented from providing efficient routings by the outdated air agreement. Because of open skies, some 60 U.S. destinations can now be reached D (1005 ) non-stop from 19 Canadian cities and many more can be reached [English] by convenient connections at U.S. hubs. D (1010 ) PRECLEARANCE ACT Parenthetically, I should point out that in transporter traffic, Hon. David M. Collenette (for the Minister of Foreign since the open skies agreement has come in, Canadian carriers Affairs) moved that Bill S-22, an act authorizing the United States dominate that market. Canadian carriers carry more passengers in to preclear travellers and goods in Canada for entry into the United the transporter market than do U.S. carriers. That is a testament to States for the purposes of customs, immigration, public health, the efficiency of Canada’s various airlines. -

Legislative Assembly of Manitoba DEBATES and PROCEEDINGS
Third Session - Thirty-Sixth Legislature of the Legislative Assembly of Manitoba DEBATES and PROCEEDINGS Official Report (Hansard) Published under the authority of The Honourable Louise M. Dacquay Speaker Vol. XLVII No. 36- 1:30 p.m., Tuesday, April29, 1997 MANITOBA LEGISLATIVE ASSEMBLY Thirty-Sixth Legislature Member Constituency Political Affiliation ASIITON, Steve Thompson N.D.P. BARRETT, Becky Wellington N.D.P. CERILLI, Marianne Radisson N.D.P. CHOMIAK, Dave Kildonan N.D.P. CUMMINGS, Glen, Hon. Ste. Rose P.C. DACQUAY, Louise, Hon. Seine River P.C. DERKACH, Leonard, Hon. Roblin-Russell P.C. DEWAR, Gregory Selkirk N.D.P. DOER, Gary Concordia N.D.P. DOWNEY, James, Hon. Arthur-Virden P.C. DRIEDGER, Albert Steinbach P.C. DYCK, Peter Pembina P.C. ENNS, Harry, Hon. Lakeside P.C. ERNST, Jim Charleswood P.C. EVANS, Clif Interlake N.D.P. EVANS, Leonard S. Brandon East N.D.P. FILMON, Gary, Hon. Tuxedo P.C. FINDLAY, Glen, Hon. Springfield P.C. FRIESEN, Jean Wolseley N.D.P. GAUDRY, Neil St. Boniface Lib. GILLESHAMMER, Harold, Hon. Minnedosa P.C. HELWER, Edward Gimli P.C. HICKES, George Point Douglas N.D.P. JENNISSEN, Gerard Flin Flon N.D.P. KOWALSKI, Gary The Maples Lib. LAMOUREUX, Kevin Inkster Lib. LATHLIN, Oscar The Pas N.D.P. LAURENDEAU, Marcel St. Norbert P.C. MACKINTOSH, Gord St. Johns N.D.P. MALOWAY, Jim Elmwood N.D.P. MARTINDALE, Doug Burrows N.D.P. McALPINE, Gerry Sturgeon Creek P.C. McCRAE, James, Hon. Brandon West P.C. McGIFFORD, Diane Osborne N.D.P. MciNTOSH, Linda, Hon. Assiniboia P.C. -

Élection 97 : La Campagne Libérate Fédérale Au Manitoba
Élection 97 : La campagne libérate fédérale au Manitoba par Richard René J. Alarie Thèse présentée à la Faculté des études supérieures de I'Université du Manitoba en vue de l'obtention d'une Maîtrise ès arts Département d'Études politiques Université du Manitoba Winnipeg, Manitoba @ Richard Alarie, 1999 N¡$onat t-iorav nationare I*I Sit[i|;¡:" Acquisitions and Acquisitions et Bibiiographic Services services bibliographiques 395 Wellington Street 395, rue Wellington Ottawa O¡'¡ XIR Ot'l¿ Ottawa ON K1A 0N4 Canada Canada Yout l¡le volrc rélérence Our l¡le Nolre rélérence The author has granted a non- L'auteur a accordé une licence non exclusive licence allowing the exclusive permettant à la National Library of Canada to Bibliothèque nationale du Canada de Il reproduce, loan, distribute or sell reproduire, prêter, distribuer ou ; ', copies of this thesis in microform, vendre des copies de cette thèse sous paper or electronic forrnats. la forme de microfiche/fiIm, de reproduction sur papier ou sur format i électronique. The author retains ownership of the L'auteur conserve la propriété du copynght in this thesis. Neither the droit d'auteur qui protège cette thèse. thesis nor substantiat extracts from it Ni la thèse ni des extraits substantiels may be printed or otherwise de celle-ci ne doivent être imprimés reproduced without the author's ou autrement reproduits Sans son permission. autorisation. 0-61241675-5 Canadä THE I]NTYERSITY OF II,IANITOBA FACT'LTY OF GRADUATE STT]DIES ***** COPYRIGHT PERMISSION PAGE Élection gTzLtcampagne libérale fédérale au M¡nitoba by Richard René J. Alarie A Thesis/Practicum submitted to the Faculty of Graduate Studies of The Universþ of Manitoba in partial ftrlfillment of the requirements of the degree of Master of Arts Richard René J. -
Steinbach Post
80 years of progress Derksen Printers founder chooses ink over plow printing plant. By this time, The Carillon by Wes Keating News had become a force in the com- ERHARD S. Derk- munity beside its parent publication, The Steinbach Post. sen found it difficult The firm contracted printing jobs of to adjust to the farm a hundred various descriptions. And the G rest, as they say, is history. life on the Saskatchewan The Gerhard S. Derksen who started prairie, and nine years after it all 80 years ago would be able to look immigrating to Canada he back with amazement at the changes new technology has wrought. moved his wife and young Plant supervisor, plant manager, pro- family to Steinbach where duction boss or whatever other title he answers to, Norm Sobering has only he began work as a writer been with the company for 38 years, and with the German-language in that time the changes he has seen have newspaper, The Steinbach been amazing enough. Sobering says the linotype machines Post. were still at the shop when he started At the time, the German newspaper work as a young press man in 1978. But and its small commercial printing shop even then, they were dinosaurs, standing was operated by Arnold Dyck, a friend idle at the back door, waiting to be hauled and former colleague of Derksen’s in away to the scrap heap. The era of lead Russia. type was definitely over. By 1936, Derksen reached a position Installation of $50,000 worth of com- where he could buy the business. -

Heritage Posting
HERITAGE POSTING Newsletter of the Manitoba Mennonite Historical Society No.26 September 1999 The reenactment of the 31 July 1874 landing of Mennonite arrivals at About 1800 persons gathered for the 12Sth anniversary service at the the forks of the Assiniboine and Red Rivers was part of the 12Sth Mennonite Heritage Village museum, also on 1 August 1999. Many anniversary worship service held on Sunday, 1 August 1999 at The people attended both this and The Forks service. Photo: Courtesy of Forks in Winnipeg. Photo: Courtesy of Bill Stoesz, Altona, MB. Isbrand Hiebert, Der Bote editor, Steinbach, MB The 125 th Anniversary of Mennonite Arrival Celebrated at The Forks and Museum by Bert Friesen and Elmer Heinrichs On Sunday, 1 August 1999 Mennonites from across the former behalf of the province by the Honourable Jack Reimer, Member of East Reserve and West Reserve, and from Winnipeg, interested in the Legislative Assembly of Manitoba for Niakwa; and on behalf of their own history gathered to celebrate the 125th anniversary of their the City and The Forks corporation by Mrs. Janice Penner. forefathers' arrival in Manitoba. Over 1000 people attended the Finally, all direct descendants of the 1870s migration were invited Forks event and many more were at the worship service held at the to board the river boat for a photograph to duplicate a well-known Mennonite Heritage Village that same morning photograph taken of that original group landing 125 years ago. The Forks event featured a reenactment of the landing of the fIrst At Mennonite Heritage Village, in Steinbach, another heritage group with the S. -

Friday, March 5, 1999
CANADA VOLUME 135 S NUMBER 190 S 1st SESSION S 36th PARLIAMENT OFFICIAL REPORT (HANSARD) Friday, March 5, 1999 Speaker: The Honourable Gilbert Parent CONTENTS (Table of Contents appears at back of this issue.) All parliamentary publications are available on the ``Parliamentary Internet Parlementaire'' at the following address: http://www.parl.gc.ca 12481 HOUSE OF COMMONS Friday, March 5, 1999 The House met at 10 a.m. As I said, it is important from my point of view to put into context the importance of Bill C-49 and the contribution that it will _______________ make to ensuring a commitment which this government has to work with first nations to build self-reliance and to provide first Prayers nations the opportunity to have the social and economic control _______________ that they need to have to better their lives within the community and the lives of their community members. GOVERNMENT ORDERS Second, if I have the time I would like to explore some of the issues that have been raised in the last few days with respect to Bill D (1000 ) C-49. I anticipate that I will be able to do that. If not, I know my parliamentary secretary will speak to some of those issues. [English] First and foremost, let us consider the context in which Bill C-49 FIRST NATIONS LAND MANAGEMENT ACT finds itself. In this regard I would like to remind the House about Hon. Jane Stewart (Minister of Indian Affairs and Northern the fact that the primary relationship that I as minister of Indian Development, Lib.) moved that Bill C-49, an act providing for the affairs and the Government of Canada has with first nations is ratification and the bringing into effect of the framework agree- through the Indian Act. -

Wednesday, June 7, 1995
VOLUME 133 NUMBER 213 1st SESSION 35th PARLIAMENT OFFICIAL REPORT (HANSARD) Wednesday, June 7, 1995 Speaker: The Honourable Gilbert Parent HOUSE OF COMMONS Wednesday, June 7, 1995 The House met at 2 p.m. Power DirecTv matter, his less than timely visit to Los Angeles and its impact on the Seagram matter, the minister just keeps on _______________ going. Prayers Why should we be surprised that the minister accepted to be the host of a $2,000 a plate dinner organized by a lobbying firm? _______________ Why should we be surprised to see that the minister’s office awarded that very firm three contracts? STATEMENTS BY MEMBERS In light of these revelations, one question comes to mind: Why does the Prime Minister protect this minister who is [English] singlehandedly bringing down the semblance of respectability and ethical conduct that the government has so painstakingly ONTARIO ELECTION built for itself? Mr. Benoît Serré (Timiskaming—French River, Lib.): Mr. Speaker, tomorrow Ontarians will be called on to elect a new * * * government. [English] Mike Harris and his crew are catering to the extreme right by promising unrealistic tax and spending cuts. I call on the ABORIGINAL AFFAIRS Conservative leader to come clean with Ontarians and tell them Mr. Dick Harris (Prince George—Bulkley Valley, Ref.): exactly how these cuts are to affect education, health care and Mr. Speaker, the native blockade at the Douglas Lake ranch has social programs. finally come to an end. It was taken down not because the RCMP I pledge my full support behind Lyn McLeod and her excellent enforced the law and removed this illegal blockade but appar- team of candidates. -

Friday, May 8, 1998
CANADA VOLUME 135 S NUMBER 102 S 1st SESSION S 36th PARLIAMENT OFFICIAL REPORT (HANSARD) Friday, May 8, 1998 Speaker: The Honourable Gilbert Parent CONTENTS (Table of Contents appears at back of this issue.) All parliamentary publications are available on the ``Parliamentary Internet Parlementaire'' at the following address: http://www.parl.gc.ca 6703 HOUSE OF COMMONS Friday, May 8, 1998 The House met at 10 a.m. The Wal-Mart case in Windsor is an example of what would happen in federally regulated industries if Bill C-19 were to pass without _______________ amendment. Prayers To refresh the memory of hon. members, the Ontario Labour Relations Board ruled that Wal-Mart agreed to certify the union _______________ even though the employees at the Windsor store voted 151 to 43 against it. That was in May 1997. The board contended that Wal-Mart had pressured the employees to vote against the union GOVERNMENT ORDERS with threats that the store would close if it were unionized. Now the employees are fighting to get rid of their union and a decertifica- D (1005) tion drive is under way. Why should they have to go through that? [English] That brings up another problem with Bill C-19. There is no provision in the bill for secret ballots. If there were a provision for CANADA LABOUR CODE secret ballots, both in certification and in strike votes, then there would be no problem with questions of pressure being applied to The House resumed from May 7 consideration of Bill C-19, an workers because nobody would know how they voted.