Mars 1996 Kri,C.A, Numero 8
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Natural Resource Condition Assessment San Juan Island National Historical Park
National Park Service U.S. Department of the Interior Natural Resource Stewardship and Science Natural Resource Condition Assessment San Juan Island National Historical Park Natural Resource Report NPS/SAJH/NRR—2020/2131 ON THIS PAGE View east from Mt. Finlayson at American Camp towards Lopez Island in distance. (Photo by Peter Dunwiddie) ON THE COVER Pacific madrone (Arbutus menziesii) on Young Hill, English Camp. (NPS) Natural Resource Condition Assessment San Juan Island National Historical Park Natural Resource Report NPS/SAJH/NRR—2020/2131 Catherin A. Schwemm, Editor Institute for Wildlife Studies Arcata, CA 95518 May 2020 U.S. Department of the Interior National Park Service Natural Resource Stewardship and Science Fort Collins, Colorado The National Park Service, Natural Resource Stewardship and Science office in Fort Collins, Colorado, publishes a range of reports that address natural resource topics. These reports are of interest and applicability to a broad audience in the National Park Service and others in natural resource management, including scientists, conservation and environmental constituencies, and the public. The Natural Resource Report Series is used to disseminate comprehensive information and analysis about natural resources and related topics concerning lands managed by the National Park Service. The series supports the advancement of science, informed decision-making, and the achievement of the National Park Service mission. The series also provides a forum for presenting more lengthy results that may not be accepted by publications with page limitations. All manuscripts in the series receive the appropriate level of peer review to ensure that the information is scientifically credible, technically accurate, appropriately written for the intended audience, and designed and published in a professional manner. -
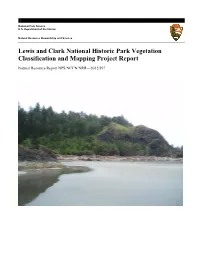
Vegetation Classification and Mapping Project Report
National Park Service U.S. Department of the Interior Natural Resource Stewardship and Science Lewis and Clark National Historic Park Vegetation Classification and Mapping Project Report Natural Resource Report NPS/NCCN/NRR—2012/597 ON THE COVER Benson Beach, Cape Disappointment State Park Photograph by: Lindsey Koepke Wise Lewis and Clark National Historic Park Vegetation Classification and Mapping Project Report Natural Resource Report NPS/NCCN/NRR—2012/597 James S. Kagan, Eric M. Nielsen, Matthew D. Noone, Jason C. van Warmerdam, and Lindsey K. Wise Oregon Biodiversity Information Center Institute for Natural Resources – Portland Portland State University P.O. Box 751 Portland, OR 97207 Gwen Kittel NatureServe 4001 Discovery Dr., Suite 2110 Boulder, CO 80303 Catharine Copass National Park Service North Coast and Cascades Network Olympic National Park 600 E. Park Avenue Port Angeles, WA 98362 December 2012 U.S. Department of the Interior National Park Service Natural Resource Stewardship and Science Fort Collins, Colorado The National Park Service, Natural Resource Stewardship and Science office in Fort Collins, Colorado, publishes a range of reports that address natural resource topics. These reports are of interest and applicability to a broad audience in the National Park Service and others in natural resource management, including scientists, conservation and environmental constituencies, and the public. The Natural Resource Report Series is used to disseminate high-priority, current natural resource management information with managerial application. The series targets a general, diverse audience, and may contain NPS policy considerations or address sensitive issues of management applicability. All manuscripts in the series receive the appropriate level of peer review to ensure that the information is scientifically credible, technically accurate, appropriately written for the intended audience, and designed and published in a professional manner. -

Vegetation Classification for San Juan Island National Historical Park
National Park Service U.S. Department of the Interior Natural Resource Stewardship and Science San Juan Island National Historical Park Vegetation Classification and Mapping Project Report Natural Resource Report NPS/NCCN/NRR—2012/603 ON THE COVER Red fescue (Festuca rubra) grassland association at American Camp, San Juan Island National Historical Park. Photograph by: Joe Rocchio San Juan Island National Historical Park Vegetation Classification and Mapping Project Report Natural Resource Report NPS/NCCN/NRR—2012/603 F. Joseph Rocchio and Rex C. Crawford Natural Heritage Program Washington Department of Natural Resources 1111 Washington Street SE Olympia, Washington 98504-7014 Catharine Copass National Park Service North Coast and Cascades Network Olympic National Park 600 E. Park Ave. Port Angeles, Washington 98362 . December 2012 U.S. Department of the Interior National Park Service Natural Resource Stewardship and Science Fort Collins, Colorado The National Park Service, Natural Resource Stewardship and Science office in Fort Collins, Colorado, publishes a range of reports that address natural resource topics. These reports are of interest and applicability to a broad audience in the National Park Service and others in natural resource management, including scientists, conservation and environmental constituencies, and the public. The Natural Resource Report Series is used to disseminate high-priority, current natural resource management information with managerial application. The series targets a general, diverse audience, and may contain NPS policy considerations or address sensitive issues of management applicability. All manuscripts in the series receive the appropriate level of peer review to ensure that the information is scientifically credible, technically accurate, appropriately written for the intended audience, and designed and published in a professional manner. -

Appendix E Nisqually Species List
Appendix E: Nisqually NWR Species Lists E.1 PLANTS Genus and Species Family Common Name Wetland Status Trees Abies grandis Pinaceae grand fir FACU- Acer macrophyllum Aceraceae big-leaf maple FACU * Acer saccharum Aceraceae sugar maple Alnus rubra Betulaceae red alder FAC Amelanchier alnifolia Rosaceae western serviceberry FACU Arbutus menziesii Ericaceae pacific madrone Cornus nuttallii Cornaceae pacific dogwood Crataegus douglasii Rosaceae Douglas’s (black) hawthorn FAC * Crataegus laevigata cv. Rosaceae Paul's scarlet * Crataegus x lavallei Rosaceae hawthorn * Crataegus monogyna Rosaceae common hawthorn Fraxinus latifolia Oleaceae Oregon ash FACW * Ilex aquifolium Aquifoliaceae English holly Malus fusca [Pyrus f.] Rosaceae Oregon crab apple FAC+ Picea engelmannii Pinaceae Engelmann spruce Picea sitchensis Pinaceae Sitka spruce FAC Pinus contorta var. c. Pinaceae shore pine FAC- * Populus alba Salicaceae white poplar Populus balsamifera Salicaceae black cottonwood FAC ssp. trichocarpa [P. t. ] * Populus nigra var. italica Salicaceae Lombardy poplar Populus tremuloides Salicaceae quaking aspen FAC+ * Prunus avium Rosaceae sweet cherry Prunus emarginata var. mollis Rosaceae bitter cherry FACU Prunus virginiana var. demissa Rosaceae choke cherry FACU Pseudotsuga menziesii var. m. Pinaceae Douglas-fir * Pyrus communis Rosaceae cultivated pear * Pyrus malus Rosaceae cultivated apple Rhamnus purshiana [Frangula p.] Rhamnaceae cascara FAC- Salix scouleriana Salicaceae Scouler’s willow FAC * Sorbus aucuparia Rosaceae European mountain ash Taxus brevifolia Taxaceae pacific yew FACU- Thuja plicata Cupressaceae western redcedar FAC Tsuga heterophylla Pinaceae western hemlock FACU- * Note: * indicates non-native (introduced) Appendix E.1: Plant List E-1 Nisqually NWR Final CCP/EIS Genus and Species Family Common Name Wetland Status Shrubs, Brambles & Vines Acer circinatum Aceraceae vine maple FACU+ Arctostaphylos uva-ursi var. -

Checklist of the Vascular Plants of San Diego County 5Th Edition
cHeckliSt of tHe vaScUlaR PlaNtS of SaN DieGo coUNty 5th edition Pinus torreyana subsp. torreyana Downingia concolor var. brevior Thermopsis californica var. semota Pogogyne abramsii Hulsea californica Cylindropuntia fosbergii Dudleya brevifolia Chorizanthe orcuttiana Astragalus deanei by Jon P. Rebman and Michael G. Simpson San Diego Natural History Museum and San Diego State University examples of checklist taxa: SPecieS SPecieS iNfRaSPecieS iNfRaSPecieS NaMe aUtHoR RaNk & NaMe aUtHoR Eriodictyon trichocalyx A. Heller var. lanatum (Brand) Jepson {SD 135251} [E. t. subsp. l. (Brand) Munz] Hairy yerba Santa SyNoNyM SyMBol foR NoN-NATIVE, NATURaliZeD PlaNt *Erodium cicutarium (L.) Aiton {SD 122398} red-Stem Filaree/StorkSbill HeRBaRiUM SPeciMeN coMMoN DocUMeNTATION NaMe SyMBol foR PlaNt Not liSteD iN THE JEPSON MANUAL †Rhus aromatica Aiton var. simplicifolia (Greene) Conquist {SD 118139} Single-leaF SkunkbruSH SyMBol foR StRict eNDeMic TO SaN DieGo coUNty §§Dudleya brevifolia (Moran) Moran {SD 130030} SHort-leaF dudleya [D. blochmaniae (Eastw.) Moran subsp. brevifolia Moran] 1B.1 S1.1 G2t1 ce SyMBol foR NeaR eNDeMic TO SaN DieGo coUNty §Nolina interrata Gentry {SD 79876} deHeSa nolina 1B.1 S2 G2 ce eNviRoNMeNTAL liStiNG SyMBol foR MiSiDeNtifieD PlaNt, Not occURRiNG iN coUNty (Note: this symbol used in appendix 1 only.) ?Cirsium brevistylum Cronq. indian tHiStle i checklist of the vascular plants of san Diego county 5th edition by Jon p. rebman and Michael g. simpson san Diego natural history Museum and san Diego state university publication of: san Diego natural history Museum san Diego, california ii Copyright © 2014 by Jon P. Rebman and Michael G. Simpson Fifth edition 2014. isBn 0-918969-08-5 Copyright © 2006 by Jon P. -

Idaho's Special Status Vascular and Nonvascular Plants
Idaho's Special Status Vascular and Nonvascular Plants IDNHP Tracked Species Conservation Rankings ³ INPS 4 Scientific Name1 Synonyms Common Name² G-Rank S-Rank USFWS BLM USFS_R1 USFS_R4 USFS_R6 RPC Abronia elliptica dwarf sand-verbena G5 S1 Feb-14 Abronia mellifera white sand-verbena G4 S1S2 Feb-16 Acorus americanus Acorus calamus var. americanus sweetflag G5 S2 Feb-16 Agastache cusickii Agastache cusickii var. parva Cusick's giant-hyssop G3G4 S2 Feb-14 Agoseris aurantiaca var. aurantiaca, Agoseris lackschewitzii pink agoseris G4 S1S2 4 S Feb-16 A. aurantiaca var. carnea Agrimonia striata roadside agrimonia G5 S1 Feb-16 Allenrolfea occidentalis Halostachys occidentalis iodinebush G4 S1 Feb-16 Allium aaseae Aase's Onion G2G3+ S2S3 2 Oct-11 Allium anceps Kellogg's Onion G4 S2 4 Allium columbianum Allium douglasii var. columbianum Columbia onion G3 S3 Feb-16 Allium madidum swamp onion G3 S3 S Allium tolmiei var. persimile Sevendevils Onion G4G5T3+ S3 4 S Allium validum tall swamp onion G4 S3 Allotropa virgata sugarstick G4 S3 S Amphidium californicum California amphidium moss G4 S1 Feb-16 Andreaea heinemannii Heinemann's andreaea moss G3G5 S1 Feb-14 Andromeda polifolia bog rosemary G5 S1 S Anemone cylindrica long-fruit anemone G5 S1 Angelica kingii Great Basin angelica G4 S1 3 Mar-18 Antennaria arcuata meadow pussytoes G2 S1 Mar-18 Arabis sparsiflora var. atrorubens Boechera atroruben sickle-pod rockcress G5T3 S3 Argemone munita ssp. rotundata prickly-poppy G4T4 SH Feb-16 Artemisia borealis, A. campestris ssp. borealis, Artemisia campestris ssp. borealis var. purshii boreal wormwood G5T5 S1 A. campestris ssp. purshii Artemisia sp. -

Vplyv Výsevku Na Produkciu Stoklasu Horského
SLOVENSKÁ PO ĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV 2122358 VPLYV VÝSEVKU NA PRODUKCIU STOKLASU HORSKÉHO 2011 Katarína Kolenová, Bc. SLOVENSKÁ PO ĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV VPLYV VÝSEVKU NA PRODUKCIU STOKLASU HORSKÉHO Diplomová práca Študijný program: Udržate ľné po ľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Študijný odbor: 6.1.1 Všeobecné po ľnohospodárstvo Školiace pracovisko: Katedra trávnych ekosystémov a k ŕmnych plodín Školite ľ: Ing. Ľuboš Vozár, PhD. Nitra 2011 Katarína Kolenová, Bc. Čestné vyhlásenie Podpísaná Katarína Kolenová vyhlasujem, že som závere čnú prácu na tému „Vplyv výsevku na produkciu stoklasu horského“ vypracovala samostatne s použitím uvedenej literatúry. Som si vedomá zákonných dôsledkov v prípade, ak uvedené údaje nie sú pravdivé. V Nitre 18. apríla 2011 Po ďakovanie Chcela by som po ďakova ť všetkým, ktorí mi akýmko ľvek spôsobom pomohli pri vypracovaní tejto diplomovej práce. Moja v ďaka patrí najmä Ing. Ľubošovi Vozárovi, PhD.- vedúcemu diplomovej práce, za odborné vedenie a cenné pripomienky pri spracovaní problematiky. SLOVENSKÁ PO ĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE Fakulta : Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Katedra : Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín Akademický rok: 2010/2011 ZADÁVACÍ PROTOKOL DIPLOMOVEJ PRÁCE Študent: Katarína Kolenová, Bc. Študijný odbor: 6.1.1 Všeobecné po ľnohospodárstvo Študijný program: Udržate ľné po ľnohospodárstvo a rozvoj vidieka V zmysle 3. časti, čl. 21 študijného poriadku SPU v Nitre z roku 2002 Vám zadávam tému diplomovej práce: Vplyv výsevku na produkciu stoklasu horského. Cie ľ práce: Cie ľom práce bolo experimenálne overenie vplyvu výšky výsevku stoklasu horského ( Bromus marginatus Nees ex Steud .) ´Tacit´ na jeho produkciu. Rámcová metodika práce: • získavanie údajov z pokusného stanoviš ťa, • získavanie literárnych zdrojov a informácií, • analýza údajov a literárnych zdrojov, • vypracovanie diplomovej práce. -

(Bromus Carinatus Hooker & Arnott 1840) Im Gebiet Der Regnitzflora
RegnitzFlora - Mitteilungen des Vereins zur Erforschung der Flora des Regnitzgebietes Band 2, S. 17 - 30 , 2008 Die Plattährige Trespe ( Bromus carinatus Hooker & Arnott 1840) im Gebiet der Regnitzflora JOHANN SIGL Zusammenfassung: Bromus carinatus wird zur Sektion Ceratochloa der Gattung Bromus gerechnet. Sie ist im westlichen Nordamerika beheimatet, inzwischen aber durch Verschleppung nahezu weltweit verbreitet. In ihrer Heimat besiedelt die Art vorwiegend Wälder, Grasland, Gebüsche. In Deutschland ist sie seit 1932 nachgewiesen und breitet sich seit etwa 1980 vermutlich vor allem aufgrund der Verwendung in Begrünungsansaaten verstärkt aus. In einigen Bundesländern gilt sie als fest eingebürgert. Die Art scheint zu verwildern und besiedelt dann vor allem ruderal beeinflusste Pflanzengesellschaften. Die Begleitpflanzen setzen sich vorwiegend aus Arten der Gesellschaftsklassen der Stellarietea mediae , Molinio-Arrhe- natheretea und Artemisietea vulgaris zusammen. Die Auswertung der Literaturangaben ergab für Bayern bisher sieben Nachweise, wobei zwei in das Gebiet der Regnitzflora fallen. Drei weitere, in den Jahren 2003 und 2007 neu entdeckte Vorkommen werden dokumentiert, wobei das Vorkommen bei Sengenthal (vermutlich Erstnachweis für die Oberpfalz) näher betrachtet wird. Eine morphologische Beschreibung wird vorgelegt. Für die in Bayern angegebenen drei Arten der Sektion Ceratochloa der Gattung Bromus ( Bromus carinatus , Bromus catharticus , Bromus sitchensis ) wird ein Schlüssel, basierend auf amerikanischer und europäischer Literatur, unter Einschluss der Varietäten beigefügt. Summary: Bromus carinatus is counted among the section Ceratochloa of the genus Bromus . It is native to western North America, but has by now spread almost worldwide. In their homeland the species inhabits predominantly forests, grassland and shrubberies. In Germany it has been detected since 1932 and has been spreading since the 1980s, probably as a result of the deploy- ment in the greening up of public spaces. -

Draft Plant Propagation Protocol
Plant Propagation Protocol for Bromus marginatus Nees ex. Steud ESRM 412 – Native Plant Production Photo By: Jeanne R. Janish 1997 Source: The New York Botanical Garden Source: fs.fed.us North America Distribution Source: USDA Plants Washington State Distribution Source: USDA Plants TAXONOMY Family Names Family Scientific Name: Poaceae Family Common Name: Grass Scientific Names Genus: Bromus Species: marginatus Species Authority: Nees ex. Steud Variety: Sub-species: Cultivar: Bromar Authority for Variety/Sub-species: Common Synonym(s) (include full Bromus breviaristatus Buckley scientific names (e.g., Elymus Bromus carinatus Hook. & Arn. Var. linearis glaucus Buckley), including variety Shear or subspecies information) Bromus marginatus Nees ex. Steud var. breviarstatus (Buckley) Beetle Bromus marginatus Nees ex. Steud var. latior Bromus marginatus Nees ex. Steud var. seminudus Shear Bromus sitchensis Trin. var. marginatus (Nees ex. Steud) B. Bolvin Ceratochloa marginata (Nees ex. Steud) B.D. Jackson Ceratochloa marginata (Nees ex. Steud) W.A. Weber Common Name(s): Mountain Brome, California Brome, Mountain grass Brome Species Code (as per USDA Plants BRMA4 database): GENERAL INFORMATION Geographical range (distribution See above for North American and Washington State maps for North America and distribution). Extends into British Columbia and Washington state) Alberta to South Dakota, New Mexico, and California, mostly on the eastern slope; adventive in Maine, introduced in the mid-west. Ecological distribution (ecosystems it Dry to moist meadows, open woods, wooded slopes, occurs in, etc): waste places like highway right-of-ways, coal mine spills, heavy metal mine tailings (Tilley), and shrublands in the mountains. Likes yellow pine forest, red fir forest, lodepole forest, subalpine forest, alpine fell-fields, and valley grassland. -

Urbanizing Flora of Portland, Oregon, 1806-2008
URBANIZING FLORA OF PORTLAND, OREGON, 1806-2008 John A. Christy, Angela Kimpo, Vernon Marttala, Philip K. Gaddis, Nancy L. Christy Occasional Paper 3 of the Native Plant Society of Oregon 2009 Recommended citation: Christy, J.A., A. Kimpo, V. Marttala, P.K. Gaddis & N.L. Christy. 2009. Urbanizing flora of Portland, Oregon, 1806-2008. Native Plant Society of Oregon Occasional Paper 3: 1-319. © Native Plant Society of Oregon and John A. Christy Second printing with corrections and additions, December 2009 ISSN: 1523-8520 Design and layout: John A. Christy and Diane Bland. Printing by Lazerquick. Dedication This Occasional Paper is dedicated to the memory of Scott D. Sundberg, whose vision and perseverance in launching the Oregon Flora Project made our job immensely easier to complete. It is also dedicated to Martin W. Gorman, who compiled the first list of Portland's flora in 1916 and who inspired us to do it again 90 years later. Acknowledgments We wish to acknowledge all the botanists, past and present, who have collected in the Portland-Vancouver area and provided us the foundation for our study. We salute them and thank them for their efforts. We extend heartfelt thanks to the many people who helped make this project possible. Rhoda Love and the board of directors of the Native Plant Society of Oregon (NPSO) exhibited infinite patience over the 5-year life of this project. Rhoda Love (NPSO) secured the funds needed to print this Occasional Paper. Katy Weil (Metro) and Deborah Lev (City of Portland) obtained funding for a draft printing for their agencies in June 2009. -

Bromus Sitchensis – Neu Für Österreich, Plantago Coronopus – Neu Für Oberösterreich Sowie Weitere Beiträge Zur Kenntnis Der Flora Des Innviertels
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Stapfia Jahr/Year: 2012 Band/Volume: 0097 Autor(en)/Author(s): Hohla Michael Artikel/Article: Bromus sitchensis - neu für Österreich, Plantago coronopus - neu für Oberösterreich sowie weitere Beiträge zur Kenntnis der Flora des Innviertels. 180-192 ©Biologiezentrum Linz, Austria, download www.biologiezentrum.at HOHLA • Beiträge zur Flora des Innviertels STAPFIA 97 (2012): 180–192 Bromus sitchensis – neu für Österreich, Plantago coronopus – neu für Oberösterreich sowie weitere Beiträge zur Kenntnis der Flora des Innviertels MICHAEL HOHLA Abstract: Floristic records of 40 interesting vascular plants are reported including the following taxa as new for the flora of Austria (not mentioned inW ALTER & al. 2002 or FISCHER & al. 2008): Allium oreophilum, Bromus sitchensis, Geranium ×cantabrigense, Geranium ×oxonianum and Melampodium montanum. New for the flora of Upper Austria (not mentioned inH OHLA & al. 2009) are Caryopteris ×clandonensis, Chenopodium foliosum, Clinopodium nepeta s. l., Dianthus giganteus, Hyacinthoides hispanica × H. non- scripta, Malcolmia maritima, Oenothera fruticosa, Plantago coronopus, Ranunculus aquatilis s. str. and Solanum sisymbriifolium. New findings for the region “Böhmische Masse” are those of:Iberis sempervirens and Tagetes patula. New findings for the region “Alpenvorland” in Upper Austria are those of:Draba aizoides and Helleborine hybridus hort. Newly observed in the flora of the Innviertel are:Agrostis castellana, Cardamine flexuosa subsp. debilis, Euphorbia marginata, Misopates orontium, Oenothera biennis × Oe. pycnocarpa and Prunus mahaleb. Rediscoveries in the Innviertel are findings ofCarex riparia, Cynodon dactylon and Festuca pseudovina. New findings of the following taxa which are “critically endangered” in Upper Austria: Cyperus flavescens, Drosera ×obovata, Hydrocharis morsus-ranae, Lemna turionifera, Orobanche lutea and Thalictrum flavum. -

Western Washington Plant List By
The NatureMapping Program Western Washington Plant List Revised: 5/21/2011 (1) Non- native, (2) ID Scientific Name Common Name Plant Family Invasive 2 Acer circinatum Vine maple Aceraceae 763 Acer glabrum Douglas maple Aceraceae 3 Acer macrophyllum Big-leaf maple Aceraceae 470 Acer platinoides* Norway maple Aceraceae 1 484 Acer pseudoplatanus* Sycamore maple Aceraceae 1 4 Acer saccharum* Sugar maple Aceraceae 1 727 Viburnum edule Squashberry Adoxaceae 19 Alisma plantago-aquatica American waterplantain Alismataceae 349 Sagittaria latifolia Broadleaf arrowhead Alismataceae 24 Amaranthus powellii* Powell's amaranth Amaranthaceae 1 255 Narcissus pseudonarcissus* Daffodil Amaryllidaceae 1 327 Rhus diversiloba Poison oak Anacardiaceae 29 Angelica arguta Sharp-tooth angelica Apiaceae 30 Angelica genuflexa Kneeling angelica Apiaceae 31 Angelica lucida Sea-watch Apiaceae 34 Anthriscus scandicina* Chervil Apiaceae 1 96 Conium maculatum* Poison hemlock Apiaceae 1 113 Daucus carota* Queen Anne's lace Apiaceae 1 167 Heracleum lanatum Cow parsnip Apiaceae 766 Heracleum mantegazzianum Giant hogweed Apiaceae 1 175 Hydrocotyle ranunculoides Marsh penny-wort Apiaceae 204 Lilaeopsis occidentalis Lilaeopsis Apiaceae 261 Oenanthe sarmentosa Water parsley Apiaceae 474 Osmorhiza chilensis Sweet-cicely Apiaceae 264 Osmorhiza occidentalis Western sweet-cicely Apiaceae 359 Sanicula crassicaulis Pacific sanicle Apiaceae 492 Sanicula graveolens Northern sanicle Apiaceae 450 Vinca major* Periwinkle Apocynaceae 1 180 Ilex aquifolium* English holly Aquifoliaceae 2