The Historical Review/La Revue Historique
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Economics the ROLE of DIMITRIE CANTEMIR
“Dimitrie Cantemir” Christian University Knowledge Horizons - Economics Volume 6, No. 2, pp. 209–211 P-ISSN: 2069-0932, E-ISSN: 2066-1061 © 2014 Pro Universitaria www.orizonturi.ucdc.ro THE ROLE OF DIMITRIE CANTEMIR IN THE ROMANIAN PEOPLE’S CULTURE Anda -Nicoleta ONE ȚIU Lecturer, Universitary Doctor, The Faculty of International Relations, „Dimitrie Cantemir” Christian University , Bucharest, Economic, Romania, E-mail: [email protected] Abstract Dimitrie Can temir, was twice Prince of Moldavia (in March -April 1693 and in 1710 -1711). He was Key words: also a prolific man of letters, philosopher, historian, composer, musicologist, linguist, etnographer Geographer, and geographer between 1711 and 1719, he wrote his most important creations. Cantemir was philosopher, historian, known as one of the greatest linguists of his time, speaking and writing eleven languages and being composer, linguist well versed in Oriental Scholarship. This oeuvre is voluminous, diverse and original; although some JEL Codes: of his scientic writings contain unconfirmed theories, his expertise, sagacity and groundbreaking. 1. Introduction Soultan’s Court, but, even if he was involved in such As a romanian chronicler (author of chronicles), Dimitrie conditions, he followed his path to learn at the Cantemir represents the most important personality of Patriarchy’s Academy, in order to complete his studies the romanian literature in the feudal era. He won the in such fields as: logics, philosophy, geography, history, respect of his contemporary intellectuals and of his medicine, chemistry and occidental languages. The descendants, he impressed by his own strong interest of the young moldavian in literature and personality as a symbol for the whole mankind, grace of occidental sciences was encouraged by the diplomats his studies concerning some fields as: history, of the occidental states and travelling through the geography, politics, music, mathematics and physics. -

Annals of the University of Craiova for Journalism, Communication and Management
University of Craiova Department of Communication, Journalism and Education Science ANNALS OF THE UNIVERSITY OF CRAIOVA FOR JOURNALISM, COMMUNICATION AND MANAGEMENT Volume 6, 2020 ISSN: 2501-3513 Editorial Board Director Associate Professor PhD Xenia Negrea, University of Craiova, Romania Chief editor Associate Professor PhD Dan Valeriu Voinea, University of Craiova, Romania Members: Associate Professor PhD Alexandra Iorgulescu, University of Craiova, Romania Associate Professor PhD Mihaela Marcu, University of Craiova, Romania Associate Professor PhD Alina Ț enescu, University of Craiova, Romania Associate Professor PhD Davian Vlad, University of Craiova, Romania International Advisory Board Professor PhD Antonio Sandu, Ț tefan cel Mare University of Suceava, Romania Professor PhD Carmen Salgado Santamaría, Universidad Complutense de Madrid, Spain Professor PhD César Viana Teixeira, PUC Goiás, PACC/UFRJ and Laicom/UAB, Brazil Professor PhD Florentin Smarandache, University of New Mexico, United States of America Professor PhD Ioan Constantin Dima, ”Valachia” University of TârgoviȚ te, Romania Professor PhD Janusz K. Grabara, Czestochowa University of Technology, Poland Professor PhD Mariana Man, University of PetroȚ ani, Romania Professor PhD Michal Balog, Technical University of Kosice, Slovakia Professor PhD Michal Kolcun, Technical University of Kosice, Slovakia Professor PhD Nicu Panea, University of Craiova, Romania Professor PhD Sebastian Kot, Czestochowa University of Technology, Poland Professor PhD Sorin Mihai Radu, University -

Dimitrie's Ethical Heritage: a Life Lived Meaningfully
Iulian Boldea, Dumitru-Mircea Buda, Cornel Sigmirean (Editors) MEDIATING GLOBALIZATION: Identities in Dialogue Arhipelag XXI Press, 2018 DIMITRIE’S ETHICAL HERITAGE: A LIFE LIVED MEANINGFULLY BETWEEN REALITY AND FICTION Lucre ția-Dorina Loghin Lecturer, PhD, ”Babe ș-Bolyai” University of Cluj-Napoca Abstract: Dimitrie Cantemir was a Romanian leader who, due to his joint merits as a highly esteemed politician of his time and as an artist, has earned himself an indisputable place of unique value in the annals of time. His personality is thus equally acclaimed on synchronic and on diachronic level. This, no doubt, can be ascribed to his highly intuitive, sensible and justice-loving personality. Yet, apart from being greatly admired for his remarkable social-political and artistic accomplishments, Dimitrie Cantemir has something special to be remembered for: his semi-fictional nature, which, to the day, remains shrouded in a mythical aura. His exquisiteness may be accounted for by the prince’s double ancestry. His innovative genius and artistic nature came in maternal lineage, an independent and cultivated spirit herself, who defied and baffled contemporary conventions with her experimental initiatives. In addition to this, Dimitrie inherited the love of justice and that of his nation from his father, Constantin, an audacious fighter for the safety and well-being of his people. This article proposes a brief examination of the double nature of Dimitrie Cantemir’s personality, which has marked his entire endeavor: his diplomatic activity as Prince of Moldova and, to an equal extent, his writings, fictional or of a different nature. Keywords: Dimitrie Cantemir, fictional character, heritage, encyclopedic spirit of Enlightenment. -

From Imaging to Slander and Dishonor
Available online at www.aucjc.ro Annals of the University of Craiova for Journalism, Communication and Management Volume 6, 177-190, 2020 ISSN 2501-3513 FROM IMAGING TO SLANDER AND DISHONOR Iulian BITOLEANU Ph.D., "Anastasescu National College", Roșiorii de Vede, Romania Abstract Instead of the controversy of ideas, some journalists (and writers) preferred misinformation, mystification of the truth, trampling on any moral principle, only out of malice, less often out of professional envy, not taking into account the imminence of an intellectual "death" or professional career. For example, horrified by the plagiarism indented by an obscure publicist (Caion), the great classic I.L. Caragiale chose Germany as its residence and oasis of peace after 1900. Exile in a civilized country where the law is obeyed and abuses and imposture restricted can be a solution to disappearing from a tainted, "poisoned" world. Sometimes for the systematic "attacks" in the press, but illogical, unfounded, the issuer will pay / suffer hard. Specifically, the successful journalist, PamfilȘeicaru, opened many battlefields in the press of the time, flirting in his uncontrolled pride, with the effigy of a literary critic, venturing into the realms of literary and grammatical chronicle. For his malice, the 177 moment of revenge comes at the address of contemporary titans like Rebreanu and Camil Petrescu, not from the annoyed ones, but from unsuspected horizons, so that a drastic sentence will be avoided by taking refuge in Spain and Germany. Keywords: slander, dishonor, Caragiale, image Preamble The aura of a famous writer does not automatically become a guarantor / card of peace, of the satisfaction of what you have achieved at your desk, but in such conditions, a contestant - two, not to mention an escort or a chorus of denigrators, it would tarnish the image badly, it would even trigger dramatic gestures, with disastrous consequences. -
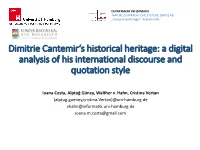
Hercore – Hermeneutic and Computer Based Analysis Of
DEPARTMENT INFORMATIK NATÜRLICHSPRACHLICHE SYSTEME (NATS) AB. „Computerphilologie“ -Arbeitsstelle Dimitrie Cantemir‘s historical heritage: a digital analysis of his international discourse and quotation style Ioana Costa, Alptuğ Güney, Walther v. Hahn, Cristina Vertan {alptug.gueney,cristina.Vertan}@uni-hamburg.de [email protected] [email protected] Outline • Computer Science methods and analysis of historical texts (W. v. Hahn) • Pilot project on Dimitrie Cantemir’s works (C. Vertan) • Research questions from the humanities (A. Güney) • From Text to digital Texts, challenges (I. Costa) • Technological approach (C. Vertan) 07.11.2018 INTELLIT - Romanian Academy 2018 DH Chalenges • Preservation of vagueness and uncertainty, • Semantic analysis based on ontologies vs. individual languages and • Preservation of intermediary results and features, • Sustainability of research and results, • Comparison of geographically distributes objects, • Support for historical text variation, • Analysis and fusion of multilingual historical background information. 07.11.2018 INTELLIT - Romanian Academy 2018 Preservation of vagueness and uncertainty If your DH aim is to analyse historical subjects, a proper treatment of vagueness and uncertainty is mandatory, because in the past most data are uncertain: “Da aber nachher dieses Volk seinen durch den tapfern Nerva Curajosul Nerva Trajan überwundenen König Decebalus verlohr, und Traian după theils vertilget, theils hin und her zerstreuet ward, aceea so wurde das ganze Land, das sie bewohnet -

Academia De Ştiinţe a Moldovei
ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI Institutul de Istorie, Stat şi Drept al A.Ş.M. Invitaţie - Program Conferinţa ştiinţifică internaţională „CANTEMIREŞTII – O CELEBRĂ DINASTIE DIN SECOLELE XVII-XVIII” 28 -29 noiembrie 2008, Chişinău Componenţa nominală a Comitetului de organizare a Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Cantemireştii o celebră dinastie din secolele XVII-XVIII” (în baza hotărîrii CSŞDT al A.Ş.M. nr.68 din 24 aprilie 2008 ) ŞLAPAC Mariana – doctor habilitat, vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe, (preşedinte al comitetului ) ROŞCA Alexandru – academician, academician coordonator al Secţiei de Ştiinţe Umanistice şi Arte ( vicepreşedinte al Comitetului) ZABOLOTNAIA Lilia – doctor, vicedirector al Institutului de Istorie, Stat şi Drept Membrii Comitetului CORBU Haralambie – academician, cercetător ştiinţific principal al Institutului de Filologie EŞANU Andrei – academician, şef Secţie la Institutul de Istorie, Stat şi Drept BOBÎNA Gheorghe – doctor habilitat, cercetător ştiinţific principal al Institutului de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice BURIAN Alexandru – doctor habilitat, director al Institutului de Istorie, Stat şi Drept BANTOŞ Ana – doctor, director al Institutului de Filologie FELEA Alina – doctor, cercetător ştiinţific superior al Institutului de Istorie, Stat şi Drept JARCUŢCHI Ion – doctor, secretar ştiinţific al Secţiei de Ştiinţe Umanistice şi Arte RUSANDU Ion – doctor, director al Institutului de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice MARAR Serghei – director al SRL “Bussines- Elita” ŢVIRCUN Victor -

Constantin Brancoveanu's Legacy from Cross-Cultural Perspectives
International Journal of Cross-Cultural Studies and Environmental Communication Special Issue: CONSTANTIN BRANCOVEANU’S LEGACY FROM CROSS-CULTURAL PERSPECTIVES 2015 ISSN 2285 – 3324 ISSN-L = 2285 – 3324 DOI: (Digital Object Identifier):10.5682/22853324 2015 , ecial Issue p 1 IJCCSEC S EDITOR-IN-CHIEF Ana-Maria Munteanu Universitatea Ovidius Constanţa, RO [email protected] ASSOCIATE EDITOR Florentina Nicolae Universitatea Ovidius Constanţa, RO [email protected] EDITOR Nicoleta Stanca Universitatea Ovidius Constanţa, RO [email protected] MEMBERS James Augerot University of Washington, Seattle, USA [email protected] Ruxandra Boicu University of Bucharest, RO [email protected] Paul Michelson Huntington University, USA [email protected] Vasile Muscalu Director Editura Universitara, RO [email protected] Aida Todi Universitatea Ovidius Constanţa, RO [email protected] Lucica Tofan Universitatea Ovidius Constanţa, RO [email protected] Mariana Cojoc Ovidius University of Constanta, RO [email protected] 2015 , Site Administrators Alina Costiana Stan & Valentin Vanghelescu [email protected] [email protected] ecial Issue p 2 IJCCSEC S International Journal of Cross-Cultural Studies and Environmental Communication http://crossculturenvironment.wordpress.com/ Special Issue: CONSTANTIN BRANCOVEANU’S LEGACY FROM CROSS-CULTURAL PERSPECTIVES 2015 Coordinators Florentina Nicolae and Nicoleta Stanca Ovidius University Constanta, RO 2012 Editura Universitară 2, -
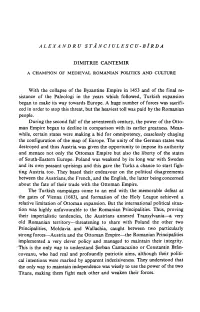
B Î RDA DIMITRIE CANTEMIR with the Collapse of the Byzantine
ALEX AN D RU S T Ä N CI U L E S C U - B î R D A DIMITRIE CANTEMIR A CHAMPION OF MEDIEVAL ROMANIAN POLITICS AND CULTURE With the collapse of the Byzantine Empire in 1453 and of the final re sistance of the Paleologi in the years which followed, Turkish expansion began to make its way towards Europe. A huge number of forces was sacrifi ced in order to stop this threat, but the heaviest toll was paid by the Romanian people. During the second falf of the seventeenth century, the power of the Otto man Empire began to decline in comparison with its earlier greatness. Mean while, certain states were making a bid for omnipotency, ceaselessly chaging the configuration of the map of Europe. The unity of the German states was destroyed and thus Austria was given the opportunity to impose its authority and menace not only the Ottoman Empire but also the liberty of the states of South-Eastern Europe. Poland was weakend by its long war with Sweden and its own peasant uprisings and this gave the Turks a chance to start figh ting Austria too. They based their endeavour on the political disagreements between the Austrians, the French, and the English, the latter being concerned about the fate of their trade with the Ottoman Empire. The Turkish campaigns come to an end with the memorable defeat at the gates of Vienna (1683), and formation of the Holy League achieved a relative limitation of Ottoman expansion. But the international political situa tion was highly unfavourable to the Romanian Principalities. -

Dimitrie Cantemir.Doc
HISTORIANS OF THE OTTOMAN EMPIRE C. Kafadar H. Karateke C. Fleischer DIMITRIE CANTEMIR (1673-1723) HAYATI Tµrkçe kaynaklarda Qantemir veya Qantemirolu olarak anªlan Dimitrie Cantemir 15 Receb 1084/26 Ekim 1673 tarihinde Bodan (Moldova) Prensliÿi sªnªrlarª da- hilindeki S¸alisteni kasabasªnda daha sonra Bodan Pren- si (Voyvodasª) olan Constantin Cantemir’in (1096-1104/ 1685-93) oÿlu olarak doÿdu. Köylµ kökenli bir paralª asker olan babasª Leh ordusunda görev yaptªÿª 17 yªl içinde Eflak Prensi Grigore I Ghica’nªn (ö. 1085/1674) yaverliÿine kadar yµkselmisti. Kendisi okuma yazma bilmeyen Constantin, belki de bu sebeple, her ikisi de sonradan Bodan prensi olacak olan Antioh ve Dimitrie adlª iki oÿlunun da mµkemmel bir öÿrenim görmesine gayret etti. Böylece D.C. Jeremias Cacavelas’dan (ö. 1109/1698’den sonra) Latince, Yunanca, edebiyat ve felsefe dersleri almaya basladª. 1099/1688 yªlªndan itibaren Istanbul’da yasayan D.C. ’in babasªnªn Receb 1104/ Mart 1693 tarihinde ölme- siyle bosalan Bodan Prensliÿi makamªna yasal varis olan aÿabeyi Antioh yerine genç Dimitrie geçirildi. Boyarlarªn genç prensi daha rahat kontrol edebilmek için tercih ettikleri dµsµnµlebilir. Ancak muhalefet, entrikalar ve Eflak voyvodasª Con- stantin Brancoveanu’nun (ö. 1126/1714) harcadªÿª bµyµk miktarda para yµzµnden D.C. voyvodalªkta sadece µç hafta kalabildi. Bunun µzerine Istanbul’a geri dönen D.C. Ekµmenik Patrikhane’nin akademisinde Bastercµman Alexander Mavrocordatos (ö. 1111/1709), Arta Baspiskoposu coÿrafyacª Meletius (ö. 1116/1714), gramerci Ia- comi (ö.?) ve daha sonra Qudµs Patriÿi olan coÿrafyacª Chrisantos Notaras’dan (ö. 1143/1731) dersler aldª. Bunun yanªsªra Yanyalª Es’ad Efendi’den (ö. 1142/ 1729-30) Tµrkçe, Kemnı A˛med Çelebı (ö. -
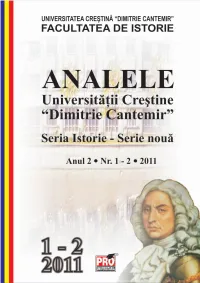
Dimitrie Cantemir”
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” Acreditată prin Legea nr. 238/23.04.2002 ANALELE Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” Seria ISTORIE – Serie nouă Bucureşti 2011 ANALELE UNIVERSITĂŢII CREŞTINE „DIMITRIE CANTEMIR” Seria ISTORIE – Serie nouă Revistă a Facultăţii de Istorie a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” cu apariţie trimestrială (online, CD-ROM şi print) Anul 2 ● Nr. 1 – 2 ● Ianuarie – Iunie 2011 COLEGIUL DE COORDONARE: Prof. univ. dr. MOMCILO LUBURICI, Preşedintele Fondator al Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” ● Prof. univ. dr. CORINA ADRIANA DUMITRESCU, Rectorul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” ● Prof. univ. dr. CRISTIANA CRISTUREANU, Prorectorul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” ● Prof. univ. dr. IOAN CHIPER, Facultatea de Istorie a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” ● Prof. univ. dr. ŞTEFAN OLTEANU, Facultatea de Istorie a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” CONSILIUL ŞTIINŢIFIC: Prof. univ. dr. CONSTANTIN HLIHOR, Decanul Facultăţii de Istorie a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” (responsabil) ● Prof. univ. dr. CONSTANTIN BUŞE, Universitatea din Bucureşti ● Prof. univ. dr. SABIN ADRIAN LUCA, Universitatea „Lucian Blaga”, Director General al Muzeului Naţional Brukenthal, Sibiu ● Prof. univ. dr. VASILE CHIRICA, Universitatea „Mihail Kogălniceanu” Iaşi ● Prof. univ. dr. MIHAI MAXIM, Director al Institutului Cultural „Dimitrie Cantemir”, M.A.E., Istanbul ● Prof. univ. dr. MARIAN COJOC, Universitatea „Ovidius” Constanţa ● Prof. univ. dr. SORIN LIVIU DAMEAN, Universitatea din Craiova ● Prof. univ. dr. CĂTĂLIN TURLIUC, cercetător ştiinţific gr. I, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” Iaşi ● Cercetător ştiinţific gr. I dr. DANIELA BUŞĂ, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” Bucureşti ● Cercetător ştiinţific gr. I dr. ILEANA CĂZAN, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” Bucureşti ● Prof. univ. dr. MARIN CÂRCIUMARU, Universitatea „Valahia”, Directorul Şcolii Doctorale, Târgovişte ● Cercetător ştiinţific gr. -

Introduction*
chapter 1 Introduction* 1 Historical Background Dimitrie Cantemir was very young when he entered the Republic of Letters. Born on October 26, 1673, in Silișteni (nowadays “Dimitrie Cantemir”, in the Republic of Moldova), as the son of Constantin Cantemir (d. 1693), who was a military commander and later prince of Moldavia, Dimitrie enjoyed the privileges of a good education and scholarly companionship. At twenty-five, when his first book was published (the Divan, in 1698, at Iași), he had mastered the art of writing so thoroughly as to be able to compose a work on Christian ethics, two thirds of which were an original contribution, while the rest was an accurate translation of a Unitarian theologian’s book written in Latin.1 There is little information on the young years of the Moldavian Prince. The portrait attributed to Jean-Baptiste Vanmour that may represent him, as sug- gested by Nicolae Iorga,2 acknowledged for a long time as a certain likeness of the Prince during his first period in Constantinople, was convincingly removed from Cantemir’s iconography by George Ciorănescu3 (see ill. 1). The descrip- tion made by the Polish ambassador Rafael Leszczyński, who met Cantemir in Iași in 1699, is his only authentic portrait that has been preserved: “An eru- dite man, conversant in Latin, and with an excellent education – as if he had been raised in Poland.”4 In his conversation with the Polish ambassador Dim- itrie behaves with perfect courtesy, “showing that he was delighted to see his [the ambassador’s] person, since he had long heard of his great name.” He has “various discussions with the ambassador’s friends on the duties of friendship.” He offers them Oriental gifts – “satin fabric for a vest, a piece of fine cloth for a coat and a Turkish handkerchief” – but greets them “in the Polish fashion, with a bow.” He comments on the quality of the ambassador’s orchestra, because “he * By Virgil Cândea. -

Pólis/Cosmópolis
Pólis/Cosmópolis Identidades Globais & Locais Carmen Soares, Maria do Céu Fialho & Thomas Figueira (coords.) IMPRENSA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA COIMBRA UNIVERSITY PRESS ANNABLUME Versão integral disponível em digitalis.uc.pt Vrbes and oppida in Dimitrie Cantemir’s Descriptio Moldauiae VRBES and OPPIDA in Dimitrie Cantemir’s DESCRIPTIO MOLDAVIAE Ioana Costa ([email protected]) University of Bucharest Abstract – Dimitrie Cantemir, who reigned for less than one year, as a member of the Moldavian dynasty founded by his father, Constantin Cantemir, was far more important as a scholar and savant. Indeed, he influenced the culture of his time (but only slightly its history). He became, in 1714, a member of the institution that would later be known as the Academy of Berlin. In this specific intellectual context he wrote Descriptio Moldaviae, a geographical, political, and historical presentation of the Moldavian state, and Historia moldo-vlahica, a learned work on the origins of the Romanians from Moldavia, Muntenia (i.e., Wallachia) and Transylvania. Interpreting this project as single endeavour with two inseparable facets, these writings put forward a horizontal, synchronic description of Moldavia as well as a vertical, diachronic one. The first of them, with an adventurous narrative, includes an extensive chapter devoted to the geography of the three regions of Moldavia (Inferior Moldavia, Superior Moldavia, and Bassarabia). That description includes 45 distinctive settlements, most of them towns and villages (urbes and oppida); these reports are both written to scientific standards and literarily appealing. Keywords: Cantemir, Moldavian history, Latin literature, geography, cartography. The Cantemir dynasty is both slight and significant, in two different dimensions, of political and literary coordinates.