Conseil Supérieur De L'audiovisuel
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Routledge Dictionary of Cultural References in Modern French
About the Table of Contents of this eBook. The Table of Contents in this eBook may be off by 1 digit. To correctly navigate chapters, use the bookmark links in the bookmarks panel. The Routledge Dictionary of Cultural References in Modern French The Routledge Dictionary of Cultural References in Modern French reveals the hidden cultural dimension of contemporary French, as used in the press, going beyond the limited and purely lexical approach of traditional bilingual dictionaries. Even foreign learners of French who possess a good level of French often have difficulty in fully understanding French articles, not because of any linguistic shortcomings on their part but because of their inadequate knowledge of the cultural references. This cultural dictionary of French provides the reader with clear and concise expla- nations of the crucial cultural dimension behind the most frequently used words and phrases found in the contemporary French press. This vital background information, gathered here in this innovative and entertaining dictionary, will allow readers to go beyond a superficial understanding of the French press and the French language in general, to see the hidden yet implied cultural significance that is so transparent to the native speaker. Key features: a broad range of cultural references from the historical and literary to the popular and classical, with an in-depth analysis of punning mechanisms. over 3,000 cultural references explained a three-level indicator of frequency over 600 questions to test knowledge before and after reading. The Routledge Dictionary of Cultural References in Modern French is the ideal refer- ence for all undergraduate and postgraduate students of French seeking to enhance their understanding of the French language. -

Théâtre / Spectacle Transfère Des Photos Dans Ses Le 04/03, Dijon Le Toiles Et Œuvres Graphiques
Le 1er mensuel gratuit 100% Lifestyle 05 Février 10 Tendance Dossier spécial Saint-Valentin Cinéma José Garcia Natalie Portman Musique Grand Popo FC BB Brunes Média George Clooney Simon Baker Ne pas jeter sur la voie publique. Laurent Baffie En route vers les Oscars High Tech Média Musique Culture Cinéma Mode Déco Cuisine Sport Société Edito 02/10 FRESH’ Magazine 182 Rue de Charenton 75012 Paris Tél : 01 43 42 43 17 [email protected] Directeur de la Publication Edito Natalie Helf Directeur de la Rédaction & Rédacteur en chef Chris Lebédyk Damned ! Valentin is not dead… Tél : 06 60 78 73 04 Le 14 février, c’est la date fatidique, le genre de moment [email protected] où l’on se dit qu’on ferait mieux de jouer les malades imaginaires où de programmer un soudain déplacement Directeur du Développement & Commercial professionnel pour justifi er un manque cruel d’imagination Natalie Helf (ou d’envie) pour fêter la Saint-Valentin. Mais bon, que Tél : 06 81 45 67 54 voulez-vous, on ne va tout de même pas l’enlever du [email protected] calendrier ! Quoique… Non, même une pétition sur « Facebook » ne me servirait à rien tant la « coutume » Publicité est ancrée dans les moeurs. Et oui, l’association du milieu Tél : 09 52 62 20 89 du mois de février avec l’amour et la fertilité date quand [email protected] même de l’Antiquité. Dans le calendrier de l’Athènes antique, la période de mi-janvier à mi-février était le Rubrique culture & Cinéma mois de Gamélion, consacré au mariage sacré de Zeus Antoine Vallette et de Héra, c’est pour -
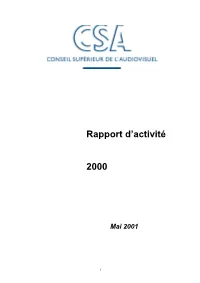
Rapport D'activité 2000
Rapport d’activité 2000 Mai 2001 1 CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’AUDIOVISUEL Depuis le 24 janvier 2001 Président Dominique Baudis Yvon Le Bars Télévision numérique terrestre, Économie de l’audiovisuel Francis Beck Nouvelles technologies de l’information et de la communication, Programme et production audiovisuelle, Cinéma et télévision, Télévision numérique terrestre Joseph Daniel Câble et satellite, Pluralisme et déontologie de l’information, campagnes électorales, Publicité et parrainage, INA, Radio France Hélène Fatou Protection de l’enfance et de l’adolescence, Outre-mer, Radio, Télévision locale, Langue française, M6 Jacqueline de Guillenchmidt Radio, Pluralisme et déontologie de l’information, campagnes électorales, Protection de l’enfance et de l’adolescence, Relations avec les éditeurs de la presse nationale et régionale, RFI, TF1 Janine Langlois-Glandier Cinéma et télévision, Publicité et parrainage, Sport et télévision, Câble et satellite, Programme et production, Canal+ Philippe Levrier Dossiers européens et relations internationales, Outre-mer, Télévision locale, Nouvelles technologies de l’information et de la communication, Sport et télévision, RFO Pierre Wiehn Économie de l’audiovisuel, Dossiers européens et relations internationales, France Télévision (France 2, France 3, La Cinquième) Jusqu’au 23 janvier 2001 Président Hervé Bourges Véronique Cayla Production audiovisuelle, Musique et audiovisuel, Outre-mer, RFO, La Cinquième-Arte Jean-Marie Cotteret Campagnes électorales et suivi du pluralisme, Respect des principes d’éthique -

Ethos, Énonc1at1on,MÉD1A Sémiotique De Pethos*
ETHos, ÉNoNc1AT1oN,MÉD1A Sémiotique de Pethos* Guillaume Soulez2 Une dizaine d'années après ses débuts, la sémiologie redécouvre la Rhétorique et l'intérêt de cette approche pour l'étude du langage et de la communication. Barthes imagine ainsi sa transposition sémiolo- gique pour liétude de la culture de masse? Or, ce “retour” du rhéto- rique prend la forme, chez Barthes, mais aussi chez Genette, Todorov, ou chez le Groupe μ, etc., d'un intérêt porté principalement sur les figures (de rhétorique), alors que la Rhétorique ancienne privilégiait l”orateur et la parole publique au sein d"`une “agora”, agora que semble précisément reprendre la scène médiatique, et la scène télévi- suelle en particulier qui met en avant un orateur (présentateur,anima- teur, journaliste, homme public, etc.). Le texte d'Aristote, en effet, offre avec la notion dierhos -dans une première approximation 1 Ce texte est la version écrite d`une conférence faite lors d`une journée d'études consacrée a l'ethos, organisée à l”Université Paris-II, le 23 novembre 2001, par le GRAM (Groupe de recherches en analyse du discours des médias, groupe d'étude de la Société française des Sciences de Vinformation et de la communication). Ciest l'occasion de remercier les animateurs du GRAM, et Simone Bonnafous en particulier, de leur invitation. 2 Université de Metz, Laboratoire Communication et politique (CNRS). 3 R. BARTHES, “Uancienne Rhétorique. Aide-mémoire", C0mmum`ccm'ons, n° 16, “Recherches rhétoriques”, [l970], réédition Seuil Folio, 1994, pp. 254-333. Recherches en commzmicarion, n° 18 (2002). 176 GUILLAUME S_oULEz __ “1”image que l”orateur donne de lui-même ã travers son discours”- un point d'ancrage très solide pour analyser ces orateurs, leurparole et leurs jeux de positionnement. -

Gilles Lellouche INTERNATIONAL PRODUCTION NOTES
A FILM BY Gilles Lellouche INTERNATIONAL PRODUCTION NOTES CONTACTS INTERNATIONAL MARKETING INTERNATIONAL PUBLICITY Lucie MICHAUT Alexandre BOURG [email protected] [email protected] SYNOPSIS A group of 40-something guys, all on the verge of a mid-life crisis, decide to form their local pool’s first ever synchronized swimming team – for men. Braving the skepticism and ridicule of those around them and trained by a fallen champion trying to pull herself together, the group set out on an unlikely adventure, and on the way will rediscover a little self-esteem and a lot about themselves and each other. After Narco and The Players, Sink or Swim is the first film you’ve made as a solo director. Did you have difficulty launching a solo project, or was it just a question of timing? A little of both! Most of all, I needed to find a subject that really spoke to me and would enable me to make a film even more personal than Narco. As for The Players, that was a group project. I really enjoyed making both of those films, but neither was intimately linked to who I am. All of this took some time because after Narco, my “actors’ films” were the center of attention. How long has it taken to bring Sink or Swim to life? Five years. In fact, it was eight years ago that I began writing a script that already contained a few of the ideas in Sink or Swim. I wanted to examine the weariness – or perhaps the somewhat latent depression – that I sensed in people of my generation or even more generally in France. -

Du Changement En Programmes Vue Jeunesse De TF1
www.lemediaplus.com Mercredi 27 juin 2018 - n°2 438 INTERVIEWS Journaux Télévisés de Yann LABASQUE Directeur des TF1 : du changement en Programmes vue Jeunesse de TF1 u changement en vue pour les téléspectateurs de TF1 : les JT Jean-Paul DIETSCH Dde la chaîne seront présentés à la rentrée prochaine dans un plateau Directeur de entièrement refait, qui permettra selon l’ACPM/OJD leurs présentateurs des évolutions sur le plan éditorial. Finie la table imposante, changée en 2015 mais qui limitait les déplacements et crééait une distance du 20H de France 2 (de taille beaucoup entre le présentateur et ses invités; plus imposante), sans aller jusqu’au adieu le décor qui remontait à une SOMMAIRE choix plus radical de M6 qui s’est dotée dizaine d’années, avec ses écrans plats d’un plateau quasiment tout-virtuel, CSA ..................................................... 4 mis bout à bout dont les bords étaient offrira aux présentateurs de TF1 un Le Conseil supérieur de l’audiovisuel ... visibles; et bye-bye les caméras fixes Récompenses .................................. 5 écrin plus adapté à leurs besoins, avec qui imposaient une gamme limitée la possibilité d’intégrer plus largement France Ô se distingue avec 2 prix aux d’angles de vue. Le futur plateau, dont Etoiles de la SCAM des technologies comme la 3D et les quelques visuels ont été dévoilés par Radio .................................................. 6 inscrustations numériques qui aident à la chaîne à des journalistes, intégrera Virgin Radio : Cauet quitte la station décrypter visuellement l’info. tout d’abord 70 m2 d’écrans, dont Internet ............................................. 7 un très large écran-fresque incurvé Groupe M6 : Golden Network, studio .. -

Étude Sociologique Sur Les Peurs Contemporaines Bertrand Vidal
Les représentations collectives de l’événement-catastrophe : étude sociologique sur les peurs contemporaines Bertrand Vidal To cite this version: Bertrand Vidal. Les représentations collectives de l’événement-catastrophe : étude sociologique sur les peurs contemporaines. Sociologie. Université Paul Valéry - Montpellier III; Universidade do Minho (Braga, Portugal), 2012. Français. NNT : 2012MON30065. tel-00825491 HAL Id: tel-00825491 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00825491 Submitted on 23 May 2013 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. UNIVERSITÉ MONTPELLIER III – PAUL - VALÉRY Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales École Doctorale n° 60 « Territoires, Temps, Sociétés et Développement » CNU section 19 DOCTORAT DE L’UNIVERSITE PAUL - VALERY – MONTPELLIER III SOUS LE REGIME DE LA COTUTELLE AVEC L’UNIVERSITE DU MINHO – BRAGA Discipline : SOCIOLOGIE THESE Présentée et soutenue publiquement par Bertrand VIDAL LES REPRESENTATIONS COLLECTIVES DE L’EVENEMENT-CATASTROPHE ETUDE SOCIOLOGIQUE SUR LES PEURS CONTEMPORAINES Sous la direction de M. le Professeur Patrick TACUSSEL et M. le Professeur Jean-Martin RABOT MEMBRES DU JURY : M. Jean-Bruno RENARD, Professeur de sociologie, Université Paul-Valéry, Montpellier III (président) M. Denis JEFFREY, Professeur de sociologie, Université de Laval, Laval (rapporteur) M. -

Dossier De Presse 09
12 e Festival International du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez 1 SOMMAIRE Sommaire p. 2 Edito p. 3 Présentation p. 4 Grille de Programmation p. 6 Le Jury p. 7 Le Jury Jeune p. 16 La Sélection Officielle p. 18 Les Courts Métrages en compétition p. 26 Les Prix p. 30 La Sélection Officielle hors compétition p. 32 Attachés de Presse des Films p. 38 Les Maîtres de Cérémonie p. 39 Ils sont attendus au 12 e Festival de l’Alpe d’Huez p. 40 Les Toiles enchantées p. 41 Les exploitants de salles de cinéma - Journée spéciale - Jury de professionnels p. 42 La Rétrospective p. 43 Plus de Courts Métrages à l’Alpe d’Huez p. 44 Opération 12 ans – 12 Courts p. 45 Exposition Du Rire aux Larmes Paris Match p. 46 La MasterClass 2009 p.47 La Journée des Lycéens et des Collégiens p. 48 Quelques mots des partenaires p. 49 Les Partenaires p. 50 Ils ont fait le Festival International de Comédie de l’Alpe d’Huez p. 51 Palmarès 2008 p. 52 La comédie au cinéma p. 53 12 e Festival International du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez 2 EDITO Petit mot de bienvenue… Et voilà… la station de l’Alpe d’Huez pour la 12 e année, devient, le temps d’une semaine, la capitale mondiale du film de comédie, et ça c’est une bonne nouvelle ! L’année dernière, le Festival de l’Alpe d’Huez était dans l’anticipation : nous étions les premiers à parler ch’ti, nous tenions des discours importants et alarmants sur la construction du budget du Festival… Pas de prédictions cette année, tenons un discours positif et entamons ce petit édito par, une fois n’est pas coutume, une liste de bonnes nouvelles… Bonne nouvelle ! Le Festival fête cette année ses 12 ans et étoffe son programme de nouveautés 100% cinéma (des projections en plein air, une rétrospective consacrée à la comédie belge, un véritable coup de projecteur sur les courts-métrages…). -

Le Traitement Humoristique Des Personnalités Politiques Dans Les Talk-Shows Français Presentation with Humour of Political Personalities in French Talk Shows
Questions de communication 10 | 2006 Humour et médias. Définition, genres et cultures Le traitement humoristique des personnalités politiques dans les Talk-Shows français Presentation with Humour of Political Personalities in French Talk Shows Guy Lochard Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/questionsdecommunication/7690 DOI : 10.4000/questionsdecommunication.7690 ISSN : 2259-8901 Éditeur Presses universitaires de Lorraine Édition imprimée Date de publication : 1 décembre 2006 Pagination : 65-79 ISBN : 978-2-86480-828-2 ISSN : 1633-5961 Référence électronique Guy Lochard, « Le traitement humoristique des personnalités politiques dans les Talk-Shows français », Questions de communication [En ligne], 10 | 2006, mis en ligne le 01 décembre 2006, consulté le 22 mars 2021. URL : http://journals.openedition.org/questionsdecommunication/7690 ; DOI : https://doi.org/10.4000/questionsdecommunication.7690 Tous droits réservés questions de communication, 2006, 10, 65-79 > DOSSIER GUY LOCHARD Centre de recherche sur l’éducation à l’actualité et aux médias Université Paris 3 [email protected] LE TRAITEMENT HUMORISTIQUE DES PERSONNALITÉS POLITIQUES DANS LES TALK-SHOWS FRANÇAIS Résumé. — Dans les années 90, on a assisté en France à une multiplication, sur les écrans de télévision, de programmes hybrides et ambivalents dans lesquels les hommes politiques sont l’objet in praesentia de traitements humoristiques portant sur des domaines et des thèmes jusque-là préservés. C’est à un examen de ce nouveau type d’interlocutions médiatiques que cet article est consacré. Il examine les dispositifs conversationnels mis en place, les thèmes et cibles ainsi que les procédés à l’œuvre.Ainsi aboutit-il au repérage de deux grandes formes de logiques humoristiques, la première s’orientant vers de véritables constructions/déconstructions argumentatives remettant en cause le cadrage non sérieux des situations interlocutives concernées, la seconde pouvant se dégrader en une véritable énonciation insultante. -

Catalogue Des Ouvrages
SERVICE ARCHIVES ECRITES ET MUSEE DE RADIO FRANCE BIBLIOTHEQUE D’ETUDE GENERALISTE ET TECHNIQUE SUR LA RADIODIFFUSION, LA TELEVISION ET LES MEDIAS CATALOGUE DES OUVRAGES La bibliothèque d’étude généraliste et technique du Service Archives écrites et Musée de Radio France regroupe près de 2000 ouvrages sur la radio, la télévision et les médias publiés du début du XX e siècle à nos jours. Présentés ici par ordre alphabétique, les ouvrages traitent prioritairement de la radiodiffusion, mais aussi de la télévision et des médias en général, selon différents angles : ⋅ Aspects politiques, administratifs et institutionnels ⋅ Histoire générale et chronologies ⋅ Aspects techniques ⋅ Politique éditoriale, contenu et traitement des programmes et des émissions ⋅ Radio France et l’audiovisuel de service public ⋅ Radios périphériques, pirates, associatives, libres, privées… ⋅ Biographies, témoignages et personnalités ⋅ Métiers de l’audiovisuel ⋅ Sociologie des médias, analyse du public, audience ⋅ Musique, programmation musicale, formations musicales de Radio France ⋅ Audiovisuel, presse et communication dans le monde ⋅ Etc. La bibliothèque d’étude comprend également : ⋅ Dossiers d’archives thématiques ⋅ Revues dont les plus anciennes datent des années vingt Documents et fonds d’archives consultables au Service Archives écrites et Musée de Radio France Le Service Archives écrites et Musée de Radio France met à la disposition des lecteurs des archives et des documents de différentes natures et de différentes provenances : ° Fonds d’archives des directions, des chaînes et des formations musicales de Radio France, conservés sur place avant leur versement aux Archives nationales consultables dans les limites des délais de classement et de communicabilité ° Documents liés à la vie institutionnelle de Radio France, reflet condensé de l’activité de l’entreprise : ⋅ Programmes diffusés : grilles, bulletins d’information destinés à la presse, communiqués de presse, etc. -

Le Mercato Radio 2020 Par
LE MERCATO RADIO 2020 PAR Information ou rumeur confirmée Information ou rumeurs ni confirmée ni infirmée Information ou rumeur démentie ABDEDDAÏM Benaouda Grand journaliste économique, Benaouda Abdeddaïm poursuit sa chronique sur l'actualité économique internationale chaque matin dans "Good morning business" sur BFM Business. "le monde qui bouge" est diffusé vers 6h50 et 7h50 (1). Par ailleurs, il joue les chroniqueurs littéraires internationaux pour "la Librairie de l'éco" (2). Sources : (1) constatation le 07/09/2010 (2) constatation le 13/09/2010 | Photo : BFM Business ACCART Aurélien Journaliste pour Franceinfo depuis avril 2015, Aurélien Accart est promu coprésentateur de la prématinale de la radio tout info avec Agathe Mahuet. Sources : dossier de presse de rentrée de Franceinfo | Photo : Radio France ACHILLI Jean-François Jean-François Achilli reste l'une des principales voix de Franceinfo avec deux rendez-vous quotidiens en semaine : "18.50 Franceinfo" à 18h50 et "les Informés" de 20h00 21h00 avec diffusion simultanée à la télévision. Sources : dossier de presse de rentrée de Franceinfo | Photo : Radio France ADAMS Kev Humoriste, acteur et enquêteur de "Mask Singer" sur TF1, Kev Adams a fait une première incursion sur Fun Radio durant l'été dernier. En cette rentrée 2020, il intègre la grille saison avec une émission mensuelle de 2 heures et son "Fridge Comedy Club". Sources : AFP le 06/09/2020 | Photo : Fun Radio ADLER Laure Figure du service public, Laure Adler poursuit "L'Heure bleue", son entretien musical lancé à la rentrée 2016. L'émission retrouve sa case du lundi au vendredi de 20h00 à 21h00. Sources : France Inter le 27/08/2020 | Photo : France Inter AGOSTINI Fanny A la rentrée 2019, alors qu'elle a quitté Paris et la télévision pour s'installer en Haute-Loire dans une ferme, Fanny Agostini a accepté l'offre d'Europe 1 de proposer quotidiennement une chronique depuis chez elle pour parler de son expérience personnelle, elle aborde les problématiques environnementales et développement durable. -

Parti Socialiste Pierre Mauroy Ou La Passion Du Parti Socialiste
PIERRE MAUROY OU LA PASSION DU PARTI SOCIALISTE PIERRE MAUROY OU LA PASSION DU PARTI SOCIALISTE Actes de la rencontre organisée en décembre 2017 au Palais Bourbon SOMMAIRE Michel THAUVIN Pierre Mauroy, l’un des plus valeureux combattants du socialisme démocratique .................................................................. 5 Gérard GRUNBERG Pierre Mauroy ou la volonté de faire du PS un parti de gouvernement ..... 11 Roger SOUTHON Sans l’adhésion de Pierre Mauroy aux Jeunesses socialistes, pas de congrès d’Epinay ? .................................................................... 19 Jean-Pierre CHEVENEMENT Avec Pierre Mauroy, la fraternité avait un visage .................................. 29 Michel CHARZAT Pierre Mauroy, l'homme du rassemblement et de la rénovation du socialisme ........................................................................................ 39 Bernard DEROSIER Dans le Nord, Pierre Mauroy ou l’image d’un rassembleur sans relâche des socialistes ................................................................... 47 Michèle ANDRE Pierre Mauroy : un Premier secrétaire convaincu de la nécessité de l’égalité entre les sexes .................................................................... 55 Gérard LINDEPERG Pierre Mauroy et Michel Rocard : une amitié et une même vision du socialisme ........................................................ 59 Martine BURON A la FNESR, Pierre Mauroy mobilise les élus ......................................... 65 Photo de couverture : François HOLLANDE Pierre Mauroy à la tribune