Auteurs Algériens De Langue Française De La Période Coloniale
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
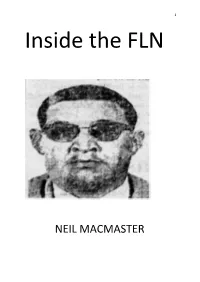
Neil Macmaster
1 Inside the FLN NEIL MACMASTER 2 Inside the FLN: the Paris massacre and the French Intelligence Service Neil MacMaster March 2013. The moral right of the author has been asserted. The author welcomes any e-mail comment: <[email protected]> Cover photograph: Mohamed Zouaoui. 3 Contents Introduction 4 1 “Operation Flore” and the arrest of Mohamed Zouaoui 10 2 The Zouaoui network: the role of the Contrôleurs 21 3 The European Support Network, Renault, and FLN Propaganda 33 4 The Problem of Violence and the Federation U-Turn 43 5 Assassination of police officers and the Federation crisis 54 6 At the grass-roots: Mohammed Ghafir and Amala 12 (13th Arrondissement) 66 7 Planning the demonstrations of 17-20 October 84 8 Abderrahmane Farès and the financial network 98 9 After the massacre: the impact of the crisis on the FLN 108 Conclusion 123 Jean-Luc Einaudi and the Sacralisation of Mohammedi Saddek: An Essay 127 Appendix 1 Who was Mohammedi Saddek? 132 Appendix 2 La guerre des chiffres: how many Algerians died? 140 Short bibliography of publications, 2006-2013 145 Note on the author 147 4 INTRODUCTION By 2006, when I and Jim House published Paris 1961. Algerians, State Terror, and Memory, a number of books, by Jean-Luc Einaudi, Jean-Paul Brunet, Alain Dewerpe, Linda Amiri, Rémy Valat, and others, meant that the main features of the Paris massacre and the demonstration of 17 October were quite well understood.1 Political controversy has continued to rage, mainly in relation to the contested issue of the numbers of Algerians that were killed, but in general the bulk of the publications that have appeared since Paris 1961 have had to do with the cultural, artistic and memorial aspects of the events, rather than with further research into primary archival sources.2 This shift from the further excavation of archives, to differing interpretations of cultural and political meanings, was exemplified by the debates surrounding Michael Haneke’s film Caché,3 and the commemoration of the 50th anniversary in October 2011. -

1 Histoire De La Guerre D'indépendance Algérienne SYLVIE
1 Histoire de la guerre d'indépendance algérienne SYLVIE THÉNAULT À Kahina. Introduction (2012) Avec le XXIe siècle, la France et les Français ont découvert – redécouvert ? – leur histoire coloniale, ou, à tout le Moins, son épisode le plus Marquant par sa durée, son intensité et sa portée : la guerre d'Algérie. Et ce, dans un rapport placé sous le signe de la culpabilité ; en téMoigne le transfert, pour désigner cette guerre, des Métaphores nées de la dénonciation du régiMe de Vichy, « heures sombres », « pages noires » de l'histoire de la France conteMporaine. Le retour sur ce passé a débuté, en 2000-2001, avec la publication à la Une du Monde du téMoignage de Louisette Ighilahriz. Cette Militante de l'indépendance algérienne, qui fut torturée Mais sauvée par un Médecin dont elle connaît le nom, voulait retrouver pour lui dire, enfin, sa reconnaissance. Le débat a ensuite été ponctué par les regrets du général Massu, la reconnaissance de l'usage courant de la torture par le général Aussaresses et les déclarations du général Bigeard, évoquant cette pratique comMe « un Mal nécessaire » dans cette guerre1. Ont suivi quantité de livres, dont les retentissants MéMoires de Paul Aussaresses, des documentaires – notaMMent L'Ennemi intime, de Patrick RotMan, diffusé en prime time sur France 3 –, et MêMe des poursuites judiciaires pour « apologie de criMes de guerre » contre le général Aussaresses, à défaut de qualification juridique plus pertinente pour sanctionner des actes, au-delà des mots. La société a fait écho. Les Français ont été touchés par ce déferleMent de questions, d'accusations, de récits et d'iMages, bien au-delà des cercles directeMent concernés. -

Bouira Béjaïa
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION - MARDI 6 AOÛT 2019 - N°5242 - ALGÉRIE 20 DA - FRANCE 1 EURO / http//:www.depechedekabylie.com COUR SUPRÊME LES DEUX EX-MINISTRES ONT COMPARU HIER Zaâlane et El Ghazi en détention provisoire Page 2. DAYA DEGHINE CHAMPIONNE D’ALGÉRIE CADETTE EN VO-VIETNAM “Maintenant je vise un titre africain et pourquoi pas mondial” Page 22. ISSN 1112-3842 AÏD EL-ADHA LE MOUTON FRÔLE LES 75 000 DA À TIZI-OUZOU CHER, CHER... LE SACRIFICE ! Page 3. TIGZIRT AWEM DE BÉJAÏA TIZI-OUZOU 11E CONCOURS NATIONAL DE 7743 LA CHANSON AMAZIGHE placements Malika classiques en six mois Domrane en invitée Les habitants de Lazayeb ferment Page 2. d’honneur Page 11. la RN24 Page 5. La Météo du Jour Alger Tizi-Ouzou Bouira Béjaïa Max: 32 Max : 40 Max : 41 Max : 33 SP RTS QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION Min : 23 Min : 27 Min : 26 Min : 27 MARDI 6 AOÛT 2019 N°5242 JS KABYLIE Racim Mebarki, à propos du match contre Al-Merrikh Le jeune latéral droit, celui qu’on surnomme «Gagner pour prendre «le TGV», en l’occurrence Racim Mebarki, promu cette saison en de l’assurance» catégorie senior, conditions idoines, afin d’aborder ça se passe pour vous et s’est dit optimiste cette rencontre en conquérants. quelles sont vos ambitions ? quant à la capacité Tout se passe bien pour moi. Je me Justement, comment se prépare dans de bonnes conditions de son équipe présente cette première et tout fonctionne à merveille. Je sortie face aux Soudanais ? me sens comme un poisson dans de faire un C’est une rencontre très importante l’eau. -

Geologie Des Mineraux Utiles
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE UNIVERSITÉ FERHAT ABBAS – SÉTIF – INSTITUT D’ARCHITECTURE ET DES SCIENCES DE LA TERRE – DEPARTEMENT DES SCIENCES DE LA TERRE MÉMOIRE PRÉSENTÉ POUR L’OBTENTION DU DIPLÔME DE MAGISTER OPTION GEOLOGIE ET RESSOURCES MINERALES THÈME CARACTÉRISTIQUES GÉOLOGIQUES, MINÉRALOGIQUES, PÉTROGRAPHIQUES ET SÉDIMENTOLOGIQUES DES SABLES CÔTIERS DES SECTEURS : OUED ZHOUR, OUED EL KÉBIR et OUED ZIAMA MANSOURIA (Wilaya de Jijel, Algérie) Présenté par : MOSTEFAOUI Lakhdar Ingénieur d’état en géologie minière Devant le jury : Président : Monsieur DEMDOUM Abdessalam Maître de conférences classe A Université de Sétif Rapporteur : Monsieur BOUIMA Tayeb Maître de conférences classe A Université de Sétif Examinateur : Monsieur LAOUAR Rabah Professeur Université d’Annaba Examinateur : Monsieur CHABOU Moulley Charaf Maître de conférences classe A Université de Sétif Novembre 2014 DÉDICACE A la mémoire de Monsieur Mohamed BENDALI, Président de l’Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier (A.N.G.C.M.), auquel je dédie ce mémoire de magister. Le défunt était un éminent géologue ; toujours sur terrain, muni de son marteau il reflétait le bâtisseur des secteurs de la géologie et des mines, au lendemain de l’Independence jusqu’aux dernières palpita- tions de son cœur. Cette dédicace représente pour moi une reconnai- ssance à ses ouvres. Aussi, cette étude et les résultats obtenus iraient à la banque nationale de données géologiques où ils seraient à la disposition du public scientifique et universitaire. Je demande à tous ceux qui exploitent ce mémoire de magister d’avoir une pieuse pensée à la mémoire de Monsieur Mohamed BENDALI. -

Lettre De L'editeur
Lettre de l'Editeur Pour une vive mémoire AMMAR KHELIFA [email protected] es nations se hissent par le savoir et se maintiennent par la mémoire. C’est cet ensemble d’évé- nements qui se créent successivement aujourd’hui pour qu’un jour on ait à le nommer : Histoire. Sans cette mémoire, imbue de pédagogie et de ressourcement, l’espèce humaine serait tel un atome libre dans le tourbillon temporel et cosmique. L’homme a eu de tout temps ce pertinent besoin de vouloir s’amarrer à des référentiels et de se coller sans équivoque à son histoire. Se confondre à un passé, à une ancestralité. Cette pertinence va se confiner dans une résistance dépassionnée et continue contre l’amnésie et les affres de l’oubli. Se contenir dans un souvenir, c’est renaître un peu. L’intérioriser, c’est le revivre ; d’où cette ardeur permanente de redécouvrir, des instants durant, ses gloires et ses notoriétés. En tant que mouvement dynamique qui ne s’arrête pas à un fait, l’Histoire se perpétue bien au-delà. Elle est éga- lement un espace pour s’affirmer et un fondement essentiel dans les domaines de prééminence et de luttes. Trans- mettant le plus souvent une charge identitaire, elle est aussi et souvent la proie pitoyable à une éventualité faussaire ou à un oubli prédateur. Seule la mémoire collective, comme un fait vital et impératif, peut soutenir la vivacité des lueurs d’antan et se projeter dans un avenir stimulant et inspirateur. Elle doit assurer chez nous le maintien et la perpétuation des liens avec les valeurs nationales et le legs éternel de la glorieuse révolution de Novembre. -

18 Les Royaumes Amazighs Koukou FR.Pdf
Le Royaume de Koukou Les Royaumes amazighs de la période musulmane Dépôt légal : 1576-2011 ISBN : 978-9947-865-40-8 Asqamu Unnig n Timmuzɣa asqamu uniG n timuz$a Haut Commissariat à l'Amazighité Direction de la Promotion Culturelle ACTES Journée d‟étude sur : Le Royaume de Koukou Maison de la culture Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou 30 septembre 2010 Haut Commissariat à l'Amazighité 2011 SOMMAIRE Présentation de la Problématique Hamid BILEK 9 Le Royaume de Koukou : chronologie et géographie des lieux. Oulhadj NAIT DJOUDI 15 Le royaume de Koukou, aspects Historiques et anecdotiques Mohamed BENMEDDOUR 25 Le «Royaume» de Koukou et ses relations avec les principaux pouvoirs politiques présents en Kabylie. Settar OUTMANI 33 Le Royaume des Ath Abbas et influences du mouvement intellectuel des Bibans Djamil AISSANI 45 Programme 59 PROBLEMATIQUE Hamid BILEK S/Directeur DPC / HCA es XIVème et XVème siècles ont vu le Maghreb sombrer dans une période de décadence de ses L trois grandes dynasties. Les Mérinides à l‟Ouest, les Abd El Ouadides au Centre et les Hafsides à l‟Est étaient en phase de déchéance et de décrépitude. C‟est alors que d‟autres forces, d‟autres chefs et d‟autres tribus ont émergé pour prendre en charge leurs destinées au niveau local. Des chefs auparavant vassaux des grands royaumes, organisés généralement autour des zaouias, indépendants les uns des autres, ont pris le relai. Plusieurs petites organisations, petits royaumes, ont vu le jour à cette période dans différentes régions : Touggourt, Ouargla, Constantine, l‟Ouarsenis, Ténès… C‟est alors que la kabylie a vu naître deux entités sur son territoire, le royaume de Koukou et celui des Aït Abbas. -

Béjaïa En Proie Aux Flammes
A la une / Actualité Plusieurs feux de forêt enregistrés dans la wilaya Béjaïa en proie aux flammes © Yahia Magha /Archi ves Libert é Les deux jours de l’Aïd ont été particulièrement chauds. Et pour cause ! Plusieurs dizaines de départs de feu ont été enregistrés aux quatre coins de la wilaya de Béjaïa. Les Béjaouis peuvent respirer. Il ne resterait, selon le communiqué de la Protection civile de Béjaïa, que “deux incendies en cours d'extinction, ceux de Toudja et d’Akfadou”. “Les équipes de la Protection civile sont appuyées par deux hélicoptères dépêchés d'Alger et de la colonne mobile de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, venues renforcer, hier soir, les moyens déployés la veille avec la collaboration d’autres services, des autorités locales, ainsi que l’apport des riverains et des volontaires”, conclut le communiqué. Au premier jour de l’Aïd, le même service a fait état de 31 départs de feu répartis en plusieurs foyers. Ils ont été enregistrés au niveau de 22 communes de la wilaya, qui en compte 52. Les feux jugés plus ou moins importants ont été enregistrés, selon le commandant Soufi, chargé de communication de la Protection civile à Mezoura, le 29 juillet dernier et avant-hier à Aït Alouane dans la commune d’Akfadou. Il y a celui qui a ravagé les forêts d’Ighil n’Saïd (Bouhatem), depuis la soirée du 30 juillet, et celui d’avant-hier à Souk El-Djemaa (Aït Oussalah) relevant de la commune de Toudja. Un autre feu, particulièrement ravageur, est celui qui a touché le lieudit Loubar, communément appelé le pont de Louvar, sur la route de Boulimat à Béjaïa. -

Etablissement Public De Santé De Proximité D'adekar
Etablissement Public de Santé de Proximité d’Adekar L’EPSP d’Adekar érigé en établissement autonome en application de Décret Exécutif n°07-140 du 17/05/2007, relevait antérieurement à cette date du Secteur Sanitaire de Sidi- Aich en tant qu’établissement public à caractère administratif. Le siège de l’EPSP est situé à Adekar, commune traversée par la route nationale n° 12 et épouse le territoire de deux Dairates Adekar Sidi-Aich Il est limité par : A l’EST Commune de Toudja A l’OUEST Commune de Yakouren Au SUD Commune d’Akfadou Au NORD Commune de Sidi-Aich Il s’étale sur une superficie de 40 140 Km2 avec un bassin total de population de 36 005 Habitants réparti comme suit : Commune Adekar 14 100 Ha soit 39,16 % Commune de Tifra 10 307 Ha soit 28,62 % Commune de Taourirt Ighil 7 153 Ha soit 19,86 % Commune de Beni-Ksila 4 445 Ha soit 12,34 % Vu la situation géographique particulière, zone éparse, isolée, accidentée aux aléas de la nature difficile, l’enclavement, décrivant ainsi deux aires géostratégique correspondant aux limites naturelles des deux Dairates. Aire de la Daira d’Adekar Réunissant 03 trois communes (Adekar, Taourirt Ighil et Beni-Ksila) avec un total de population de 25 698 Ha représentant un pourcentage de 71,37 % Aire de la Daira de Sidi-Aich Représentée par la commune de Tifra avec un total de population de 10 307 Ha ce qui représente 28,62 %. L’EPSP d’Adekar est composé de : a-) Commune Adekar 1- Polyclinique Adekar Chef lieu Point d’Urgence H 24 Maternité intégrée H24 (PCIM et Vaccination) Service Laboratoire H24 Service Radiologie H24 Stomatologie – Consultations Médicales – Consultation Spécialisée Service Maladies Chroniques - Psychologie U.D.S Plein temps Lycée mixte 2- Polyclinique Kiria 3- Salle de Soins Tizi-Ougueni b-) Commune de Taourirt Ighil Cinq (05) salles de soins (Taourirt – Aguemoune – Ait Idir – Cheurfa –Tizi El Korn non fonctionnelle pour réfection) S.E.M.E.P Médecine de Travail Unité de contrôle de la Tuberculose (SCTMR) Stomatologie – U.D.S partielle. -

BOOK REVIEW Une Révolution Algérienne À Hauteur Dlhomme, By
FNAS1622255 Techset Composition India (P) Ltd., Bangalore and Chennai, India 5/21/2019 THE JOURNAL OF NORTH AFRICAN STUDIES BOOK REVIEW 5 Une révolution algérienne à hauteur d’homme, by Mohammed Bedjaoui, preface by Jacques Frémieux, Paris, Riveneuve, 2018, iv+372+10 iconographic pp., €22 (softcover), ISBN 978-2-36013-479-3 Dr. Mohammed Bedjaoui (b. 1929) is a distinguished Algerian judge and diplo- 10 mat who subsequently became the first Arab to join, and eventually preside over, the International Court of Justice at The Hague.1 His recollections of the Algerian revolution (1954–62) have astonishing, if unintended, relevance to the Algerian people’sefforts of regime change begun on 22 February 2019, just five months after this book was published. Bedjaoui served as legal 15 advisor to the Gouvernement Provisoire de la République Algérienne (GPRA) from 1958 to 1961. These memoirs relive the author’s original classic, La Révo- lution algérienne et le droit (Brussels, 1961), and show how a small number of exemplary, dedicated patriots erected a new legal system while engaged in a war of national liberation. The very idea of ‘war’, connoting a contest between two sovereign entities, was 20 indeed suppressed by Algeria’s French colonial masters despite their mobilising hundreds of thousands of conscripts to snuff out the ‘troubles’ and punish ‘terror- ism’ in French Algeria. Against its toxic legal logic the Algerians devised a new legal system and gained new forms of international recognition even as the war raged on. Not only did numerous states recognise the GPRA, Dr. Bedjaoui 25 relates how he, armed with a Libyan passport and accompanied by the young Libyan diplomat Mansour Rashid El-Kikhia, officially registered the GPRA’s acces- sion to all four Geneva Conventions of 1949 in their Swiss depository.2 This put the Swiss government in a dilemma. -
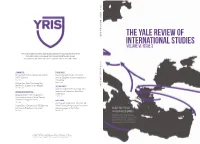
Final-Proof-For-Website.Pdf
Editor – In – Chief Academic Advisors Andrew Tran The Acheson Prize Amanda Behm Executive Editor Associate Director, Sophia Kecskes International Security Studies, Yale University Managing Editors Lysander Christakis Beverly Gage Stephen Mettler Professor of History, Yale University Senior Editors Aaron Berman Charles Hill Miguel Gabriel Goncalves Diplomat – in – Residence Erwin Li and Lecturer in International Studies, Editors Yale University Pranav Bhandarkar Jacob Fender Jolyon Howorth Zeshan Gondal Visiting Professor Yoojin Han of Political Science, Makayla Haussler Yale University Harry Seavey Elena Vazquez Jean Krasno Distinguished Fellow Graphic Design at International Ben Fehrman – Lee Security Studies, Biba Košmerl Yale University Contributors Michelle Malvesti Haley Adams Senior Fellow, Micaela Bullard Jackson Institute, Hannah Carrese Yale University Samantha Gardner Sergio Infante Nuno Monteiro Ryan Pearson Associate Professor of Political Science, Printing Yale University Grand Meridian Printing Long Island City, NY Paul Kennedy J. Richardson Dilworth Professor of History, Yale University Ryan Crocker Kissinger Senior Fellow, Jackson Institute, Yale University Walter Russell Mead James Clarke Chace Volume VI, Issue 3 Professor of Foreign Affairs, Bard College Summer 2016 Table of Contents 6 LETTER FROM THE EDITORS Comment Third Prize 11 THE LONG ROAD TO PEACE: 67 REPATRIATING MACHU NEGOTIATIONS WITH THE PICCHU: ON THE YALE FARC IN COLOMBIA PERUVIAN EXPEDITION Haley Adams AND THE IMPERIALISM OF ARCHAEOLOGY Comment Micaela -

Divx Manager
Liste des films de Utilisateur. - Nombre de films dans la liste: ........ 531 films - Date de création de la liste: ............ le 14/09/2013 ___________________________________________________________________________ _______________ La Nouvelle guerre des boutons (Comédie) Mars 1944. Alors que la planète est secouée par les soubresauts de la guerre mondiale, dans un petit coin d’une campagne française se joue une guerre de gosses… Car, depuis toujours, les gamins des villages voisins de Longeverne et Velrans s'affrontent sans merci. Mais, cette fois, leur guerre va prendre une tournure inattendue : tous les petits prisonniers se voient délestés des boutons de leurs vêtements, en sorte qu’ils repartent presque dénudés, vaincus et humiliés. Ce conflit porte désormais un nom : la "guerre des boutons". Et le village qui aura récolté le plus de boutons sera déclaré v... Christophe Barratier, 2011 (Avec: Laetitia Casta, Guillaume Canet, Kad Merad) Durée du film: 1h40 Le Graphique de Boscop (Comédie) Un éboueur crée un ordinateur qui doit lui faire connaitre la gloire. Georges Dumoulin, 2013 (Avec: Romain Bouteille, Catherine Mitry, Patrice Minet) Durée du film: 1h45 nemo-tore.xvidmp3.avi (Films non triés) Synopsis inconnu Réalisateur inconnu, Année inconnue (Acteurs inconnus) Durée inconnue Dexter (Drame) Brillant expert scientifique du service médico-légal de la police de Miami, Dexter Morgan est spécialisé dans l'analyse de prélèvements sanguins. Mais voilà, Dexter cache un terrible secret : il est également tueur en série. Un serial killer pas comme les autres, avec sa propre vision de la justice. James Manos Jr, 2009 (Avec: Michael C. Hall, Jennifer Carpenter, David Zayas) Durée du film: 0h52 Voyage au centre de la Terre (Aventure) Le professeur Oliver Lindenbrook, convaincu que l'explorateur Arne Saknussem, porté disparu, est parvenu au centre de la Terre, quitte Edimbourg avec ses camarades Alec McEwen, Jenny, Carla Goetaborg et Hans Belker. -

Liste Des Commerçants Réquisitionnés Pour La Permanence De L'aïd EL
Liste des Commerçants réquisitionnés pour la permanence de l’Aïd EL Adha 2018 1- Boulangerie : N° Commune Boulangerie NRC Adresse 1 Hadjili Lounes 06A0257476 Tizi Ouzou 2 Sahouane Hamid 17A5218572 Tala Allam 3 Makoudi Rachid 4 Sahouane Med Arezki 05A0219283 Rue des Frères Beggaz - Amyoud T/O 5 Sahnoune Hakim 07A0257970 Cit2 500 logts Bd Krim Belkacem T/O 6 SNC Kebdi Seddik et cie 99B0043487 Rue des frères Aimène Tizi Ouzou 7 Sarl Boulangerie Rubis 08B0047207 Rhun Sud Quartier 09 A T/Ouzou 8 Oumlil Ali 04A0245932 Tizi Ouzou 9 Zrourou Ali 15A0312874 Tizi Ouzou 10 Yahiou Merzouk 08A0264902 Rue Iratni Ahmed T/Ouzou 11 SNC Nezlioui et Cie 00B0043809 Lotis Louggar - T/Ouzou 12 SNC Da Moussa 08B0047050 Bd Colonel Amirouche - T/O 13 Merakeb Nouredine 14A0309560 Tizi Ouzou 14 snc Chetouani 99B0042787 Zone Sud - T/Ouzou 15 Sahnoune Mohamed 98A0213958 Rue du Cimetière -Villa Hamdad T/O 16 Ait Kaci Salem Artisan Akar - A E H Ait Yahia 2 17 Benmansour Fazia née Ihout 12A0297224 Route Ait Yahia - A E H 18 Ihadadene Yazid 07A00258651 Tzroust - Abi Youcef - A E H Abi Youcef 2 19 Yacini Farid 06A0255904 Abi Youcef - A E H 20 Akbil 1 Bouzidi Med Said 11A0286881 Ait Laaziz - Cne Akbil - A E H 21 Ihadadene Mohand 02A0237256 Rue Colonel Amirouche - A E H Ain el 22 3 Ait Yacoub M'hana 14A0311408 Ahechad Boukouir - A E H Hammam 23 Ait Abdelmalek Akli 13A0304896 Tamzirt el Karn - A E H 24 Illiltene 1 Eurl Yahoui Boulangerie 10B0047802 Illiltène - Iferhounene 25 Iferhounene 1 Saich el Ghezali 17A5511058 Iferhounene 26 Beni Gada Ali 99A0220796 Beni Zmenzer 2 27