Anatole De Monzie Et Georges Mandel
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

LE PASSANT DU MATIN © 1989, Éditions Jean-Claude Lattès JEAN-LUC GENDRY
LE PASSANT DU MATIN © 1989, éditions Jean-Claude Lattès JEAN-LUC GENDRY LE PASSANT DU MATIN CHAPITRE 1 Le lieutenant lui avait dit : « Si votre moto ne peut pas sui- vre, on ne pourra pas vous attendre. Le peloton n'a plus les moyens de traîner. » Depuis deux jours, il traînait en queue de peloton, avec des ratés interminables, des soubresauts, des reprises inattendues qui lui donnaient un fol espoir. Les autres rigolaient sous leurs lunettes et leurs casques. Cette amitié née sous les bombes des stukas et les balles traçantes des mitrail- leuses, cette fraternité des vingt-six hommes au combat, dans la poussière des routes, l'odeur chaude des champs de blé, la fraîcheur des nuits à la belle étoile se dissolvaient bêtement sous l'ironie facile de ceux dont les machines tournaient rond. Il n'y a rien à faire avec les Français, la rigolade leur tient lieu d'habillage. Ils font les mariolles. La plus grande déroute de leur histoire. La plus fantastique défaite jamais subie par une armée, donnée encore un mois plus tôt pour la première du monde. Et ils rient encore. Pour la première fois depuis un an, il les détesta et se détesta de les critiquer. Son moteur ne mar- chait plus que sur trois pattes. L'écart sur les derniers s'agran- dissait à vue d'œil. Ils lui avaient dit : « Tu nous rejoindras au prochain cantonnement. Direction Saumur, Bordeaux, Saint- Jean-de-Luz. » Ils auraient aussi bien dit : Périgueux, Cahors et Montauban. Qu'est-ce qu'ils en savaient ? Il n'y avait plus d'ordres. -

LE RASSEMBLEMENT DES GAUCHES REPUBLICAINES ET SES COMPOSANTES Article Extrait De La Revue Recherches Contemporaines, N° 5, 1998-1999
LE RASSEMBLEMENT DES GAUCHES REPUBLICAINES ET SES COMPOSANTES Article extrait de la revue Recherches contemporaines, n° 5, 1998-1999 Le Rassemblement comme rassemblement Éric DUHAMEL De toutes les formations politiques, le RGR est probablement celle qui a le moins retenu l’attention des historiens. Les histoires générales de la 4e République se contentent de le qualifier de cartel électoral quand il n’est pas purement et simplement assimilé au Parti radical1. Or, le RGR, sans avoir été un parti politique stricto sensu, a été beaucoup plus qu’un cartel électoral ; en fait une confédération de forces politiques comparable à l’UDF. Mais si l’UDF, à l’origine cartel électoral, s’est transformée en "groupement politique"2, le RGR, ainsi que nous le verrons, a été pensé d’emblée comme une formule originale de regroupement de forces politiques. A ce titre, le RGR a joué un rôle et remplit une fonction non négligeable durant la 4e République. En outre, il constitue un type d’organisation dont la connaissance peut utilement enrichir les études sur les associations partisanes. Le lecteur ne trouvera pas dans les lignes qui suivent une étude exhaustive de cette formation mais, à l’occasion de la publication des notes politiques de Pierre de Léotard dans ce numéro de Recherches contemporaines, une brève présentation. L’histoire du RGR est celle de ses paradoxes. Le moindre n’a-t-il pas été de voir associés dans une même formation radicaux et manifestants du 6 février 1934, survivants de Vichy et résistants parmi les plus authentiques ? Que ce Rassemblement ait eu une influence certaine au Parlement, quand bien même ses principales composantes sont sorties discréditées de la seconde guerre mondiale, à l’exception 1. -

Article (Accepted Version)
Article De Gaulle et la reconstruction BAUDOUI, Remi Abstract Il s'agit de s'interroger sur le rôle du Général de Gaulle en matière de reconstruction de la France depuis les débats de la résistance jusqu'à son rôle de chef de gouvernement provisoire de la République française Reference BAUDOUI, Remi. De Gaulle et la reconstruction. Espoir, 1995, vol. 103 Available at: http://archive-ouverte.unige.ch/unige:110874 Disclaimer: layout of this document may differ from the published version. 1 / 1 De Gaulle et la reconstruction Rémi BAUDOUI Professeur à l’université Pierre Mendès France (Grenoble) « De Gaulle et la reconstruction », Espoir n°103, 1995 Bien que la nécessité de créer une administration de la reconstruction ne semble pas avoir été évoquée par le général de Gaulle lors de la constitution du gouvernement du 9 septembre 1944, les travaux promus depuis Alger par le CFLN soulignent que cette hypothèse avait, depuis longtemps, cheminée dans les esprits. Les bombardements anglo-américains, la perspective des débarquements et des combats de libération nationale, laissaient présager une importante aggravation des destructions. Le 1er décembre 1943, Robert Lévi, directeur des Transports du secrétariat aux Communications, recommandait, pour l'après-guerre, de constituer aux côtés des ministères des Travaux publics et de la production industrielle un ministère de la Reconstruction. Pour sa part, Maxime Blocq-Mascart au titre du mouvement de résistance OCM avait suggéré de constituer auprès du ministère de la Vie sociale une direction de l'Urbanisme et du Logement chargée de dresser les plans d'urbanisme et de procéder à la construction de logements. -

Gardes Des Sceaux En France, D'hier Et D'aujourd'hui
GARDES DES SCEAUX EN FRANCE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI GARDES DESGARDES D’AUJOURD’HUI ET D’HIER EN FRANCE, SCEAUX GARDES DES SCEAUX EN FRANCE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI ÉDITO Depuis près de 300 ans, sans interruption, la Chancellerie située place Vendôme, accueille les chanceliers de France, gardes des sceaux et ministres de la justice.Une fonction qui existe, elle, depuis 1545. Située sur l’une des plus prestigieuses places de Paris, la Chancellerie témoigne en ces lieux de la pérennité de l’État. Danton, d’Aguesseau, Cambacérès ... les noms de personnalités illustres résonnent dans l’hôtel de Bourvallais comme pour en scander l’histoire. Tous y ont laissé leur empreinte. Extension, embellissement de l’hôtel d’une part, affirmation de la fonction de ministre de la justice de l’autre, ainsi se sont entremêlés pendant près de trois siècles architecture, art et politique. GARDES DES SCEAUX · ANCIEN RÉGIME FRANÇOIS OLIVIER 28 avril 1545 - 22 mai 1551 Rois de France : François Ier et Henri II © Gallica.bnf.fr/Bibliothèque nationale de France 5 GARDES DES SCEAUX · ANCIEN RÉGIME JEAN DE BERTRAND 22 mai 1551- 10 juillet 1559 Roi de France : Henri II © Château de Versailles, Dist. RMN-Grand Palais/image château de Versailles 6 GARDES DES SCEAUX · ANCIEN RÉGIME FRANÇOIS OLIVIER 10 juillet 1559 - 2 janvier 1560 Roi de France : François II © Gallica.bnf.fr/Bibliothèque nationale de France 7 GARDES DES SCEAUX · ANCIEN RÉGIME JEAN DE MORVILLIER fin avril 1560 - 2 juin 1560 Roi de France : François II © Gallica.bnf.fr/Bibliothèque nationale de France 8 GARDES -

Alain Au Fil Du Temps De Napoléon III À Vincent AURIOL 1 8
+- Alain au fil du temps de Napoléon III à Vincent AURIOL ALAIN POLITIQUE et INSTITUTIONS CULTURE et FAITS DIVERS SECOND EMPIRE Napoléon III est Empereur des Français depuis le 2 décembre 1852 (date de promulgation du Sénatus-Consulte du 7 novembre 1852, approuvé par le plébiscite des 21 et 22 novembre 1852 et portant rétablissement de la « dignité impériale ») 1 8 6 8 3 mars 1868 – Naissance d’Emile Auguste CHARTIER à Mortagne-au-Perche). L’acte de naissance (n°16) conservé aux Archives Départementales de l’Orne mentionne qu’il est le fils : - d’Etienne Chartier, âgé de 32 ans, Médecin-vétérinaire, 28 mars 1868 - (calendrier grégorien) – demeurant rue de la Comédie ; Naissance à Nijni Novgord de l’écrivain russe - et de son épouse Juliette CHALINE, âgée de 28 ans, sans Maxime GORKI, fondateur en littérature du profession ; réalisme socialiste, engagé aux côtés de la - les témoins sont : Charles Bugleau, Huisser et Alphonse révolution bolchévique, proche de Lénine, il doit Chaline, rentier, grand-oncle de l’enfant. cependant s’exiler en Italie pour certaines prises de L’acte porte également les mentions suivantes : positions critiques, de 1921 à 1932, où Staline - marié « à » Le Vésinet le 27 décembre 1965 avec Gabrielle l’encourage à rentrer. Il meurt à Moscou le 18 juin Louise LANDORMY ; 1936 dans des conditions suspectes, mais aura des - décédé « à » Vésinet le 2 juin 1951 (acte de naissance encore funérailles nationales. non communicable moins de 70 ans) 1er avril 1868 – Naissance à Marseille de l’écrivain, dramaturge, poète et essayiste Edmond ROSTAND (Cirano de Bergerac, L’Aiglon…). -

Consultez Les Jours De Collecte En Tri'sac
Index des rues et jours de collecte Tri’sac à Nantes Cet index vous permet de connaître le(s) jour(s) de collecte de vos déchets en fonction de votre rue. Pour rechercher votre rue dans ce document : 1) Appuyer simultanément sur les touches Ctrl + F de votre clavier 2) Saisir le libellé directeur de votre rue dans le petit encadré du menu en haut de page (comme dans l’exemple ci-dessous) 3) Valider en appuyant sur la touche entrée de votre clavier. Vous allez automatiquement accéder à la page concernée et votre rue sera surlignée en bleu. PRECISIONS SUR LE JOURS DE LIBELLE DE RUE LIBELLE DIRECTEUR DE RUE DECOUPAGE DES RUES COLLECTE Ruelle Aino Aalto Aalto (Ruelle Aino ) mardi et vendredi Allée des Abeilles Abeilles (Allée des ) lundi et jeudi Rue des Acadiens Acadiens (Rue des ) lundi et jeudi Rue Konrad Adenauer Adenauer (Rue Konrad ) mardi et vendredi Rue de l'Adour Adour (Rue de l') lundi et jeudi Rue de l'Adriatique Adriatique (Rue de l') mardi et vendredi Avenue des Agneaux Agneaux (Avenue des ) lundi et jeudi Boulevard Saint Aignan Aignan (Boulevard Saint ) à partir des numéros 75 et 82 lundi et jeudi Quai du Marquis d'Aiguillon Aiguillon (Quai du Marquis d') lundi et jeudi Rue d'El Alamein Alamein (Rue d'El ) mardi et vendredi Rue François Albert Albert (Rue François ) mardi et vendredi Rue des Albizzias Albizzias (Rue des ) mardi et vendredi Avenue de l'Alcyon Alcyon (Avenue de l') mardi et vendredi Avenue Alphonse Allais Allais (Avenue Alphonse ) lundi et jeudi Boulevard Salvador Allende Allende (Boulevard Salvador ) lundi et -

Fund Appeal 10 Tydings Gives Lie Communist Piot
WEATHER. (TJ. 8. Weather Bureau Forecast.) The only evening paper r«ir tonight; tomorrow fair and slightly in with the warmer; gentle variable winds. Tempera- Washington tures today—Highest, 87, at 2 p.m.; Associated Press News Full report on page A-2. and Wirephoto Services. Closing N.Y. Markets—Sales—Page 14 S3?.*»T'8 128,364 S«L8„. 144,809 (Some Return. Nut Tut Received.) 86th YEAR. No. 34,446. SrMwSSSSS.1^ WASHINGTON, D. C., MONDAY, AUGUST 22, 1938—THIRTY PAGES. Ajaaarg-. three cents. ■ Ruled Out / Tommy, i LIE / Wfe’RE GETTlM’l TYDINGS GIVES / A LOT Q’WiLD, COMMUNIST PIOT l STUFF IN THIS / FUND APPEAL 10 TO LOBBY CHARGE V" CROP; / ON DEMOCRATIC fK/EW DtAl^l IN 124-SHIP DEAL -Pri mar.V-4 Propagating ; PARTY CHARGED | GARDENS ~j Disapproves Alliance Drive 2 Members of Socialist Contended Senator Push Split to Open Way for for $50,000 to Fight Union Group Quit in Aided Big 'Business’ in Farmer-Labor Group, Rep. O’Connor. Surprise Move. Sale of U. S. Vessels. Matthews Says. SAYS MOVE IS LEGAL, SUCCESSOR SELECTED, BOATS WERE BEING SOLD NEW ‘SOVIET AMERICA’ BUT HE DISLIKES IDEA SAY PREMIER’S FRIENDS TO JAPAN RIVAL SAYS AIM, HE TELLS QUIZ Reiterates That No One in W.P.A. ‘Interference’ Becomes Issue in Franc Strengthens Against Dollar Shirley Temple and Robert Taylor Will Lose Job Because of and Pound in Spite of Primary Fight—Defended by MAURY MAVERICK. Are Listed as Among Those Way He Votes. f Designations. Bepresentative. ‘Exploited’ by Communists. Bf the Associated Press. -

Historical Dictionary of World War II France Historical Dictionaries of French History
Historical Dictionary of World War II France Historical Dictionaries of French History Historical Dictionary of the French Revolution, 1789–1799 Samuel F. Scott and Barry Rothaus, editors Historical Dictionary of Napoleonic France, 1799–1815 Owen Connelly, editor Historical Dictionary of France from the 1815 Restoration to the Second Empire Edgar Leon Newman, editor Historical Dictionary of the French Second Empire, 1852–1870 William E. Echard, editor Historical Dictionary of the Third French Republic, 1870–1940 Patrick H. Hutton, editor-in-chief Historical Dictionary of the French Fourth and Fifth Republics, 1946–1991 Wayne Northcutt, editor-in-chief Historical Dictionary of World War II France The Occupation, Vichy, and the Resistance, 1938–1946 Edited by BERTRAM M. GORDON Greenwood Press Westport, Connecticut Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Historical dictionary of World War II France : the Occupation, Vichy, and the Resistance, 1938–1946 / edited by Bertram M. Gordon. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 0–313–29421–6 (alk. paper) 1. France—History—German occupation, 1940–1945—Dictionaries. 2. World War, 1939–1945—Underground movements—France— Dictionaries. 3. World War, 1939–1945—France—Colonies— Dictionaries. I. Gordon, Bertram M., 1943– . DC397.H58 1998 940.53'44—dc21 97–18190 British Library Cataloguing in Publication Data is available. Copyright ᭧ 1998 by Bertram M. Gordon All rights reserved. No portion of this book may be reproduced, by any process or technique, without the express written consent of the publisher. Library of Congress Catalog Card Number: 97–18190 ISBN: 0–313–29421–6 First published in 1998 Greenwood Press, 88 Post Road West, Westport, CT 06881 An imprint of Greenwood Publishing Group, Inc. -
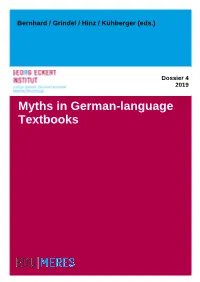
Myths in German-Language Textbooks Eckert
Bernhard / Grindel / Hinz / Kühberger (eds.) Dossier 4 2019 Myths in German-language Textbooks Eckert. Dossiers 4 (2019) Roland Bernhard / Susanne Grindel / Felix Hinz / Christoph Kühberger (eds.) Myths in German-language Textbooks: Their Influence on Historical Accounts from the Battle of Marathon to the Élysée Treaty This publication was published under the creative commons licence:Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/, with the exception of the illustrations (see p. 317). Eckert. Dossiers Georg Eckert Institute for International Textbook Research ISSN 2191-0790 Volume 4 (2019) Editor Wibke Westermeyer Translator Katherine Ebisch-Burton Cite as: Roland Bernhard, Susanne Grindel, Felix Hinz and Christoph Kühberger (eds.). Myths in German-language Textbooks: Their Influence on Historical Accounts from the Battle of Marathon to the Élysée Treaty. Eckert. Dossiers 4 (2019). urn:nbn:de:0220- 2019-0040. Contents Roland Bernhard / Susanne Grindel / Felix Hinz / Christoph Kühberger Editors’ preface – Myths and sense-making in history textbooks: a window on cultures of history, knowledge and communication ................................................................. 6 Roland Bernhard / Susanne Grindel / Felix Hinz / Johannes Meyer-Hamme Historical myth: a definition from the perspective of history education research .......... 12 Felix Hinz White dwarves in the firmament of historical consciousness? Marathon/Salamis and Tours/Poitiers as European myths of deliverance ........................ 35 Björn Onken The myth of Arminius (Hermann) in German textbooks between 1800 and 2000 ........ 61 Roland Bernhard Martin Behaim of Nuremberg: the 'real discoverer of America'? German textbooks of the 18th to 21st centuries and the myth of the flat Earth .............. 94 Susanne Grindel The myth of colonialism: European expansion in Africa ................................................... -

Jewish Resistance
Durham E-Theses Philo-Semites, Anti-Semites and France's Jewish Communities in the late Third Republic (c.1900-1940) YOO, YOUNGHO How to cite: YOO, YOUNGHO (2020) Philo-Semites, Anti-Semites and France's Jewish Communities in the late Third Republic (c.1900-1940), Durham theses, Durham University. Available at Durham E-Theses Online: http://etheses.dur.ac.uk/13909/ Use policy The full-text may be used and/or reproduced, and given to third parties in any format or medium, without prior permission or charge, for personal research or study, educational, or not-for-prot purposes provided that: • a full bibliographic reference is made to the original source • a link is made to the metadata record in Durham E-Theses • the full-text is not changed in any way The full-text must not be sold in any format or medium without the formal permission of the copyright holders. Please consult the full Durham E-Theses policy for further details. Academic Support Oce, Durham University, University Oce, Old Elvet, Durham DH1 3HP e-mail: [email protected] Tel: +44 0191 334 6107 http://etheses.dur.ac.uk 2 Philo-Semites, Anti-Semites and France’s Jewish Communities in the late Third Republic (c.1900-1940) Youngho Yoo Master of Arts (by Thesis) History Department Durham University 2020 1 Abstract This study analyses the attitudes of a wide spectrum of political commentators and the press on Jews in France between the 1880s and 1930s, and how these debates affected the self- understanding and mutual perspectives of the two distinctive French Jewish communities – the long-established Jews (known as Israélites) and the foreign Jews (known as Juifs). -

Andre Tardieus Failure As Prime Minister of France, 1929-1930 Tim K
Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Master's Theses Graduate School 2002 The aT rdieu moment: Andre Tardieus failure as Prime Minister of France, 1929-1930 Tim K. Fuchs Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_theses Part of the History Commons Recommended Citation Fuchs, Tim K., "The aT rdieu moment: Andre Tardieus failure as Prime Minister of France, 1929-1930" (2002). LSU Master's Theses. 634. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_theses/634 This Thesis is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Master's Theses by an authorized graduate school editor of LSU Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. THE TARDIEU MOMENT: ANDRE TARDIEU’S FAILURE AS PRIME MINISTER OF FRANCE, 1929-1930 A Thesis Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in The Department of History by Tim K. Fuchs B.A., Georgia Southern University, 1998 May 2002 TABLE OF CONTENTS ABSTRACT ................................................................................................................................. iii CHAPTER 1 INTRODUCTION ............................................................................................................ 1 2 ECONOMIC BACKGROUND ....................................................................................... -

French and German Cultural Cooperation, 1925-1954
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Carolina Digital Repository The Cultivation of Friendship: French and German Cultural Cooperation, 1925-1954 Elana Passman A dissertation submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of History Chapel Hill 2008 Approved by: Dr. Donald M. Reid Dr. Christopher R. Browning Dr. Konrad H. Jarausch Dr. Alice Kaplan Dr. Lloyd Kramer Dr. Jay M. Smith ©2008 Elana Passman ALL RIGHTS RESERVED ii ABSTRACT ELANA PASSMAN The Cultivation of Friendship: French and German Cultural Cooperation, 1925-1954 (under the direction of Donald M. Reid) Through a series of case studies of French-German friendship societies, this dissertation investigates the ways in which activists in France and Germany battled the dominant strains of nationalism to overcome their traditional antagonism. It asks how the Germans and the French recast their relationship as “hereditary enemies” to enable them to become partners at the heart of today’s Europe. Looking to the transformative power of civic activism, it examines how journalists, intellectuals, students, industrialists, and priests developed associations and lobbying groups to reconfigure the French-German dynamic through cultural exchanges, bilingual or binational journals, conferences, lectures, exhibits, and charitable ventures. As a study of transnational cultural relations, this dissertation focuses on individual mediators along with the networks and institutions they developed; it also explores the history of the idea of cooperation. Attempts at rapprochement in the interwar period proved remarkably resilient in the face of the prevalent nationalist spirit.