Rimbaud : La Clef Alchimique
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Arthur Rimbaud Napfény És Hús Arthur Rimbaud Minden Verse, Prózája És Válogatott Levelei
Arthur Rimbaud Napfény és hús Arthur Rimbaud minden verse, prózája és válogatott levelei Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket készítette Bárdos László A KÖTET FORDÍTÓI ADAMIK LAJOS BABITS MIHÁLY FRANYÓ ZOLTÁN HATÁR GYŐZŐ ILLYÉS GYULA JÁNOSY ISTVÁN JÉKELY ZOLTÁN JÓZSEF ATTILA JUHÁSZ GYULA KARDOS LÁSZLÓ KÉPES GÉZA KOSZTOLÁNYI DEZSŐ KOVÁCS ILONA MÁRTON LÁSZLÓ NAGY LÁSZLÓ NEMES NAGY ÁGNES PÁLFFY GABRIELLA RADNÓTI MIKLÓS RÓNAY GYÖRGY SOMLYÓ GYÖRGY SZABÓ LŐRINC SZEKERES GYÖRGY TANDORI DEZSŐ TELLÉR GYULA TIMÁR GYÖRGY TÓTH ÁRPÁD TÓTH JUDIT WEÖRES SÁNDOR TARTALOM VERSEK 1869-1871 A magánhangzók szonettje (Tóth Árpád fordítása) Árvák újévi ajándéka (Kardos László fordítása) Magánhangzók (Kardos László fordítása) Érzés (Kardos László fordítása) Magánhangzók (Rónay György fordítása) Élmény (Rónay György fordítása) Magánhangzók (Képes Géza fordítása) Érzelem (Képes Géza fordítása) Magánhangzók (Tandori Dezső fordítása) Napfény és hús (Kardos László fordítása) (A csillag könnyezik...) (Franyó Zoltán fordítása) Ofélia (Rónay György fordítása) (Füled köré...) (Somlyó György fordítása) Az akasztottak bálja (Rónay György fordítása) Tetvésző lányok (Kardos László fordítása) Az akasztottak bálja (Márton László fordítása) Tetükeresők (Rónay György fordítása) Tartufe bűnhődése (Somlyó György fordítása) Az igaz ember (Töredék; Nagy László fordítása) A kovács (Nemes Nagy Ágnes fordítása) Amit a virágokról mondanak a költőnek (Kilencvenkettesek s kilencvenhármasok) (Somlyó György fordítása) (Kardos László fordítása) Első áldozások (Somlyó György fordítása) -
Best Western Hôtel Littéraire Arthur Rimbaud
Arthur Rimbaud Hôtel Littéraire 6, rue Gustave Goublier, 75010 PARIS Tél. +33 (0)1 40 40 02 02 www.hotel-litteraire-arthur-rimbaud.com 1 « …Et d’ineffables vents m’ont hélé par instants. » Arthur Rimbaud, notre premier poète ; celui qui bouleverse les adolescences paisibles, renverse notre vision de la littérature et nous ouvre les yeux sur un monde saturé de couleurs, d’émotions, de vie. Arthur Rimbaud, celui qui, par son souffle épique, a emporté notre jeunesse ; nous aussi nous avions 17 ans et avec lui, nous allions « sous le ciel », nous descendions « les fleuves impassibles » et avec lui, nous avons su « …les cieux crevant en éclairs, et les trombes Et les ressacs et les courants... » Il faut se laisser emporter par le rythme, la fulgurance des mots, le chatoiement des images et du style de Rimbaud pour découvrir dans un seul poème, voire un seul vers, le génie du plus précoce et du plus important des poètes. « Ce n’était ni le diable ni le Bon Dieu, c’était Arthur Rimbaud, c’est à dire un très grand poète, absolument original, d’une saveur unique ». (Verlaine). C’est ce bouleversement que nous voulons partager avec vous, à travers 42 chambres, des éditions originales, une bibliothèque de 500 livres, des dizaines de références, de clins d’œil. Retrouver ensemble, l’émotion de Rimbaud : il est celui, disait François Mauriac « qui ne se retourne même pas pour regarder la trace que ses pas d’enfants ont laissée sur le monde ». Arthur Rimbaud, our first poet; the poet who disrupts the peaceful years of adolescence, turns our vision of literature upside down and opens our eyes to a world full of colour, emotions and life. -

Arthur Rimbaud Titles in the Series Critical Lives Present the Work of Leading Cultural figures of the Modern Period
Arthur Rimbaud Titles in the series Critical Lives present the work of leading cultural figures of the modern period. Each book explores the life of the artist, writer, philosopher or architect in question and relates it to their major works. In the same series Antonin Artaud David A. Shafer Franz Kafka Sander L. Gilman Roland Barthes Andy Stafford Frida Kahlo Gannit Ankori Georges Bataille Stuart Kendall Søren Kierkegaard Alastair Hannay Charles Baudelaire Rosemary Lloyd Yves Klein Nuit Banai Simone de Beauvoir Ursula Tidd Arthur Koestler Edward Saunders Samuel Beckett Andrew Gibson Akira Kurosawa Peter Wild Walter Benjamin Esther Leslie Lenin Lars T. Lih John Berger Andy Merrifield Pierre Loti Richard M. Berrong Leonard Bernstein Paul R. Laird Jean-François Lyotard Kiff Bamford Joseph Beuys Claudia Mesch Stéphane Mallarmé Roger Pearson Jorge Luis Borges Jason Wilson Gabriel García Márquez Stephen M. Hart Constantin Brancusi Sanda Miller Karl Marx Paul Thomas Bertolt Brecht Philip Glahn Henry Miller David Stephen Calonne Charles Bukowski David Stephen Calonne Herman Melville Kevin J. Hayes Mikhail Bulgakov J.A.E. Curtis Yukio Mishima Damian Flanagan William S. Burroughs Phil Baker Eadweard Muybridge Marta Braun John Cage Rob Haskins Vladimir Nabokov Barbara Wyllie Albert Camus Edward J. Hughes Pablo Neruda Dominic Moran Fidel Castro Nick Caistor Georgia O’Keeffe Nancy J. Scott Paul Cézanne Jon Kear Octavio Paz Nick Caistor Coco Chanel Linda Simon Pablo Picasso Mary Ann Caws Noam Chomsky Wolfgang B. Sperlich Edgar Allan Poe Kevin J. Hayes Jean Cocteau James S. Williams Ezra Pound Alec Marsh Salvador Dalí Mary Ann Caws Marcel Proust Adam Watt Guy Debord Andy Merrifield Arthur Rimbaud Seth Whidden Claude Debussy David J. -
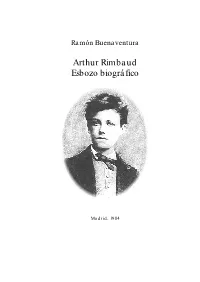
Arthur Rimbaud Esbozo Biográfico
Ramón Buenaventura Arthur Rimbaud Esbozo biográfico Madrid, 1984 © Copyright Ramón Buenaventura, 1985 © Copyright de las características de esta edición: EDICIONES HIPERIÓN, S.L. Salustiano Olózaga, 14 - 28001 Madrid ISBN: 84-7517-142-7 Depósito Legal: M - 7979 - 1985 1 Este librito es resultado de mi caída, a gravedad suelta, en una trampa de la devoción. Había previsto que cada tomo de las obras de Arthur Rimbaud fuera acompañado de un mero cuadro cronológico que orientara el lector por los momentos clave. Al repasar, para leve modificación, el cuadro cronológico que había in- cluido en Una temporada en el infierno, me pareció de pronto despreciable, por mi parte, no sacarme un esfuerzo más, y escribir una corta noticia bio- gráfica. Apunté a treinta o cuarenta folios —y han salido ciento dos. Buen ojo, como de costumbre1. De todas formas, no se entienda que esta sobreabundancia ensoberbece la modestia del proyecto inicial. Si tenemos un libro, en vez de un añadido a la edición de las Iluminaciones, es porque todas las reliquias que colocaba en el altar del santo se me antojaban pocas. Me he metido a traducir docu- mentos de la vida de Rimbaud que aparecen por primera vez en castellano, casi todos ellos. Pero, como me tenía firmemente prometido, he sobrado la tentación de hacer literatura a costa de Rimbaud. Lo que he escrito es un breve informe con datos. Sin adornarme más que en las cuatro o cinco inevitables ocasio- nes en que a uno se le distraen los dedos sobre las teclas y, zas, hace una frase. Los modernos inventos electrónicos facilitan en grado sumo tales devaneos. -

Silence Et Renversement De Rimbaud : Par-Delà Le Nihilisme
Document généré le 2 oct. 2021 18:24 Les écrits Silence et renversement de Rimbaud Par-delà le nihilisme Fernand Ouellette Numéro 147, août 2016 URI : https://id.erudit.org/iderudit/83281ac Aller au sommaire du numéro Éditeur(s) Les écrits de l’Académie des lettres du Québec ISSN 1200-7935 (imprimé) 2371-3445 (numérique) Découvrir la revue Citer cet article Ouellette, F. (2016). Silence et renversement de Rimbaud : par-delà le nihilisme. Les écrits, (147), 251–266. Tous droits réservés © Les écrits de l’Académie des lettres du Québec, 2016 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne. https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/ Cet article est diffusé et préservé par Érudit. Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. https://www.erudit.org/fr/ l 251 FERNAND OUELLETTE Silence et renversement de Rimbaud PAR-DELÀ LE NIHILISME Pourquoi Arthur Rimbaud cesse-t-il d’écrire, se retire-t-il dans un silence fait de « plusieurs silences », comme si la poésie l’avait abandonné, lui, pourtant l’antipode de l’homme de lettres, qui avait traversé le langage comme une fusée, dans une tension dialectique, s’était baigné dans « le Poème de la Mer », avait « rêvé la nuit verte aux neiges éblouies » et « L’assaut -

Mise En Page 1
Bibliothèque Historique de la Ville de Paris Dossier de presse - Avril 2010 SOMMAIRE Informations pratiques p. 2 Communiqué de presse p. 3 Arthur Rimbaud : repères biographiques p. 4 Parcours de l’exposition p. 5 Les origines et l’œuvre p. 5 L’icône p. 7 Les arts vivants, littérature et cinéma p. 9 Dévotions p. 11 L’explosion multimédia et art de la rue p. 12 Le livre p. 13 Autour de l’exposition p. 14 Les images qui ponctuent ce dossier sont disponibles et libres de droits pour la presse dans le cadre de la promotion de cette exposition. Contact : [email protected] 01 44 78 80 46/58 Body rose pour bébé Zazzle (USA), collection Tee-shirt rouge du Parti communiste, cellule particulière, DR, cliché Youngtae. de Charleville, 2007, collection Jean-Charles Bervesseles, cliché Studio Carl Gustin. INFORMATIONS PRATIQUES RIMBAUDMANIA. L’éternité d’une icône 7 mai - 1er août 2010 Du mardi au dimanche, de 13h à 19h Nocturne les jeudis jusqu’à 21h Fermeture les 8, 13 mai et 14 juillet > Galerie des bibliothèques / Ville de Paris 22, rue Malher Paris 4e Métro : Saint-Paul Entrée 4 €. Tarif réduit : 2 € Réservation pour les groupes, scolaires et centres de loisirs : Galerie des bibliothèques : 01 44 59 29 60 [email protected] > Visites commentées par le commissaire de l’exposition : Samedi 22 mai - 14h30 Vendredi 11 juin - 15h30 Samedi 26 juin - 14h30 > Commissaire de l’exposition : Claude Jeancolas Scénographie : Gaëlle Seltzer Graphisme : Christophe Billoret > Contacts presse / Paris bibliothèques Annabelle Allain 01 44 78 80 46 Gérald Ciolkowski 01 44 78 80 58 Visuels sur demande : [email protected] > Coproduction Paris bibliothèques / www.paris-bibliotheques.org Ville de Charleville-Mézières 2 COMMUNIQUÉ DE PRESSE En un siècle, Arthur Rimbaud s’est imposé comme l’un des mythes fondateurs de la culture moderne. -

Arthur Rimbaud – Revolutionärer Schwuler Lyriker Im Späten 19
1 Arthur Rimbaud – revolutionärer schwuler Lyriker im späten 19. Jahrhundert Jean -Nicholas -Arthur Rimbaud (1854 – 1891) wurde am 20. October 1854 in Charleville in den Ardennen, Frankreich, als zweiter Sohn von Vitalie Rimbaud (geborene Cuif ) und Frédéric R imbaud , einem Offizier der französischen Armee, geboren. Als Arthur vier Jahre alt war, wurde seine Schwester Vitalie geboren, gefolgt von Isabelle , die zwei Jahre später, 1860, das Licht der Welt erblickte. Im selben Jahr von Isabelles Geburt verließ Frédéric Rimbaud seine Familie. Vitalie Rimbaud und die vier Kinder (Arthur hatte noch einen älteren Bruder namens Fréderic ) gerieten durch den Weggang des Va- ters in wirtschaftliche Not und mussten in ein ärmeres Quartier umziehen. Vitalie, vom Verlassenwerden durch ihren Ehemann traumatisiert, schirmte ihre Kinder von nun an fast akribisch von Allem ab, das sie mit scheinbar „schlechten Einflüssen“ in Verbindung brachte, um zu verhindern, dass sie nach ihrem Vater schlagen. Als der junge Arthur eine Vorliebe dafür entwickelte, sich aus dem Haus zu schleichen und gegen den Willen seiner beschützenden Mutter mit den ansässigen Kindern zu spielen, sorgte Mutter Vitalie erneut für einen Umzug der Familie. Ab 1861 nutzte Vitalie zusammen mit ihren Kindern ein von ihrer Familie geerbtes bzw. überschriebenes Anwesen in der ländlichen Umgebung von Charleville, um einen eigenen Bauernhof zu betreiben, was für sie selbst und die vier Kinder (Fréderic, Arthur, Vitalie und Isabelle) neben ihren schulischen Ver- pflichtungen auch noch harte Arbeit auf den Feldern und in den Stallungen des müttler- lichen Hofes bedeutete. Vitalie Rimbaud meldete ihre beiden Söhne Arthur und dessen älteren Bruder Frédéric am Rossat Institut , einer angesehenen, weiterführenden Schule in Charleville, an und erwartete zwecks Wiederherstellung der Ehre der Familie von beiden Söhnen heraus- ragende schulische Leistungen. -

Rimbaud D'outre-Tombe
TOUS LES JOURS, TOUTE L’INFO Rimbaud d'outre-tombe Par Jérôme Dupuis, publié le 13/04/2010 C'est une première dans l'édition : la publication de la correspondance échangée après la mort de l'auteur du Bateau ivre par des proches, des écrivains et même des explorateurs. Où l'on assiste à la naissance d'une légende. C'est la revue La Plume qui, la première, révèle le "scoop" : "Nous avons le triste devoir d'annoncer au monde littéraire la mort d'Arthur Rimbaud. Il a été enterré ces jours derniers à Charleville. Son corps a été ramené de Marseille. Sa mère et sa soeur suivaient SEULES le convoi funèbre. Au prochain numéro, détails complets." Ce mardi 1er décembre 1891, la disparition de l'auteur du Bateau ivre n'occupe encore que trois maigres lignes dans la presse. Pourtant, cet enterrement intime d'un poète, qui n'a pas vendu le moindre exemplaire de son vivant, marque moins la fin d'une destinée que la naissance d'une légende. Dans les jours, les mois et les années qui vont suivre, une nuée de poètes, faussaires, parents, anciens compagnons de beuverie, explorateurs abyssins, sans même parler d'un célèbre amant, vont dessiner les contours du Rimbaud que nous connaissons aujourd'hui. C'est cette métamorphose que dévoile l'incroyable recueil intitulé Sur Arthur Rimbaud. Correspondance posthume 1891-1900, qui sort aujourd'hui. Après un premier volume de Correspondance "anthume" du poète, paru en 2007, les éditions Fayard et le grand rimbaldien Jean-Jacques Lefrère se sont en effet lancés dans une entreprise folle et, semble-t-il, sans équivalent dans la littérature mondiale : publier l'intégralité des lettres échangées par des proches, des hommes de lettres et des témoins, à propos d'un poète, Rimbaud, à compter du jour de sa mort. -

Bad Blood Ancestry: from Barbarian to Christian
2017 HAWAII UNIVERSITY INTERNATIONAL CONFERENCES ARTS, HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES & EDUCATION JANUARY 3 - 6, 2017 ALA MOANA HOTEL, HONOLULU, HAWAII BAD BLOOD ANCESTRY: FROM BARBARIAN TO CHRISTIAN KREPPS, MYRIAM PITTSBURG STATE UNIVERSITY DEPARTMENT OF ENGLISH AND MODERN LANGUAGES Dr. Myriam Krepps Department of English and Modern Languages Pittsburg State University Bad Blood Ancestry: From Barbarian to Christian Synopsis: Should we assume that in “Bad Blood” Rimbaud is asserting the Gaul as his authentic historical ancestors? He is not the only Frenchman to have elected the barbarians as his distant relatives, so has the French Republic and its people; for France, the Gaul represent a common chosen ancestry, a unifying symbol. My study concentrates on how Rimbaud, through his narrator’s claim to ancestry, whether singular or plural, barbarian or Christian, shapes his identity, and the identity of his readers. Dr. Myriam Krepps Associate Professor of French Modern Languages Program Coordinator Department of English and Modern Languages Pittsburg State University Bad Blood Ancestry: From Barbarian to Christian When the narrator of Une saison en enfer (A Season in Hell) claims in “Mauvais sang:” “J’ai de mes ancêtres gaulois l’œil bleu blanc, la cervelle étroite, et la maladresse dans la lutte,”1 should we assume that Rimbaud is asserting the Gaul as his authentic ancestors? Rimbaud is not the only Frenchman to have elected the Gallic barbarians as his distant relatives, so has the French Republic and its people; for 19th-century France, the Gaul represent a common chosen ancestry, a unifying symbol. The French did not always claim the Gaul as their ancestors, and until the nineteenth century, the Francs were the recognized ancestors by the French nobility of the Ancient Régime, while the Gallic ancestry could only be claimed by commoners. -

Edouard Jolly À Son Frère Louis 19 13 Novembre : Jules Desdouest Au Recteur De L'académie De Douai 20
SOMMAIRE Avant-propos 7-12 Remerciements 13 Principes de l'établissement du texte 15 1868 Année 1868 17-18 26 mai : Edouard Jolly à son frère Louis 19 13 novembre : Jules Desdouest au recteur de l'Académie de Douai 20 1869 Année 1869 21-22 6 novembre : J. Kremp au recteur de l'Académie de Douai 23 11 novembre : J. Kremp au recteur de l'Académie de Douai 24 26 décembre : La rédaction de La Revue pour tous à Rimbaud 25 1870 Année 1870 27-28 2 janvier : Les Étrennes des orphelins dans La Revue pour tous 29 Premier semestre : Rimbaud à Georges Izambard 30 4 mai : Vitalie Rimbaud à Georges Izambard 31 24 mai : Rimbaud à Théodore de Banville 32-37 13 août : Trois baisers dans la Charge j 38 25 août : Rimbaud à Georges Izambard 39-43 31 août : Rapport du commissaire de police de la Compagnie des Chemins de fer 44 5 septembre : Rimbaud à Georges Izambard 45 24 septembre : Vitalie Rimbaud à Georges Izambard 46 Fin septembre : Lettre de protestation des membres de la Garde nationale de Douai 47 25 septembre : Chronique locale du Libéral du Nord 48 Fin septembre ou fin octobre : Rimbaud à Paul Demeny 49 2 novembre : Rimbaud à Georges Izambard 50 9 novembre : Le Progrès des Ardennes à J. Baudry 51 11 novembre : Scipion Lenel et Léon Deverrière à Georges Izambard 52-53 29 décembre : Le Progrès des Ardennes à MM. Baudry et Dhayle 54 Lettres non retrouvées de 1870 55 1871 Année 1871 57-58 16 avril : Charles Gillet à Georges Izambard 59 17 avril : Rimbaud à Paul Demeny 60-62 13 mai : Rimbaud à Georges Izambard 63-64 Vers le 15 mai : Georges Izambard -
DOSSIER PEDAGOGIQUE La Rimb
Du 24 avril au 5 mai 2012 LA RIMB de Xavier Grall Mise en scène Jean-Noël Dahan CÉLESTINE Dossier pédagogique Le DDDormeurDormeur du val C'est un trou de verdure où chante une rivière, Accrochant follement aux herbes des haillons D'argent ; où le soleil, de la montagne fière, Luit : c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, Dort ; il est étendu dans l'herbe, sous la nue, Pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme Sourirait un enfant malade, il fait un somme : Nature, berce-le chaudement : il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine ; Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. Arthur Rimbaud, octobre 1870, Anthologie des poètes français , tome IV, Lemerre, 1888 2 TEXTE DE XAVIER GRALL MISE EN SCÈNE JEANJEAN----NOËLNOËL DAHAN Du 24 avril au 5 mai LA RIMB Le destin secret d’Arthur Rimbaud Avec Martine Vandeville Scénographie et lumières : Julie Peisseul | Création sonore : Jean-Marc Istria Production Cie Éclats Rémanence, Spectacle LABEL « Rue du Conservatoire » Avec le soutien du Théâtre Nanterre-Amandiers, des Célestins - Théâtre de Lyon et d’ARCADI dans le cadre des Plateaux Solidaires Production exécutive En Votre Compagnie Laurence Santini et Olivier Talpaert Durée : 1h10 3 SOMMAIRE Les souvenirs d’une mère............................................................................5 Xavier Grall.....................................................................................................6 Jean-Noël Dahan ...........................................................................................7 Note d’intention.............................................................................................8 Note de scénographie.............................................................................. -

Impassible N'est Pas Rimbaud: Étude Sur Les Différences Entre La Poésie D
Impassible n’est pas Rimbaud : étude sur les différences entre la poésie d’Arthur Rimbaud et la poésie parnassienne de 1870 à 1871 Benjamin Aguillon To cite this version: Benjamin Aguillon. Impassible n’est pas Rimbaud : étude sur les différences entre la poésie d’Arthur Rimbaud et la poésie parnassienne de 1870 à 1871. Littératures. 2012. dumas-01136180 HAL Id: dumas-01136180 https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01136180 Submitted on 26 Mar 2015 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Benjamin AGUILLON Impassible n'est pas Rimbaud Étude sur les différences entre la poésie d'Arthur Rimbaud et la poésie parnassienne de 1870 à 1871 Mémoire de Master 1 «Master Arts, Lettres, Langues» Mention : Lettres et Civilisations Spécialité : Poétiques et Histoire de la littérature et des arts Parcours : Poétiques et Histoire littéraire Sous la direction de M. Jean-Yves CASANOVA Année universitaire 2011-2012 Remerciements Merci à Anne-Line, la capitaine exemplaire de mon bateau ivre, dont le soutien a été plus que précieux tout au long de mon année de recherches. Sa présence a été primordiale et je lui suis très reconnaissant.