Rimbaud D'outre-Tombe
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Arthur Rimbaud Napfény És Hús Arthur Rimbaud Minden Verse, Prózája És Válogatott Levelei
Arthur Rimbaud Napfény és hús Arthur Rimbaud minden verse, prózája és válogatott levelei Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket készítette Bárdos László A KÖTET FORDÍTÓI ADAMIK LAJOS BABITS MIHÁLY FRANYÓ ZOLTÁN HATÁR GYŐZŐ ILLYÉS GYULA JÁNOSY ISTVÁN JÉKELY ZOLTÁN JÓZSEF ATTILA JUHÁSZ GYULA KARDOS LÁSZLÓ KÉPES GÉZA KOSZTOLÁNYI DEZSŐ KOVÁCS ILONA MÁRTON LÁSZLÓ NAGY LÁSZLÓ NEMES NAGY ÁGNES PÁLFFY GABRIELLA RADNÓTI MIKLÓS RÓNAY GYÖRGY SOMLYÓ GYÖRGY SZABÓ LŐRINC SZEKERES GYÖRGY TANDORI DEZSŐ TELLÉR GYULA TIMÁR GYÖRGY TÓTH ÁRPÁD TÓTH JUDIT WEÖRES SÁNDOR TARTALOM VERSEK 1869-1871 A magánhangzók szonettje (Tóth Árpád fordítása) Árvák újévi ajándéka (Kardos László fordítása) Magánhangzók (Kardos László fordítása) Érzés (Kardos László fordítása) Magánhangzók (Rónay György fordítása) Élmény (Rónay György fordítása) Magánhangzók (Képes Géza fordítása) Érzelem (Képes Géza fordítása) Magánhangzók (Tandori Dezső fordítása) Napfény és hús (Kardos László fordítása) (A csillag könnyezik...) (Franyó Zoltán fordítása) Ofélia (Rónay György fordítása) (Füled köré...) (Somlyó György fordítása) Az akasztottak bálja (Rónay György fordítása) Tetvésző lányok (Kardos László fordítása) Az akasztottak bálja (Márton László fordítása) Tetükeresők (Rónay György fordítása) Tartufe bűnhődése (Somlyó György fordítása) Az igaz ember (Töredék; Nagy László fordítása) A kovács (Nemes Nagy Ágnes fordítása) Amit a virágokról mondanak a költőnek (Kilencvenkettesek s kilencvenhármasok) (Somlyó György fordítása) (Kardos László fordítása) Első áldozások (Somlyó György fordítása) -
Best Western Hôtel Littéraire Arthur Rimbaud
Arthur Rimbaud Hôtel Littéraire 6, rue Gustave Goublier, 75010 PARIS Tél. +33 (0)1 40 40 02 02 www.hotel-litteraire-arthur-rimbaud.com 1 « …Et d’ineffables vents m’ont hélé par instants. » Arthur Rimbaud, notre premier poète ; celui qui bouleverse les adolescences paisibles, renverse notre vision de la littérature et nous ouvre les yeux sur un monde saturé de couleurs, d’émotions, de vie. Arthur Rimbaud, celui qui, par son souffle épique, a emporté notre jeunesse ; nous aussi nous avions 17 ans et avec lui, nous allions « sous le ciel », nous descendions « les fleuves impassibles » et avec lui, nous avons su « …les cieux crevant en éclairs, et les trombes Et les ressacs et les courants... » Il faut se laisser emporter par le rythme, la fulgurance des mots, le chatoiement des images et du style de Rimbaud pour découvrir dans un seul poème, voire un seul vers, le génie du plus précoce et du plus important des poètes. « Ce n’était ni le diable ni le Bon Dieu, c’était Arthur Rimbaud, c’est à dire un très grand poète, absolument original, d’une saveur unique ». (Verlaine). C’est ce bouleversement que nous voulons partager avec vous, à travers 42 chambres, des éditions originales, une bibliothèque de 500 livres, des dizaines de références, de clins d’œil. Retrouver ensemble, l’émotion de Rimbaud : il est celui, disait François Mauriac « qui ne se retourne même pas pour regarder la trace que ses pas d’enfants ont laissée sur le monde ». Arthur Rimbaud, our first poet; the poet who disrupts the peaceful years of adolescence, turns our vision of literature upside down and opens our eyes to a world full of colour, emotions and life. -

Rimbaud, Entre Le Parnasse Et La Prose — Parcours Du Signifiant
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CfflCOUTIMI MÉMOIRE PRÉSENTÉ À L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES COMME EXIGENCE PARTIELLE DE LA MAÎTRISE EN ÉTUDES LITTÉRAIRES OFFERTEÀ L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI EN VERTU D'UN PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES par Jocelyn Lord Rimbaud, entre le Parnasse et la prose — parcours du signifiant 20 février 1995 UIUQAC bibliothèque Paul-Emile-Bouletj Mise en garde/Advice Afin de rendre accessible au plus Motivated by a desire to make the grand nombre le résultat des results of its graduate students' travaux de recherche menés par ses research accessible to all, and in étudiants gradués et dans l'esprit des accordance with the rules règles qui régissent le dépôt et la governing the acceptation and diffusion des mémoires et thèses diffusion of dissertations and produits dans cette Institution, theses in this Institution, the l'Université du Québec à Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) est fière de Chicoutimi (UQAC) is proud to rendre accessible une version make a complete version of this complète et gratuite de cette œuvre. work available at no cost to the reader. L'auteur conserve néanmoins la The author retains ownership of the propriété du droit d'auteur qui copyright of this dissertation or protège ce mémoire ou cette thèse. thesis. Neither the dissertation or Ni le mémoire ou la thèse ni des thesis, nor substantial extracts from extraits substantiels de ceux-ci ne it, may be printed or otherwise peuvent être imprimés ou autrement reproduced without the author's reproduits sans son autorisation. -

Arthur Rimbaud
Arthur Rimbaud Jean Nicolas Arthur Rimbaud (/ræmˈboʊ/[2] or las Frédéric (“Frédéric”), arrived nine months later on 2 /ˈræmboʊ/; French pronunciation: [aʁtyʁ ʁɛ̃bo] ; 20 Oc- November.[3] The next year, on 20 October 1854, Jean tober 1854 – 10 November 1891) was a French poet Nicolas Arthur (“Arthur”) was born.[3] Three more chil- born in Charleville, Ardennes.[3] He influenced modern dren followed: Victorine-Pauline-Vitalie on 4 June 1857 literature and arts, and prefigured surrealism. He started (who died a few weeks later), Jeanne-Rosalie-Vitalie writing poems at a very young age, while still in primary (“Vitalie”) on 15 June 1858 and, finally, Frédérique school, and stopped completely before he turned 21. He Marie Isabelle (“Isabelle”) on 1 June 1860.[17] was mostly creative in his teens (17–20). The critic Ce- Though the marriage lasted seven years, Captain Rim- cil Arthur Hackett wrote that his “genius, its flowering, [4] baud lived continuously in the matrimonial home for less explosion and sudden extinction, still astonishes”. than three months, from February to May 1853.[18] The Rimbaud was known to have been a libertine and for be- rest of the time his military postings – including active ing a restless soul. He traveled extensively on three con- service in the Crimean War and the Sardinian Campaign tinents before his death from cancer just after his thirty- (with medals earned in both)[19] – meant he returned seventh birthday.[5] home to Charleville only when on leave.[18] He was not at home for his children’s births, nor their -

Arthur Rimbaud Titles in the Series Critical Lives Present the Work of Leading Cultural figures of the Modern Period
Arthur Rimbaud Titles in the series Critical Lives present the work of leading cultural figures of the modern period. Each book explores the life of the artist, writer, philosopher or architect in question and relates it to their major works. In the same series Antonin Artaud David A. Shafer Franz Kafka Sander L. Gilman Roland Barthes Andy Stafford Frida Kahlo Gannit Ankori Georges Bataille Stuart Kendall Søren Kierkegaard Alastair Hannay Charles Baudelaire Rosemary Lloyd Yves Klein Nuit Banai Simone de Beauvoir Ursula Tidd Arthur Koestler Edward Saunders Samuel Beckett Andrew Gibson Akira Kurosawa Peter Wild Walter Benjamin Esther Leslie Lenin Lars T. Lih John Berger Andy Merrifield Pierre Loti Richard M. Berrong Leonard Bernstein Paul R. Laird Jean-François Lyotard Kiff Bamford Joseph Beuys Claudia Mesch Stéphane Mallarmé Roger Pearson Jorge Luis Borges Jason Wilson Gabriel García Márquez Stephen M. Hart Constantin Brancusi Sanda Miller Karl Marx Paul Thomas Bertolt Brecht Philip Glahn Henry Miller David Stephen Calonne Charles Bukowski David Stephen Calonne Herman Melville Kevin J. Hayes Mikhail Bulgakov J.A.E. Curtis Yukio Mishima Damian Flanagan William S. Burroughs Phil Baker Eadweard Muybridge Marta Braun John Cage Rob Haskins Vladimir Nabokov Barbara Wyllie Albert Camus Edward J. Hughes Pablo Neruda Dominic Moran Fidel Castro Nick Caistor Georgia O’Keeffe Nancy J. Scott Paul Cézanne Jon Kear Octavio Paz Nick Caistor Coco Chanel Linda Simon Pablo Picasso Mary Ann Caws Noam Chomsky Wolfgang B. Sperlich Edgar Allan Poe Kevin J. Hayes Jean Cocteau James S. Williams Ezra Pound Alec Marsh Salvador Dalí Mary Ann Caws Marcel Proust Adam Watt Guy Debord Andy Merrifield Arthur Rimbaud Seth Whidden Claude Debussy David J. -
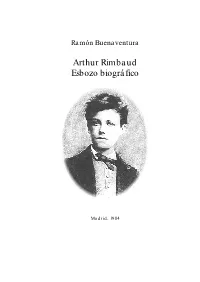
Arthur Rimbaud Esbozo Biográfico
Ramón Buenaventura Arthur Rimbaud Esbozo biográfico Madrid, 1984 © Copyright Ramón Buenaventura, 1985 © Copyright de las características de esta edición: EDICIONES HIPERIÓN, S.L. Salustiano Olózaga, 14 - 28001 Madrid ISBN: 84-7517-142-7 Depósito Legal: M - 7979 - 1985 1 Este librito es resultado de mi caída, a gravedad suelta, en una trampa de la devoción. Había previsto que cada tomo de las obras de Arthur Rimbaud fuera acompañado de un mero cuadro cronológico que orientara el lector por los momentos clave. Al repasar, para leve modificación, el cuadro cronológico que había in- cluido en Una temporada en el infierno, me pareció de pronto despreciable, por mi parte, no sacarme un esfuerzo más, y escribir una corta noticia bio- gráfica. Apunté a treinta o cuarenta folios —y han salido ciento dos. Buen ojo, como de costumbre1. De todas formas, no se entienda que esta sobreabundancia ensoberbece la modestia del proyecto inicial. Si tenemos un libro, en vez de un añadido a la edición de las Iluminaciones, es porque todas las reliquias que colocaba en el altar del santo se me antojaban pocas. Me he metido a traducir docu- mentos de la vida de Rimbaud que aparecen por primera vez en castellano, casi todos ellos. Pero, como me tenía firmemente prometido, he sobrado la tentación de hacer literatura a costa de Rimbaud. Lo que he escrito es un breve informe con datos. Sin adornarme más que en las cuatro o cinco inevitables ocasio- nes en que a uno se le distraen los dedos sobre las teclas y, zas, hace una frase. Los modernos inventos electrónicos facilitan en grado sumo tales devaneos. -

Rimbaud Och Sekelskiftets Sverige
SAMLAREN TIDSKRIFT FÖR SVENSK LITTERATURHISTORISK FORSKNING • NY FÖLJD. ÅRGÅNG 35 1954 UPPSALA 1966 SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET Detta verk har digitaliserats. Bilderna av den tryckta texten har tolkats maskinellt (OCR-tolkats) för att skapa en sökbar text som ligger osynlig bakom bilden. Den maskinellt tolkade texten kan innehålla fel. UPPSALA 1955 ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI AB 547565 Rimbaud och sekelskiftets Sverige. Av Helmer Lång. Enligt gammal biografisk tradition1 besökte Arthur Rimbaud Sverige 1877, som manager i Loissets cirkussällskap, vilket han skulle ha träffat på i Tyskland våren 1877 och följt på dess nordliga turné, lockad av cirkusdirektörens vackra döttrar. Enligt samma källa skulle Rimbaud ha blivit hemsänd genom Franska konsulatet i Stockholm på statens bekost nad. En engelsk forskare, miss Enid Starkie1 2, har emellertid genom hän vändelse till Franska konsulatet konstaterat, att den senare uppgiften är felaktig. I och för sig är det väl föga konstigt, om traditionen avviker från verkligheten just på den punkten: det var Rimbauds vanliga sätt att bli återbördad till fosterlandet efter sina utländska strövtåg; nya doku ment som bestyrker tekniken har nyligen framkommit.3 Värre är att Rimbaud icke, som traditionen uppger, kan ha följt med Cirkus Loisset från Hamburg. De biografiska dokumenten4 tyder på att han kommit hem från ett äventyr i holländsk militärtjänst på Java och därpå följande desertering i slutet av år 1876, varefter han en tid vista des i moderstjället. Annonser i Göteborgspressen visar nu, att Loissets sällskap redan i början av december 1876 slagit upp sina tält i rikets andra stad. Cirkusen gjorde sedan på våren en avstickare till Oslo, innan den drog till Stockholm i april.5 Rimbauds syster Isabelle, som jämte modern brukade få rapporter om vagabondens vistelseort, förnekar också (brev 30/12 1896) all kännedom om cirkusen och säger, att Rimbaud när han var i Sverige arbetade på ett sågverk. -

Silence Et Renversement De Rimbaud : Par-Delà Le Nihilisme
Document généré le 2 oct. 2021 18:24 Les écrits Silence et renversement de Rimbaud Par-delà le nihilisme Fernand Ouellette Numéro 147, août 2016 URI : https://id.erudit.org/iderudit/83281ac Aller au sommaire du numéro Éditeur(s) Les écrits de l’Académie des lettres du Québec ISSN 1200-7935 (imprimé) 2371-3445 (numérique) Découvrir la revue Citer cet article Ouellette, F. (2016). Silence et renversement de Rimbaud : par-delà le nihilisme. Les écrits, (147), 251–266. Tous droits réservés © Les écrits de l’Académie des lettres du Québec, 2016 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne. https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/ Cet article est diffusé et préservé par Érudit. Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. https://www.erudit.org/fr/ l 251 FERNAND OUELLETTE Silence et renversement de Rimbaud PAR-DELÀ LE NIHILISME Pourquoi Arthur Rimbaud cesse-t-il d’écrire, se retire-t-il dans un silence fait de « plusieurs silences », comme si la poésie l’avait abandonné, lui, pourtant l’antipode de l’homme de lettres, qui avait traversé le langage comme une fusée, dans une tension dialectique, s’était baigné dans « le Poème de la Mer », avait « rêvé la nuit verte aux neiges éblouies » et « L’assaut -

Paul Celan Traducteur Du Bateau Ivre Par Hermann H. Wetzel
Paul Celan traducteur du Bateau ivre par Hermann H. Wetzel 1. Si l'on ne se tient qu'aux traductions et aux essais de traduction, Paul Celan s'intéressait surtout aux œuvres poétiques de Rimbaud au sens res• treint. Dans l'édition des Poésies par H. de Bouillane de Lacoste (Paris, Mer• cure de France, 1939), que possédait le poète, il a marqué au crayon, à la « Table des matières », les titres suivants1 : Sensation, A la musique, Le Dormeur du val, Ma Bohême, Les Corbeaux, Tête de faune, Les Poètes de sept ans, Les Sœurs de charité, Voyelles, « L'étoile a pleuré rose », Les Cher• cheuses de poux, Le Bateau ivre. On peut présumer que Celan avait prévu de traduire ces poèmes-ci. Sauf deux poèmes supplémentaires (Larme ex Eternité), tous les textes traduits (ou dont la traduction a été commencée sous une forme ou une autre) font partie de cette liste : — [Le Bateau ivre] Das trunkene Schiff, essais de traduction en marge de l'éd. Bouillane de Lacoste, manuscrits dactylographiés à partir de juillet 1957, dernières corrections en septembre 1957, publié en édition bilingue, Wies- baden, Insel, 1958 ; — [« Elle est retrouvée »] Wiedergefunden, traduit entre la fin de 1957 (manuscrit autographe sans date et texte dactylographié daté du 26.12.57) et le 18.2.58 (dernières corrections), publié dans Almanach S. Fischer 74, 1960, p. 81 ; — [Sensation] Empfindung, deux feuilles autographes sans date et manus• crit dactylographié du 25.11.58 avec corrections ; — [Larme] Tràne, manuscrit dactylographié du 2.8.57 avec corrections du 3.8.57 ; — [Le Dormeur du val] Der Schlàfer im Tal, manuscrit dactylographié du 2,8.57 avec corrections ; — [« L'étoile a pleuré rose.. -

Arthur Rimbaud. Je Est Un Autre», Strauhof Zürich, 15.12
«Arthur Rimbaud. Je est un autre», Strauhof Zürich, 15.12. 2004 – 27. 2. 2005 Oder Rimbaud: Einmal mit dem ungestümen Herzen an der Sprache rütteln, dass sie göttlich «unbrauchbar» werde für einen Augenblick – und dann fortgehen, nicht zurückschaun, Kaufmann sein. (Rainer Maria Rilke, Das Testament, Berg am Irchel 1921) Kurze Vorstellung der Räume Raum 1 L'homme aux semelles de vent / Der doppelte Rimbaud – Der Mythos Rimbaud Die Welt ist sehr gross und voller wunderbarer Gegenden – das Leben von tausend Menschen würde nicht reichen, sie zu besuchen. [...] Aber immer am gleichen Ort zu leben, das wird mir immer eine grässliche Vorstellung sein. (Rimbaud an die Familie, Aden, 15. Januar 1885) «Ich bin ein Fussgänger, das ist alles», schrieb der siebzehnjährige Rimbaud in einem Brief. Später trugen ihm seine ausgedehnten Reisen die Spitznamen «der Mann mit den Windsohlen», «der verrückte Reisende», «der neue Ewige Jude» ein. Nachdem Rimbaud ganz Europa durchwandert hatte, überquerte er zu Fuss den Gotthard und fuhr mit dem Schiff von Genua nach Ägypten. Er begann ein neues Leben als Kaufmann in Arabien und Afrika. Der doppelte Rimbaud, ein Buchtitel von Victor Segalen, bezieht sich auf diese zwei Existenzen: sind Rimbauds Schweigen und seine Abreise aus Europa ein Verrat an seiner Dichtung oder deren logische Konsequenz? Rimbauds Leben und Werk regten die verschiedensten Phantasien und Deutungen an – Variationen eines «Mythos», die der Literaturwissenschafter Étiemble ironisch in mehreren Bänden zusammentrug. Sechs Vitrinen sind Rimbauds abenteuerlichem Leben gewidmet (Charleville, Paris, Europa, die Überquerung des Gotthard, Arabien/Afrika, Marseille). Die Wände widerspiegeln den Mythos Rimbaud, vom berühmten Bild von Fantin-Latour, Coin de table, bis zu modernen Portraits des Dichters (Giacometti, Picasso, Léger). -

Los Infantes Terribles: Una Viñeta Y Tres Paréntesis
LIBRETAS 01 LIBRETAS 01 estuvieron de acuerdo en la sentencia (lo cual, desde luego, lleva a LOS INFANTES sospechar que los críticos, por su parte, no pueden evitar del todo TERRIBLES: caer en la tentación de tratar a las obras más como casos que como asuntos estéticos). En Rimbaud, todos, hasta el propio Verlaine, UNA VIÑETA aunque por distintas razones, veían lo mismo: a un monstruo. El enfant Y TRES terrible por excelencia. PARÉNTESIS — MARÍA MINERA Veamos: según el Oxford English Dictionary (uno de los pocos diccionarios que registran el término), la expresión enfant terrible comenzó a utilizarse a mediados del siglo XIX, en Francia, para referirse al “niño Y su mejilla se encendía cada vez más roja que avergüenza a sus mayores con observaciones inoportunas”. Es Con esa juventud que no se nos escapa nunca, decir, llegado el momento, enfants terribles eran todos los niños, Con ese valor que tarde o temprano pues una de las tareas más puntuales de la infancia consiste en Vence la resistencia del mundo obtuso poner en aprieto a los padres. Estaríamos hablando entonces, según la acepción original, más de una cuestión –una bomba, en realidad– de Goethe, epílogo a La Campana, de Schiller tiempo que de un rasgo de carácter: el día en que, por ejemplo, el niño hace la pregunta: “Mamá, ¿cómo exactamente le hicieron tú y mi ( ) papá para que yo naciera?”, llega sin falta; y también sin falta la mamá quiere que en ese instante se la trague la tierra. Lo terrible, ya vamos En moral y talento, este Raimbaud [sic], de viendo, no es entonces el niño, destinado a preguntar (¡Ah!, la infan- entre 15 y 16 años, era y es un monstruo. -

No. 227 Seth Whidden, Arthur Rimbaud. London
H-France Review Volume 19 (2019) Page 1 H-France Review Vol. 19 (November 2019), No. 227 Seth Whidden, Arthur Rimbaud. London: Reaktion Books, 2018. 204 pp. Notes and bibliography. £11.99 (pb). ISBN 978-1-78023-980-4. Review by Caroline Ardrey, The University of Birmingham. It is perhaps unusual for a critical study—even a biographical one—to be described as a “page turner;” in the case of Seth Whidden’s recent study of Arthur Rimbaud, however, the epithet seems fitting. Published as part of Reaktion Books’ “Critical Lives” series in 2018, Whidden’s take on the much-studied enfant terrible of nineteenth-century French poetry is refreshing and captivating. Bringing his considerable expertise on Rimbaud to bear, Whidden adeptly unites the critical dimension of this particular series with the biographical demands of the “Critical Lives” format. The resulting book is both an illuminating introduction to Rimbaud and his works, and an insightful textual study that has already become an essential addition to reading lists on nineteenth-century French poetry for Modern Languages and comparative literature courses. In the introduction, Whidden sets out two broad questions that serve as starting points for the study: “What makes Rimbaud’s poetry important, and what makes his story so compelling that it needs to be told?” (p. 12). Throughout the book, Whidden’s detailed yet precise analyses of Rimbaud’s innovative poetics and his intricate yet vivacious delivery of the poet’s story makes for a convincing response to these questions, bringing that compelling narrative to the fore in a complete and sensitive reading of the poet and his oeuvre.