1839 : La Fin De L'unité Luxembourgeoise
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
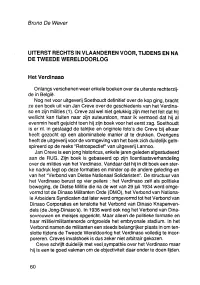
Gescande Afbeelding
Bruno De Wever UITERST RECHTS IN VLAANDEREN VOOR, TIJDENS EN NA DE TWEEDE WERELDOORLOG | Het Verdinaso Onlangs verschenen weer enkele boeken over de uiterste rechterzij- de in België. Nog net voor uitgeverij Soethoudt definitief over de kop ging, bracht ze een boek uit van Jan Creve over de geschiedenis van het Verdina- so en zijn milities (1). Creve zal wel niet gelukkig zijn met het feit dat hij wellicht kan fluiten naar zijn auteursloon, maar ik vermoed dat hij al evenmin heeft gejuicht toen hij zijn boek voor het eerst zag. Soethoudt is er nl. in geslaagd de talrijke en originele foto's die Creve bij elkaar heeft gezocht op een abominabele manier af te drukken. Overigens heeft de uitgeverij voor de vormgeving van het boek zich duidelijk geïn- spireerd op de reeks “Retrospectief van uitgeverij Lannoo. Jan Creve is een jong historicus, enkele jaren geleden afgestudeerd aan de RUG. Zijn boek is gebaseerd op zijn licentiaatsverhandeling over de milities van het Verdinaso. Vandaar dat hij in dit boek een ster- ke nadruk legt op deze formaties en minder op de andere geleding-en van het "Verbond van Dietse Nationaal Solidaristen". De structuur van het Verdinaso berust op vier peilers : het Verdinaso zelf a!s politieke beweging, de Dietse Militie die na de wet van 29 juli 1934 werd omge- vormd tot de Dinaso Militanten Orde (DMO), het Verbond van Nationa- le Arbeiders Syndicaten dat later werd omgevormd tot het Verbond van Dinaso Corporaties en tenslotte het Verbond van Dinaso Knapenven- dels (de Jong-Dinaso's). In 1936 werd ook nog het Verbond van Dina- sovrouwen en meisjes opgericht. -

Formation Des Choses Et Des Gens Fondée Sur L’Héritage
LA BELGIQUE ET SES DÉMONS Luc Beyer de Ryke LA BELGIQUE ET SES DÉMONS Mythes fondateurs et destructeurs édition mols François-Xavier de Guibert Ces pages ne sont pas disponibles à la pré- visualisation. de Versailles. Jusqu’en 1925, ils dépendirent du Ministère des Colonies tout comme le Ruanda-Urundi. C’est le lieutenant- général Baltia qui en exerça la tutelle militaire. Il y eut un plébiscite censé consulter les populations. Rares furent ceux qui osèrent se prononcer en faveur de l’Allemagne. 271 électeurs contre 33 726 le firent. En Belgique, seul le P.O.B. (Parti ouvrier belge) marque ses réserves et même son hostilité. Les grandes voix du socialisme belge, celle d’Émile Vandervelde, familièrement appelé par les siens le « Patron », celle de Louis De Brouckère se firent entendre. Après l’adhésion forcée apportée par le plébiscite, Louis De Brouckère dit ne pas voir « l’intérêt véritable de [son] pays de créer une petite Alsace à sa frontière ». Entre les deux guerres, l’irrédentisme pro-allemand fut important. Ainsi, lors des élections de 1936, le Heimattreue Front (le Front patriotique) prôna le vote blanc. Il fut majoritaire. Sans compter que les rexistes d’un Léon Degrelle, dont la collaboration avec le Reich se profilait, obtenaient plus de 26 % des suffrages. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata, les cantons redevinrent allemands. D’autorité. Là, comme en Alsace, il y eut les « malgré nous ». Sur 8 000 hommes enrôlés, 3 400 ne revinrent pas. Ici aussi l’épuration eut la main dure. On soupçonna et accusa de collaboration un quart de la population. -

La Droite Belge Et L'aide À Franco
LA DROITE BELGE ET L'AIDE A FRANCO par Francis BALACE le PARTIE : L'INACTION ".. - Is there any point to which you would wish to draw my atten- tion ? - To the curious incident of the dog in the night-time. - The dog did nothing in the night-time. - That was the curious incident, remarked Sherlock Holmes..." A. CONAN DOYLE, Silver Blaze "...Les Espagnols avaient tout pour être heureux. Baignés d'azur, sans grands besoins, ils pouvaient rêver sous le soleil, vivre de leur industrie, se nourrir de leur sol, et jouer de la mandoline. Or, un jour, 60 juifs arrivent de Moscou. Il sont chargés de montrer à ce peuple qu'il est très malheureux : "Si vous saviez comme on est mieux chez nous!...' Et voici cette nation chevaleresque qui se met, pieds et poings liés à la domesticité d'une lointaine Russie [...I II y a, dans l'ombre, quelqu'un d'autrement puissant que la soixantaine de misérables juifs qui, il y a trois ans, passèrent la frontière espagnole pour le service de Moscou II y a celui dont le Christ disait à Pierre : "Satan m'a demandé de te cribler comme on crible le froment..." Il y a celui que l'Evangile appelle "Le prince de ce monde" et dont l'éphémère mais horrible succès est prédit dans l'Apocalypse [...] Derrière le prétexte de difficultés ouvrières, qui s'arrangeraient facilement dans une autre atmosphère, il y a le choc de deux doc- trines, qui se heurtent dans leur essentialité. Le temps des "flirts" est passé. Les partis de nuances n'existent plus. -

The Lion, the Rooster, and the Union: National Identity in the Belgian Clandestine Press, 1914-1918
THE LION, THE ROOSTER, AND THE UNION: NATIONAL IDENTITY IN THE BELGIAN CLANDESTINE PRESS, 1914-1918 by MATTHEW R. DUNN Submitted to the Department of History of the University of Kansas in partial fulfillment of the requirements for departmental honors Approved by: _________________________ Dr. Andrew Denning _________________________ Dr. Nathan Wood _________________________ Dr. Erik Scott _________________________ Date Abstract Significant research has been conducted on the trials and tribulations of Belgium during the First World War. While amateur historians can often summarize the “Rape of Belgium” and cite nationalism as a cause of the war, few people are aware of the substantial contributions of the Belgian people to the war effort and their significance, especially in the historical context of Belgian nationalism. Relatively few works have been written about the underground press in Belgium during the war, and even fewer of those works are scholarly. The Belgian underground press attempted to unite the country's two major national identities, Flemings and Walloons, using the German occupation as the catalyst to do so. Belgian nationalists were able to momentarily unite the Belgian people to resist their German occupiers by publishing pro-Belgian newspapers and articles. They relied on three pillars of identity—Catholic heritage, loyalty to the Belgian Crown, and anti-German sentiment. While this expansion of Belgian identity dissipated to an extent after WWI, the efforts of the clandestine press still serve as an important framework for the development of national identity today. By examining how the clandestine press convinced members of two separate nations, Flanders and Wallonia, to re-imagine their community to the nation of Belgium, historians can analyze the successful expansion of a nation in a war-time context. -

De Schaduw Van De Leider Joris Van Severen En Het Na-Oorlogs Vlaams-Nationalisme (1945-1970)
De schaduw van de leider Joris Van Severen en het na-oorlogs Vlaams-nationalisme (1945-1970) BART DE WEVER licentiaat in de geschiedenis Op 20 mei 1940 viel het doek voor Joris Van Severen. Het VerDinaso zou zijn leider niet lang overleven. De volgelingen gingen tijdens de bezetting diverse richtingen uit, van de meest extreme Duitsgezinde collaboratie tot het verzet. Dat ging gepaard met een felle strijd over de gedachtenis aan Van Severen die door de verschillende strekkingen werd geclaimd als rechtvaardiging Kennelijk had dus niet zozeer de ideologie als wel de persoon van Van Severen houvast aan de beweging gegeven. Rommelpot – één van de eerste Vlaams-nationalistische periodieken van enige omvang na de oorlog – schreef in zijn editie van 5 mei 1946: “Tijdens de bezetting werden vele halve waarheden en hele leugens over Joris Van Severen geschreven. Sedert september ’44 is het stil geworden rond zijn naam. Als eenmaal zijn vroegere volgelingen – voor zover zij niet ten onder gingen in het avontuur der collaboratie – terug aan het woord zullen komen, zal het weer niet aan tegenstrijdige beweringen ontbreken. Voorlopig zwijgen allen. Want al zou men Van Severen moeilijk een ‘verrader’ kunnen noemen in de huidige betekenis van dat woord (...) toch schrikken de meesten er voor terug, er aan te herinneren dat zij eens ‘de allereerste fascist in Vlaanderen’ gevolgd hebben.” De inschatting van het blad was correct. De oud-Dinaso’s die na de oorlog weer politiek actief werden, kwamen terecht in zowat alle secties van het katholiek-rechtse kamp. In de christen-democratische zuil vinden we namen als: Willem Melis, eerste hoofdredacteur van de heruitgave van De Standaard in 1947; Frantz Van Dorpe, VEV-voorzitter; Rafaël Renard, adjunct-kabinets- chef van de minister van Binnenlandse Zaken Arthur Gilson (1961-1965) en voorzitter van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (1964-1976); Jef Van Bilsen, secretaris-generaal en later commissaris van de koning voor ontwikke- lingssamenwerking. -

Beyond the Metropolis: French and Belgian Symbolists Between the Region and the Republic of Letters
Comparative Critical Studies 10.2 (2013): 241–258 Edinburgh University Press DOI: 10.3366/ccs.2013.0090 C British Comparative Literature Association www.euppublishing.com/ccs Beyond the Metropolis: French and Belgian Symbolists between the Region and the Republic of Letters DANIEL LAQUA AND CHRISTOPHE VERBRUGGEN In 1892, the editors of the journal La Jeune Belgique – the bell-ringer of Belgian modernism – made a claim that seemingly contradicted the publication’s central role in the country’s so-called ‘literary renaissance’.1 They asserted that their periodical had ‘never promoted a national literature, that is to say, “Belgian literature”’.2 Instead, they portrayed themselves as French writers, comparable to authors in Brittany and the South of France: Noussommesdoncdesécrivainsfrançais.[...]Lesécrivainsdesouchebretonne, normande ou provençale ont leur accent particulier, nous croyons que les écrivains de Belgique ont aussi le leur. Pourquoi ces derniers, qui sont nés à Bruxelles, à Gand ou à Liège, ne seraient-ils pas des écrivains de langue française au même titre que les écrivains nés à Paimpol, à Rouen ou à Marseille?’ (The writers of Breton, Norman or Provencal origin have their particular accent, and we believe that the writers from Belgium have theirs. Why should the latter, who were born in Brussels, Ghent or Liège, not be French-language authors in the same sense as authors born in Paimpol, Rouen or Marseille?)3 Was Belgium merely a region within the French literary world? The debate on whether Francophone Belgian authors represented a national literature rather than being submerged in the wider field of French literature continued in the early twentieth century. -

België in De Tweede Wereldoorlog. Deel 5
België in de Tweede Wereldoorlog. Deel 5 De kollaboratie Maurice de Wilde bron Maurice de Wilde, België in de Tweede Wereldoorlog. Deel 5: De kollaboratie. DNB/Uitgeverij Peckmans, Kapellen 1985 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/wild022belg02_01/colofon.htm © 2008 dbnl / erven Maurice de Wilde 5 Gebruikte afkortingen ALG. SS - VL.: Algeme(e)ne SS-Vlaanderen BL: Beschermende Leden (van de Alg. SS-Vl.) DEVLAG: Duits(ch)-Vlaams(ch)e Arbeidsgemeenschap Deutsch-Vlämische Arbeitsgemeinschaft D-DIENST: Documentatiedienst DINASO: Diets(ch)e Nationaal Solidarist DM: Diets(ch)e Militie DM/ZB: Diets(ch)e Militie-Zwarte Brigade DMO: Dinaso Militanten Orde DRK: Deutsches Rotes Kreuz FLAK: Fliegerabwehrkanone HB: Hulpbrigade KAJ: Katholieke Arbeidersjeugd KSA: Katholieke Studentenactie KVV: Katholieke Vlaams(ch)e Volkspartij MB: Militair Bestuur MO: Militaire Organisatie NS: nationaal-socialisme, nationaal-socialistisch NSB: Nationaal-Socialistische Beweging Nederland NSDAP: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei NSJV: Nationaal-Socialistische Jeugd (in) Vlaanderen NSKK: Nationalsozialistisches Kraftfahrerkorps NSVAP: Nationaal-Socialistische Vlaams(ch)e Arbeiderspartij OFK: Oberfeldkommandantur OKW: Oberkommando der Wehrmacht OT: Organisation Todt Maurice de Wilde, België in de Tweede Wereldoorlog. Deel 5 PROMI: Reichsministerium für Propaganda und Volksaufklärung SA: Sturmabteilung SD: Sicherheitsdienst SIPO: Sicherheitspolizei SS: Schutzstaffel SS-Ustuf.: SS-Untersturmführer TAA: Troupe(s) auxiliaire(s) de l'Armée VAVV: -

Belgium's Dilemma
Belgium’s Dilemma History of Warfare Editors Kelly DeVries (Loyola University Maryland) John France (University of Wales, Swansea) Michael S. Neiberg (United States Army War College, Pennsylvania) Frederick Schneid (High Point University, North Carolina) VOLUME 96 The titles published in this series are listed at brill.com/hw Belgium’s Dilemma The Formation of the Belgian Defense Policy, 1932-1940 By Jonathan A. Epstein LEIDEN | BOSTON Cover illustration: Minister of National Defense Albert Devèze (in civilian clothing) observing anti-tank training in 1935. Collection of the Royal Army Museum, Brussels. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Epstein, Jonathan A. Belgium’s dilemma : the formation of the Belgian defense policy, 1932-1940 / by Jonathan A. Epstein. pages cm. -- (History of warfare, ISSN 1385-7827 ; volume 96) Includes bibliographical references and index. ISBN 978-90-04-25467-1 (hardback : alk. paper) -- ISBN 978-90-04-26973-6 (e-book) 1. Belgium--Military policy--History--20th century. 2. Belgium--Defenses--History--20th century. 3. Neutral- ity, Armed--Belgium--History--20th century. 4. Belgium. Arm?e--History--20th century. I. Title. UA680.E77 2014 355’.033549309043--dc23 2014001348 Figures 17 and 18 from West Point Military History Series: Atlas for the Second World War – Europe and the Mediterranean by Thomas E. Greiss, Series Editor, Square One Publishers, Inc. © 2002. Reprinted by permission. Brill has made all reasonable efforts to trace all copyright holders. In case these efforts have not been successful the publisher welcomes communications from copyright holders, so that the appropriate acknowledgements can be made in future editions, and to settle other permission matters. -

Holocaust Denial
Holocaust Denial Holocaust Denial The Politics of Perfidy Edited by Robert Solomon Wistrich Co-published by The Hebrew University Magnes Press (Jerusalem) and De Gruyter (Berlin/Boston) for the Vidal Sassoon International Center for the Study of Antisemitism DE GRUYTER MAGNES An electronic version of this book is freely available, thanks to the support of libra- ries working with Knowledge Unlatched. KU is a collaborative initiative designed to make high quality books Open Access. More information about the initiative can be found at www.knowledgeunlatched.org We would like to acknowledge the support of the Fondation pour la Mémoire de la Shoah in Paris which made possible the publication of this volume. Editorial Manager: Alifa Saadya An electronic version of this book is freely available, thanks to the support of libra- ries working with Knowledge Unlatched. KU is a collaborative initiative designed to make high quality books Open Access. More information about the initiative can be found at www.knowledgeunlatched.org ISBN 978-3-11-021808-4 e-ISBN (PDF) 978-3-11-021809-1 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-021806-2 ISSN 0179-0986 e-ISSN 0179-3256 This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License, as of February 23, 2017. For details go to http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/. ISBNLibrary 978-3-11-028814-8 of Congress Cataloging-in-Publication Data e-ISBNA CIP catalog 978-3-11-028821-9 record for this book has been applied for at the Library of Congress. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek LibraryDie Deutsche of Congress Nationalbibliothek Cataloging-in-Publication verzeichnet diese Data Publikation in der Deutschen Nationalbibliogra- ISBN 978-3-11-021808-4 Afie; CIP detaillierte catalog record bibliografische for this book Daten has sindbeen im applied Internet for über at the Library of Congress. -

Mythe Médian ». Les Imaginaires Carolingien Et Lotharingien Dans Les Revendications Territoriales Belges À L’Égard De L’Allemagne Après 1945 Christoph Brüll
Revue belge de philologie et d'histoire Évoquer le « mythe médian ». Les imaginaires carolingien et lotharingien dans les revendications territoriales belges à l’égard de l’Allemagne après 1945 Christoph Brüll Het gebruik van de “ mythe van het midden” : Karolingische en Lotharingische sociale verbeelding in de Belgische territoriale eisen aan Duitsland na 1945 Het is een ‘ klassieke’ strategie om bij territoriale schikkingen na een militair conflict te verwijzen naar op de geschiedenis gebaseerde sociale verbeelding en legitimeringen. Deze bijdrage tracht te tonen hoe Karolingische en Lotharingische sociale verbeelding een invloed uitoefende op bepaalde actoren van op gebiedsuitbreiding gerichte bewegingen, een echo van 1918, in het België van na 1945. Zelfs indien de Belgische territoriale eisen aan Duitsland zich uiteindelijk nauwelijks op deze denkbeelden baseerden, wijst deze bijdrage erop dat het discours met als doel Aken en Keulen in “ Belgische” steden te veranderen – de nadruk werd hierbij gelegd op de nauwe banden tussen “ Belgen” en “ Rijnlanders” – de basis zou leggen voor toenadering tussen de twee oude vijanden in de jaren vijftig. Van toen af aan werd het historische landschap tussen Maas en Rijn in de politieke organisatie van “ het Westen” geïntegreerd, waarvan de politieke organisatie als van primair belang werd beschouwd in het licht van de voortschrijdende Sovjetdreiging. Citer ce document / Cite this document : Brüll Christoph. Évoquer le « mythe médian ». Les imaginaires carolingien et lotharingien dans les revendications territoriales belges à l’égard de l’Allemagne après 1945. In: Revue belge de philologie et d'histoire, tome 91, fasc. 4, 2013. Histoire médiévale, moderne et contemporaine Middeleeuwse, moderne en hedendaagse geschiedenis. -

Holocaust Denial
Holocaust Denial Holocaust Denial The Politics of Perfidy Edited by Robert Solomon Wistrich Co-published by The Hebrew University Magnes Press (Jerusalem) and De Gruyter (Berlin/Boston) for the Vidal Sassoon International Center for the Study of Antisemitism DE GRUYTER MAGNES An electronic version of this book is freely available, thanks to the support of libra- ries working with Knowledge Unlatched. KU is a collaborative initiative designed to make high quality books Open Access. More information about the initiative can be found at www.knowledgeunlatched.org We would like to acknowledge the support of the Fondation pour la Mémoire de la Shoah in Paris which made possible the publication of this volume. Editorial Manager: Alifa Saadya An electronic version of this book is freely available, thanks to the support of libra- ries working with Knowledge Unlatched. KU is a collaborative initiative designed to make high quality books Open Access. More information about the initiative can be found at www.knowledgeunlatched.org ISBN 978-3-11-021808-4 e-ISBN (PDF) 978-3-11-021809-1 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-021806-2 ISSN 0179-0986 e-ISSN 0179-3256 This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License, as of February 23, 2017. For details go to http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/. ISBNLibrary 978-3-11-028814-8 of Congress Cataloging-in-Publication Data e-ISBNA CIP catalog 978-3-11-028821-9 record for this book has been applied for at the Library of Congress. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek LibraryDie Deutsche of Congress Nationalbibliothek Cataloging-in-Publication verzeichnet diese Data Publikation in der Deutschen Nationalbibliogra- ISBN 978-3-11-021808-4 Afie; CIP detaillierte catalog record bibliografische for this book Daten has sindbeen im applied Internet for über at the Library of Congress. -

Download PDF Van Tekst
België in de Tweede Wereldoorlog. Deel 3 De nieuwe orde Maurice de Wilde bron Maurice de Wilde, België in de Tweede Wereldoorlog. Deel 3: De nieuwe orde. DNB/Uitgeverij Peckmans, Kapellen 1982 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/wild022belg01_01/colofon.htm © 2008 dbnl / erven Maurice de Wilde 5 Woord vooraf Zo men het nog niet wist, is ons land verscheidene keren uniek. Ook op het gebied van de geschiedschrijving. Het is inderdaad opvallend hoe bijzonder weinig in ons land, in tegenstelling tot elders, over de tweede wereldoorlog, en dan vooral over de kollaboratie, is gepubliceerd. Zouden onze geschiedschrijvers dan minder werklust dan elders aan de dag leggen? Bijlange niet. Ongetwijfeld heeft dit gebrek aan publikaties hiermee te maken, dat wij in ons land sedert 1955 begiftigd zijn met een wet, de zgn. archiefwet, waarbij de raadpleging van archieven slechts na verloop van, zegge en schrijve, 100 jaar door de burger van dit land kan opgeëist worden. Die raadpleging is bijgevolg gedurende een eeuw lang overgelaten aan de goede... of minder goede wil van de overheidsinstellingen om uit te maken of zij al dan niet toegang tot hun archieven verlenen. Zelfs de uitstervende generatie, die de oorlog nog heeft meegemaakt, mag blijkbaar niet weten wat achter haar rug om is gebeurd. Waarbij onmiddellijk de vraag rijst waarom, opnieuw in tegenstelling tot andere landen, zó lang moet verborgen blijven wat onze maatschappij zo grondig heeft dooreengeschud als zulks tijdens de tweede wereldoorlog het geval is geweest. Waarom onze bevolking en vooral onze jeugd zo onwetend moet worden gehouden van hetgeen zich achter de schermen van de kollaboratie heeft afgespeeld.