Grands Motets De Colasse Et Desmarest À La Chapelle De Louis Xiv
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

2. French Baroque Sacred Choral Music 1643-1774
2. FRENCH BAROQUE SACRED CHORAL MUSIC 1643-1774 By Jason Allen Anderson 1) Historical Context a) Spanned the reigns of four Bourbon kings and three regents b) Restrict our study to the last two regents and kings i) Anne of Austria, Regent for Louis XIV (1643-1651) ii) Louis XIV ‘Le Roi Soleil’ (1643-1715) iii) Philippe d’Orléans, Regent for Louis XV (1715-1723) iv) Louis XV (1715-1774) 2) Hallmarks of the French Baroque Musical Style a) Galant “ornamented with many small figures and passages” (Grove Online) b) Rococo “A term from decorative art that has been applied by analogy to music, especially French music, of the 18th century” (Grove Online) i) Originated in France during the last years of the 17th century ii) Born of a relaxation of the rules of French classicism iii) Derivation of the term (rocaille, ‘shellwork’) is post facto and pejorative, like most critical descriptions of the style c) Slow to adopt Italian innovations, such as oratorio, basso continuo, the recitative, the formal aria, and the concertato d) Church music in France is very different from church music elsewhere on the continent (Palisca 265). i) Causes of reluctance to adopt above innovations include: (1) Control of the monarch (often at the insistence of Lully) on all matters related to music, art, architecture, dance—in essence all the fine and performing arts in an attempt to cultivate a French national style; consequently, (2) Musicians from other parts of Europe rarely found employment in the musical establishments of both court and church in France; thus, the other national styles were unable to penetrate those establishments through foreigners. -

Psalms to Plainchant: Seventeenth-Century Sacred Music in New England and New France
W&M ScholarWorks Dissertations, Theses, and Masters Projects Theses, Dissertations, & Master Projects 1989 Psalms to Plainchant: Seventeenth-Century Sacred Music in New England and New France Caroline Beth Kunkel College of William & Mary - Arts & Sciences Follow this and additional works at: https://scholarworks.wm.edu/etd Recommended Citation Kunkel, Caroline Beth, "Psalms to Plainchant: Seventeenth-Century Sacred Music in New England and New France" (1989). Dissertations, Theses, and Masters Projects. Paper 1539625537. https://dx.doi.org/doi:10.21220/s2-874z-r767 This Thesis is brought to you for free and open access by the Theses, Dissertations, & Master Projects at W&M ScholarWorks. It has been accepted for inclusion in Dissertations, Theses, and Masters Projects by an authorized administrator of W&M ScholarWorks. For more information, please contact [email protected]. PSALMS TO PLAINCHANT Seventeenth-Century Sacred Music in New England and New France A Thesis Presented to The Faculty of the Department of History The College of William and Mary in Virginia In Partial Fulfillment Of the Requirements for the Degree of Master of Arts by Caroline B. Kunkel 1989 APPROVAL SHEET This thesis is submitted in partial fulfillment the requirements for the degree of Master of Arts Caroline B. Kunkel Approved, May 1990 < 3 /(yCeJU______________ James Axtell A )ds Dale Cockrell Department of Music (IlliM .d (jdb&r Michael McGiffertA / I All the various affections of our soul have modes of their own in music and song by which they are stirred up as by an indescribable and secret sympathy. - St. Augustine Sermo To my parents TABLE OF CONTENTS Page ACKNOWLEDGEMENTS........ -

Deux Siècles D'orgue
La Chapelle Royale du Château de Versailles DEUX SIÈCLES D’ORGUE Collection Versailles Alpha 950 Enregistrement du 4 au 9 avril 2011 à la Chapelle Royale du Château de Versailles Prise de son, montage et Mastering : Christoph Frommen Direction de production : Julien Dubois Photos : Christian Milet , Jean-Marc Manaï (p. 20) Julien Dubois (digipack, photo 4 p.19, p. 23, 24 &27) Édition : Pauline Pujol Graphisme, illustrations et typographie : Sarah Lazarevic Traduction anglaise :Mary Pardoe Texte composé en Rameau et Scala sans DEUX SIÈCLES D’ORGUE CD1 *********************** Jean-Baptiste Robin Nicolas Lebègue (1631-1702) Extraits du Premier Livre d ’orgue (pièces du sixième ton) 1 Prélude 1'48 2 Duo 1'31 3 Fugue Grave 2'05 4 Basse de Trompette 1'45 5 Écho 1'45 6 Dialogue 1'55 Extraits du Troisième Livre d’orgue (Noëls) 7 À la venue de Noël 2'27 8 Or nous ditte Marie 2'47 9 Les Cloches 2'18 Jacques-Denis Thomelin (v.1640-1693) Hymne Ave Maris Stella 10 Plain chant en taille du 1er ton 2'22 3 11 Fugue grave pour la Trompette et le Clairon duer 1 ton 2'43 12 Autre fugue à 3 2'22 Guillaume-Gabriel Nivers (1632-1714) Extraits du Deuxième Livre d ’orgue contenant la Messe et les Hymnes de l’Église –1667 (Messe) 13 Récit de Cromhorne (Benedictus) 4'08 14 Offerte en fugue et Dialogue 6'41 François Espinasse François Couperin (1668-1733) Extraits de la Messe propre pour les couvents de religieux et religieuses(1690) KYRIE 15 Plein jeu, 1er couplet du Kyrie 1'36 16 Fugue sur la trompette, 2e couplet du Kyrie 1'48 17 Récit de chromorne 2'52 18 Trio -

Les Pages & Les Chantres Du Centre De Musique Baroque De Versailles
C h a Chantal Santon-Jeffery, soprano [csj] p e l l e r Reinoud Van Mechelen, haute-contre [rvm] o y a l e , C François Joron, taille [fj] h â t e a Lisandro Abadie, basse-taille [la] u d e V e r s a i l l Les Pages & les Chantres du Centre de musique baroque de Versailles e s Collegium Marianum (dir. Jana Semerádová) Olivier Schneebeli, direction ba A Centre de musique baroque de Versailles production, with the support of the Institut Français (Prague) and the Ministry of Culture of the Czech Republic. Recording made with support from Jean-Claude and Joëlle Broguet. Recorded live in the Chapelle royale of the Château de Versailles on 5 and 7 July 2017 (Concerts co-produced by the CMBV and Château de Versailles Spectacles) Engineered by Frédéric Briant Produced by Dominique Daigremont Editorial director & layout: Carlos Céster Editorial assistance: Mark Wiggins, María Díaz Design: Rosa Tendero Photographs: Summer Festivities of Early Music, Martin Divíšek, St-Simon and St-Jude Church, Prague © 2018 note 1 music gmbh michel-richard de lalande (1657-1726) Grands Motets Venite, exultemus Domino Dominus regnavit 1 Venite, exultemus Domino [csj, chorus] 3:29 18 Dominus regnavit [chorus] 3:46 2 Præoccupemus faciem ejus [rvm] 2:31 19 Nubes, et caligo [la] 2:45 3 Quoniam Deus magnus Dominus [rvm, chorus] 3:46 20 Illuxerunt fulgura ejus orbi terræ [chorus] 1:54 4 Quoniam non repellet [la] 2:26 21 Montes, sicut cera [rvm] 1:22 5 Quoniam ipsius est mare [fj, la] 1:57 22 Annuntiaverunt cæli justitiam ejus [csj, la] 2:47 6 Venite, adoremus [csj, rvm, -
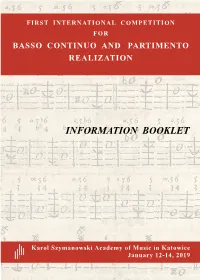
Basso Continuo and Partimento Realization
FIRST INTERNATIONAL COMPETITION FOR BASSO CONTINUO AND PARTIMENTO REALIZATION INFORMATION BOOKLET Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice January 12-14, 2019 organisers Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice Harpsichord and Historical Performance Practice Department Organisation: Prof. Marek Pilch Artistic directors: Prof. Marek Toporowski, Prof. Marcin Świątkiewicz, Prof. Marek Pilch. Competition office: Katarzyna Drogosz, Dominika Maszczyńska Cooperating institutions: Academy of Music in Łódź, Harpsichord and Early Music Department, baroque flute class of Prof. Magdalena Pilch Academy of Music, University in Ljubjana (delegating Prof. Dalibor Miklavčič as a jury member) Vocal Institute of the Academy of Music in Katowice Henryk Mikołaj Górecki Silesian Philharmonic NOSPR Chamber music partners: In the first round: Students in the baroque violin class of Prof. Martyna Pastuszka: Izabela Kozak, Marta Korbel, Antonina Cierpioł & Aleksandra Radwańska, and Martyna Pastuszka & Adam Pastuszka. Students in the baroque flute class of Prof. Magdalena Pilch: Aleksandra Gajkowska (AM Łódź), Radosław Orawski (AM Łódź) & Marta Gawlas (AM Katowice) In the second round: Instrumental ensemble: Antonina Cierpioł, Marta Korbel (violin), Szymon Stochniol (viola), Monika Hartmann (violoncello), Marta Gawlas & Aleksandra Gajkowska (baroque flute) Vocalist: Katarzyna Bełkius (soprano), Olena Zaiets (soprano), Barbara Grzybek (alto), Artur Plinta (alto) & Adrian Janus (bass). competition schedule FIRST ROUND Saturday, January 12, 2019 11:00 - 13:00 and 17:00 - 19:30 Sunday, January 13, 2019 11:00 - 13:00 and 16:00-17:30 ca. 18:30 results of the first round SECOND ROUND (FINAL) Monday, January 14, 2019 15:00-17:30 ca. 18:30 final results The competition will take place at the Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice, at the Bolesław Szabelski recital hall. -

Brochure.Pdf
LES GRANDS CONCERTS Direction Eric Desnoues sont placés sous la Présidence d’Honneur de Monsieur Gérard Colomb Maire de Lyon Monsieur Laurent Wauquiez Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ont été fondés en 1983 grâce au mécénat de BIOMÉRIEUX et LCL et bénéficient depuis 2002 du mécénat de SEIA SEIA Les Grands Concerts bénéficient du soutien de la VILLE DE LYON et de la RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES avec le partenariat des Amis des Concerts Baroques de la Chapelle de la Trinité SOMMAIRE calendrier p. 2-3 concerts p. 4-33 abonnement p. 34-35 places à l’unité p. 36-37 choisissez et prenez place p. 38 plans des salles et accès p. 39 l’association des Amis p. 40 1 septembre octobre novembre décembre 2019 2019 2019 2019 mercredi 6 CONCERT POUR LA PIÉTA VIVALDI mardi 8 Ensemble Matheus dimanche 8 MUSIQUE POUR LES J.-Ch. Spinosi MUSIQUE SACRÉE CHAPELLES DE ROME ET POUR LA CITÉ VENISE DES DOGES ALLEGRI, SCARLATTI dimanche 17 MONFERRATO Ensemble Voces Suaves Ensemble Céladon STABAT MATER Michele Vannelli Paulin Bündgen HAYDN Le Concert de la Loge Julien Chauvin samedi 14 LES ARTS samedi 23 FLORISSANS CHARPENTIER vendredi 20 MESSE EN SI MINEUR Ensemble BACH Marguerite Louise GLORIA Ensemble Vox Luminis Gaétan Jarry VIVALDI Lionel Meunier DIXIT DOMINUS HAENDEL Ensemble Matheus jeudi 19 J.-Ch. Spinosi VIOLON, VIOLONCELLE ET PIANO BEETHOVEN FAURÉ MENDELSSOHN Trio Messiaen vendredi 20 MARIAGE ET NOËL RUSSES Chœur de la Société Philharmonique de St-Petersbourg Y. Khutorestakaya 2 janvier février mars avril mai 2020 2020 2020 2020 2020 jeudi 6 SEPTUOR BEETHOVEN SYMPHONIE mardi 7 REICHA STABAT MATER Le Concert PERGOLESI de la Loge Les Musiciens Julien Chauvin du Louvre Francesco Corti vendredi 13 dimanche 9 TE DEUM samedi 11 JUDITAH CHARPENTIER mardi 14 TRIUMPHANS HOMMAGE Ensemble RÉCITAL VIVALDI Correspondances J ORLINSKY AUX GRANDES Ens.Matheus DAMES DU JAZZ Sébastien Daucé HAENDEL, Gospel J.-Ch. -

17CM Fall 2011.Indd
The Newsletter of the Society for Seventeenth-Century Music Vol. 21,20, No. 1,3, Fall 2011 Seventeenth-Century“Manhattan” for SSCM Music 201 in2 byIndianapolis: Barbara Hanning Notes from AMS 2010 by Brians Oberlanderthe old Rodgers and Hart song proclaims,he American the Musicological island of Manhat Society- careful analysis of the extant score of Akheldtan holdsits 2010 an Annualembarrassment Meeting inof Artemisia, tracing a certain expressive logic riches todowntown delight Indianapolismembers of (November the Soci- in the composer’s revisions and placing this Tety for Seventeenth-Century Music for 4–7), joined by the Society for Music Theory. in dialogue with such theoretical sources Paperstheir twentieth relevant toannual seventeenth-century conference, to as Aristotle and Descartes. In another musicbe held were April delightfully 19–22, 2012, numerous at the Metand- venture of revaluation, Valeria De Lucca generallyropolitan Museumof fine quality, of Art thoughin New York.most argued against the idea of an operatic nadir Home to 1.5 million people, New York were found in sessions that looked beyond in Rome following the closure of its first County (Manhattan) is still neverthe- periodization. From “Special Voices” and Venetian-style theater in 1675. Presenting less a clutch of small neighborhoods, “Marianeach with Topics” its distinct to “Private style Musics”and flavor. and a detailed case study of Prince Lorenzo “Beyond the Book,” the seventeenth century Colonna and his semi-private enterprise The song will serve to highlight some as “Museum Mile,” which includes Park. The concert, on Saturday took its place alongside studies of the met- at the Colonna palace, De Lucca revealed of those relevant to the conference. -

1 Reflexion Sur L'autorite Reconnue Aux Musiciens
Sequentia / Article 2 / juillet 2005 REFLEXION SUR L’AUTORITE RECONNUE AUX MUSICIENS DANS LE DOMAINE DU PLAIN-CHANT EN FRANCE ENTRE 1650 ET 1750 Le manuscrit Vm1. 395 conservé au Département de la musique de la Bibliothèque nationale de France est remarquable en ce qu’il rassemble plusieurs messes et autres pièces en plain-chant attribuées à sept auteurs. Quatre d’entre eux au moins étaient des musiciens d’église : il s’agit de Du Mont, Campra, Lalouette et Lalande 1. Seule source pour l’instant connue de la plupart de ces messes, ce manuscrit utilisé par une communauté de religieuses 2 est sans doute l’un des rares témoins d’une plus vaste production manuscrite et imprimée de recueils de ce type 3. Sa particularité tient aussi au fait qu’il regroupe les œuvres de plain-chant de plusieurs musiciens, dont, de surcroît, certains comptent parmi les plus fameux de leur temps. Ceci nous conduit à nous interroger sur ces questions encore peu explorées de la production des musiciens en matière de chant ecclésiastique et, plus spécifiquement ici, de la nature de l’autorité qu’on leur a reconnu depuis les années 1650-1660, moment des premières 1. Ce manuscrit fut plusieurs fois remanié comme le montrent les deux tables, dont aucune ne correspond exactement au contenu, et les traces de plusieurs feuillets arrachés. Dans son état actuel, il contient : une messe anonyme du Saint-Sacrement, un Ordinaire de la messe de Campra avec un Domine salvum, deux Ordinaires de Du Mont, l’office grégorien de Vêpres pour la Saint Jean-Baptiste, un Ordinaire anonyme dit « messe italienne », un Ordinaire de « deffunt mons. -

So M M Aire É D
e 14 sheures o m m a i r e édito musicales 3 Présentation 4-7 Vendredi 13 juillet Orchestre et Chœur de l’Opéra de Rouen - Requiem de Maurice Duruflé Si la restauration du patrimoine reste 8-13 Lundi 16 juillet avant tout l’affaire de spécialistes, sa mise Les Arts Florissants dirigé par William Christie - La Création de J. Haydn en valeur peut concerner tout un chacun, ainsi en est-il de l’église abbatiale de 14-17 Vendredi 20 juillet Musique de chambre à Canville-La-Rocque - Ensemble Hélios Lessay. C’est en effet au talent et la Création de Charles Chaynes : Trois Images de la Poésie grecque rigoureuse patience des architectes que nous devons la renaissance de ce joyau de 18-23 Mardi 24 juillet Le Concert des Nations dirigé par Jordi Savall - Il siglo de Boccherini l’art roman, profondément blessé par les combats de la seconde guerre mondiale ; et 24-27 Vendredi 27 juillet c’est à l’engagement passionné d’une Concerto Soave dirigé par J-M. Aymes avec Maria-Cristina Kiehr équipe de bénévoles la mise en œuvre d’un et Stephan MacLeod - Il Ballo della Ninfa de Monteverdi festival dont la renommée dépasse 28-29 Dimanche 29 juillet maintenant les frontières de notre Récital d’orgue - Vincent Dubois département. 30-33 Mardi 31 juillet L’ Arpeggiata dirigée par Christina Pluhar - Stéphanie d’Oustrac, soprano Désormais rendez-vous incontournable des Airs d’opéra et cantates de Luigi Rossi amateurs de musique religieuse, ce festival Jeudi 2 août et Vendredi 3 août continue chaque année à nous surprendre 34-37 Musique de chambre au Manoir de Gonfreville : par la qualité et la diversité de ses Marc Coppey, violoncelle, Hélène Desmoulin, piano, Philippe Graffin, violon propositions. -

Sacred, Secular, and Political: Dance Rhythms in French Grands Motets
Sacred, Secular, and Political: Dance Rhythms in French grands motets under Louis XIV Lindsey O’Brien University of Florida Gainesville, Florida April 20, 2012 O’Brien 1 Any form of art reflects the values of the society in which it is created. Because contemporary society tends to focus on the ‘self’ and personal identity, to a great extent the arts of today are a vehicle of self-expression. However, this was not always the case. Before it served as a means of self-expression, art played a much different role: rather than serving the artist alone, the art served the interests of an institution, such as the church or a particular monarch. As a result, prior to the Romantic era, the majority of professional and highly esteemed artists made a living by working either within the Catholic Church or at a noble court,1 institutions that served as training grounds and helped define both local and national artistic aesthetics. Whereas religious art reinforcing God’s omnipresence and supremacy was the primary focus of the church, royal courts produced politically charged art reminding all courtiers of the monarch’s ubiquity and infallibility throughout his kingdom. Rather than serving God and the church institution, artists now directly served a single person: a king who possessed a higher social standing than all of his subjects, including the artists. All art forms filled the social and political function of extolling the monarch. Two that did this particularly well (and often in conjunction with one another) in seventeenth century France under the reign of Louis XIV are music and dance. -

Majesté Lalande Ensemble Aedes Le Poème Harmonique Vincent Dumestre Menu › Tracklist › Texte Français › English Text › Deutsch Kommentar › Sung Texts
MAJESTÉ LALANDE ENSEMBLE AEDES LE POÈME HARMONIQUE VINCENT DUMESTRE MENU › TRACKLIST › TEXTE FRANÇAIS › ENGLISH TEXT › DEUTSCH KOMMENTAR › SUNG TEXTS MICHEL-RICHARD DE LALANDE (1657-1726) DEITATIS MAJESTATEM 1 DEITATIS MAJESTATEM 4’39 2 HIC ENIM MISERICORS 4’31 3 SIMPHONIE 0’44 4 O CARO CHRISTI VERA 2’23 5 TE OMNES ANGELI 3’14 6 O MENTIS JUBILATIO 4’17 7 QUAM DULCIS EST 3’03 8 O BONITATIS PRODIGIUM 3’53 ECCE NUNC BENEDICITE 9 ECCE NUNC BENEDICITE DOMINUM 4’58 10 IN NOCTIBUS EXTOLLITE 5’34 11 BENEDICAT TE DOMINUS EX SION 3’07 › MENU TE DEUM 12 TE DEUM LAUDAMUS 2’11 13 TE ÆTERNUM PATREM 1‘08 14 TIBI OMNES ANGELI 1‘46 15 SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS 1’33 16 TE GLORIOSUS APOSTOLORUM CHORUS 2’30 17 TE PER ORBEM TERRARUM 1’23 18 TU REX GLORIÆ 2’18 19 TU, AD LIBERANDUM 2’19 20 TU, DEVICTO MORTIS ACULEO 2’47 21 TU AD DEXTERAM DEI SEDES 1’26 22 TE ERGO QUÆSUMUS 1’40 23 ÆTERNA FAC CUM SANCTIS 1’50 24 SALVUM FAC POPULUM TUUM 1’17 25 ET REGE EOS 1’44 26 PER SINGULOS DIES BENEDICIMUS TE 2‘15 27 DIGNARE, DOMINE 1‘15 28 MISERERE NOSTRI 1’35 29 IN TE, DOMINE, SPERAVI 2’58 TOTAL TIME : 74’32 EMMANUELLE DE NEGRI SOPRANO DAGMAR ŠAŠKOVÁ SOPRANO SEAN CLAYTON HAUTE-CONTRE CYRIL AUVITY TÉNOR ANDRÉ MORSCH BASSE ENSEMBLE AEDES LE POÈME HARMONIQUE VINCENT DUMESTRE ENSEMBLE AEDES MATHIEU ROMANO JULIA BEAUMIER, AGATHE BOUDET, CÉCILE DALMON, EUGÉNIE DE PADIRAC, AGATHE PEYRAT, VIRGINIE THOMAS DESSUS CAMILLO ANGARITA, ELISE BÉDÈNES, SARAH BRETON, PAULINE LEROY, MARCIO SOARES HOLANDA ALTOS & HAUTES-CONTRE PAUL CRÉMAZY, FRANÇOIS-OLIVIER JEAN, NICOLAS RETHER, FLORENT THIOUX, -

The Broude Trust for Musicological Editions
The Broude Trust A not-for-profit organization supporting the publication of fine musicological editions Collected Editions Historical Sets Critical Facsimiles® 2017 The Broude Trust P.O. Box 547 Williamstown, MA 01267 Distributed by C. F. Peters Corporation 70-30 80th Street Glendale, NY 11358 Telephone: (718) 416-7800 E-mail: [email protected] Web: www.edition-peters.com The Broude Trust for the Publication of Musicological Editions Trustees Ronald Broude Christoph Wolff Advisory Board Philip Gossett, Ellen S. Beebe, Gwen Broude The Broude Trust for the Publication of Musicological Editions, established in 1983, is a not-for-profit organization formed for the purpose of producing scholarly editions of a quality not possible under normal commercial conditions. Among its publications are some of the most editorially sophisticated and handsomely produced musicological editions published during the past three decades. The Trust is committed to bringing together the disciplines of textual scholarship and musicology in order to produce editions of music that are responsibly prepared and methodologically innovative. This commitment has been evident in its various projects. In its Art of the Keyboard volumes, “versioning” (the strategy of printing more than one text of a work) has been employed to afford scholars and performers access to the multiple forms in which much early keyboard music circulated. The advantages of critical editing and facsimiles are inventively combined in the controversial Critical Facsimiles® series. The complex and untidy transmission of Buxtehude’s organ compositions, only one of which survives in an authoritative source, is exhaustively discussed in Michael Belotti and Christoph Wolff’s much-praised editions of these works, enabling users to understand just what the editor’s texts represent.