Conseil De Sécurité Distr
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Voting for Hope Elections in Haiti
COMMENTARY Voting for hope Elections in Haiti Peter Hallward ate in the night of 29 February 2004, after weeks of confusion and uncertainty, the enemies of Haitiʼs president Jean-Bertrand Aristide forced him into exile Lfor the second time. There was plenty of ground for confusion. Although twice elected with landslide majorities, by 2004 Aristide was routinely identified as an enemy of democracy. Although political violence declined dramatically during his years in office, he was just as regularly condemned as an enemy of human rights. Although he was prepared to make far-reaching compromises with his opponents, he was attacked as intolerant of dissent. Although still immensely popular among the poor, he was derided as aloof and corrupt. And although his enemies presented themselves as the friends of democracy, pluralism and civil society, the only way they could get rid of their nemesis was through foreign intervention and military force. Four times postponed, the election of Aristideʼs successor finally took place a few months ago, in February 2006. These elections were supposed to clear up the confusion of 2004 once and for all. With Aristide safely out of the picture, they were supposed to show how his violent and illegal expulsion had actually been a victory for democracy. With his Fanmi Lavalas party broken and divided, they were intended to give the true friends of pluralism and civil society that democratic mandate they had so long been denied. Haitiʼs career politicians, confined to the margins since Aristideʼs first election back in 1990, were finally to be given a chance to inherit their rightful place. -

Haiti: Developments and U.S. Policy Since 1991 and Current Congressional Concerns
Order Code RL32294 Haiti: Developments and U.S. Policy Since 1991 and Current Congressional Concerns Updated January 25, 2008 Maureen Taft-Morales Specialist in Latin American Affairs Foreign Affairs, Defense, and Trade Division Clare Ribando Seelke Analyst in Latin American Affairs Foreign Affairs, Defense, and Trade Division Haiti: Developments and U.S. Policy Since 1991 and Current Congressional Concerns Summary Following the first free and fair elections in Haiti’s history, Jean-Bertrand Aristide first became Haitian President in February 1991. He was overthrown by a military coup in September 1991. For over three years, the military regime resisted international demands that Aristide be restored to office. In September 1994, after a U.S. military intervention had been launched, the military regime agreed to Aristide’s return, the immediate, unopposed entry of U.S. troops, and the resignation of its leadership. President Aristide returned to Haiti in October 1994 under the protection of some 20,000 U.S. troops, and disbanded the Haitian army. U.S. aid helped train a civilian police force. Subsequently, critics charged Aristide with politicizing that force and engaging in corrupt practices. Elections held under Aristide and his successor, René Préval (1996-2000), including the one in which Aristide was reelected in 2000, were marred by alleged irregularities, low voter turnout, and opposition boycotts. Efforts to negotiate a resolution to the electoral dispute frustrated the international community for years. Tension and violence continued throughout Aristide’s second term, culminating in his departure from office in February 2004, after the opposition repeatedly refused to negotiate a political solution and armed groups took control of half the country. -
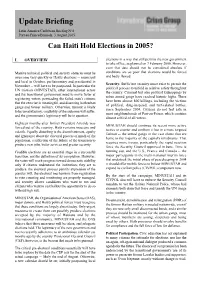
Haiti at a Turning Point
Update Briefing Latin America/Caribbean Briefing N°8 Port-au-Prince/Brussels, 3 August 2005 Can Haiti Hold Elections in 2005? I. OVERVIEW elections in a way that still permits the new government to take office, as planned on 7 February 2006. However, even that date should not be considered absolute if Massive technical, political and security obstacles must be conditions are so poor that elections would be forced overcome very quickly or Haiti's elections -- municipal and badly flawed. and local in October, parliamentary and presidential in Security. Sufficient security must exist to permit the November -- will have to be postponed. In particular the political process to unfold in relative safety throughout UN mission (MINUSTAH), other international actors the country. Criminal but also political kidnappings by and the transitional government need to move faster at urban armed gangs have reached historic highs. There registering voters, persuading the failed state's citizens have been almost 800 killings, including the victims that the exercise is meaningful, and disarming both urban of political, drug-inspired, and turf-related battles, gangs and former military. Otherwise, turnout is likely since September 2004. Citizens do not feel safe in to be unsatisfactory, credibility of the outcome will suffer, most neighbourhoods of Port-au-Prince, which contains and the government's legitimacy will be in question. almost a third of all voters. Eighteen months after former President Aristide was MINUSTAH should continue its recent more active forced out of the country, Haiti remains insecure and tactics to counter and confront -- but in a more targeted volatile. -

Haiti on the Brink: Assessing US Policy Toward a Country in Crisis
“Haiti on the Brink: Assessing U.S. Policy Toward a Country in Crisis” Prepared Testimony Before the U.S. House of Representatives’ Committee on Foreign Affairs, Subcommittee on the Western Hemisphere, Civilian Security, and Trade Daniel P. Erikson Managing Director, Blue Star Strategies Senior Fellow, Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement December 10, 2019 I begin my testimony by thanking Chairman Sires, Ranking Member Rooney, and the members of this distinguished committee for the opportunity to testify before you today about the current situation in Haiti – and to offer some ideas on what needs to be done to address the pressing challenges there. It is an honor for me to be here. I look forward to hearing from the committee and my fellow panelists and the subsequent discussion. The testimony that I provide you today is in my personal capacity. The views and opinions are my own, informed by my more than two decades of experience working on Latin American and Caribbean issues, including a longstanding engagement with Haiti that has included more than a dozen trips to the country, most recently in November 2019. However, among the other institutions with which I am affiliated, I would like to also acknowledge the Inter- American Dialogue think-tank, where I worked on Haiti for many years and whose leadership has encouraged my renewed inquiry on the political and economic situation in Haiti. My testimony today will focus on two areas: (1) a review of the current situation in Haiti; and (2) what a forward-leaning and constructive response by the United States and the broader international community should look like in 2020. -

Haitian Historical and Cultural Legacy
Haitian Historical and Cultural Legacy A Journey Through Time A Resource Guide for Teachers HABETAC The Haitian Bilingual/ESL Technical Assistance Center HABETAC The Haitian Bilingual/ESL Technical Assistance Center @ Brooklyn College 2900 Bedford Avenue James Hall, Room 3103J Brooklyn, NY 11210 Copyright © 2005 Teachers and educators, please feel free to make copies as needed to use with your students in class. Please contact HABETAC at 718-951-4668 to obtain copies of this publication. Funded by the New York State Education Department Acknowledgments Haitian Historical and Cultural Legacy: A Journey Through Time is for teachers of grades K through 12. The idea of this book was initiated by the Haitian Bilingual/ESL Technical Assistance Center (HABETAC) at City College under the direction of Myriam C. Augustin, the former director of HABETAC. This is the realization of the following team of committed, knowledgeable, and creative writers, researchers, activity developers, artists, and editors: Marie José Bernard, Resource Specialist, HABETAC at City College, New York, NY Menes Dejoie, School Psychologist, CSD 17, Brooklyn, NY Yves Raymond, Bilingual Coordinator, Erasmus Hall High School for Science and Math, Brooklyn, NY Marie Lily Cerat, Writing Specialist, P.S. 181, CSD 17, Brooklyn, NY Christine Etienne, Bilingual Staff Developer, CSD 17, Brooklyn, NY Amidor Almonord, Bilingual Teacher, P.S. 189, CSD 17, Brooklyn, NY Peter Kondrat, Educational Consultant and Freelance Writer, Brooklyn, NY Alix Ambroise, Jr., Social Studies Teacher, P.S. 138, CSD 17, Brooklyn, NY Professor Jean Y. Plaisir, Assistant Professor, Department of Childhood Education, City College of New York, New York, NY Claudette Laurent, Administrative Assistant, HABETAC at City College, New York, NY Christian Lemoine, Graphic Artist, HLH Panoramic, New York, NY. -

The Executive Survey General Information and Guidelines
The Executive Survey General Information and Guidelines Dear Country Expert, In this section, we distinguish between the head of state (HOS) and the head of government (HOG). • The Head of State (HOS) is an individual or collective body that serves as the chief public representative of the country; his or her function could be purely ceremonial. • The Head of Government (HOG) is the chief officer(s) of the executive branch of government; the HOG may also be HOS, in which case the executive survey only pertains to the HOS. • The executive survey applies to the person who effectively holds these positions in practice. • The HOS/HOG pair will always include the effective ruler of the country, even if for a period this is the commander of foreign occupying forces. • The HOS and/or HOG must rule over a significant part of the country’s territory. • The HOS and/or HOG must be a resident of the country — governments in exile are not listed. • By implication, if you are considering a semi-sovereign territory, such as a colony or an annexed territory, the HOS and/or HOG will be a person located in the territory in question, not in the capital of the colonizing/annexing country. • Only HOSs and/or HOGs who stay in power for 100 consecutive days or more will be included in the surveys. • A country may go without a HOG but there will be no period listed with only a HOG and no HOS. • If a HOG also becomes HOS (interim or full), s/he is moved to the HOS list and removed from the HOG list for the duration of their tenure. -
![[ 2005 ] Part 1 Chapter 3 Americas](https://docslib.b-cdn.net/cover/2009/2005-part-1-chapter-3-americas-1922009.webp)
[ 2005 ] Part 1 Chapter 3 Americas
Americas 373 Chapter III Political and security questions Americas During 2005, the United Nations continued to ceedings against Nicaragua in a dispute concern- advance the cause of lasting peace, human rights, ing navigational and related rights on the San sustainable development and the rule of law in Juan River. The General Assembly again called the Americas. With the ending of the mandate of on States to refrain from promulgating laws and the United Nations Verification Mission in Gua- measures, such as the ongoing embargo against temala at the end of 2004, the Guatemalan peace Cuba by the United States. The Assembly process had matured into a new phase in which granted observer status to the Ibero-American national actors had assumed fuller responsibility community of nations and the Latin American for monitoring and promoting the accords. A Integration Association. joint agreement in May between the Government of Guatemala and the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights resulted in the establishment of an office for Central America monitoring and reporting on human rights in that country. Despite efforts by the United Nations Stabili- The situation in Central America zation Mission in Haiti (MINUSTAH) and the Hai- Report of Secretary-General. As requested tian National Police to ensure a secure and stable by the General Assembly in resolution 58/239 environment in Haiti, the security situation re- [YUN 2003, p. 276], the Secretary-General submitted mained precarious. Outbreaks of violence and an August report on the situation in Central illegal activities of armed groups continued to be America [A/60/218], which summarized progress a serious concern. -

Haitian Ex-Minister Freed from Jail 19 Jun 2006 Reuters by Joseph Guyler Delva
Haitian ex-minister freed from jail 19 Jun 2006 Reuters By Joseph Guyler Delva PORT-AU-PRINCE, Haiti, June 19 (Reuters) - Haitian authorities released a former government minister who was jailed for more than two years on murder accusations, and they could soon free other high-profile prisoners who served under former President Jean-Bertrand Aristide, a prosecutor said on Monday. Jocelerme Privert, Aristide's interior minister, was released on Friday after a prosector said there was no evidence of wrongdoing. Privert said he was a victim of a political conspiracy by the U.S.-backed interim government of former Prime Minister Gerard Latortue, who was installed after Aristide was ousted in an armed revolt in February 2004. "Thanks to God I am free now after 26 months of political persecutions and injustice," Privert told Reuters and radio station Melodie FM. Privert was arrested on April 6, 2004, and jailed on accusations that he was the mastermind behind what Aristide's opponents called a massacre on Feb. 11, 2004, in La Scierie, a small village near the northern town of St-Marc. Privert has denied the accusations. "I spent all this time in jail just because there were authorities who wanted to have their political revenge," he said. Former Prime Minister Yvon Neptune and a former legislator from Aristide's Lavalas Family party, Amanus Mayette, are among others held on similar accusations and expected to be released. A prosecutor working on the case has demanded that an appeals court dismiss the charges for lack of evidence. The court has yet to rule. -

A Quoi Ont Servi Les Milliards De L'aide Post-Séisme ?
Haïti en Marche, édition du 21 au 27 Janvier 2015 • Vol XXIX • N° 01 A quoi ont servi les milliards de l’aide post-séisme ? PORT-AU-PRINCE, 15 Janvier – L’aide post-séisme les victimes. survenue dans la Caraïbe pendant un siècle et demi, le a été en partie gaspillée, en partie ramenée à son point de C’est ce qu’il ressort des bilans et compte rendus séisme qui détruisit la capitale haïtienne le 12 janvier 2010, e départ. Et pour une plus faible part, servi à aider réellement publiés à l’occasion du 5 anniversaire de la pire catastrophe (5 ANS APRES / p. 8) Nouveau Cabinet Le discours ambivalent ministériel Dimanche 18 Janvier 2014 : Le Premier ministre du PMKP ou le consensus (Evans Paul), en accord avec le Président de la République, a procédé, le dimanche 18 Janvier 2015, conformément à la Constitution, à la formation du Cabinet ministériel. dans la continuité (NOUVEAU GOUVERNEMENT / p. 4) PORT-AU-PRINCE, 17 Janvier – Deux charmants Mr Evans Paul, installé officiellement ce vendredi 16 janvier, speeches, mais taillés sur mesure et pour la même personne, le semble d’abord se donner pour mission de rassurer le chef de président Michel Martelly, vu que le nouveau Premier ministre, L’opposition (PM / p. 5) de sa majesté ! PORT-AU-PRINCE, 16 Janvier – Les manifestations populaires occupent davantage le terrain dans l’opinion internationale que prévu depuis qu’elles sont couvertes par (ALTERNATIVE / p. 6) Le Premier ministre Evans Paul après son installation le vendredi 16 janvier (photo Robenson Eugène) Carte rouge pour l’équipe au pouvoir EXECUTIF-LEGISLATIF Seuls les gouvernements Tsunami non, provisoires qui sachent faire crétinisme de bonnes élections ??? PORT-AU-PRINCE, 18 Janvier – Bizarrement Les premières élections qualifiées de démocratiques et égoïsme oui ! presque toutes les élections qui se sont bien passées ont furent celles de 1990 qui virent la victoire de Jean-Bertrand PORT-AU-PRINCE, 13 Janvier – Ils sont fous ces toujours été organisées par un gouvernement provisoire. -

Haiti After the Elections: Challenges for Préval’S First 100 Days
Policy Briefing Latin America/Caribbean Briefing N°10 Port-au-Prince/Brussels, 11 May 2006 Haiti after the Elections: Challenges for Préval’s First 100 Days I. OVERVIEW Deep structural challenges still threaten what may be Haiti’s last chance to extricate itself from chaos and despair, and action in the first 100 days is needed to René Préval’s inauguration on 14 May 2006 opens a convey to Haitians that a new chapter has been opened crucial window of opportunity for Haiti to move beyond in their history. political polarisation, crime and economic decline. The Security. It is essential to preserve the much 7 February presidential and parliamentary elections improved security situation in the capital since the succeeded despite logistical problems, missing tally sheets end of January. In large part the improvement stems and the after-the-fact reinterpretation of the electoral from a tacit truce declared by some of the main law. There was little violence, turnout was high, and the gangs – especially those in Cité Soleil – whose results reflected the general will. The 21 April second leaders support Préval. The new administration round parliamentary elections were at least as calm, and and MINUSTAH should pursue efforts to combine although turnout was lower, the electoral machinery reduced gang violence with rapid implementation of operated more effectively. During his first 100 days high-profile interventions to benefit the inhabitants in office, the new president needs to form a governing of the capital’s worst urban districts. Urgent action partnership with a multi-party parliament, show Haitians is needed to disarm and dismantle urban and rural some visible progress with international help and build armed gangs through a re-focused Disarmament, on a rare climate of optimism in the country. -

Byografi Youn Powèt Ileus Papillon
Haïti en Marche, édition du 09 au 15 Novembre 2011 • Vol XXV • N° 42 UN POUVOIR QUI SE RESPECTE Les coupables doivent partir d'eux-mêmes et le chef de l'Etat s'assumer PORT-AU-PRINCE, 5 Novembre – Nul n’est dent de la République parce qu’il était à l’étranger en voyage de une cérémonie dans un autre coin du pays. Le ministre de responsable ! Une faute majeure est commise au niveau de santé. Le premier ministre parce qu’il ne voulait pas interférer l’Intérieur et de la Défense nationale accompagnait son l’action gouvernementale. Tout le monde se défile. Le prési- dans le processus judiciaire. Le ministre de la Justice présidait (POUVOIR / p. 4) Les responsables de la sécurité publique convoqués au Sénat : de la droite, le chef de la police Le président Michel Martelly (le bras gauche en écharpe) rentre prématurément de son séjour Mario Andresol, le premier ministre Garry Conille, le ministre de l’intérieur Thierry Mayard-Paul, aux Etats-Unis où il a été opéré à l’épaule (photo Robenson Eugène/HENM) et le secrétaire d’Etat Réginald Delva (photo Georges Dupé/HENM) Arnel Bélizaire ENVIRONNEMENT avait refusé Un miracle en accomplissement d’assassiner Yvon Neptune dans le Sud-est (DEVELOPPEMENT / p. 8) pour le gouvernement Latortue PORT-AU-PRINCE, 6 Novembre – Dans un article publié le 13 Mai 2005, Arnel Bélizaire explique les circonstances de son évasion du Pénitencier National comme le résultat d’une requête par un membre du gou- (BELIZAIRE / p. 6) Les montagnes (et les réalisations entreprises après le séisme) vues de la route de Jacmel (photo Haïti en Marche) PRESIDENCE – PARLEMENT Une lutte au finish dont Haïti est la seule perdante PORT-AU-PRINCE, 3 Novembre – Au point l’international, qui permettrait d’assurer une collaboration où nous en sommes, seul un pacte de gouvernement qui plus ou moins viable entre l’exécutif et le législatif en Haïti. -

CENTER for the STUDY of HUMAN RIGHTS UNIVERSITY of MIAMI SCHOOL of LAW Professor Irwin P
CENTER FOR THE STUDY OF HUMAN RIGHTS UNIVERSITY OF MIAMI SCHOOL OF LAW Professor Irwin P. Stotzky, Director HAITI HUMAN RIGHTS INVESTIGATION: NOVEMBER 11-21, 2004 By Thomas M. Griffin, Esq. EXECUTIVE SUMMARY After ten months under an interim government backed by the United States, Canada, and France and buttressed by a United Nations force, Haiti’s people churn inside a hurricane of violence. Gunfire crackles, once bustling streets are abandoned to cadavers, and whole neighborhoods are cut off from the outside world. Nightmarish fear now accompanies Haiti’s poorest in their struggle to survive in destitution. Gangs, police, irregular soldiers, and even UN peacekeepers bring fear. There has been no investment in dialogue to end the violence. Haiti’s security and justice institutions fuel the cycle of violence. Summary executions are a police tactic, and even well-meaning officers treat poor neighborhoods seeking a democratic voice as enemy territory where they must kill or be killed. Haiti’s brutal and disbanded army has returned to join the fray. Suspected dissidents fill the prisons, their Constitutional rights ignored. As voices for non-violent change are silenced by arrest, assassination, or fear, violent defense becomes a credible option. Mounting evidence suggests that members of Haiti’s elite, including political powerbroker Andy Apaid, pay gangs to kill Lavalas supporters and finance the illegal army. UN police and soldiers, unable to speak the language of most Haitians, are overwhelmed by the firestorm. Unable to communicate with the police, they resort to heavy-handed incursions into the poorest neighborhoods that force intermittent peace at the expense of innocent residents.