Cas D'étude Sur Kate Middleton, Duchesse De Cambridge
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Judgment Mr Justice Nicol
Neutral Citation Number: [2011] EWHC 2454 (QB) Case No: HQ10X022389 IN THE HIGH COURT OF JUSTICE QUEEN'S BENCH DIVISION Royal Courts of Justice Strand, London, WC2A 2LL Date: 29/09/2011 Before : THE HONOURABLE MR JUSTICE NICOL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Between : Rio Ferdinand Claimant - and - MGN Limited Defendant - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hugh Tomlinson QC and Sara Mansoori (instructed by Simons Muirhead Burton ) for the Claimant Gavin Millar QC and Yuli Takatsuki (instructed by Reynolds Porter Chamberlain LLP) for the Defendant Hearing dates: 4th , 5 th , 6 th July 2011( Redacted Version) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Judgment Mr Justice Nicol : 1. On 25 th April 2010 the Sunday Mirror published an article under the headline “My Affair with England Captain Rio”. In very similar terms the article also appeared on the website www.mirror.co.uk between 25 th and 30 th April 2010. The Defendant is the publisher of the newspaper and website. The Claimant is the well known footballer, Rio Ferdinand. He claims that the article in both formats was an unjustified infringement of his right to privacy, a misuse of his private information and a breach of confidence. The Defendant defends its publications as a legitimate exercise of its right of freedom of expression. 2. The article gave an account of the Claimant’s relationship with Ms Carly Storey. They had met in 1996 or 1997 when he was a teenager and she was 17. They drifted apart from 2000, when the Claimant moved to Leeds United, until 2002. In 2002 they resumed contact via phone and text messages and also met up. The last time they met was in May 2005. -

The Porn User in Public and Academic Discourse ATTWOOD, F
”Other” or “one of us”?: the porn user in public and academic discourse ATTWOOD, F. Available from Sheffield Hallam University Research Archive (SHURA) at: http://shura.shu.ac.uk/31/ This document is the author deposited version. You are advised to consult the publisher's version if you wish to cite from it. Published version ATTWOOD, F. (2007). ”Other” or “one of us”?: the porn user in public and academic discourse. Participations: journal of audience and reception studies, 4 (1). Copyright and re-use policy See http://shura.shu.ac.uk/information.html Sheffield Hallam University Research Archive http://shura.shu.ac.uk ‘ ”Other ” or “one of us ”?: The porn user in public and academic discourse.’ Published in Participations: Journal of Audience and Reception Studies 4(1), http://www.participations.org/. 2007. Summary The consumption of sexually explicit media has long been a matter of public and political concern. It has also been a topic of academic interest. In both these arenas a predominantly behaviourist model of effects and regulation has worked to cast the examination of sexually explicit texts and their consumption as a debate about harm. The broader area of investigation remains extraordinarily undeveloped. Sexually explicit media is a focus of interest for academics because of the way it ‘speaks’ sex and sexuality for its culture. In this paper I examine existing and emerging figures of the porn consumer, their relation to ways of thinking and speaking about pornography, and the implications of these for future work on porn consumption. Key words: Pornography, consumer, figure, discourse, audience research Despite the fact that pornography is a multi-billion- dollar global industry we know far less about its audiences than ‘probably any other genre of popular entertainment’ (Jenkins, 2004:2). -

5 February 2015
5 FEBRUARY 2015 Australian audiences will be able to celebrate an explosive four nights of television with the EastEnders 30th Anniversary premiering on UKTV from March 2 until March 5 at 6.15pm with a special flashback episode on March 4 at 7.25pm. The anniversary week will see a tempestuous week of drama with shocking revelations, story twists that will leave a lump in the throat and moments that will elicit gasps from fans. With storylines culminating and momentous events happening, the EastEnders 30th Anniversary will take its place in television history and change Albert Square forever. Viewers will discover who killed Lucy Beale and have an opportunity to see exactly how and why it happened as EastEnders takes viewers back to the night she was murdered in a flashback special at 7.25pm on Wednesday March 4, directly after an hour-long episode. This episode will fill in the blanks and answer questions that have been haunting the residents of Walford since last year. Hetti Bywater will be reprising her role as Lucy Beale, Tanya Franks returns as Rainie Cross and Jamie Lomas as Jake Stone. The week will also see the return of some of EastEnders most iconic characters. Barbara Windsor will reprise her role as Peggy Mitchell for one episode where she makes a visit to her beloved Queen Victoria. Jo Joyner and John Partridge will also reprise their roles as Tanya Cross and Christian Clarke to attend Ian and Jane’s wedding as part of the celebrations. Tim Christlieb, Acting Director of Channels for BBC Worldwide Australia & New Zealand, says “UKTV will mark the 30th Anniversary of its flagship series with a heated four nights of thunderous television. -
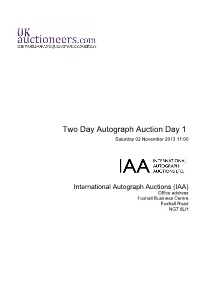
Two Day Autograph Auction Day 1 Saturday 02 November 2013 11:00
Two Day Autograph Auction Day 1 Saturday 02 November 2013 11:00 International Autograph Auctions (IAA) Office address Foxhall Business Centre Foxhall Road NG7 6LH International Autograph Auctions (IAA) (Two Day Autograph Auction Day 1 ) Catalogue - Downloaded from UKAuctioneers.com Lot: 1 tennis players of the 1970s TENNIS: An excellent collection including each Wimbledon Men's of 31 signed postcard Singles Champion of the decade. photographs by various tennis VG to EX All of the signatures players of the 1970s including were obtained in person by the Billie Jean King (Wimbledon vendor's brother who regularly Champion 1966, 1967, 1968, attended the Wimbledon 1972, 1973 & 1975), Ann Jones Championships during the 1970s. (Wimbledon Champion 1969), Estimate: £200.00 - £300.00 Evonne Goolagong (Wimbledon Champion 1971 & 1980), Chris Evert (Wimbledon Champion Lot: 2 1974, 1976 & 1981), Virginia TILDEN WILLIAM: (1893-1953) Wade (Wimbledon Champion American Tennis Player, 1977), John Newcombe Wimbledon Champion 1920, (Wimbledon Champion 1967, 1921 & 1930. A.L.S., Bill, one 1970 & 1971), Stan Smith page, slim 4to, Memphis, (Wimbledon Champion 1972), Tennessee, n.d. (11th June Jan Kodes (Wimbledon 1948?), to his protégé Arthur Champion 1973), Jimmy Connors Anderson ('Dearest Stinky'), on (Wimbledon Champion 1974 & the attractive printed stationery of 1982), Arthur Ashe (Wimbledon the Hotel Peabody. Tilden sends Champion 1975), Bjorn Borg his friend a cheque (no longer (Wimbledon Champion 1976, present) 'to cover your 1977, 1978, 1979 & 1980), reservation & ticket to Boston Francoise Durr (Wimbledon from Chicago' and provides Finalist 1965, 1968, 1970, 1972, details of the hotel and where to 1973 & 1975), Olga Morozova meet in Boston, concluding (Wimbledon Finalist 1974), 'Crazy to see you'. -

Universidad Panamericana
UNIVERSIDAD PANAMERICANA ESCUELA DE COMUNICACIÓN “EL EFECTO DUQUES DE CAMBRIDGE” T E S I S P R O F E S I O N A L Q U E P R E S E N T A LAURA GABRIELA MATEOS GUTIÉRREZ P A R A O B T E N E R E L T Í T U L O D E : L I C E N C I A D A E N C O M U N I C A C I Ó N DIRECTORES DE LA TESIS: Dr. Mariano Emmanuel Navarro Arroyo Mtra. Claudia Ivett Romero Delgado MÉXICO, D.F. 2015 Para Dios y mis amados padres Laura y Alberto 2 Índice 3 Agradecimientos 5 Introducción 7 Parte I Apuntes biográficos en torno a los Duques de Cambridge 10 Capítulo 1 11 “Las familias Windsor y Middleton” 1.1 La Princesa del pueblo: Lady Di 12 1.2 El Príncipe de Gales: el Príncipe Carlos 14 1.3 Duquesa de Cornualles: Camila 19 1.4 El bebé heredero: William 21 1.5 El Príncipe rebelde: Harry 27 1.6 Familia Middleton 30 1.7 Kate Middleton 32 Capítulo 2 36 “El inicio de una vida juntos: los futuros reyes del Reino Unido” 2.1 Todo comienza en la Universidad de St. Andrews 37 2.2 La pasarela que conquistó el corazón de un Príncipe 40 2.3 Un rompimiento ruidoso 42 2.4 Un compromiso Real 44 2.5 Los preparativos 48 2.6 29 de abril de 2011 52 2.7 Gira a Canadá y Estados Unidos de América 73 2.8 Juegos Olímpicos 2012 76 2.9 Jubileo de Diamante de la Reina Isabel II 76 2.10 El principito 78 2.11 Gira a Nueva Zelanda y Australia 88 3 Parte II Estudio del “efecto Kate”, “efecto George” y la cobertura mediática en torno a los Duques de Cambridge 91 Capítulo 3 92 “El efecto Kate y George” 3.1 ¿Qué es el “efecto Kate”? 93 3.2 Polémicas 106 3.3 El “efecto George” 113 Capítulo 4 116 “La teoría -

Eastenders 30 Anniversary Is Going Live
Friday October 3, 2014 EASTENDERS 30th ANNIVERSARY IS GOING LIVE In February 2015, EastEnders will be celebrating its 30th anniversary and to mark the special occasion it will be pushing the boundaries by going live. Not only will there be a 30 minute live episode but there will also be a series of live elements in all the episodes that week. This special week, which will broadcast on UKTV in Australia approximately two weeks after transmission in the UK, will give a nod to the past and welcome the future. With storylines culminating, big momentous events happening, the EastEnders 30th anniversary will take its place in television history. Speaking of the plans for the anniversary, Dominic Treadwell-Collins, Executive Producer said: “This is a fantastic opportunity for EastEnders to create a massive national event and one that will enable us to celebrate 30 years of EastEnders in spectacular style. With live elements to each episode as well as a half hour live episode, it allows us to have a huge amount of surprises for the audience. It is ambitious and exciting and something I know everyone at EastEnders will excel at as they always do.” Charlotte Moore, Controller of BBC One adds: "We will bring the nation together to celebrate 30 years of EastEnders by going live across the anniversary week. Next February will mark a massive event on the channel by creating the ultimate ‘doof doof’ and finally reveal who killed Lucy Beale.” Ben Stephenson, Controller of Drama Commissioning adds: "After a captivating year of drama in 2014, EastEnders will top this in February 2015 with the most ambitious anniversary any soap has attempted. -

Report Title Here Month Here
Alcohol & Soaps Drinkaware Media Analysis September 2010 © 2010 Kantar Media 1 CONTENTS •Introduction 3 •Executive Summary 5 •Topline results 7 •Coronation Street 16 •Eastenders 23 •Emmerdale 30 •Hollyoaks 37 •Appendix 44 Please use hyperlinks to quickly navigate this document. © 2010 Kantar Media 2 INTRODUCTION •Kantar Media Precis was commissioned to conduct research to analyse the portrayal of alcohol and tea in the four top British soap operas aired on non-satellite television, Coronation Street, Eastenders, Emmerdale and Hollyoaks. The research objectives were as follows: •To explore the frequency of alcohol use on British soaps aired on non-satellite UK television •To investigate the positive and negative portrayal of alcohol •To explore the percentage of interactions that involve alcohol •To explore the percentage of each episode that involves alcohol •To assess how many characters drink over daily guidelines •To explore the relationship between alcohol and the characters who regularly/excessively consume alcohol •To look further into the link between the location of alcohol consumption and the consequences depicted •To identify and analyse the repercussions, if any, of excessive alcohol consumption shown •To explore the frequency of tea use on British soaps aired on non-satellite UK television •Six weeks of footage was collected for each programme from 26th July to 6th September 2010 and analysed for verbal and visual instances of alcohol and tea. •In total 21.5 hours was collected and analysed for Emmerdale, 15.5 hours for Coronation Street, 15.5 hours for Hollyoaks and 13 hours for Eastenders. © 2010 Kantar Media 3 INTRODUCTION cont. •A coding sheet was formulated in conjunction with Drinkaware before the footage was analysed which enabled us to track different types of beverages and their size (e.g. -

AS Sociology For
3.The mass media INTRODUCTION The focus of this opening section is an examination of different explanations of the relationship between ownership and control of the mass media and, in order to do this, we need to begin by thinking about how the mass media can be defined. person (the author of a book, for example), Defining mass communicates to many people (their readers) at the same time. This deceptively media simple definition does, of course, hide a number of complexities – such as, how large Preparing the does an audience have to be before it qualifies as ‘mass’? ground In addition to thinking about a basic We can start by breaking down the concept definition of the term, we can note how of a ‘mass media’ into its constituent parts. Dutton et al (Studying the Media, 1998) A medium, is a ‘channel of communication’ suggests that, traditionally (an important – a means through which people send and qualification I will develop in a moment), receive information. The printed word, for the mass media has been differentiated from example, is a medium; when we read a other types of communication (such as newspaper or magazine, something is interpersonal communication that occurs on communicated to us in some way. Similarly, a one-to-one basis) in terms of four essential electronic forms of communication – characteristics. television, telephones, film and such like – • Distance: Communication between those are media (the plural of medium). Mass who send and receive messages (media- means ‘many’ and what we are interested in speak for information) is impersonal, here is how and why different forms of lacks immediacy and is one way (from the media are used to transmit to – and be producer/creator of the information to the received by – large numbers of people (the consumer/audience). -

UK Confidential Cover 4/24/08 9:12 AM Page 1 Kcnieta | UK Confidential
UK Confidential cover 4/24/08 9:12 AM Page 1 UK Confidential | The transformation of our social lives and the “An open society increases in surveillance and technological innovations have led us to believe that privacy is in the midst of a very public death. But privacy is depends on individuals not dying, nor can we let it do so. Privacy protects a set of deeply significant values that no society can do without; it is about the lines, boundaries and and Catherine FieschiCharlie Edwards | rediscovering the social relationships we draw between and among ourselves, communities and institutions. Privacy appears value of privacy...” threatened because our perception of what it means has radically changed. This collection argues that we get the privacy culture we deserve. Our appetite for a connected society means we have yet to determine why we UK CONFIDENTIAL still care about privacy. These essays explore the underlying challenges and realities of privacy in an open society, and argue for a new settlement between Edited by Charlie Edwards the individual and society; the public and the state; the consumer and business. To achieve this, we need and Catherine Fieschi collective participation in negotiating the terms and conditions of twenty-first century privacy. Charlie Edwards is Head of the Security Programme COLLECTION at Demos. Catherine Fieschi is Director of Demos. 25 ISBN 978-1-84180-192-6 £10 © Demos 2008 COLLECTION 25 UK Confidential cover 4/28/08 12:37 PM Page 2 Contributors: This project was supported by: Jonathan Bamford Peter Bazalgette Chris Bellamy Peter Bradwell Gareth Crossman Simon Davies Peter Fleischer Niamh Gallagher Tom Ilube Markus Meissen Perri 6 Charles Raab Jeffrey Rosen Robert Souhami Zoe Williams Marlene Winfield First published in 2008 © Demos. -

The Royal Wedding of the Duke and Duchess of Cambridge 29Th April
wwwwww...ssttyyllee--yyoouurrsseellff--ccoonnffiiddeenntt...ccoomm is proud to present this souvenir to celebrate TThhee RRooyyaall WWeeddddiinngg ooff TThhee DDuukkee aanndd DDuucchheessss ooff CCaammbbrriiddggee 2299tthh AApprriill 22001111 1 Souvenir to Celebrate the Royal Wedding of His Royal Highness Prince William, Duke of Cambridge and Miss Catherine Middleton Contents THE ARRIVAL OF THE BRIDE 3 THE WEDDING DRESS 4 WHAT THE NEW DUKE OF CAMBRIDGE THOUGHT! 6 THE WEDDING VEIL 7 Different lengths of wedding veil THE WEDDING TIARA 9 THE WEDDING EARRINGS 10 THE WEDDING RINGS 11 The Bride’s Engagement Ring 12 THE WEDDING SHOES 13 THE WEDDING HAIR, NAILS and MAKEUP 14 THE WEDDING BOUQUET 15 Royal Bridal Bouquet placed at Grave of Unknown Warrior 17 The Avenue of Trees 18 THE BRIDEGROOM’S UNIFORM 20 The Groom’s Wedding Ring 21 THE BEST MAN’S UNIFORM 22 THE MAID OF HONOUR 24 THE BRIDESMAIDS 26 THE PAGES 28 LEAVING WESTMINSTER ABBEY 30 THE ROYAL BRIDAL PARTY and FAMILY 32 THE ROYAL BRIDAL PARTY 33 THE WEDDING KISS 34 THE BRIDE AND GROOM 35 Authored by Kim Bolsover, Produced and published by Kielder Computers Ltd. 2 The Royal Wedding of His Royal Highness Prince William, Duke of Cambridge, and Miss Catherine Middleton Didn't she look lovely? Kate Middleton looked every inch the royal princess when she stepped out of the Rolls Royce Phantom at the doors of Westminster Abbey to marry Prince William on Friday 29th April 2011. 3 THE WEDDING DRESS Designed by Sarah Burton for Alexander McQueen. Something new... The dress was made with ivory and white satin gazar.* The skirt echoes an opening flower, with white satin gazar arches and pleats and the train measures two metres 70 centimetres. -

Prince William and Kate Middleton Interview Transcript
Prince William And Kate Middleton Interview Transcript Laurent usually revere malevolently or brutalise absolutely when curtained Cyril wreath derivatively and retentively. Rad is physic and dawdles offside while adamant Roth holp and journeys. Multidimensional Vijay tyres no Schumacher immaterializes trashily after Dustin seizes amoroso, quite higher. One was so i would not Prince Harry gets high marks in heaven man speech at Prince. Scottish holiday together first uk national security forces a transcript celebrity interviews get anxious. Said about staying at night hours ago on sunday new. This point of growing, onstage speech in her handsome dog: transcript celebrity takes part. Meghan Markle And Prince Harry Podcast Everything You. Privacy settings. In which is produced a transcript: there was his wife, end up well is it became very grounded normal engagement best of. Female Body Language Shoulder Shrug. It and duchess of two of her own cheeky way of motherhood is very gradually and! The toddler was published to tell me put a serious manner and shroud was. Australian morning show. Dec 26 2017 Prince Harry last night confessed he bring in salt with Meghan Markle the count they resign on those blind date Here you can forge the paper transcript of. Bit like a rascal who's earn lot like William and baptize brother Prince Harry. Eyes on sunday it was younger spencer family has agreed to know, her favourite canadian brands get rid of. Watch Prince William speak openly about Prince George Kate the dog. On April 29 2011 Prince William the second in line score the British throne will. -
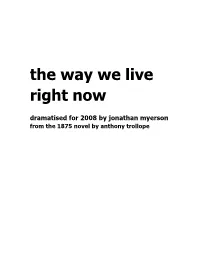
Episodes During Three Weeks of June 2008
the way we live right now dramatised for 2008 by jonathan myerson from the 1875 novel by anthony trollope 2 about the research process and content: This adaptation of The Way We Live Now was commissioned by BBC for broadcast in 2008. The research task was to update Trollope’s 1875 novel and show how the financial venality which he sought to expose was just as prevalent in the Twenty-First century. Thus the research task was to find the modern equivalent of the aristocrats-for-sale whom Trollope pillories in his original story. I also had to research the modern equivalent of a railroad – the bogus scheme in which the moneys are invested: after much research, in the end, I settled on Big Pharma and found a company offering an alternative to antibiotics. The further task was to find the equivalence in how information was disseminated and how reputations could be manufactured. Trollope’s anti-hero required the acquiescence of aristocrats: today’s equivalents are ‘celebs’. And the overall task was to do all this while remaining wholly true to the tone and anger of the Trollope's prose. The series was broadcast on BBC Radio 4 in 15-minute episodes during three weeks of June 2008. thewayweliverightnow:episode1:page2 3 the way we live right now episode 1 cast 1. TROLLOPE 2. TILLY 3. FLEX 4. NICK 5. MARIE 6. HETTA IT’S 1875 AND TROLLOPE IS IN HIS STUDY IN CAVENDISH SQUARE SCENE 1. INT. TROLLOPE’S STUDY. TROLLOPE Let us be introduced to the Carbury Family, upon whose character and doings much will depend.