On L'appelait Docteur La Mort
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

December Layout 1
AMERICAN & INTERNATIONAL SOCIETIES FOR YAD VASHEM Vol. 41-No. 2 ISSN 0892-1571 November/December 2014-Kislev/Tevet 5775 The American & International Societies for Yad Vashem Annual Tribute Dinner he 60th Anniversary of Yad Vashem Tribute Dinner We were gratified by the extensive turnout, which included Theld on November 16th was a very memorable many representatives of the second and third generations. evening. We were honored to present Mr. Sigmund Rolat With inspiring addresses from honoree Zigmund A. Rolat with the Yad Vashem Remembrance Award. Mr. Rolat is a and Chairman of the Yad Vashem Council Rabbi Israel Meir survivor who has dedicated his life to supporting Yad Lau — the dinner marked the 60th Anniversary of Yad Vashem and to restoring the place of Polish Jewry in world Vashem. The program was presided over by dinner chairman history. He was instrumental in establishing the newly Mark Moskowitz, with the Chairman of the American Society opened Museum of the History of Polish Jews in Warsaw. for Yad Vashem Leonard A. Wilf giving opening remarks. SIGMUND A. ROLAT: “YAD VASHEM ENSHRINES THE MILLIONS THAT WERE LOST” e are often called – and even W sometimes accused of – being obsessed with memory. The Torah calls on us repeatedly and command- ingly: Zakhor – Remember. Even the least religious among us observe this particular mitzvah – a true corner- stone of our identity: Zakhor – Remember – and logically L’dor V’dor – From generation to generation. The American Society for Yad Vashem has chosen to honor me with the Yad Vashem Remembrance Award. I am deeply grateful and moved to receive this honor. -

Annual Report 2007
Worldwide Investigation and Prosecution of Nazi War Criminals (April 1, 2006 – March 31, 2007) An Annual Status Report Dr. Efraim Zuroff Simon Wiesenthal Center – Israel Office Snider Social Action Institute August 2007 2 TABLE OF CONTENTS Executive Summary 5 Introduction 6 The Period Under Review: April 1, 2006 – March 31, 2007 8 Convictions of Nazi War Criminals Obtained During the Period Under Review 14 Convictions of Nazi War Criminals: Comparative Statistics 2001-2007 17 New Cases of Nazi War Criminals Filed During the Period Under Review 18 New Cases of Nazi War Criminals: Comparative Statistics 2001-2007 19 New Investigations of Nazi War Criminals Initiated During the Period Under Review 20 New Investigations of Nazi War Criminals: Comparative Statistics 2001-2007 21 Ongoing Investigations of Nazi War Criminals As of March 31, 2007 22 Ongoing Investigations of Nazi War Criminals: Comparative Statistics 2001-2007 23 Investigation and Prosecution Report Card 24 Investigation and Prosecution Report Card: Comparative Statistics 2001-2007 42 SWC Most Wanted List of Nazi War Criminals 44 About the Simon Wiesenthal Center 47 Index of Countries 51 3 4 EXECUTIVE SUMMARY 1. During the period in question the investigation and prosecution of Nazi war criminals continued in twelve countries, among them countries such as Germany, Austria and Poland in which the crimes of the Holocaust were committed and others like the United States and Canada which afforded a postwar haven to Holocaust perpetrators. 2. From April 1, 2006 until March 31, 2007, twenty-one convictions of Nazi war criminals were obtained. Most of those convicted participated in atrocities against civilians in Italy or served as armed guards in concentration and death camps in Poland and Germany. -

Reportage Enthüllung Hitlers Folter- Doktor Und Die Schweiz Sadistische Menschen-Experimente Waren Die Spezialität Des KZ-Arztes Aribert Heim
SOHP36_0909_0018.qxp-SBM 12.09.2007 09:33 Seite 18 reportage Enthüllung Hitlers Folter- Doktor und die Schweiz Sadistische Menschen-Experimente waren die Spezialität des KZ-Arztes Aribert Heim. Die Häftlinge nannten ihn «Dr. Tod». Heute ist Heim 93 Jahre alt und lebt unerkannt mitten unter uns. Um ihn zu fassen, überwacht die Polizei ein Konto in der Schweiz und Häuser im Tessin. Text Sandro Brotz SPUREN INS TESSIN Die Familie Heim besitzt in Lugano-Castagnola eine Mietwohnung (o.) – und ein Haus im nahen Massagno. DAS PHANTOM DES GRAUENS Aribert Heim ist der schlimmste noch lebende NS-Verbrecher. Der Arzt tötete über 300 KZ-Häft- linge – oft mit einer Giftspritze (r.) ins Herz. Vor 45 Jahren ist er untergetaucht. Er wird von einer Sondereinheit der KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Collection USHMM, BMI/Fotoarchiv Fotos: Brotz Sandro gesucht 18 | SonntagsBlick Magazin SOHP36_0909_0018.qxp-SBM 12.09.2007 09:33 Seite 20 reportage STATIONEN EINER SUCHE Diese Weltkarte im Landeskri- minalamt in Stuttgart zeigt die Spuren im Fall Heim. Blau be- deutet eine konkrete Spur – wie «Aus unseren Befunden müs- in die Schweiz. Rot steht für od nicht erhärtete Hinweise aus sen wir nicht nur schliessen, dass der Bevölkerung solche Personen weder krank noch einzig- artig sind, sondern auch, dass wir sie heute in jedem anderen Land der Erde antreffen würden.» (Douglas Kelly, Gerichtspsychologe an den Nürnberger Prozessen, 1945 - 1949) Die vergilbte Weltkarte hängt im Lan- deskriminalamt (LKA) in Stuttgart, Ba- den-Württemberg, vierter Stock, Büro DF041. Mitten in der Schweiz stecken ein blaues Fähnchen und zwei rote Nadeln. Insgesamt sind es – von Südamerika über Mitteleuropa bis nach Finnland – 16 blaue Fähnchen und etwa gleich viele rote Nadeln. -

The Beacon, November 20, 2009 Florida International University
Florida International University FIU Digital Commons The aP nther Press (formerly The Beacon) Special Collections and University Archives 11-20-2009 The Beacon, November 20, 2009 Florida International University Follow this and additional works at: https://digitalcommons.fiu.edu/student_newspaper Recommended Citation Florida International University, "The Beacon, November 20, 2009" (2009). The Panther Press (formerly The Beacon). 361. https://digitalcommons.fiu.edu/student_newspaper/361 This work is brought to you for free and open access by the Special Collections and University Archives at FIU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in The aP nther Press (formerly The Beacon) by an authorized administrator of FIU Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. Weekend A Forum for Free Student Expression at Florida International University Vol. 22, Issue 43 www.fi usm.com Friday, November 20, 2009 Students burn a few calories Sacha Baren Cohen is back with for a free turkey Bruno – Is It Worth It? PAGE 3 PAGE 6 SPOTLIGHT PAGE 3 Police get AT THE BAY Students learned about violence against women, how to identify it, and even how to fi ght it. new leads OPINION PAGE 4 FIU vs UF on missing Hulu subscription should be op- student case tional, not mandatory. JULIA CARDENUTO OPINION PAGE 4 News Director FIU Police reported on Tuesday that student Tom Daniels, who has been missing since Nov. 2, called 911 three days after he disappeared, according to the University. Cabralitics: Don’t let the Constitution get in the way: try Essentials for the big game Daniels, a law student, was reported missing Nov. -

Worldwide Investigation and Prosecution of Nazi War Criminals
Worldwide Investigation and Prosecution of Nazi War Criminals (April 1, 2009 – March 31, 2010) An Annual Status Report Dr. Efraim Zuroff Simon Wiesenthal Center – Israel Office Snider Social Action Institute November 2010 2 TABLE OF CONTENTS Executive Summary 5 Introduction 7 The Period Under Review: April 1, 2009 – March 31, 2010 9 Convictions of Nazi War Criminals Obtained During the Period Under Review 14 Convictions of Nazi War Criminals: Comparative Statistics 2001-2010 15 New Cases of Nazi War Criminals Filed During the Period Under Review 16 New Cases of Nazi War Criminals: Comparative Statistics 2001-2010 18 New Investigations of Nazi War Criminals Initiated During the Period Under Review 19 New Investigations of Nazi War Criminals: Comparative Statistics 2001-2010 20 Ongoing Investigations of Nazi War Criminals As of April 1, 2010 21 Ongoing Investigations of Nazi War Criminals: Comparative Statistics 2001-2010 22 Investigation and Prosecution Report Card 23 Investigation and Prosecution Report Card: Comparative Statistics 2001-2010 36 SWC Most Wanted List of Nazi War Criminals 38 About the Simon Wiesenthal Center 43 Index of Countries 47 3 4 EXECUTIVE SUMMARY 1. During the period in question the investigation and prosecution of Nazi war criminals continued in fourteen countries, among them countries such as Germany, Austria and Poland in which the crimes of the Holocaust were committed and others like the United States and Canada, which afforded a postwar haven to Holocaust perpetrators. 2. During the period from April 1, 2009 until March 31, 2010, five individuals were convicted for Nazi war crimes, three (in absentia) in Italy and two in Germany. -

The Nazi Hunter.Pdf
NEWS Friday, October 12, 2012 The Australian Jewish New s – jewishnews.net.au 15 THE NAZI HUNTER In your time at the Simon Wiesenthal of Mauthausen doctor Aribert Heim, Centre (SWC), you have uncovered the Dr Efraim Zuroff is the story of which also appears in the postwar escape of hundreds of Nazi war determined to book. In both cases, the children criminals to Western countries. These bring Nazi war found it very difficult to deal with efforts have influenced the creation of criminals to special laws in Canada (1987), justice. their parents’ alleged past. Zentai’s Australia (1989) and Great Britain children clung to their father’s denial (1991). How instrumental was the SWC of his participation in the murder of in prompting these countries to pursue Peter Balazs, although they had no such legislative measures? concrete proof, other than their The SWC was one of several father’s account. In the Heim case, the groups in each country that fought to daughter claimed never to have even convince these governments to take seen her father. legal action against the Nazi war criminals living in Canada, Australia Why did you decide to write the book? and the UK. The local Jewish com - Writing the book was in certain munity organisations, such as the respects a labour of love for the mem - Canadian Jewish Congress and B’nai ory of the victims of the Shoah and to B’rith in Canada, and the Executive explain my mission. It took me about Council of Australian Jewry and nine months. So far I have had many Australia/Israel & Jewish Affairs wonderful moments, but my share of Council in Australia, usually played a frustrations as well. -

The Story of Gerd and the Von Halle Family
Loss, Perseverance, and Triumph: The Story of Gerd and the von Halle Family Jeremy Sanford von Halle Duke University 2011 1 Introduction In kindergarten, I decided to write my last name as “Vonhalle” because it was “easier”. My father quickly corrected, “But that is not our last name.” The complex aggregation of the lower case V, the space, the upper case H, the Chicago‐ized, German‐American pronunciation (von Hall‐EE) made it extremely difficult for friends, classmates, and coaches to ever fully grasp. People called me everything from the phonetic von Hail to van Halen, names I became accustomed to answering to. Between youth athletics, school, and hearing my mother effortlessly deliver, “V as in Victor‐O‐N‐SPACE‐Capital H‐A‐L‐L‐E” to delivery restaurants, my last name, von Halle, became a part of my identity. In truth, it was not until my grandfather slipped me a little piece of knowledge that I then developed a years long obsession with my last name and my family history. When I was 10 or 11 years old, my grandfather told me the reason why the V in “von” was lower case. In Germany, my grandfather explained, von signified a type of nobility. That little tidbit, I remember, stopped me in my tracks. Was I the long lost heir to a million dollar royal fortune? Was I a Duke, Prince, or maybe even a King? I continued to interrogate my grandfather, unfortunately confirming that I was not the German version of Anastasia Romanov. Despite self‐interested beginnings, the now irrelevant piece of information actually triggered my interest in uncovering, learning, and documenting my family’s nearly 300‐year long story. -

Can the Farhud, a Slaughter of Jews by Their Longtime Arab Neighbors, Happen Again?
Can the Farhud, a Slaughter of Jews by Their Longtime Arab Neighbors, Happen Again? by Edwin Black BESA Center Perspectives Paper No. 2,064, June 4, 2021 EXECUTIVE SUMMARY: The world just marked the 80th anniversary of the Farhud, the Arab-Nazi pogrom against the Jews of Baghdad and Basra that occurred on June 1-2, 1941. The term Arab-Nazi is entirely appropriate, not simply because these Arabs were fascist in mind and deed, but because they explicitly identified with Germany’s Nazi Party. Some of the rioters wore swastikas; more than a few marched in the Nuremberg torchlight parades. The Nazi ideology that motivated the Arab slaughterers of Jews in 1941—the desire to exterminate Jews from the face of the earth—motivates the Arabs and Muslims who assault Israelis and Jews today. The word “farhud” means “violent dispossession.” During the Farhud riots in Iraq in 1941, Arabs turned against their longtime Jewish neighbors. Jews were hunted in the streets by mobs wielding swords. When found, Jews were subjected to unspeakable torment. Girls were raped in front of their parents, fathers beheaded in front of their children, mothers brutalized in public, babies sliced in half and thrown into the Tigris River. A busload of Jewish schoolgirls was hijacked and the girls taken to a camp outside of town, where they were raped. The Baghdad Arab mobs burned dozens of Jewish stores and invaded and looted Jewish homes. Many families tell a similar story: a wild mob pushed past the furniture stacked against the door, and with swords swinging, chased the Jews up to the roof. -
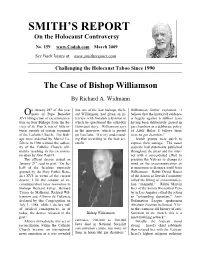
Smith's Report
SMITH’S REPORT On the Holocaust Controversy No. 159 www.Codoh.com March 2009 See Back Issues at: www.smithsreport.com Challenging the Holocaust Taboo Since 1990 The Case of Bishop Williamson By Richard A. Widmann n January 24th of this year that one of the four bishops, Rich- Williamson further explained, “I O news of Pope Benedict ard Williamson, had given an in- believe that the historical evidence XVI lifting a ban of excommunica- terview with Swedish television in is hugely against 6 million Jews tion on four Bishops from the So- which he questioned the orthodox having been deliberately gassed in ciety of St. Pius X was of little in- Holocaust story. Williamson says gas chambers as a deliberate policy terest outside of certain segments in the interview, which is posted of Adolf Hitler. I believe there of the Catholic Church. The Bish- on YouTube, “It is my understand- were no gas chambers." ops were ordained by Marcel Le- ing that according to the best sci- Jewish groups were quick to febvre in 1988 without the author- entific express their outrage. The usual ity of the Catholic Church, ulti- suspects had statements published mately resulting in the excommu- throughout the press and the inter- nication by John Paul II. net with a concentrated effort to The official decree issued on pressure the Vatican to change its January 21st read in part, “On be- mind on the excommunication or half of the faculties expressly at minimum to distance itself from granted by the Holy Father Bene- Williamson. Rabbi David Rosen dict XVI, in virtue of -

De Mauthausen a Denia: La Desmemoria Histórica En Lo Que Esconde Tu Nombre, De Clara Sánchez
De Mauthausen a Denia: la desmemoria histórica en Lo que esconde tu nombre, de Clara Sánchez Fidel López Criado Universidad de La Coruña [email protected] ◆ Se estudia la novela de Clara Sánchez Lo como lanzadera de un debate ético-social que esconde tu nombre, como ejemplo de (propiciado por la polémica Ley de Me- la recuperación y la reorientación de la moria Histórica) en torno a la historia, la novela social española en el siglo XXI. Se memoria y la verdad. Para ello, se da par- analiza el trasvase de un tema histórico- ticular atención a las claves propedéuti- social (las víctimas del nacionalsocialis- cas de la novela (su contexto y referentes mo y la ocultación de criminales nazis en histórico-sociales) y su intención didácti- territorio español) hacia el cauce literario ca (la literatura como memoria histórica), del bildungsroman o novela de aprendi- que comprometen al lector, principal- zaje (la historia de una joven inmadura mente joven, en la búsqueda personal de que se escapa de casa y es acogida por verdad y trascendencia. unos octogenarios torturadores nazis), Palabras clave: literatura e historia, Ley de memoria histórica, víctimas y verdugos de Mauthausen, Eribert Heim, el “Doctor Muerte”, ODESSA en España. A Leopoldo López Criado, asesinado en Mauthausen-Gusen, 3-11-1941. Historia vero testis temporum. La voz “historia” (ἱστορία, en griego) fue utilizada por primera vez por Aristóteles, en su Historia de los anima- les (Περὶ τὰ ζῷα ἱστορίαι). Proviene de la voz “hístōr” (ἵστωρ), que signifi- ca “hombre sabio”, “testigo” o “juez”, y con este sentido de testimonio 175 Letras Históricas / Número 10 / Primavera-verano 2014 / pp. -

Annual Tribute Dinner
Vol. 35-No.1 ISSN 0892-1571 September/October 2008-Tishri/Cheshvan 5769 THE AMERICAN & INTERNATIONAL SOCIETIES FOR YAD VASHEM AANNNNUUAALL TTRRIIBBUUTTEE DDIINNNNEERR GUEST SPEAKER MARGARET SPELLINGS, U.S. SECRETARY OF EDUCATION argaret Spellings is the U.S. Secretary of MEducation. As the first mother of school- aged children to serve as Education Secretary, Spellings has a special appreciation for the hopes and concerns of American families. Secretary Spellings is working to ensure that every young American has the knowledge and skills to succeed in the 21st century. She has partnered with states to implement and enforce the No Child Left Behind Act, which commits our schools to bringing all students up to grade level or better in reading and math by 2014. The law has led to rising test scores and shrinking achievement gaps in states across the country. Secretary Spellings has been a leader in reform to make education more innovative and respon- sive. She supported teachers with new financial incentives for gains in student achievement and parents with new educational choices and options. She announced new rules to ensure that students with disabilities and English language learners are educated to the highest standards. She also proposed a landmark Plan for Higher Education that would improve accessibility, affordability and accountability. Secretary Spellings believes we must not retreat from the world in the face of increased competition. She led the effort to pass President Bush's American Competitiveness Initiative to strengthen math and science instruction and It is with great pleasure that we write to invite you encourage high schools to offer more rigorous and advanced coursework. -

Congressional Record—Senate S6969
July 21, 2008 CONGRESSIONAL RECORD — SENATE S6969 Vucetich, both distinguished research- one of the most wanted Nazis still at H.R. 4289. An act to name the Department ers affiliated with Michigan Techno- large. Dr. Heim, a former SS con- of Veterans Affairs outpatient clinic in logical University’s School of Forest centration camp doctor, was nick- Ponce, Puerto Rico, as the ‘‘Euripides Rubio Resources and Environmental Science. named ‘‘Dr. Death’’ for his brutal and Department of Veterans Affairs Outpatient Clinic’’. In partnership with the National Park sadistic experiments on camp inmates. S. 231. An act to authorize the Edward Service, Michigan Technological Uni- At Mauthausen, the camp where he Byrne Memorial Justice Assistance Grant versity, and the volunteer efforts of committed his worst crimes, Dr. Heim Program at fiscal year 2006 levels through Earthwatch, among many other con- was known for murdering inmates by 2012. tributors, this project has provided a injecting toxins directly into their S. 2607. An act to make a technical correc- wealth of information and has contrib- hearts. Though detained after the Sec- tion to section 3009 of the Deficit Reduction uted in many important ways to our ond World War, Heim was subsequently Act of 2005. understanding of the interaction with- released and remained free until 1962. S. 3145. An act to designate a portion of United States Route 20A, located in Orchard in and between these two species. After he was tipped off that German Park, New York, as the ‘‘Timothy J. Russert Today, scientists enjoy a deeper un- authorities intended to prosecute him Highway’’.