Surveillance Des Eaux Souterraines Et Superficielles
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bulletin Paroissial Du District De Porrentruy
BULLETIN PAROISSIAL DU DISTRICT DE PORRENTRUY No 1 Octobre - Novembre - Décembre 2020 SOMMAIRE Editorial 1 Conseil de paroisse 2 Autorité de l’Assemblée de paroisse Pasteurs - Diacre - Aumônière Délégués à l’Assemblée 3 de l’Église réformée Membres au Conseil de l’Église réformée Membres au Synode d’arrondissement Synode de l’USBJ Calendrier des cultes 4 francophones Die deutsche Seite 5 Predigtplan Annonces 6 Informations 7 Témoignage 8 Remerciement Méditation 9 Adresses utiles 10 EDITORIAL Philippe Berthoud Président du Conseil de Paroisse Vous tenez dans les mains le premier Le COVID-19 continue de bulletin paroissial que nous vous chambouler les activités de la enverrons tous les 3 mois. Nous nous paroisse. C’est ainsi que la efforcerons de vous fournir toutes les traditionnelle kermesse est informations utiles concernant la annulée. Vue la situation sanitaire paroisse. L’horaire des cultes ne actuelle, la confirmation est paraîtra plus sous l’ancienne version reportée à une date ultérieure. mais se trouvera dorénavant dans ce bulletin. Le CP a dans ses priorités l’engagement d’un(e) pasteur(e). Comme vous l’avez appris par la Actuellement quatre pasteurs ont presse bien des choses ont changé fait acte de candidature. Nous les dans notre paroisse. Mme Françoise auditionnerons prochainement Vallat a pris sa retraite avec une avec toute l’attention que ce année d’avance et M. Yvan Bourquin, ministère mérite. Nous aurons comme il nous l’avait annoncé lors de comme autre priorité la l’assemblée du 29 novembre passé, a rénovation de la cure adjacente décidé de changer d’air. -
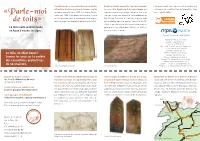
La Tuile, Un Objet Banal ? Levons Les Yeux
Parallèlement à sa production de vaisselle En Ajoie, la tuile apparaît à l’époque romaine. Un grand merci à nos sponsors et donateurs qui réfractaire, Bonfol a eu plusieurs tuileries. La plus Le nom latin tegula vient du verbe tegere qui ont permis de couvrir les frais de l’exposition. Sans ancienne apparaît vers 1820. La tuilerie Fattet, signifie couvrir et qui a donné « tuile » et « toit » en eux... quelle tuile ! créée vers 1883 à l’extérieur de la localité, a joué français. Après une éclipse, la tuile réapparaît au un rôle pionnier dans la mécanisation de la pro- Bas Moyen Âge sous la forme de la petite tuile duction jusqu’à sa disparition définitive en 1919. plate adaptée aux toits pentus. Vers la fin du 19e siècle, le procédé de production mécanique mis au La terre cuite architecturale point par les frères Gilardoni à Altkirch en 1841 est en Ajoie à travers les âges peu à peu mis en œuvre. Boulangerie L’Ami du Pain, Bonfol Louis Bélet SA, Vendlincourt Pius Borer, électricité, Bonfol A+C Corbat SA, industrie du bois, Vendlincourt Cosendey SA, construction, Bonfol Denner Bonmag Sàrl, Bonfol La tuile, un objet banal ? Filipetto Constructions, Vendlincourt Restaurant du Grütli, Bonfol Levons les yeux sur la variété Moderna SA, blanchisserie, Bonfol Technopoli SA, terminaison horlogère, Bonfol des couvertures protectrices Charpentes en bois Babey Sàrl, Boncourt de nos maisons. Charpente et couverture Maillard Philippe, Asuel Tuiles mécaniques de Bonfol. Un toit de Bonfol. Entreprise de construction Marcel Pheulpin, Bonfol Ouvert de mars à octobre La tuile est un élément architectural pesant et Outre l’argile, le tuilier n’a besoin que d’eau, Bienvenue au Musée de la poterie de Bonfol les 1er et 3e dimanches du mois résistant au temps et aux intempéries, mais de grands lieux de séchage et de stockage, de Autoroute A16 direction Porrentruy, sortie Courge- de 14 h 00 à 17 h 00 pas aux chocs. -

Etat Civil : Arrondissement De Bonfol
Etat civil : arrondissement de Bonfol Autor(en): [s.n.] Objekttyp: Article Zeitschrift: Le pays du dimanche Band (Jahr): 3 (1900) Heft 131 PDF erstellt am: 30.09.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-249935 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch travers les vovageuses qui croyant à l'approche qui portent des yeux humains doivent les avoir Décès. d'un se* ramassent de suite el ne tardent arrachés eux-mêmes. orage Janvier. Du 8 à Bonfol, Bourgnon à se généralement près de lerre jù pas poser Joséphine de Bonfol, épouse de Pierre Bourgnon de les Si l'essaim recueilli * * il est facile capturer. -

Swiss Travel System Map 2021
ai160326587010_STS-GB-Pass-S-21.pdf 1 21.10.20 09:37 Kruth Strasbourg | Paris Karlsruhe | Frankfurt | Dortmund | Hamburg | Berlin Stuttgart Ulm | München München Swiss Travel System 2021 Stockach Swiss Travel Pass Blumberg-Zollhaus Engen Swiss Travel Pass Youth | Swiss Travel Pass Flex Bargen Opfertshofen Überlingen Area of validity Seebrugg Beggingen Singen Ravensburg DEUTSCHLAND Radolfzell Schleitheim Hemmental Lines for unlimited travel (tunnel) Mulhouse Thayngen Mainau Geltungsbereich Meersburg Schaffhausen Ramsen Linien für unbegrenzte Fahrten (Tunnel) Zell (Wiesental) Wangen (Allgäu) Erzingen Oster- Neuhausen Stein a.R. Konstanz fingen Version/Stand/Etat/Stato:12.2020 (Baden) Rheinau Kreuzlingen Friedrichshafen Waldshut Due to lack of space not all lines are indicated. Subject to change. Marthalen Basel Weil a.R. Aus Platzgründen sind nicht alle Linien angegeben. Änderungen vorbehalten. Bad Zurzach Weinfelden Lines with reductions (50%, 1 25%) No reductions EuroAirport Riehen Koblenz Eglisau Frauenfeld Romanshorn Lindau Basel St.Johann Basel Möhlin Laufenburg Immenstadt Linien mit Vergünstigungen (50%, 1 25%) Keine Ermässigung Bad Bf Nieder- Stein-Säckingen Bülach Sulgen Arbon Basel Rheinfelden weningen Braunau Sonthofen Delle Pratteln Turgi Rorschach Bregenz Boncourt Ettingen Frick Brugg Zürich Bischofszell Rheineck Bonfol Liestal Baden Flughafen Winterthur Wil Rodersdorf Dornach Oberglatt Heiden St.Margrethen Aesch Gelterkinden Kloten Turbenthal St.Gallen Walzenhausen Roggenburg Wettingen Also valid for local public transport -

Numéro 90 Mars 2019 C Omité De Rédaction CP 71 2882
Numéro 90 Mars 2019 C omité de rédaction CP 71 2882 Dans ce numéro Le coup d’Pitch... 2 Marché de Noël 3 Sculpteurs situation de handicap. d'évoluer au mieux dans leur L'hôtel - restaurant de la Demi travail. Nous commencerons Pub 4 - Lune avait exactement tous avec une petite équipe Des nouvelles du front 5 ces critères. d'employés différents qui Première étape : obtenir les augmentera au fil du temps. Médaille - Anniversaire 6 fonds nécessaires à l'achat Et dernière étape, la cerise du bâtiment. Ce fut chose sur le gâteau : la Ursinia 7 faite en mai 2018 grâce au réouverture complète de soutien de la population, de l'Hôtel - Restaurant la Demi - Cuire un œuf 8 communes, des autorités Lune à Saint - Ursanne, début La pêche 9 jurassiennes, de plusieurs avril. fondations, et grâce au Nous avons voulu que le Le secret des œufs 10 travail inlassable du comité restaurant soit proche de la L'Association Décrochez la et des membres de population régionale et Carême 11 Lune a mis en place son l'association. accueille également le premier projet : un hôtel - tourisme. Nous vous Sudoku du Klodüdu 12 restaurant employant des Nous tenons à remercier proposerons donc à la carte Patin couffin personnes en situation de toutes les personnes qui des produits de la région : Mots croisés 13 handicap coachées de nous ont aidés pour cette Filet de truites, fromages de Joies et peines manière spécifique par du première étape. Saint - Ursanne, saucisse du personnel de la restauration Produits locaux 14 Jura, hamburger de la Demi - formé et supervisé pour le Deuxième étape : rénover le Lune, tartare maison, Produits locaux 15 monde du handicap. -

Etat Civil : Arrondissement De Bonfol
Etat civil : arrondissement de Bonfol Autor(en): [s.n.] Objekttyp: Article Zeitschrift: Le pays du dimanche Band (Jahr): 3 (1900) Heft 131 PDF erstellt am: 28.09.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-249935 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch travers les vovageuses qui croyant à l'approche qui portent des yeux humains doivent les avoir Décès. d'un se* ramassent de suite el ne tardent arrachés eux-mêmes. orage Janvier. Du 8 à Bonfol, Bourgnon à se généralement près de lerre jù pas poser Joséphine de Bonfol, épouse de Pierre Bourgnon de les Si l'essaim recueilli * * il est facile capturer. -

Effectifs Et Équipements Des SIS Au 01.01.2020 1 VT 3 VTH Lugnez 6
3. Basse-Allaine 68 SP 4. Vendline REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA 1 TP 41 SP 1 TP 2 VPI Boncourt Beurnevésin Effectifs et équipements des SIS au 01.01.2020 1 VT 3 VTH Lugnez 6. Mont-Terri 65 SP 1 VTH 1 EPA Montignez Bonfol 4 MP2 1 TP 1 ER Buix 3 MP2 12 ARAC Damphreux 1 VPI 7. Baroche CR Porrentruy 14 ARAC 21 POLY 4 1 VT 38 SP 14. Haut-Plateau 35 SP 12 POLY 3 1 ER 1 VT 67 SP 2 TP Courtemaîche 3 VPI 1 EPA Coeuve Vendlincourt 2 MP2 3 MP2 2. Haute-Ajoie Centre 1 VT 10 ARAC 6 ARAC 1 PI 46 SP 7 MP2 1 SR Courchavon 4 POLY 1 VPI Bure 12 ARAC 1 VC 2 VT Alle Miécourt 13 POLY 3 VTH 1 ER Charmoille Fahy 2 1 VB 2 MP2 Porrentruy Pleigne Ederswiler 1 VDCH 8 ARAC Courtedoux Pleujouse 1 ER 3 POLY Fregiécourt Movelier 2 MP2 1 MP4 6 Cornol Mettembert Soyhières 1. Haute-Ajoie Grandfontaine Courgenay 7 14 16+17bi ARAC Chevenez Fontenais 33 POLY 53 SP Rocourt Asuel Bourrignon 1 VPI Bressaucourt 2 MP2 1 5 Montmelon 6 ARAC Réclère Delémont Courroux Damvant Roche-d'Or Seleute Develier 4 POLY St-Ursanne Boécourt Montmelon Montsevelier Ocourt Montmelon 16 5. Calabri Vicques Corban Seleute Montenol 8. Clos-du-Doubs 34 SP 8 St-Ursanne Rossemaison Courchapoix 52 SP 1 VPI Mervelier Epauvillers St-Ursanne Bassecourt Courrendlin 17 1 TP 2 MP2 Courtételle 1 VPI 10 ARAC Epiquerez Glovelier Courfaivre 1 VT 1 VTH Châtillon 13 15 Rebeuvelier Vermes 1 ER 3 POLY Vellerat 3 MP2 Soubey Saint-Brais 15. -

Note Préliminaire Sur Les Groupements Végétaux Du Clos Du Doubs (Jura Suisse) Et Leur Écologie
Note préliminaire sur les groupements végétaux du Clos du Doubs (Jura suisse) et leur écologie Autor(en): Richard, Jean-Louis Objekttyp: Article Zeitschrift: Actes de la Société jurassienne d'émulation Band (Jahr): 73 (1970) PDF erstellt am: 04.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-549896 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Note préliminaire sur les groupements végétaux du Clos du Doubs (Jura suisse) et leur écologie pzzr j^zm-Lozzz's R/c/wd 1. SITUATION La région du Clos du Doubs est située dans le Jura septen- trional, au sud de Porrentruy. -

CFC D'employé-E De Commerce
MODELE Liste des diplômé-e-s - Employé-e-s de commerce DIVCOM - FOR - MOD 2.64 GAW Mise à jour : 27.06.2017 EXAMENS DE FIN D'APPRENTISSAGE 2017 Employé-e-s de commerce Liste des diplômé-e-s N° Profil Nom Prénom Domicile Entreprise formatrice 101 E Adelfio Deborah Delémont Banque Raiffeisen Région Delémont, Delémont 102 E Bedzeti Dashmire Bassecourt Office des véhicules, Delémont 103 E Belharfi Tania Delémont Service de l’enseignement, Delémont Login formation professionnelle SA, 104 E Biétry Kevin Courchapoix Delémont, Porrentruy et Lausanne 105 E Bron Tatiana Vicques BKW Energie SA, Delémont 106 E Carpinteiro Caroline Alle Willemin-Macodel SA, Delémont 107 E Cerf Anne Saulcy Administration communale, Cornol 108 E Chenal Alexandre Bassecourt CSS Assurance, Delémont 109 E de Blaireville Tifany Miécourt Bluesped Logistics Sàrl, Boncourt 110 E Fracasso Melina Courrendlin Service social régional du district de Delémont, Delémont 111 E Frey Marie-Emilie Chevenez Ateliers Busch SA, Chevenez 112 E Froidevaux Dana Courgenay Administration communale, Courgenay 113 E Gigon Madyson Boncourt Banque Cantonale du Jura SA, Porrentruy Municipalité, Service de l'urbanisme, 114 E Girard Manon Le Noirmont de l'environnement et des travaux publics, Delémont 115 E Henz Charlotte Courfaivre Fiduciaire Henz & Schaffner Sàrl, Courfaivre 116 E Houlmann Ophélie St-Ursanne Office de l’environnement, St-Ursanne 117 E Hulaj Edmond Fontenais Tribunal cantonal, Porrentruy 118 E Hulmann Julie Bassecourt Service de l’informatique, Delémont 119 E Känzig Gianni Courrendlin Banque Raiffeisen Région Delémont, Delémont 120 E Mamie Penafiel Salomé Porrentruy Hôpital du Jura, Porrentruy 121 E Marti Mathias Fontenais O.R.C. -

Journal Officiel No 04 Du 01.02.2012
La présente édition JOURNAL ne contient pas les publications contenant des données personnelles protégées. Dès lors, seule la version officielle OFFICIEL sur papier fait foi. JAA 2900 Porrentruy – 34e année – N° 4 – Mercredi 1er février 2012 Le « Journal officiel de la République et Canton du Jura » paraît chaque semaine, Tarif des insertions : Fr. 1.55 le mm, sur deux colonnes à la page (une colonne : le mercredi. Terme de la remise des publications : le lundi à 12 heures. Ce délai 85 mm de large). Une publication ne peut être retirée que par une personne peut être avancé si la date de parution est jour férié. Abonnement : 70 francs compétente ; si la composition est terminée, elle est facturée. Les ordres de par an. Vente au numéro : Fr. 1.80. Editeur : Centre d’impression Le Pays S A, retrait ne peuvent être donnés que jusqu’au mardi, à 8 h 30. Adresse postale pour Porrentruy, tél. 032 465 89 39, fax 032 466 51 04. Compte de chèques postaux l’envoi des publications : « Journal officiel de la République et Canton du Jura », 25-3568-2. case postale 1350, 2900 Porrentruy 1. Courriel : [email protected] de vérifier si les exigences sanitaires en vue de la produc- Publications tion laitière sont remplies et si les règles applicables aux des autorités administratives cantonales médicaments sont respectées. Article 6 Pour remplir sa tâche, le vétérinaire cantonal peut déléguer les inspections à des services accrédités. République et Canton du Jura SECTION 3 : Mesures administratives Ordonnance Article 7 1L’autorité d’exécution cantonale -

Le Réseau Postal 2020 Dans Le Canton De Jura État 1Er Juin 2020
Le réseau postal 2020 État: dans le canton de Jura 1er juin 2020 Canton Formats à valeur réglementaire Points service Total JU Filiales tradition- Services à Points Points de Automates Points nelles et filiales domicile clientèle dépôt / points My Post 24 d’accès en partenariat commerciale de retrait Aujourd’hui 38 52 1 2 1 94 NPA Désignation Commune Point d’accès 2942 Alle Alle Filiale 2925 Buix Basse-Allaine Service à domicile 2923 Courtemaîche Basse-Allaine Filiale en partenariat 2924 Montignez Basse-Allaine Service à domicile 2935 Beurnevésin Beurnevésin Service à domicile 2856 Boécourt Boécourt Filiale en partenariat 2857 Montavon Boécourt Service à domicile 2926 Boncourt Boncourt Filiale 2944 Bonfol Bonfol Filiale en partenariat 2803 Bourrignon Bourrignon Service à domicile 2915 Bure Bure Filiale en partenariat 2843 Châtillon JU Châtillon (JU) Service à domicile 2885 Epauvillers Clos du Doubs Service à domicile 2886 Epiquerez Clos du Doubs Service à domicile 2884 Montenol Clos du Doubs Service à domicile 2883 Montmelon Clos du Doubs Service à domicile 2889 Ocourt Clos du Doubs Service à domicile 2888 Seleute Clos du Doubs Service à domicile 2882 St-Ursanne Clos du Doubs Filiale 2932 Coeuve Coeuve Filiale en partenariat 2952 Cornol Cornol Filiale à examiner 2825 Courchapoix Courchapoix Service à domicile 2922 Courchavon Courchavon Service à domicile 2950 Courgenay Courgenay Filiale 2830 Courrendlin Courrendlin Filiale 2832 Rebeuvelier Courrendlin Service à domicile Le réseau postal 2020 dans le canton de Jura NPA Désignation Commune -

Green Finance Approaches to Soil Remediation: International Examples
Financing Models for Soil Remediation Green Finance Approaches to Soil Remediation International examples Green Finance Approaches To Soil Remediation: International examples © 2018 Norwegian Institute for Water Research (NIVA) Published by the International Institute for Sustainable Development and the Norwegian Institute for Water Research. INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT The International Institute for Sustainable Development (IISD) is an IISD Head Office independent think tank championing sustainable solutions to 21st–century 111 Lombard Avenue problems. Our mission is to promote human development and environmental Suite 325 sustainability. We do this through research, analysis and knowledge products Winnipeg, Manitoba that support sound policymaking. Our big-picture view allows us to address the Canada R3B 0T4 root causes of some of the greatest challenges facing our planet today: ecological destruction, social exclusion, unfair laws and economic rules, a changing climate. IISD’s staff of over 120 people, plus over 50 associates and 100 consultants, Tel: +1 (204) 958-7700 come from across the globe and from many disciplines. Our work affects lives in Website: www.iisd.org nearly 100 countries. Part scientist, part strategist—IISD delivers the knowledge Twitter: @IISD_news to act. IISD is registered as a charitable organization in Canada and has 501(c)(3) status in the United States. IISD receives core operating support from the Province of Manitoba and project funding from numerous governments inside and outside Canada, United Nations agencies, foundations, the private sector and individuals. NIVA Head Office Gaustadalléen 21 NORWEGIAN INSTITUTE FOR WATER RESEARCH 0349 Oslo The Norwegian Institute for Water Research (NIVA) is Norway’s leading Norway institute for basic and applied research on marine and freshwaters.