DEPARTEMENT DES EAUX ET FORETS Président
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Liste Candidatures Conseillers Alaotra Mangoro
NOMBRE DISTRICT COMMUNE ENTITE NOM ET PRENOM(S) CANDIDATS CANDIDATS AMBATONDRAZAKA AMBANDRIKA 1 RTM (Refondation Totale De Madagascar) RAKOTOZAFY Jean Marie Réné AMBATONDRAZAKA AMBANDRIKA 1 MMM (Malagasy Miara-Miainga) ARIMAHANDRIZOA Raherinantenaina INDEPENDANT RANAIVOARISON HERINJIVA AMBATONDRAZAKA AMBANDRIKA 1 RANAIVOARISON Herinjiva (Ranaivoarison Herinjiva) AMBATONDRAZAKA AMBANDRIKA 1 IRD (Isika Rehetra Miaraka @ Andry Rajoelina) RANDRIARISON Célestin AMBATONDRAZAKA AMBATONDRAZAKA 1 TIM (Tiako I Madagasikara) RANDRIAMANARINA - INDEPENDANT RAZAKAMAMONJY HAJASOA AMBATONDRAZAKA AMBATONDRAZAKA 1 RAZAKAMAMONJY Hajasoa Mazarin MAZARIN (Razakamamonjy Hajasoa Mazarin) INDEPENDANT RAHARIJAONA ROJO AMBATONDRAZAKA AMBATONDRAZAKA 1 RAHARIJAONA Rojo (Raharijaona Rojo) AMBATONDRAZAKA AMBATONDRAZAKA 1 IRD (Isika Rehetra Miaraka @ Andry Rajoelina) RATIANARIVO Jean Cyprien Roger AMBATONDRAZAKA AMBATONDRAZAKA 1 IRD (Isika Rehetra Miaraka @ Andry Rajoelina) RABEVASON Hajatiana Thierry Germain SUBURBAINE AMBATONDRAZAKA INDEPENDANT RANDRIANASOLO ROLLAND AMBATONDRAZAKA 1 RANDRIANASOLO Rolland SUBURBAINE (Randrianasolo Rolland) AMBATONDRAZAKA AMBATONDRAZAKA 1 MMM (Malagasy Miara-Miainga) RAKOTONDRASOA Emile SUBURBAINE AMBATONDRAZAKA AMBATONDRAZAKA 1 TIM (Tiako I Madagasikara) RANJAKASOA Albert SUBURBAINE INDEPENDANT RANDRIAMAHAZO FIDISOA AMBATONDRAZAKA AMBATOSORATRA 1 HERINIAINA (Randriamahazo Fidisoa RANDRIAMAHAZO Fidisoa Heriniaina Heriniaina) AMBATONDRAZAKA AMBATOSORATRA 1 IRD (Isika Rehetra Miaraka @ Andry Rajoelina) RANDRIANANTOANDRO Gérard AMBATONDRAZAKA -

Hazavanahazavana Herin’Aratra Vokarina Amin’Ny Zava-Maniry Fandrehitra Electrification Rurale Décentralisée Par Combustion De Biomasse
Pierre Montagne, Mamisoa Rakotoarimanana, François Pinta et Serge Razafimahatratra Coordinateurs scientifiques HAZAVANAHAZAVANA Herin’Aratra Vokarina Amin’ny Zava-Maniry Fandrehitra Electrification Rurale Décentralisée par Combustion de Biomasse IRONNEME NV N E T L’ E T E D D E S E R F O E T R S E I T N I S M HAZAVANA Herin’Aratra Vokarina Amin’ny Zava-Maniry Fandrehitra Electrification Rurale Décentralisée par Combustion de Biomasse Expérience des projets Gesforcom et Bioenergelec à Madagascar, de 2008 à 2015 BIOENERGELEC Biomasse énergie pour la réduction de la pauvreté par l’électrification rurale décentralisée à Madagascar Pierre Montagne, Mamisoa Rakotoarimanana, François Pinta et Serge Razafimahatratra Coordinateurs scientifiques © Homme et Environnement ISBN : 978-2-9555221-0-3 L’Homme et l’Environnement Lot II M 90 Antsakaviro, Tél. +261 22 674 90 e-mail : [email protected] http ://www.madagascar-environnement.com www.bioenergelec.org Le contenu de cette publication n’engage que la responsabilité de ses auteurs et ne représente pas nécessairement l’opinion de l’Union Européenne. L’Union Européenne n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y figurent. Pierre Montagne, Mamisoa Rakotoarimanana, François Pinta et Serge Razafimahatratra Coordinateurs scientifiques HAZAVANA Herin’Aratra Vokarina Amin’ny Zava-Maniry Fandrehitra Electrification Rurale Décentralisée par Combustion de Biomasse Expérience des projets Gesforcom et Bioenergelec à Madagascar, de 2008 à 2015 Ouvrage de synthèse édité à partir -

Répartition De La Caisse-École 2020 Des Collèges D'enseignement
Repartition de la caisse-école 2020 des Collèges d'Enseignement Général DREN ALAOTRA-MANGORO CISCO AMBATONDRAZAKA Prestataire OTIV ALMA Commune Code Etablissement Montant AMBANDRIKA 503010005 CEG AMBANDRIKA 1 598 669 AMBATONDRAZAKA 503020018 C.E.G. ANOSINDRAFILO 1 427 133 AMBATONDRAZAKA 503020016 CEG RAZAKA 3 779 515 AMBATONDRAZAKA SUBURBAINE 503030002 C.E.G. ANDINGADINGANA 1 142 422 AMBATOSORATRA 503040001 CEG AMBATOSORATRA 1 372 802 AMBOHIBOROMANGA 503070012 CEG ANNEXE AMBOHIBOROMANGA 878 417 AMBOHIBOROMANGA 503150018 CEG ANNEXE MARIANINA 775 871 AMBOHIBOROMANGA 503150016 CEGFERAMANGA SUD 710 931 AMBOHIDAVA 503040017 CEG AMBOHIDAVA 1 203 171 AMBOHITSILAOZANA 503050001 CEG AMBOHITSILAOZANA 1 671 044 AMBOHITSILAOZANA CEG TANAMBAO JIAPASIKA 622 687 AMPARIHINTSOKATRA 503060013 CEG AMPARIHINTSOKATRA 1 080 499 AMPITATSIMO 503070001 CEG AMPITATSIMO 1 530 936 AMPITATSIMO 503070015 CEG ANNEXE AMBOHITANIBE 860 667 ANDILANATOBY 503080025 CEG ANDRANOKOBAKA 760 039 ANDILANATOBY 503080001 CEG ANDILANATOBY 1 196 620 ANDILANATOBY 503080026 CEG ANNEXE SAHANIDINGANA 709 718 ANDILANATOBY 503080027 CEG COMMUNAUTAIRE AMBODINONOKA 817 973 ANDILANATOBY 503080031 CEG COMMUNAUTAIRE MANGATANY 723 676 ANDILANATOBY 503080036 CEG COMMUNAUTAIRE RANOFOTSY 668 769 ANDROMBA 503090005 CEG ANDROMBA 1 008 043 ANTANANDAVA 503100020 CEG ANTANANDAVA 1 056 579 ANTSANGASANGA 503110004 CEG ANTSANGASANGA 757 763 BEJOFO 503120016 C.E.G. -
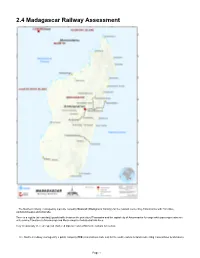
2.4 Madagascar Railway Assessment
2.4 Madagascar Railway Assessment - The Northern railway, managed by a private company Madarail (Madagascar Railway) for the network connecting Antananarivo with Tamatave, Ambatondrazaka and Antsirabe. There is a regular (at least daily) goods traffic between the port city of Toamasina and the capital city of Antananarivo for cargo while passenger trains are only serving Tamatave to Moramanga and Moramanga to Ambatrodrazaka lines. Very occasionally there are special chartered trips on restored Micheline railcars for tourists. - The Southern railway, managed by a public company FCE (Fianarantsoa Cote Est) for the south eastern network connecting Fianarantsoa to Manakara. Page 1 The southern line has regular passenger and cargo trains, which provides a slow but picturesque alternative to the recently rehabilitated road in the region. For more information on railway company contact details, please see the following link: Madagascar Railway Assessment Railway Companies and Consortia 4.2.7 Madagascar Railway Company Contact List Northern railway*: *During our study, Madarail was in the midst of restructuring, therefore, they did not want to share information, statistics or even contacts. All the information gathered and shared in this document comes exclusively from third parties or from data found on the internet. Madarail, was founded on October 10, 2002 following the decision of the Malagasy State to privatize the Malagasy National Railway Network1 (RNCFM). A concession agreement for the management of the North network is then established between the new private operator and the State. Madarail began operating the Northern railway network in Madagascar on 1 July 2003. In 2008, the Belgian operator Vecturis, already active in eight other African countries, became the majority shareholder of the company and the new railway operator. -

Résultats Détaillés Toamasina
RESULTATS SENATORIALES DU 29/12/2015 FARITANY: 5 TOAMASINA BV reçus: 249 sur 249 MAPAR FAHAIZ MIFANA MTS FIRAISA AREMA HVM TIM ANA SY SOA N-KINA FAHEN NO N°BV Emplacement AP AT Inscrits Votants B N S E DRENA HERY NO REGION 51 ALAOTRA-MANGORO BV reçus 87 sur 87 DISTRICT: 5101 AMBATONDRAZAKA BV reçus22 sur 22 01 AMBANDRIKA 0 0 6 6 0 6 0 0 5 0 0 0 1 0 02 AMBATONDRAZAKA 0 0 14 12 0 12 0 0 5 0 0 0 4 3 03 AMBATONDRAZAKA S 0 0 8 8 0 8 0 0 6 0 0 0 2 0 04 AMBATOSORATRA 0 0 8 5 0 5 0 0 1 0 0 0 4 0 05 AMBOHIBOROMANGA 0 0 6 6 0 6 0 0 1 0 0 0 2 3 06 AMBOHIDAVA 0 0 8 8 0 8 0 0 3 0 0 0 5 0 07 AMBOHITSILAOZANA 0 0 8 8 0 8 0 0 3 0 0 0 5 0 08 AMPARIHINTSOKATRA 0 0 8 7 1 6 0 0 1 0 0 0 5 0 09 AMPITATSIMO 0 0 8 8 0 8 0 0 3 0 0 0 5 0 10 ANDILANATOBY 0 0 8 8 0 8 0 0 5 0 0 0 3 0 11 ANDROMBA 0 0 6 4 0 4 0 0 3 0 0 0 1 0 12 ANTANANDAVA 0 0 8 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 13 ANTSANGASANGA 0 0 8 8 0 8 0 0 3 0 0 0 5 0 14 BEJOFO 0 0 8 8 0 8 0 0 4 0 0 0 3 1 15 DIDY 0 0 8 7 0 7 0 0 5 0 0 0 2 0 16 FERAMANGA NORD 0 0 8 8 0 8 0 0 3 0 0 0 5 0 17 ILAFY 0 0 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 18 IMERIMANDROSO 0 0 8 8 0 8 0 0 3 0 0 0 5 0 19 MANAKAMBAHINY ES 0 0 8 8 0 8 0 0 2 0 0 0 6 0 20 MANAKAMBAHINY OU 0 0 8 7 0 7 1 0 2 0 0 0 4 0 21 SOALAZAINA 0 0 8 7 0 7 0 0 5 0 0 0 2 0 22 TANAMBAO BESAKAY 0 0 8 8 0 8 0 0 2 0 0 0 4 2 TOTAL DISTRICT 0 0 176 164 1 163 1 0 65 0 0 0 88 9 DISTRICT: 5102 AMPARAFARAVOLA BV reçus22 sur 22 01 AMBATOMAINTY 0 0 8 8 0 8 1 0 2 0 0 0 5 0 02 AMBOAVORY 0 0 8 8 0 8 1 0 2 0 0 0 1 4 03 AMBODIMANGA 0 0 6 6 0 6 0 0 2 0 0 0 3 1 04 AMBODIRANO 0 0 6 6 0 6 0 0 1 0 0 0 4 1 Page 1 sur -

This Is a Print Edition, Issued in 1998. to Ensure That You Are Reviewing Current Information, See the Online Version, Updated in the SOAS Archives Catalogue
This is a print edition, issued in 1998. To ensure that you are reviewing current information, see the online version, updated in the SOAS Archives Catalogue. http://archives.soas.ac.uk/CalmView/ Record.aspx?src=CalmView.Catalog&id=PP+MS+63 PAPERS OF J. T. HARDYMAN PP MS 63 July 1998 J. T. HARDYMAN PP MS 63 Introduction James Trenchard Hardyman was born in Madagascar in 1918, son of missionaries A. V. Hardyman and Laura Hardyman (nee Stubbs). The Hardymans married in 1916 and worked in Madagascar for the London Missionary Society from that year until 1938 and from 1944 to 1950. As a child J. T. Hardyman was sent to England to be educated under the guardianship of the Rev. and Mrs J. H. Haile. Hardyman became a missionary with the London Missionary Society in 1945, in the same year that he married Marjorie Tucker. From 1946 until 1974 the Hardymans lived in Madagascar at Imerimandroso. As well as his missionary work within the Antsihanaka area, Hardyman became the Principal of the Imerimandroso College training Malagasy pastors. Following his return to England, Hardyman worked as Honorary Archivist of the CWM at Livingstone House (1974-91) and for the CBMS (1976-1988). In this capacity he oversaw the deposit of both archives at SOAS. From 1974-83 he also worked for the Overseas Book Service of Feed the Minds. J. T. Hardyman died on 1 October 1995. At the age of eleven, Hardyman was given by Haile a second-hand copy of a book on Madagascar published anonymously by 'a resident' in the 1840s, and this began his collection of published and unpublished material relating to Madagascar; a collection which was to become possibly the most comprehensive private collection in the world. -

Mémoire De Fin D'études De Miarintsoa RAKOTONDRABE, Promotion HINA
UNIVERSITE D’ANTANANARIVO ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES AGRONOMIQUE DEPARTEMENT DES EAUX ET FORETS Mémoire de fin d’études pour l’obtention du diplôme d’Ingé nieur en Sciences Agronomiques Option ESSA-Forêts Promotion : HINA Année : 2009- 2014 ETUDE DES POTENTIALITES DE TAILLIS D’EUCALYPTUS D’ANKARIERA EN VUE DE L’APPROVISIONNEMENT EN BOIS DE LA CENTRALE THERMO ELECTRIQUE DANS LA COMMUNE RURALE D’ANDAINGO, DISTRICT MORAMANGA, REGION ALAOTRA MANGORO Présenté par : RAKOTONDRABE Miarintsoa Soutenu le 05 Juin 2014 Devant le jury composé de : • Président : Professeur RAMAMONJISOA Bruno Salomon • Rapporteur : Docteur RABEMANANJARA Zo Hasina • Co-rapporteur : Docteur Daniel VERHAEGEN • Examinateurs : Docteur RANDRIANJAFY Honoré Docteur RABEFARIHY Tahiry REMERCIEMENTS Je remercie Dieu Tout Puissant pour sa bénédiction et son grand amour qui m’a permis de réaliser ce mémoire. A Lui seul revient la gloire. Au terme de ce travail, je tiens à remercier aux membres du jury • Monsieur RAMAMONJISOA Bruno Salomon, Professeur d’enseignement supérieur et de recherche à l’Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques, Chef de Département des « Eaux et Forêts » à l’Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques, pour m’avoir fait l’honneur de présider cette soutenance; • Monsieur RABEMANANJARA Zo Hasina, Docteur et enseignant-Chercheur au sein du Département des « Eaux et Forêts », pour ses précieux aides et conseils ainsi que tout le temps qu’il m’a consacré durant toutes les étapes du travail; • Monsieur Daniel VERHAEGEN, Représentant du CIRAD, Docteur et chercheur CIRAD, pour son appui et sa disponibilité durant les diverses phases de réalisation de ce mémoire; • Monsieur RANDRIANJAFY Honoré, Encadreur technique, Docteur et chercheur au sein de DRFP/ FOFIFA, qui a consacré beaucoup de temps dans l’orientation de l’investigation sur terrain; • Monsieur RABEFARIHY Tahiry, Docteur et assistant au sein du Département des « Eaux et Forêts » qui a accepté de siéger parmi les membres de jury. -

Programme De Coopération Décentralisée Entre Le Finistère Et La
Grande Comore COMORES Iles Glorieuses Cap d'Ambre Moroni (France) (Tanjona Bobaomby) Anjouan Antsiranana (Diégo-Suarez) Mohéli Ambohitra Ambolobozokely Grande Comore 1475 COMORES Iles Glorieuses Cap d'Ambre Moroni (France) (Tanjona Bobaomby) Anjouan Antsiranana (Diégo-Suarez) Mohéli Ambohitra Ambolobozokely Bobasakoa 1475 Anivorano Avaratra Bobasakoa Anivorano Avaratra Ile Mitsio ANTSIRANANA Antsohimbondrona Mayotte (France) Daraina Nosy Be Ambilobe Betsiaka M a Andoany (Hell-Ville) h Aharana a v a (Vohemar) v Ile Mitsio y Fanambana Ambanja Antsaba 1785 du assif Marovato M Antsirabe Avaratra emarivo Maromokotro 2876 B Maromandia Amboahangibe Sambava 2262 ANTSIRANANA 2133 e Ile Lava Bealanana Marojezy M Analalava aev o u aran Andapa Antsambalahy q Antsahabe Antsohihy Matsoandakana Antsohimbondrona i 1438 Antalaha Baie de Maromandia b la Mahajamba Antsakabary Befandriana Ambohitralanana Mahajanga Mariarano Boriziny Avaratra Maroantsetra Cap Est m B (Port-Bergé) Sofia a (Tanjona i e 1105 d Angonsty) (Majunga) Rantabe ' Daraina A a Mayotte (France) n Tsinjomitondraka t Katsepy a o n Vinanivao n Marovato Mandritsara g i Ambilobe z i l Cap Masoala M Mitsinjo Mampikony an Cap St-André Soalala o B an Manambololosy (Tanjona Masoala) Betsiaka e ara m o (Tanjona Vilanandro) Marovoay B a Marotandrano Nosy Be Lac Kinkony riv Mananara Avaratra o g o Tsaramandroso Ile Chesterfield Ankasakasa n Ambinda o Madirovalo Sandrakatsy b Atanambre M M Ambato Boeny m Miarinarivo A Bekapaika 1301 Andranomavo Ambodiatafana Besalampy Sitampiky MAHAJANGA M Tsararanana -

Au Lac Alaotra »
UNIVERSITE D’ANTANANARIVO Domaine Arts, Lettres et Sciences Humaines Mention Géographie Parcours 3 : Géographie et Economie Mémoire de Master 2 en Géographie « LA RIZICULTURE ET LE DEVELOPPEMENT RURAL DU PERIMETRE DE CULTURE 23 SUD (PC 23 SUD) AU LAC ALAOTRA » Présenté par RANDRIANIFERANA Tsihoarana Herivony Directeur de mémoire : Madame RAKOTOARISOA Jacqueline, Maître de conférences Mention Géographie, Université d’Antananarivo Année Universitaire 2015 – 2016 UNIVERSITE D’ANTANANARIVO Domaine Arts, Lettres et Sciences Humaines Mention Géographie Parcours 3 : Géographie et Economie Mémoire de Master 2 en Géographie « LA RIZICULTURE ET LE DEVELOPPEMENT RURAL DU PERIMETRE DE CULTURE 23 SUD (PC 23 SUD) AU LAC ALAOTRA » Présenté par RANDRIANIFERANA Tsihoarana Herivony JURY Madame RANAIVOSON Joséphine, Professeur Président Monsieur RAZANAKOTO Pascal Clément, Maître de Conférences Juge Madame RAKOTOARISOA Jacqueline, Maître de Conférences Rapporteur Mention Géographie, Université d’Antananarivo Année Universitaire 2015 – 2016 REMERCIEMENTS Au terme de ce mémoire, j’aimerais remercier particulièrement Madame RAKOTOARISOA Jacqueline, Maître de Conférences, sans lui ce travail n’a pas pu aboutir. Elle a été pour moi autant une amie qu’un directeur de mémoire; elle s’est montrée patiente, généreuse et exceptionnellement compréhensive à mon égard durant la réalisation de ce mémoire. Elle m’a initié, dirigé et conseillé précieusement. Qu’elle trouve ici l’expression de ma profonde gratitude. Ensuite, je remercie sincèrement RASAMIMANANA Louis Michel qui m’a encadré dans l’élaboration de mon dossier de projet de recherche l’année dernière. Mes remerciements vont aussi à l’endroit au personnel du JICA et des Maires des Communes Rurales Morarano Chrome et Ambodirano qui m’ont amicalement accueilli. -

Partie III Plan D'exécution Du Projet
Partie III Plan d’exécution du Projet Document à distribution limitée Assistance spéciale pour la formation de projet (SAPROF) pour le Projet d’irrigation et de gestion des bassins versants dans le Sud-Ouest du lac Alaotra PARTIE III : PLAN D’EXÉCUTION DU PROJET CHAPITRE 1 ZONE DE PROJET 1.1 Zone de projet La zone de projet consiste en 2 zones : l’une concerne le périmètre irrigué (PI) du PC23 relevant du canal principal P1 d’une superficie de 4 540 ha excepté le PI financé par la coopération financière non-remboursable du Gouvernement du Japon, et l’autre faisant partie des bassins versants (BV) des cours d’eau Ampashimena, Asahamena, Behengitra et Sahamilahy s’étalant sur une étendue de 386 km2. 1.2 Conditions naturelles (1) Climatologie La zone de projet appartient aux zones subtropicales humides soumises à la mousson. La pluviométrie moyenne annuelle de la zone périphérique du PC23 est de 1 066 mm. La saison des pluies dure 4 mois, de décembre à mars, et 90% des précipitations annuelles se concentrent en ces mois. La température moyenne annuelle est de 21,4ºC avec la température minimale de 17,1 ºC en août et celle maximale de 23,6 ºC en janvier, L’évaporation moyenne annuelle est de 1 290 mm, alors qu’en amont du PC23, les précipitations varient de 1 000 mm à 1 600 mm. Cela souligne qu’il y a une relation corrélative entre la pluviométrie et l’altitude. La quantité de précipitations a tendance à devenir d’autant plus importante que la cote devient plus élevée. -

The Project on Master Plan Formulation for Economic Axis of Tatom (Antananarivo-Toamasina, Madagasikara)
Ministry of Regional Development, Building, Housing and Public Works (MAHTP) Government of the Republic of Madagascar The Project on Master Plan Formulation for Economic Axis of TaToM (Antananarivo-Toamasina, Madagasikara) Final Report Main Text: Volume 1 October 2019 Japan International Cooperation Agency (JICA) Oriental Consultants Global Co., Ltd. CTI Engineering International Co., Ltd. CTI Engineering Co., Ltd. EI JR 19-102 Ministry of Regional Development, Building, Housing and Public Works (MAHTP) Government of the Republic of Madagascar The Project on Master Plan Formulation for Economic Axis of TaToM (Antananarivo-Toamasina, Madagasikara) Final Report Main Text: Volume 1 October 2019 Japan International Cooperation Agency (JICA) Oriental Consultants Global Co., Ltd. CTI Engineering International Co., Ltd. CTI Engineering Co., Ltd. Currency Exchange Rates EUR 1.00 = JPY 127.145 EUR 1.00 = MGA 3,989.95 USD 1.00 = JPY 111.126 USD 1.00 = MGA 3,489.153 MGA 1.00 = JPY 0.0319 Average during the period between June 2018 and June 2019 The Project on Master Plan Formulation for Economic Axis of TaToM (Antananarivo-Toamasina, Madagasikara) Final Report The Project on Master Plan Formulation for Economic Axis of TaToM (Antananarivo-Toamasina, Madagasikara) Final Report Main Text: Volume 1 Table of Contents Page Table of Contents ........................................................................................................................................ i List of Figures ......................................................................................................................................... -

3 Madagascar's Rural Electrification Concessions
Public Disclosure Authorized Evaluation of Rural Electrification Concessions in Public Disclosure Authorized sub-Saharan Africa Detailed Case Study: Madagascar Public Disclosure Authorized Report to World Bank December 2015 Public Disclosure Authorized Copyright World Bank. All rights reserved. Report Prepared by Castalia Limited, a part of the worldwide Castalia Advisory Group. Table of Contents Executive Summary i 1 Introduction 1 2 Madagascar Background 2 2.1 Power Market Structure 3 2.2 Rural Electrification Approach 7 3 Madagascar’s Rural Electrification Concessions 10 3.1 Key Objectives, Challenges and Risks 11 3.2 Stages of Development 12 3.3 Operations and Management 12 3.4 Financing Arrangements 14 3.5 Contractual Arrangements 15 3.6 Technological Approach 16 3.7 Regulatory Arrangements 17 3.8 Extent of Risk Transfer 18 4 Assessment of Concession 20 4.1 Evaluating Success of Concession 20 4.1.1 Access 20 4.1.2 Quality of service 22 4.1.3 Sustainability 22 4.1.4 Efficiency 23 4.1.5 Other Impacts 24 4.2 Arrangements that Could Have Delivered Better Results 24 4.3 Reasons for Results 25 4.4 Replicability of Experience and Success 25 4.5 Lessons for Future Concessions 26 Appendices Appendix A : Small Concessionaire Case Study – BETC 27 Appendix B : Small Concessionaire Case Study – HIER 33 Appendix C : Small Concessionaire Case Study – CASIELEC 37 Appendix D : Location and Map of Rural Electrification Facilities, Madagascar (Source: ADER, December 2014) 42 Appendix E : Rural Electricity Private Operators Active by Year 44 Tables