Tramway T10 La Croix-De-Berny (Antony) - Place De Garde (Clamart)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Plaquette Du Curious
DES DÉFIS COMMUNAUX RELEVÉS PAR DES ÉTUDIANTS IOIIOIOIOIOI[ DES YVELINES ET DES HAUTS-DE-SEINE ] OIOIOIIOIIIO IIOIOIIOOIOI CURIOUSOOIIIOIIOIIO OIOIIIOIIOOILAB IOIOOIIIOIIO[ LABORATOIRE D’INNOVATION TERRITORIALE ] IOIIOIOIOIOI OIIIOOIOIIIO OIOIIIOIIOOIwww.78-92.fr Véritable laboratoire d’innovation territoriale, le Curious Lab’ est une démarche interdépartementale originale qui conforte le rôle des départements comme soutien aux communes. Le Curious Lab’ intègre les jeunes générations, qui apportent originalité et créativité dans la fabrique de l’action publique locale. En trois ans, Curious Lab’, a fait ainsi grandir ensemble les communes et les Départements, et s’est vu récemment récompenser par trois prix nationaux en 2019 et en 2020 : un prix Territoria, un prix de la Gazette des Communes et un prix d’Innov’Acteurs. Georges Siffredi Pierre Bédier Président du Département Président du Département des Hauts-de-Seine des Yvelines UNE DÉMARCHE [ MULTIPRIMÉE ] Le trophée d’Or 2020 dans la catégorie « co-innovation et créativité » dans le cadre des Trophées de l’innovation participative par Innov’Acteurs Le trophée Territoria d’Argent 2019 de l’innovation managériale dans le cadre du Prix Territoria Le prix de la Gazette des Communes 2020 dans le cadre des Prix Territoriaux par la Gazette des Communes et GMF LE [ CURIOUS LAB’ C’EST QUOI ? ] C’est un laboratoire d’idées innovantes et de réflexion collective visant à enri- chir l’action publique locale, et en particulier communale, par la contribution des futurs actifs et des générations futures, notamment les étudiants. Dans un contexte de changement institutionnel majeur, les collectivités s’engagent dans de nouvelles logiques de développement. L’une des solutions innovantes ap- portées par le département est de mettre en relation les communes avec des étu- diants du territoire porteurs d’idées originales et de créativité. -

La Ligne 15 Sud À Boulogne Billancourt
NOTRE NOUVEAU MÉTRO LA LIGNE 15 SUD À BOULOGNE! BILLANCOURT societedugrandparis.fr LE GRAND PARIS EXPRESS À BOULOGNE!BILLANCOURT 2 LIGNES, 1 GARE, 1 OUVRAGE DE SERVICE V E R S S A IN T !D E N LI IS G P N L E E 15 Y O E UE L ST BOULOGNE!BILLANCOURT PUITS SAINT!CLOUD ÎLE DE MONSIEUR GARE PONT DE SÈVRES LIGNE 15 SUD ISSY!LES!MOULINEAUX SÈVRES OUVRAGE TRAPÈZE GARE HAUTS!DE!SEINE OUVRAGE ISSY RER RÉSISTANCE MEUDON AU CŒUR DU GRAND PARIS EXPRESS Gare Ouvrage de service Puits de tunnelier Du long de ses 33 km, la ligne 15 Sud La gare Pont de Sèvres s’implante Construits le long du tracé tous les 800 m Chantiers indispensables à la construction traversera 22 communes et 4 départements sous le quai Georges Gorse, à la jonction maximum, ces ouvrages serviront d’accès du nouveau métro, ils accueillent les entre Pont de Sèvres et Noisy-Champs ; des communes de Boulogne-Billancourt de secours au tunnel. L’ouvrage Trapèze équipements essentiels au creusement elle desservira 16 gares en 37 minutes et de Sèvres. Un couloir souterrain s’implante à l’intérieur de la ZAC Île Seguin du tunnel et servent de points de départ et et sera mise en service en 2025. sous le Rond-Point du Pont de Sèvres Rives de Seine. Ce puits de 40 m de profondeur, d’arrivée aux différents tunneliers en sous-sol. Terminus provisoire de la ligne 15 Sud assurera la correspondance avec la ligne 9 servira également d’ouvrage de ventilation. -

Comme Chaque Année, Le Plessis-Robinson
N° 335 NOVEMBRE 2019 PAGE 2 ÉDITORIAL : JIDE Pas d’éditorial jusqu’en mars 2020 PAGE 2 11 NOVEMBRE : Cérémonie commémorative Aux PAGE 2 droits CONVENTION DU DISQUE : La fête du vinyle de l’enfant Comme chaque année, Le Plessis-Robinson, « ville amie des enfants », va consacrer une journée, samedi 23 PAGE 4 novembre, à la Maison des Arts, pour rappeler les droits de l’enfant, protégés depuis trente ans CONSEIL DES ENFANTS : par une convention internationale. Les enjeux et le programme de la manifestation à la Maison des Arts. Les heureux élus Une importante manifestation dont les enjeux sont à découvrir au fil du programme de la journée. Lire p. 3 PetitRob-335-1-13.indd 1 25/10/2019 16:42 2 ACTUALITÉ ACTUALITÉ ÉDITORIAL HOMMAGE Disparition de Jacques Chirac Minute de silence et drapeau en berne. e 26 septembre dernier, c’est avec une profonde tristesse que la France apprenait le décès de LJacques Chirac, l’ancien président de la Répu- blique, à l’âge de 86 ans. Député de la Corrèze à 34 La photo officielle du président élu en 1995. ans, secrétaire d’État dans la foulée sous la prési- dence du Général de Gaulle, Jacques Chirac, maire berne au Plessis-Robinson et un hommage silencieux de Paris pendant dix-huit ans, deux fois premier d’une minute a été organisé dans la cour d’honneur ministre, élu président en 1995 et réélu en 2002, a de l’Hôtel de Ville par la Municipalité comme dans marqué un demi-siècle d’histoire politique française, toute la France, le 30 septembre à 15h. -

Les Premiers Travaux À Saint-Cloud 2017 – 2019
NOUS PRÉPARONS LE CHANTIER DU MÉTRO LES PREMIERS TRAVAUX À SAINT-CLOUD 2017 – 2019 En savoir plus sur les travaux societedugrandparis.fr/saint-cloud LE RÉSEAU GRAND PARIS EXPRESS Calendrier de mises en service D’ici 2030, 200 km de métro Le Mesnil-Amelot 17 2019 automatique pour relier les territoires Aéroport 14 Mairie de Saint-Ouen H Charles-de-Gaulle T4 DE GONESSEBARREAU Saint-Lazare du Grand Paris. B Aéroport H Charles-de-Gaulle T2 RER C Avec la création de quatre nouvelles lignes de métro H RER D RER B CDG EXPRESS automatique et le prolongement de deux lignes du réseau A RER J Triangle de Gonesse 2022 L existant, le Grand Paris Express est le plus grand projet H J B Noisy T13 Parc des Expositions de transport collectif en Île-de-France depuis le RER. J 17 Champs T11 Aulnay Pont de Sèvres EXPRESS K Son réseau de 200 km et ses 68 gares contribueront Aulnay T11 Le Bourget Aéroport 15 RER A - E 16 Sevran Beaudottes à renforcer l’attractivité de la région, à favoriser l’égalité T11 13 J EXPRESS Le Blanc-Mesnil 2023-2024 au sein de la métropole et à créer, pour deux millions T11 17 CDG (T2) Bois-Colombes Les Grésillons La Courneuve Sevran – Livry A de voyageurs chaque jour, une nouvelle manière de vivre J - L Six-Routes 16 17 RER B RER A - E 13 Saint-Denis Saint-Denis Pleyel Colombes Pleyel Le Bourget RER T4 16 leur temps de transport, et, plus largement, leur territoire. EXPRESST13 Mairie Mairie de d’Aubervilliers Drancy – Bobigny Saint-Ouen 14 La Garenne-Colombes Les Agnettes Stade de Aux commandes de ce projet hors normes, la Société 12 Bobigny Pablo-Picasso T4 Olympiades Noisy Saint-Ouen Mairie France 7 15 Champs Nanterre La Folie Clichy – Montfermeil du Grand Paris est en charge de concevoir et de construire de Saint-Ouen Fort 5 Pont de Bondy T4 CEA RER A Bécon- Saint-Ouen RER C d’Aubervilliers T13 15 T11 T4 RER E Saint-Aubin 18 le nouveau métro. -

Gare Fort D'issy Vanves – Clamart Le Nouveau Métro
EN PASSANT GARE FORT D’ISSY PAR LA GARE Au-delà de ses fonctions de desserte du futur métro et VANVES – CLAMART de correspondance avec la ligne N du Transilien, la gare Fort d’Issy Vanves – Clamart se présente comme un nouvel espace de ville, avec sa rue intérieure de 110 m de long sur presque 7 m de large, jalonnée de commerces et services, dans la tradition des passages LE NOUVEAU MÉTRO urbains couverts. On l’empruntera autant pour rejoindre le métro ou le train que pour passer à pied, en quelques minutes, EN CŒUR DE VILLE d’un quartier à l’autre, d’une ville à l’autre. « L’espace intérieur de la gare Aéroport Le Mesnil-Amelot Charles- de-Gaulle articule l’espace urbain et Triangle VAL-D’OISE de Gonesse LIGNE 17 ISSY-LES-MOULINEAUX SEINE-ET-MARNE UNE GARE Saint-Denis N Pleyel le crée un lien entre les quartiers l u 16-17 a 15 Seine Nanterre E Le Bourget RER Clichy G N e IG La Folie L Montfermeil d GARE PONT DE SÈVRES l SEINE- L a I r G SOUS LA GARE Saint- N SAINT-DENIS L é Bobigny E I G n 15 Lazare N é P. Picasso VANVES LIGNE 14 E La Défense G aujourd’hui séparés par 1 6 u La gare du Grand Paris Express vient se glisser sous les voies LIGNE d 11 Marne . Rosny ette v alm a ur C Bois-Perrier sse ofe Pr ferrées SNCF. Elle se déploie en souterrain sur 4 niveaux u on PARIS Noisy d ol Pont v. -

Gender Equality
The information contained in this brochure is of a general nature. For specific information related to your personal situation, please contact your local CIDFF, which will provide you with information and assistance, and recommend qualified professionals. Information provided is confidential and free. There are 106 CIDFF (National Information Centres on the Rights of Women and Families) in France, as well as in some overseas departments and territories, with many local branches. You can find the address and contact details of a CIDFF near you on the website Gender equality www.infofemmes.com Dunkerque Boulogne- Roubaix-Tourcoing sur-Mer Béthune HAUTS-DE-SEINE : Lille Valenciennes Boulogne-Billancourt Clamart Arras Cambrai Access to rights for newly immigrated women Nanterre Neuilly-sur-Seine Amiens Charleville-Mézières Cherbourg Rouen Beauvais Laon Longwy Lisieux Cergy Verdun Forbach Évreux La Courneuve Metz Brest Paris Flers Poissy Lognes Châlons- Créteil en-Champagne Nancy Saint Brieuc Strasbourg Evry Lunéville Rennes Chartres Laval Troyes Le Mans Épinal Vannes Orléans Chaumont Mulhouse Saint Nazaire Blois Auxerre Vesoul Angers Tours Belfort Quétigny Nantes Bourges Besançon Nevers La Roche-sur-Yon Châteauroux Lons- le-Saunier Poitiers Niort Moulins Mâcon Guéret La Rochelle Bourg-en- Clermont- Bresse Annecy Angoulême Limoges Ferrand Lyon St Etienne Chambéry Périgueux Brive Grenoble Le Puy- en-Velay Bordeaux Aurillac Valence Cahors Aubenas Gap Rodez Mende Agen Montauban Digne Mont-de-Marsan Avignon Albi Nîmes Auch Nice Arles Toulouse Montpellier Pau Marseille Tarbes Hyères Narbonne Foix Perpignan Bastia Cayenne Pointe-à-Pitre Papeete Ajaccio In France, men and women are equal and have the same rights. Violation of these rights is punishable by law. -

Liste Des Services D'aide Et Accompagnement a Domicile (Saad)
LISTE DES SERVICES D'AIDE ET ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE (SAAD) PRESTATAIRES AUTORISES PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR INTERVENIR AUPRES DES PERSONNES HANDICAPEES ET DES PERSONNES AGEES DE PLUS DE 60 ANS I/ STRUCTURES IMPLANTEES SUR LE DEPARTEMENT Ville Dénomination Sociale Adresse Téléphone BIEN ETRE 1 rue Dunoyer de Segonzac 0140960220 CCAS D'ANTONY 81 rue Prosper Legouté 0140967142 O2 ANTONY 4 avenue Gabriel Péri 0243720202 ANTONY ONELA ANTONY (BIEN A LA MAISON) 3 avenue Jeanne d'Arc 0184011132 SENIOR COMPAGNIE ANTONY - DORART 64 rue Adolphe Pajeaud 0661124242 SERVICES ADHAP SERVICES ASNIERES-SUR-SEINE - AIDE A DOMICILE DE LA BOUCLE NORD DU 92 10 rue de Normandie 0141119819 (ADBN 92) ADHEO SERVICES ASNIERES-SUR-SEINE - SOUS 8 rue Raphaël 0147335564 MON TOIT ASSOCIATION GERONTOLOGIQUE ASNIERES-SUR-SEINE D'ASNIERES-SUR-SEINE ET BOIS-COLOMBES 18 place des Victoires 0140864300 (AGABC) BIEN VIEILLIR EN IDF ASNIERES-SUR-SEINE - 177 avenue d'Argenteuil 0148850634 ARMONY DOM HOME SERVICES LAND 19 rue de Colombes 0664919316 O2 ASNIERES-SUR-SEINE 4 avenue Laurent Cély 0243720202 1 Mise à jour juin 2019 SENIOR PLUS 4 rue Mortinat 0134052360 ADHAP SERVICES BAGNEUX - AIDE A 12 avenue Victor Hugo 0145472152 DOMICILE SUD 92 BAGNEUX AGE D'OR SERVICES BAGNEUX - PROXIMITE 92 70 avenue Henri Ravera 0149124270 CCAS DE BAGNEUX 57 rue Henri Ravéra 0142316016 ADTP SERVICES 70 rue Charles Chefson 0147943228 AIDE ASSISTANCE A DOMICILE (AAAD) 4 rue du Général Leclerc 0659407092 ALLIANCE VIE BOIS-COLOMBES 5 rue Gambetta 0612652416 BOIS-COLOMBES -

Argenteuil Aulnay-Sous-Bois Bobigny Bourg-La-Reine / Sceaux Cachan Clamart Evry
Ville siège de Classement Dépt CT en charge de l'équipement l'établissement actuel 78 Commune d'Achères Achères CRC 94 EPT Grand Paris Sud Est Avenir Alfortville CRI 92 EPT Vallée Sud Grand Paris Antony CRI 95 Commune d'Argenteuil Argenteuil CRD Aubervilliers La 93 SIVU CRR Courneuve 93 Commune d'Aulnay-sous-bois Aulnay-sous-Bois CRD 92 EPT Vallée Sud Grand Paris Bagneux CRI 93 EPT Est Ensemble Bagnolet (danse) CRC 93 EPT Est Ensemble Bagnolet (musique) CRC 93 Commune de Bobigny Bobigny CRD 93 EPT Est Ensemble Bondy CRC 92 EPT Grand Paris Seine Ouest Boulogne-Billancourt CRR 92 EPT Vallée Sud Grand Paris Bourg-la-Reine / Sceaux CRD 94 Commune de Bry-sur-Marne Bry-sur-Marne CRC 94 EPT Grand Orly Seine Bièvre Cachan CRD 95 CA Cergy Pontoise Cergy-Pontoise CRR 92 EPT Vallée Sud Grand Paris Châtenay-Malabry CRI 92 EPT Vallée Sud Grand Paris Châtillon CRC 78 Commune de Chatou Chatou CRC 91 Commune de Chilly-Mazarin Chilly-Mazarin CRC 94 Commune de Choisy-le-Roi Choisy-le-Roi CRC 92 EPT Vallée Sud Grand Paris Clamart CRD Commune de Conflans-Sainte- 78 Conflans-Sainte-Honorine CRC Honorine 77 Commune de Coulommiers Coulommiers CRC 92 Commune de Courbevoie Courbevoie CRC 94 EPT Grand Paris Sud Est Avenir Créteil CRR 91 Commune de Dourdan Dourdan CRC 91 CA Val d'Yerres Val de Seine Draveil CRC 95 Commune d'Eaubonne Eaubonne CRC 95 Commune d'Ermont Ermont CRC CA Grand Paris Sud Seine 91 Evry CRD Essonne Sénart 91 Commune de Fleury-Mérogis Fleury-Mérogis CRC 77 Commune de Fontainebleau Fontainebleau CRC 92 EPT Vallée Sud Grand Paris Fontenay-aux-Roses -
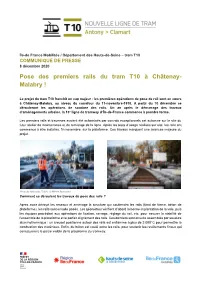
Pose Des Premiers Rails Du Tram T10 À Châtenay- Malabry !
Île-de France Mobilités / Département des Hauts-de-Seine – tram T10 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 8 décembre 2020 Pose des premiers rails du tram T10 à Châtenay- Malabry ! Le projet du tram T10 franchit un cap majeur : les premières opérations de pose de rail sont en cours à Châtenay-Malabry, au niveau du carrefour du 11-novembre-1918. A partir du 10 décembre se dérouleront les opérations de soudure des rails. Un an après le démarrage des travaux d’aménagements urbains, la 10e ligne de tramway d’Île-de-France commence à prendre forme. Les premiers rails et traverses avaient été acheminés par convois exceptionnels cet automne sur le site du futur atelier de maintenance et de remisage de la ligne. Après les tests d’usage réalisés sur site, les rails ont commencé à être installés, fin novembre, sur la plateforme. Ces travaux marquent une avancée majeure du projet. Photo des rails posés / Crédit : © William Beaucardet Comment se déroulent les travaux de pose des rails ? Après avoir dévoyé les réseaux et aménagé la structure qui soutiendra les rails (fond de forme, béton de plateforme), les rails sont ensuite posés. Les géomètres vérifient d’abord la bonne implantation de la voie, puis les équipes procèdent aux opérations de fixation, serrage, réglage du rail, etc. pour assurer la stabilité de l’ensemble de la plateforme et le parfait alignement des rails. Ces derniers sont ensuite assemblés par soudure aluminothermique : un creuset positionné autour des rails est enflammé à plus de 2 000°C pour permettre la combustion des matériaux. Enfin, du béton est coulé entre les rails, pour soutenir les revêtements finaux qui constitueront la partie visible de la plateforme du tramway. -

Ecoles De Conduite Des Hauts-De-Seine
Ecoles de conduite des Hauts-de-Seine N° de Raison sociale Adresse Code postal Ville moto B poids lourds l'établissement 09258330 CER POINT CONDUITE 2 11 BIS AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 92160 ANTONY X 09254060 BACONNETS 11 RUE DE LA FONTAINE MOUTON 92160 ANTONY X 09256950 C.E.R. PRELUDE 200 RUE PAJEAUD 92160 ANTONY X X 09256670 FONTAINE MICHALON 36 RUE MIRABEAU 92160 ANTONY X 09258320 ANTONY CENTRE DE CONDUITE 50 RUE PROSPER LEGOUTE 92160 ANTONY X X 09258460 CER POINT CONDUITE 66 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 92160 ANTONY X X 09255190 NATIONALE 20 96 AVENUE ARISTIDE BRIAND 92160 ANTONY X X 09259300 ACF AUTO MOTO ECOLE 113 BOULEVARD VOLTAIRE 92600 ASNIERES X X 09258640 ECOLE DE CONDUITE D ASNIERES 192 BOULEVARD VOLTAIRE 92600 ASNIERES X 09258410 CFSR 4 ROUTES 378 AVENUE D'ARGENTEUIL 92600 ASNIERES X 09258680 ANDRE 2 6 RUE DES BOURGUIGNONS 92600 ASNIERES X X 09259080 ACSEF PRO PERMIS 72-74 AVENUE DE LA MARNE 92600 ASNIERES X X 09255640 C.E.R. ASNIERES 89 AVENUE D'ARGENTEUIL 92600 ASNIERES X X 09257530 PARIS-OUEST 9 RUE DES BAS 92600 ASNIERES X 09259440 AUTO ECOLE DE BECON 1 RUE DE BELFORT 92600 ASNIERES SUR SEINE X 09259070 PONT D'ASNIERES 10 GRAND RUE CHARLES DE GAULLE 92600 ASNIERES SUR SEINE X X X 09259270 AUTO ECOLE RIVES DE SEINE 10 RUE EUGENE EBOUE 92600 ASNIERES SUR SEINE X X 09258620 SAINT CHRISTOPHE 19 RUE BAPST 92600 ASNIERES SUR SEINE X 09255930 POINCARE 21-25 AVENUE DE LA REDOUTE 92600 ASNIERES SUR SEINE X 09256470 ASSOC ECOLE PLUS AUTO 16 AVENUE VICTOR HUGO 92220 BAGNEUX X 09253950 R.E.R. -

Projet De Tramway T10 Antony-Clamart
Avis délibéré de l’Autorité environnementale sur le tramway T 10 entre La-Croix-de-Berny (Antony) et La-Place-de-Garde (Clamart) (92) n°Ae: 2015-22 Avis délibéré n°Ae 2015-22 adopté lors de la séance du 10 juin 2015 Formation d’Autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable Avis délibéré du 10 juin 2015 – Tramway T10 entre La-Croix-de-Berny (Antony) et la Place-de-Garde (Clamart) CGEDD (92) Page 1 sur 20 Préambule relatif à l’élaboration de l’avis L’Autorité environnementale 1 du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), s’est réunie le 10 juin 2015 à Paris. L’ordre du jour comportait, notamment, l’avis sur le tramway T 10 entre Antony et Clamart (92). Étaient présents et ont délibéré : Mmes Bour-Desprez, Fonquernie, Guth, Hubert, Perrin, Steinfelder, MM. Bar- thod, Clément, Galibert, Ledenvic, Orizet, Ullmann, Vindimian. En application du § 2.4.1 du règlement intérieur du CGEDD, chacun des membres délibérants cités ci-dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature à met- tre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet du présent avis. Étaient absents ou excusés : MM. Chevassus-au-Louis, Lefebvre, Letourneux N’ont pas participé à la délibération, en application de l’article 2.4.1 du règlement intérieur de l’Ae : M. Roche * * L’Ae a été saisie pour avis par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine et par la directrice générale du syndicats des transports d’Île-de-France (STIF), le dossier ayant été reçu complet le 20 mars 2015. -

Hans Arp & Other Masters of 20Th Century Sculpture
Hans Arp & Other Masters Stiftung Arp e. V. Papers of 20th Century Sculpture Volume 3 Edited by Elisa Tamaschke, Jana Teuscher, and Loretta Würtenberger Stiftung Arp e. V. Papers Volume 3 Hans Arp & Other Masters of 20th Century Sculpture Edited by Elisa Tamaschke, Jana Teuscher, and Loretta Würtenberger Table of Contents 10 Director’s Foreword Engelbert Büning 12 Hans Arp & Other Masters of 20th Century Sculpture An Introduction Jana Teuscher 20 Negative Space in the Art of Hans Arp Daria Mille 26 Similar, Although Obviously Dissimilar Paul Richer and Hans Arp Evoke Prehistory as the Present Werner Schnell 54 Formlinge Carola Giedion-Welcker, Hans Arp, and the Prehistory of Modern Sculpture Megan R. Luke 68 Appealing to the Recipient’s Tactile and Sensorimotor Experience Somaesthetic Redefinitions of the Pedestal in Arp, Brâncuşi, and Giacometti Marta Smolińska 89 Arp and the Italian Sculptors His Artistic Dialogue with Alberto Viani as a Case Study Emanuele Greco 108 An Old Modernist Hans Arp’s Impact on French Sculpture after the Second World War Jana Teuscher 123 Hans Arp and the Sculpture of the 1940s and 1950s Julia Wallner 142 Sculpture and/or Object Hans Arp between Minimal and Pop Christian Spies 160 Contributors 164 Photo Credits 9 Director’s Foreword Engelbert Büning Hans Arp is one of the established greats of twentieth-century art. As a founder of the Dada movement and an associate of the Surrealists and Con- structivists alike, as well as co-author of the iconic book Die Kunst-ismen, which he published together with El Lissitzky in 1925, Arp was active at the very core of the avant-garde.