Savoyard (Langue)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Improving Impactful Currency Systems for a Sustainable Economy in Switzerland
4th International Conference on Social and Complementary Currencies Money, Consciousness and Values for Social Change: Real Experiences Swiss impact currency: improving impactful currency systems for a sustainable economy in Switzerland Christophe PLACE ▪ Antonin CALDERON ▪ Fabien CORDEIRO 10th of May 2017 Haute École de Gestion de Genève ▪ Geneva ▪ Switzerland Corresponding author: [email protected] 10th of May 2017 to 14th of May 2017 ▪ Barcelona ▪ Spain Parc Tecnològic Nou Barris ▪ Universitat Oberta de Catalunya http://ramics.org/barcelona2017/ ABSTRACT Switzerland has not only the oldest and biggest modern complementary currency in the world, the WIR created in 1934 with a transaction volume equivalent of CHF 1.5 billion Swiss francs representing 3.5% of Swiss franc currency circulation in 2008, but also the second cross-border complementary currency in the world, the Léman created in September 2015 in a Franco-Swiss conurbation with 80'000 units in circulation at par with Swiss franc and euro among a network of 350 organizations and 1'300 users in November 2016. Moreover, with about 44 social currencies, 14 complementary currencies, Switzerland, counts among reference case studies in the virtual, social and complementary currency systems domain. Nevertheless, some questions remain: (1) What is the historical, cultural, political and economical context of this innovation laboratory? (2) What is the relevant legislation to support such monetary innovation? (3) What are the genuine utility and impact of these currencies? To contribute to these research questions, a literature review and a research survey will allow us not only to overview the Swiss and the Greater Geneva currency systems, but also evaluate the interest of using complementary and virtual currency systems for a sustainable economy. -

Onomastica Uralica
Edited by RICHARD COATES KATALIN RESZEGI Debrecen–Helsinki 2018 Onomastica Uralica President of the editorial board István Hoffmann, Debrecen Co-president of the editorial board Terhi Ainiala, Helsinki Editorial board Tatyana Dmitrieva, Yekaterinburg Sándor Maticsák, Debrecen Kaisa Rautio Helander, Irma Mullonen, Petrozavodsk Guovdageaidnu Aleksej Musanov, Syktyvkar Marja Kallasmaa, Tallinn Peeter Päll, Tallinn Nina Kazaeva, Saransk Janne Saarikivi, Helsinki Lyudmila Kirillova, Izhevsk Valéria Tóth, Debrecen Technical editor Edit Marosi Cover design and typography József Varga The volume was published under the auspices of the Research Group on Hungarian Language History and Toponomastics (University of Debrecen–Hungarian Academy of Sciences). It was supported by the International Council of Onomastic Sciences, the University of Debrecen as well as the ÚNKP-18-4 New National Excellence Program of The Ministry of Human Capacities. The papers of the volume were peer-reviewed by Terhi Ainiala, Barbara Bába, Keith Briggs, Richard Coates, Eunice Fajobi, Milan Harvalík, Róbert Kenyhercz, Adrian Koopman, Unni-Päivä Leino, Staffan Nyström, Harry Parkin, Katalin Reszegi, Maggie Scott, Dmitry Spiridonov, Pavel Štěpán, Judit Takács, Peter Trudgill, Mats Wahlberg, Christian Zschieschang. The studies are to be found on the following website http://mnytud.arts.unideb.hu/onomural/ ISSN 1586-3719 (Print), ISSN 2061-0661 (Online) ISBN 978-963-318-660-2 Published by Debrecen University Press, a member of the Hungarian Publishers’ and Booksellers’ Association established in 1975. Managing Publisher: Gyöngyi Karácsony, Director General Printed by Kapitális Nyomdaipari és Kereskedelmi Bt. Contents GRANT W. SMITH The symbolic meanings of names .......................................................... 5 ANNAMÁRIA ULLA SZABÓ T. Bilingualism: binominalism? ................................................................. 17 ESZTER DITRÓI Statistical Approaches to Researching Onomastic Systems ................. -

Francoprovençal – Arpitan – Savoyard)
Cahiers de l’ILSL, № 52, 2017, pp. 119-138 Baptêmes d’une langue ou un peu de magie sociale dans le passé et dans le présent (francoprovençal – arpitan – savoyard) Natalia BICHURINA Université de Bergame Résumé: Dans cet article nous analysons le discours sur la nomination d’une langue romane – le francoprovençal, l’arpitan ou le savoyard – produit à des époques différentes par deux types d’acteurs sociaux: des linguistes et des militants linguistiques. Il s’agit d’étudier leurs systèmes d’argumentation afin de dégager les idéologies linguistiques et les enjeux sociaux et politiques qui se cachent derrière les nomina- tions concurrentes. Simultanément, cette analyse nous permettra de voir sur quels critères se basent les constats qu’un idiome serait une langue à part entière, et comment les frontières entre les «langues» sont tracées. S’agissant d’une langue transfrontalière, parlée dans trois États construits selon des modèles extrêmement différents, la Suisse, la France et l’Italie, cette étude nous permettra d’explorer dans quelle mesure la différence d’organisation politico-étatique détermine les représen- tations linguistiques. L’article est basé sur une enquête menée entre 2009 et 2013 selon les méthodes de l’entretien, de l’analyse de textes écrits (des articles, des blogs de militants, etc.) et de l’observation, y compris l’observation participante. Mots-clés: nomination des langues, idéologies linguistiques, analyse du discours, langues régionales, francoprovençal, arpitan, savoyard, patois 120 Cahiers de l’ILSL, № 52, 2017 Aujourd’hui -

Tesi Prova.Pages
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI Dottorato di ricerca in Lettere - XXIX ciclo Curriculum in Dialettologia italiana, Geografia linguistica e Sociolinguistica LA VARIETÀ DI MONASTERO DI LANZO: UNA PARLATA DI CONFINE Tesi di dottorato presentata da: PAOLO BENEDETTO MAS Tutor: PROF. RICCARDO REGIS SSD: L-FIL-LET/12 Anno Accademico 2016/2017 !4 a Francesca che c’è e a Matteo che prima non c’era e adesso c’è - Dovrò considerare pari a me questo scudiero, Gurdulú, che non sa neppure se c’è o se non c’è? - Imparerà anche lui… Neppure noi sapevamo d’essere al mondo. Anche ad essere si impara. Italo Calvino - Il cavaliere inesistente !5 I. INTRODUZIONE I. INTRODUZIONE La presente ricerca intende descrivere, nel suo complesso, la parlata di un comune delle Valli di Lanzo: Monastero di Lanzo. L’analisi di un singolo dialetto, ridotto oramai ad avere poche centinaia di parlanti, può avere una rilevanza e un interesse molto discutibili, ma è proprio dallo studio approfondito e globale di una (piccola) realtà che, penso, si possano ottenere dati e materiali interessanti per leggere e comprendere anche altre dinamiche linguistiche. Questo progetto ha subito, nel corso degli anni di dottorato, interruzioni, ripartenze, cambi di rotta e di metodologia anche se l’ambito della ricerca ha sempre ruotato attorno alla descrizione delle varietà francoprovenzali del Piemonte. Inizialmente intendevo svolgere un’indagine di tipo quantitativo, nell’ambito della sociologia del linguaggio, che investigasse, attraverso un questionario auto- valutativo, aspetti come il numero di parlanti, la strutturazione del repertorio e i domini d’uso di tutte le varietà francoprovenzali del Piemonte con un’attenzione alle nuove tendenze identitarie che stanno coinvolgendo le lingue minoritarie. -

Le Francoprovençal
Janvier 2011 Numéro 18 Langues et cité Le francoprovençal Le francoprovençal concentre plusieurs problématiques de la sociolinguistique actuelle : les enjeux de la délimitation et de l'appellation d'une aire linguistique, le rapport des langues Langues et cité Bulletin de l’observatoire des pratiques linguistiques minoritaires aux langues offi cielles, la mise à l'épreuve de Le francoprovençal p. 2 l'impératif de diversité culturelle, l'eff et de l'intervention politique sur les langues… La littérature p. 4 Identifi é et dénommé par le monde savant au 19e siècle seulement, Étude FORA p. 5 le francoprovençal est sans doute la plus méconnue des langues historiques de l'Hexagone, largement absente de l'idée que nous Quel nom pour nous faisons du paysage linguistique de notre pays. En même une langue ? p. 6 temps, par l'intérêt nouveau qui se porte sur la pluralité des langues et sur leur importance dans la vie sociale, elle devient L'enseignement objet de réfl exion collective et d'action publique. Elle illustre ainsi scolaire p. 7 la situation des langues en France. Politique de la Au moment où la région Rhône-Alpes lance une politique de Région Rhône-Alpes p. 8 valorisation du francoprovençal, il est apparu souhaitable de faire état des travaux qui, au fi l des décennies, ont rendu possible Les régionalismes p. 9 cet heureux développement, car « toute politique se fonde sur des savoirs ». À côté de celui de Pierre Gardette, on évoquera En Vallée d'Aoste p.10 parmi les précurseurs le nom d'André Martinet, qui a appliqué sa méthode de description phonologique au parler francoprovençal d'Hauteville en Savoie. -

As a Sociolinguistic Variable in Francoprovençal Kasstan, J. and Müller, D
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by WestminsterResearch WestminsterResearch http://www.westminster.ac.uk/westminsterresearch (l) as a sociolinguistic variable in Francoprovençal Kasstan, J. and Müller, D. This is a copy of the final version of an article published in the International Journal of the Sociology of Language, 249, pp. 99-118. It is available from the publisher at: https://dx.doi.org/10.1515/ijsl-2017-0039 The WestminsterResearch online digital archive at the University of Westminster aims to make the research output of the University available to a wider audience. Copyright and Moral Rights remain with the authors and/or copyright owners. Whilst further distribution of specific materials from within this archive is forbidden, you may freely distribute the URL of WestminsterResearch: ((http://westminsterresearch.wmin.ac.uk/). In case of abuse or copyright appearing without permission e-mail [email protected] IJSL 2018; 249: 99–118 Jonathan Kasstan* and Daniela Müller (l) as a sociolinguistic variable in Francoprovençal https://doi.org/10.1515/ijsl-2017-0039 Abstract: This article argues for (l) as a sociolinguistic variable in Francoprovençal: (l) refers to variable palatalisation of /l/ in obstruent + lateral onset clusters (/kl, ɡl, pl, bl, fl/), a feature that has long been the subject of metalinguistic commentary, but no systematic analysis. Our data, which come from a larger study of Francoprovençal (FP), show significant intraspeaker variation. Sociolinguistic inter- views were carried out in the Lyonnais region of France among 21 FP speakers with different acquisition routes. /l/-palatalisation is far from categorical in our sample, with increased rates of the French variant [l] over the traditional [j] variant. -

Bibliographie NB
Research Output / Résultats de recherche Natalia Bichurina 1. Publications in peer-reviewed scientific journals / Publications évaluées par les pairs dans des revues scientifiques internationales 2020 « Combler le fossé entre les locuteurs natifs, passifs et les nouveaux locuteurs : un exemple francoprovençal », in Nouvelles du Centre d’Études Francoprovençales René Willien, no 77 2020. 81 – 103. 2019 « Conflits linguistiques invisibles : une communauté romande au bord de la mer Noire », in Carmen Alén Garabato (ed.) Sociolinguistique des contacts / conflits de langues en domaine roman des origines à nos jours, Revue des langues romanes. Tome CXXIII N°1 2019, p. 93-121. https://journals.openedition.org/rlr/1629 2019 «Le chercheur comme passeur de mondes: l’«air du lieu» dans la production du savoir linguistique», Epistemologica et historiographica linguistica Lausannensia, № 1, 2019, 37-43. 2018 «Francoprovençal as social practice: Comparative study in Italy, France and Switzerland», in Kasstan, Jonathan R. and Nagy, Naomi (eds.) ‘Francoprovençal: documenting a contact variety in Europe and North America’, International Journal of the Sociology of Language, 249. 151-166. DOI: https://doi.org/10.1515/ijsl-2017-0044 2017 « Baptêmes d’une langue ou un peu de magie sociale dans le passé et dans le présent (« Francoprovençal » - « Arpitan » - « Savoyard ») », in Ekaterina Velmezova (ed.) Cahiers de l’ILSL n°52 Historiographie & épistémologie des sciences du langage: du passé vers le présent, Lausanne. Pp. 119-138. https://www.unil.ch/clsl/files/live/sites/clsl/files/shared/Cahier%2052/cahier-52 2017 « Entre transformation et disparition de la diglossie : les dynamiques bilingues de type ‘focalisé’ ou ‘diffus’ dans la transmission du francoprovençal en Suisse et en Vallée d’Aoste », in Manuel Meune, Katrin Mutz (eds.) Revue transatlantique d'études suisses, 6/7 2016/17, Montréal. -

Master Reference
Master Quale futuro per il francoprovenzale in Valle d'Aosta? : Politiche linguistiche e misure per la sua tutela UNIO, Evelina Abstract La Vallée d'Aoste est un cas particulier dans le paysage linguistique italien, car il s'agit d'une région plurilingue où les langues italienne et française jouissent d'une reconnaissance égale en tant que langues officielles, et coexistent avec des minorités linguistiques telles que le patois franco-provençal. Ce travail s'intéresse à ce dernier et à son avenir : à ce propos, après en avoir examiné la perception, l'utilisation et la vitalité sur le territoire, nous avons analysé les politiques linguistiques et les initiatives visant à le protéger. Les résultats montrent que le franco-provençal en Vallée d'Aoste – contrairement aux régions francophones où il est aussi présent – a de bonnes perspectives de survie et de vitalité, et que les initiatives pour sa protection se multiplient et s'améliorent. Néanmoins, un soutien structurel aux initiatives déjà existantes sur le territoire par la création d'une base législative plus solide permettrait de mieux protéger les droits de la langue et de ses locuteurs. Reference UNIO, Evelina. Quale futuro per il francoprovenzale in Valle d'Aosta? : Politiche linguistiche e misure per la sua tutela. Master : Univ. Genève, 2020 Available at: http://archive-ouverte.unige.ch/unige:145367 Disclaimer: layout of this document may differ from the published version. 1 / 1 UNIO EVELINA Quale futuro per il francoprovenzale in Valle d’Aosta? Politiche linguistiche e misure per la sua tutela Directeur : Titus-Brianti Giovanna Juré : Canavese Paolo Mémoire présenté à la Faculté de traduction et d’interprétation (Département de traduction, Unité d’italien) pour l’obtention de la Maîtrise universitaire en traduction et communication spécialisée multilingue. -

Languages: from “Francoprovençal Patois” to “Arpitan” and “Arpitania”
Trans-border communities in Europe and the emergence of “new” languages : From “Francoprovençal patois” to “Arpitan” and “Arpitania” Natalia Bichurina To cite this version: Natalia Bichurina. Trans-border communities in Europe and the emergence of “new” languages : From “Francoprovençal patois” to “Arpitan” and “Arpitania”. Linguistics. Université de Perpignan; Università degli studi (Bergame, Italie), 2016. English. NNT : 2016PERP0016. tel-01368201 HAL Id: tel-01368201 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01368201 Submitted on 26 Jan 2017 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Natalia Bichurina Trans-border communities in Europe and the emergence of “new” languages: From “Francoprovençal patois” to “Arpitan” and “Arpitania” Doctoral degree dissertation Supervisors: Prof. Christian LAGARDE Université de Perpignan Via Domitia (France) Dr. Caroline LIPOVSKY University of Sydney (Australia) Prof. Federica VENIER Università degli studi di Bergamo (Italy) Thesis presented for public defence at the Institut Franco-Català Transfronterer, Casa dels Països Catalans, University of Perpignan via Domitia 2016 1 Declaration of good academic conduct I Natalia Bichurina, hereby certify that this dissertation, which is 148 512 words in length, has been written by me, that it is a record of work carried out by me, and that it has not been submitted in any previous application for a higher degree. -

Westminsterresearch New Speakers and Language Revitalisation: Arpitan and Community (Re)Formation Kasstan, J
WestminsterResearch http://www.westminster.ac.uk/westminsterresearch New Speakers and Language Revitalisation: Arpitan and Community (Re)formation Kasstan, J. An author formatted manuscript of a chapter published in Harrison, M. and Joubert, A. (eds.) French Language Policies and the Revitalisation of Regional Languages in the 21st Century, Palgrave Macmillan, pp. 149-170, reproduced with permission of Palgrave Macmillan. This extract is taken from the author's original manuscript and has not been edited. The definitive, published, version of record is available here: https://doi.org/10.1007/978-3-319-95939-9_7 The WestminsterResearch online digital archive at the University of Westminster aims to make the research output of the University available to a wider audience. Copyright and Moral Rights remain with the authors and/or copyright owners. Whilst further distribution of specific materials from within this archive is forbidden, you may freely distribute the URL of WestminsterResearch: ((http://westminsterresearch.wmin.ac.uk/). In case of abuse or copyright appearing without permission e-mail [email protected] On new speakers and language revitalisation: Arpitan and community (re)formation Jonathan Kasstan (Queen Mary University of London) [email protected] ORCID: 0000-0003-4134-5876 Abstract: Today, it is uncontroversial to claim that France’s regional (minority) languages (RLs) are in decline. However, revitalisation movements have nonetheless continued to surface, and this chapter considers one by-product of such efforts: the emergence of new speakers in RL contexts. The term ‘new speaker’ refers to individuals who acquire the target language not through traditional transmission contexts (e.g. home, family), but instead as adults through language revitalisation initiatives. -

Langue Et Identités Transfrontalières: La Pratique Du Francoprovençal
Langue et identités transfrontalières : la pratique du francoprovençal dans le ”Far-West” français Marie Chocquet To cite this version: Marie Chocquet. Langue et identités transfrontalières : la pratique du francoprovençal dans le ”Far- West” français. Histoire. 2011. dumas-00680883 HAL Id: dumas-00680883 https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00680883 Submitted on 20 Mar 2012 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Marie CHOCQUET Langue et identités transfrontalières : La pratique du francoprovençal dans le « Far-West » français Volume I Mémoire de Master 1 « Sciences humaines et sociales » Mention : Histoire-Histoire de l’art. Spécialité : Histoire des relations et des échanges culturels et internationaux. Sous la direction de Mme Marie-Anne MATARD-BONUCCI Année universitaire 2010-2011 Marie CHOCQUET Langue et identités transfrontalières : La pratique du francoprovençal dans le « Far-West » français Volume I Mémoire de Master 1 « Sciences humaines et sociales » Mention : Histoire-Histoire de l’art. Spécialité : Histoire des relations et des échanges culturels et internationaux. Sous la direction de Mme Marie-Anne MATARD-BONUCCI Année universitaire 2010-2011 Dédicace A la question « Peut-on détruire les patois ? », posée par l’Abbé Grégoire, certains de ceux qu’il interrogea en 1793 répondaient : « Le patois est une langue de frères et d’amis. -
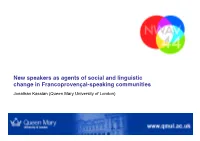
New Speakers As Agents of Social and Linguistic Change In
New speakers as agents of social and linguistic change in Francoprovençal-speaking communities Jonathan Kasstan (Queen Mary University of London) Presentation outline • Brief overview of Francoprovençal • Concept of the ‘new speaker’ • New speakers of Francoprovençal • Research questions • Methodology • The data • Conclusions Francoprovençal: brief overview (Bert et al. 2009: 14) (Hall 1949: 2) Francoprovençal: some problems i) Does it actually exist? ‘Le nouveau groupe proposé [...] n'offre aucune unité géographique’ (Meyer 1875: 295). [This newly proposed dialect grouping […] does not form a discrete unit]. ‘Le francoprovençal tout court n’existe pas’ (Helmut Lüdtke 1971: 69). [In short, the Francoprovençal language does not exist]. ‘Le francoprovençal existe-t-il?’ (Tuaillon 2007: 9) [Does Francoprovençal exist?] iii) No linguistic identity? ‘[Le francoprovençal n’a] jamais fait l’objet d’une conscience linguistique commune’ (Matthey and Meune 2012: 108) [Francoprovençal has never been a coherent linguistic unit] ii) A confusing name ‘Ce nom est […] un peu trompeur, car il semble suggérer qu’il s’agit d’une langue mixte’ (Walter 2003: vii). [This name is somewhat misleading, for it seems to suggest a hybrid language]. ‘New speakers’ and revitalisation As a category of speaker • Acquire the minority language in an educational context • Linguistic forms can be far removed from traditional norms (e.g. Hornsby 2005 on Breton) • Reported to find themselves to be socially and linguistically ‘incompatible’ with native speakers (cf. O’Rourke and Ramallo 2011, 2013) Francoprovençal à Arpitan • Emerging out of efforts to revitalise Francoprovençal • Term their varieties instead ‘Arpitan’ • Highly politicised language militants • Support a pan-regional linguistic identity and a multidialectal orthography Picking up the mantel? ‘L’unification de ces parlers sera le but du mouvement populaire harpitan […] De la fusion entre les langues, sortira une langue « nouvelle » : la LANGUE HARPITANIE’ [emphasis in original]’ (Harriet 1974: 7-8).