Titre Du Projet
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
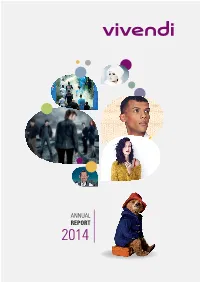
Annual Report
ANNUAL REPORT 2014 Management Message 02 At the center of our businesses 04 12 Group Profi le | Businesses | Societal, Social and Litigation | Risk Factors 07 Environmental Information 41 1. Group Profi le 09 1. Corporate Social Responsibility (CSR) Policy 42 2. Businesses 20 2. Societal Information 47 3. Litigation 32 3. Social Information 62 4. Risk Factors 38 4. Environmental Information 77 5. Verifi cation of Non-Financial Data 85 3 Information about the Company | Corporate Governance | Reports 91 1. General Information about the Company 92 2. Additional Information about the Company 93 3. Corporate Governance 106 4. Report by the Chairman of Vivendi’s Supervisory Board on Corporate Governance, Internal Audits and Risk Management – Fiscal Year 2014 147 5. Statutory Auditors’ report, prepared in accordance with Article L.225-235 of the French Commercial Code, on the Report prepared by the Chairman of the Supervisory Board of Vivendi SA 156 4 Financial Report | Statutory Auditors’ Report on the Consolidated Financial Statements | Consolidated Financial Statements | Statutory Auditors’ Report on the Financial Statements | Statutory Financial Statements 159 Selected key consolidated fi nancial data 160 I - 2014 Financial Report 161 II - Appendices to the Financial Report: Unaudited supplementary fi nancial data 191 III - Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2014 195 IV - Vivendi SA - 2014 Statutory Financial Statements 294 56 Recent events | Outlook 337 Responsibility for Auditing 1. Recent events 338 the Financial Statements 341 2. Outlook 339 1. Responsibility for Auditing the Financial Statements 342 ANNUAL REPORT 2014 The Annual Report in English is a translation of the French “Document de référence” provided for information purposes. -

Vital Kamerhe Placé Sous Mandat De Dépôt À Makala
E-Journal Kinshasa n°0024 1 Édito 2020, sans Pâques ! E-Journal e temps semble s'être arrêté et le monde s'est figé. Une attitude com- KINSHASA Lmandée par des circons- tances particulières impo- Hebdomadaire d’informations générales, des programmes TV, Radio et Publicité sant un confinement de 6ème année - Série B - n°0024 du jeudi 08 avril 2020 presque toute la planète. Fondateur : EALE IKABE - Directeur de la publication : BONA MASANU Cette année, de façon in- Tel. et whatsapp: +243840748000 - e-mail: [email protected] - Facebook: EJournal Kinshasa - habituelle, les chrétiens youtube : télé[email protected] (disponible fin janvier 2020) de toute la terre ne vi- vront pas, le 12 avril, jour Justice (Lire en pages 2, 19 et 20) de Pâques comme les an- nées précédentes. Pour cause de crise sanitaire liée au coronavirus, aucun Vital Kamerhe rassemblement ne sera observé, car interdit ici et ailleurs, en souvenir de Jésus-Christ, mort et res- placé sous mandat suscité en l'an 30. Pâques, qui arrive après la se- maine sainte, est un jour de dépôt à Makala de réjouissances pour tous chrétiens. Ainsi, en pré- lude à sa célébration, tous Controverse autour du don des les interdits de Carême Chloroquines par l’ex-première dame sont levés, en conformité avec la tradition millé- naire. C'est tout le céré- L’OCC réfute avoir analysé monial en lien avec la ré- surrection du Christ, pour cette circonstance particu- un échantillon du produit lière, qui ne sera pas res- (Lire en page 3) pecté : sans fidèles, ni la- vements des pieds ou pro- cessions, jeudi et vendredi Hommage COVID-19/ saints. -
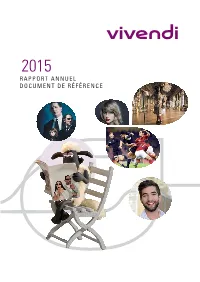
Rapport Annuel Document De Référence Sommaire
2015 RAPPORT ANNUEL DOCUMENT DE RÉFÉRENCE SOMMAIRE MESSAGE DE LA DIRECTION 02 PROFIL DU GROUPE ET SES MÉTIERS | COMMUNICATION FINANCIÈRE 1 ET CADRE RÉGLEMENTAIRE | FACTEURS DE RISQUES 05 1. Profi l du groupe et ses métiers 07 2. Communication fi nancière et cadre réglementaire 41 3. Facteurs de risques 44 2 INFORMATIONS SOCIÉTALES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES 47 1. Politique de responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) 48 2. Messages clés 55 3. Indicateurs sociétaux, sociaux et environnementaux 62 4. Vérifi cation des informations extra-fi nancières 95 3 INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIÉTÉ | GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE | RAPPORTS 101 1. Informations générales concernant la société 102 2. Informations complémentaires concernant la société 103 3. Gouvernement d’entreprise 116 4. Rapport du Président du Conseil de surveillance de Vivendi sur le gouvernement d’entreprise, le contrôle interne et la gestion des risques – exercice 2015 158 5. Rapport des Commissaires aux comptes, établi en application de l’article L. 225-235 du Code de commerce, sur le rapport du Président du Conseil de surveillance de la société Vivendi SA 167 RAPPORT FINANCIER | RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES 4 CONSOLIDÉS | ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS | RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS | COMPTES ANNUELS DE VIVENDI SA 169 Chiffres clés consolidés 170 I - Rapport fi nancier de l’exercice 2015 171 II - Annexe au rapport fi nancier : Données fi nancières complémentaires non auditées 193 III - États fi nanciers consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015 194 IV - Comptes annuels 2015 280 5 ÉVÉNEMENTS RÉCENTS | PERSPECTIVES D’AVENIR 325 1. Évé nements récents 326 2. -

Rapport Annuel Document De Référence Sommaire
2016 RAPPORT ANNUEL DOCUMENT DE RÉFÉRENCE SOMMAIRE MESSAGES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET DU DIRECTOIRE 02 1 4 Profil du groupe et ses métiers | Rapport financier | Rapport des Commissaires Communication financière, politique fiscale aux comptes sur les comptes consolidés | et cadre réglementaire | Facteurs de risques 05 États financiers consolidés | Rapport des 1. Profi l du groupe et ses métiers 07 Commissaires aux comptes sur les comptes 2. Communication fi nancière, politique fi scale et cadre réglementaire 43 annuels | Comptes annuels de Vivendi SA 183 3. Facteurs de risques 47 Chiffres clés consolidés 184 I - Rapport fi nancier de l’exercice 2016 185 II - Annexe au rapport fi nancier : données fi nancières complémentaires non auditées 208 III - États fi nanciers consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016 210 2 IV - Comptes annuels 300 Informations sociétales, sociales et environnementales 51 1. Politique de responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) 52 2. Messages clés 58 5 3. Indicateurs sociétaux, sociaux et environnementaux 64 4. Vérifi cation des informations extra-fi nancières 101 Événements récents | Prévisions | Rapport des Commissaires aux comptes sur les prévisions de résultat opérationnel ajusté (EBITA) 343 1. Événements récents 344 2. Prévisions 344 3 3. Rapport des Commissaires aux comptes sur les prévisions Informations concernant la société | de résultat opérationnel ajusté (EBITA) 345 Gouvernement d’entreprise | Rapports 107 1. Informations générales concernant la société 108 2. Informations complémentaires concernant la société 109 3. Gouvernement d’entreprise 125 4. Rapport du Président du Conseil de surveillance de Vivendi 6 sur le gouvernement d’entreprise, le contrôle interne Responsable du Document de référence | Attestation et la gestion des risques – exercice 2016 172 du Responsable du Document de référence | 5. -

West African Music in the Music of Art Blakey, Yusef Lateef, and Randy Weston
West African Music in the Music of Art Blakey, Yusef Lateef, and Randy Weston by Jason John Squinobal Batchelor of Music, Music Education, Berklee College of Music, 2003 Master of Arts, Ethnomusicology, University of Pittsburgh, 2007 Submitted to the Graduate Faculty of Arts and Sciences in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Ethnomusicology University of Pittsburgh 2009 ffh UNIVERSITY OF PITTSBURGH SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES This dissertation was presented by Jason John Squinobal It was defended on April 14, 2009 and approved by Dr. Nathan T. Davis, Professor, Music Department Dr. Akin Euba, Professor, Music Department Dr. Eric Moe, Professor, Music Department Dr. Joseph K. Adjaye, Professor, Africana Studies Dissertation Director: Dr. Nathan T. Davis, Professor, Music Department ii Copyright © by Jason John Squinobal 2009 iii West African Music in the Music of Art Blakey, Yusef Lateef, and Randy Weston Jason John Squinobal, PhD University of Pittsburgh, 2009 Abstract This Dissertation is a historical study of the cultural, social and musical influences that have led to the use of West African music in the compositions and performance of Art Blakey, Yusef Lateef, and Randy Weston. Many jazz musicians have utilized West African music in their musical compositions. Blakey, Lateef and Weston were not the first musicians to do so, however they were chosen for this dissertation because their experiences, influences, and music clearly illustrate the importance that West African culture has played in the lives of African American jazz musicians. Born during the Harlem Renaissance each of these musicians was influenced by the political views and concepts that predominated African American culture at that time. -
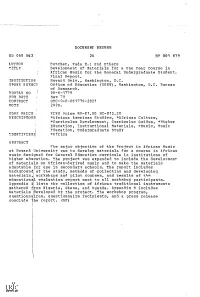
Development of Materials for a One Year Course in African Music for the General Undergraduate Student
DOCUMENT RESUME ED 045 042 24 HE 001 879 AUTHOR Butcher, Vada E.; And Others TITLE Development of Materials for a One Year Course in African Music for the General Undergraduate Student. Final Report. INSTITUTION Howard Univ., Washington, D.C. SPONS AGENCY Office of Education (DHEW) , Washington, D.C. Bureau of Research. BUREAU NO PR-6-1779 PUB DATE Sep 70 CONTRACT OEC0-8-061779-2821 NOTE 242p. FDRS PRICE. 7rRs Price MF-$1.00 HC-$12.20 DESCRIPTORS. *African American Studies, *A.Erican Culture, *Curriculum Development, Curriculum Guides, *Higher Education, Instructional Materials; *Music, Music Education, Undergraduate Study IDENTIFIERS *Africa ABSTRACT The major objective of the Project in African Music at Howard University was to develop materials for a course in African music designed for General Education curricula in institutions of higher education. The project was expanded to include the development of materials on African-derived music and to make the materials adaptable for use in secondary schools. The report includes background!of the study, methods of collecting and developing materials, workshops and pilot courses, and results of the educational evaluation report sent to all workshop participants. Appendix A lists the collection of African traditional instruments gathered from Nigeria, Ghana, and Uganda. Appendix B includes materials developed by the project. The workshop program, auestionnaires, questionnaire recipients, and a press release conclude the report. (AF) 1,e e- 77(7 e,9 2_ id FINAL REPORT Project No. 6-1779 Contract No. 0-8-061779-2821 DEVELOPMENT OF MATERIALS FOR A ONE YEAR COURSE IN AFRICAN MUSIC FOR THE GENERAL UNDERGRADUATE STUDENT (PROJECT IN AFRICAN MUSIC) by Veda E. -
Document De Référence
RAPPORT ANNUEL DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2014 Message de la Direction 02 Au cœur de nos métiers 04 12 Profi l du groupe | Activités | Litiges | Informations sociétales, sociales Facteurs de risques 07 et environnementales 41 1. Profi l du groupe 09 1. Politique de responsabilité sociétale 2. Activités 20 de l’entreprise (RSE) 42 3. Litiges 32 2. Informations sociétales 47 4. Facteurs de risque 38 3. Informations sociales 62 4. Informations environnementales 77 5. Vérifi cation des informations extra-fi nancières 85 3 Informations concernant la société | Gouvernement d’entreprise | Rapports 91 1. Informations générales concernant la société 92 2. Informations complémentaires concernant la société 93 3. Gouvernement d’entreprise 106 4. Rapport du Président du Conseil de surveillance de Vivendi sur le gouvernement d’entreprise, le contrôle interne et la gestion des risques – exercice 2014 147 5. Rapport des Commissaires aux comptes, établi en application de l’article L. 225-235 du Code de commerce, sur le rapport du Président du Conseil de surveillance de la société Vivendi SA 156 4 Rapport fi nancier | Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés | États fi nanciers consolidés | Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels | Comptes annuels de Vivendi SA 159 Chiffres clés consolidés 160 I - Rapport fi nancier de l’exercice 2014 161 II - Annexes au rapport fi nancier : Données fi nancières complémentaires non auditées 191 III - États fi nanciers consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014 195 IV - Comptes annuels 2014 de Vivendi SA 294 56 Événements récents | Responsable du Document de référence | Perspectives d’avenir 337 Attestation du Responsable du 1. -
Societal 4 Indicators
SOCIETAL 4 INDICATORS 4.1. Vivendi’s Four “Core” Issues relating to Human Rights 13 4.2. Local, Economic and Social Impact of Business Activity 23 4.3. Relations with Stakeholders 26 4.4. CSR Criteria as Part of Purchasing Policy and in Relations with Suppliers and Subcontractors 27 4.5. Fair Business Practices 29 In 2011, the United Nations Council on Human Rights approved the These issues, which since 2004 have been rigorously reported, are part Guiding Principles on Business and Human Rights. of the societal component of French Grenelle II law, under the heading Being aware of the human and cultural infl uence exerted by the group on information relating to action taken in support of human rights over millions of customers and citizens, and of the role it can play in (see Section 4.1). promoting learning to live together, Vivendi has defi ned four CSR strategic Data regarding compliance with the fundamental conventions of the “core” issues relating to human rights: International Labor Organization (ILO) is discussed in the suppliers and p promoting cultural diversity in content production and distribution; sub-contractors section (see Section 4.4) and in the “Social Indicators ” section of this Handbook (see Section 5.7). p empowering and protecting young people in their use of digital media; p fostering knowledge sharing which includes pluralism of content, media accessibility and literacy; and p valuating and protecting personal data. The abbreviations or acronyms used under the title of the indicators are p Universal Music Group, limited to a focus group of nine countries, provided in detail on p. -

Centrafrique
L’ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CONGO 200 FCFA www.adiac-congo.com N° 2162 - JEUDI 13 NOVEMBRE 2014 Dialogue inter générationnel Des membres du gouvernement accrochés par les jeunes Invités à s’expliquer devant la jeunesse sur la politique du gouvernement dans leurs domaines respectifs, des membres du gouverne- ment ont été soumis à rude épreuve à l’occasion de la 2ème édition du dialogue intergénérationnel, une ini- tiative du ministère de la Jeunesse et de l’éducation civique. Si Rigobert Maboundou a été épinglé pour le prix de l’œuf en constante augmen- tation, en dépit de lourds investissements dans les villages agricoles, son col- lègue François Ibovi a été contraint, quant à lui, à s’ex- pliquer sur les dossiers des étudiants congolais orientés à Cuba. Page 3 Des membres du gouvernement invités au dialogue inter générationnel ASSAINISSEMENT CENTRAFRIQUE Vers une stratégie nationale de Un nouveau calendrier pour gestion des déchets au Congo les prochaines élections Le groupe de contact international sur ropéenne, la France, les États-Unis, La table ronde « la gestion des déchets au la Centrafrique, réuni le 11 novembre le Congo-Brazzaville, la Communauté Congo, enjeux et perspectives » s’ouvre à Bangui, a approuvé la proposition économique des États de l’Afrique aujourd’hui à Brazzaville, à l’initiative de faite par l’Autorité nationale des élec- centrale et la Banque mondiale, l’Agence française de développement. tions d’organiser les scrutins prési- le groupe de contact a également Cette rencontre envisage de scruter les dentiels et législatifs dans la période souhaité la tenue d’un forum poli- voies et moyens de mise en œuvre d’une de juin à août de l’année prochaine. -
L'opposition Promet De Saisir La Justice Contre Kitebi Et Musungayi
L’ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN RD-CONGO 300 FC www.adiac-congo.com N° 2162 - JEUDI 13 NOVEMBRE 2014 Assemblée nationale L’opposition promet de saisir la justice contre Kitebi et Musungayi Après le cinglant revers qu’elle a subi le lundi de cause en actionnant la voie judiciaire comme 10 novembre à l’hémicycle du Palais du peuple, ultime recours. après le rejet des motions de défiance initiées Entre-temps, la même opposition parlementaire contre Patrice Kitebi et Remy Musungayi res- entreprend une nouvelle croisade contre le pre- pectivement ministre délégué aux finances et mier-vice président du bureau de l’Assemblée de l’industrie, l’opposition est en passe de sai- nationale, Charles Mwando Nsimba, qui a as- sir les juridictions compétentes pour entendre suré la police de débats au cours de la plénière les ministres incriminés. Considérant la justesse surchauffée de lundi dernier qu’elle accuse de des griefs à charge de deux précités, Samy Ba- partiale. Samy Badibanga et ses partenaires politiques dibanga et ses pairs entendent ainsi obtenir gain Page 12 GRÈVE DES MAGISTRATS Le gouvernement invité à respecter ses engagements Dans un communiqué conjoint publié le 12 tements et avantages que les deux autres en novembre, relatif à la grève des magistrats, vue de permettre aux Cours et tribunaux des ONG des droits de l’homme de la RDC ainsi qu’aux parquets de fonctionner norma- signataires recommandent au président de lement. la République de s’investir personnellement Ces organisations ont, par contre, exhorté le pour garantir l’effectivité du principe de gouvernement à engager en urgence un dia- séparation des pouvoirs et d’intervenir en logue social avec les magistrats grévistes afin urgence afin que les parties concernées se de garantir une meilleure administration de retrouvent autour d’une table. -

Black South African Urban Music Styles
BLACK SOUTH AFRICAN URBAN MUSIC STYLES: THE IDEOLOGICAL CONCEPTS AND BELIEFS SURROUNDING THEIR DEVELOPMENT 1930 -1960 Submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree Doctor of Philosophy Department of Music, School of the Arts Faculty of Humanities University of Pretoria © University of Pretoria ACKNOWLEDGEMENTS SUMMARY CHAPTER 1 STRUCTURE AND LAYOUT 1.7 POLITICAL DEVELOPMENTS IN SOUTH AFRICA RELEVANT TO TillS 1-13 THESIS CHAPTER 2 AN OVERVIEW OF URBAN POPULAR MUSIC IN AFRICA 2.8 MAJOR HYBRID URBAN STYLES 2-20 2.8.1 Congo-Zairean music 2-20 2.8.2 Highlife 2-25 2.8.3 Juju 2-31 2.8.4 Fuji 2-33 2.8.5 Afro-beat 2-34 2.8.6 Makossa 2-35 2.8.7 Chimurenga 2-36 2.8.8 Jit-jive 2-37 2.8.9 The Griot style 2-37 2.8.10 Mbalax 2-40 2.9 THE COMPARATIVE DEVELOPMENT OF URBAN POPULAR MUSIC IN 2-41 SOUTH AFRICA CHAPTER 3 AN OVERVIEW OF MILESTONES IN THE DEVELOPMENT OF BLACK SOUTH AFRICAN STYLES 3.3.1 Western Style Choral Singing 3-8 3.3.1.1 The Use of Other Terms 3-9 3.3.1.2 Africans' Adoption of Four-part Singing 3-12 3.3.1.3 'Folk 'Music 3-19 3.3.1.4 The Social Effects of Missionisation 3-20 3.3.1.5 Western-style Choral Competitions, Both Secular and Sacred 3-23 3.3.1.6 The Indigenisation of Sacred Choral Singing 3-24 3.3.1.7 Separatist Church Music 3-26 3.3.1.8 Amachorus 3-28 3.3.1.9 Protest Songs 3-32 3.3.2 Brass Bands 3-33 3.4.1 Minstrels 3-34 3.4.2 The Contributions of Reuben Caluza 3-36 3.8.1 Brass Bands as a Training Ground for Jazz Musicians 3-62 3.8.2 The Concert and Dance Tradition 3-63 3.8.3 Sophiatown and the 4Modern Jazz' -

Chambardements En
L’ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN RD-CONGO 300 FC www.adiac-congo.com N° 2233 - VENDREDI 13 FÉVRIER 2015 Publication du calendrier électoral L’élection présidentielle fixée au 27 novembre 2016 La Commission électorale nationale indépendante (Céni) a publié hier le calendrier des élections générales couvrant tous les niveaux des scrutins jusqu’aux législatives et la présidentielle. Ce calendrier qui tend à répondre aux exigences de la commu- nauté internationale se veut conforme à la Constitution et à la loi électorale. Il intègre tous les détails inhérents à la tenue des élections crédibles et transparentes assorties des dates précises. L’on retiendra que le 13 juillet 2016, la Céni procédera à la publi- cation des listes définitives des candidats aux élections législatives et présidentielle. Les Congolais accompliront leur devoir civique de vote le 27 novembre 2016, date arrêtée pour la tenue des législatives et de la présidentielle. Les résultats définitifs se- ront annoncés le 17 décembre de la même année. Par ailleurs, la Céni a annoncé que les élections provinciales, municipales, urbaines et locales auront lieu le 25 octobre 2015. Les résultats seront annoncés le 10 décembre. Les sénateurs seront élus le 17 janvier 2016 alors que l’élection des gouverneurs et vice-gouverneurs aura lieu le 31 janvier 2016. Page 13 Un citoyen accomplissant son devoir civique dans un centre de vote TRAQUE DES FDLR MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE La Monusco réitère Chambardements en vue ses préalables La mission onusienne a décidé de mettre une pause dans la coopé- ration avec les Fardc en attendant qu’on puisse clarifier la situation de deux généraux congolais récemment nommés et auteurs pré- sumés de nombreux abus en matière de droits de l’Homme.