Histoire De Romanswiller
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bulletin Familial
BULLETIN FAMILIAL ici n° 1946 COSSWILLER Du 18 novembre au 1 décembre 2019 CRASTATT HOHENGOEFT KNOERSHEIM RANGEN ROMANSWILLER WANGEN WANGENBOURG ENGENTHAL WASSELONNE WESTHOFFEN ZEHNACKER ZEINHEIM Recueil d’informations réalisé, imprimé par l’Association Générale des Familles Centre social et familial 2, rue Romantica 67310 WASSELONNE 03 88 87 05 59 / [email protected] https://www.facebook.com/CSFWasselonne/ Quel monde voulons-nous pour demain ? Des petits camions de pompiers pour les garçons, des poupées et ustensiles de ménage pour les filles, est-ce vraiment cela que nous souhaitons pour nos enfants ? Nous sommes dans un monde dicté par l’identification par le genre, loin de préceptes d’ouverture et d’égalité. Le lundi 25 novembre nous accueillerons au sein du CSF de Wasselonne, une conférence sur l’égalité femme -homme. Ce temps d’information se déroulera lors de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Plus qu’un sujet d’actualité c’est un sujet de société que nous traiterons lors de cette soirée. La conférence sera animée par le CIDFF (centre d’information aux droits des femmes et des familles). Nous espérons vous voir nombreux afin d’échanger sur ce fléau. Gaby SIMON OUI je soutiens la publication du ICI et fais un don de : ……. € 15 € 22 € 50 € 100 € Après déduction Après déduction Après déduction Après déduction fiscale mon don fiscale mon don fiscale mon don fiscale mon don ne me coûte que ne me coûte que ne me coûte que ne me coûte que 5, 10 € 8, 80 € 17 € 34 € OUI je souhaite recevoir un reçu fiscal : Nom et Prénom : ________________________________________ Un IMMENSE MERCI Adresse : ________________________________________________ à tous ceux et celles qui ont déjà contribué ! ______________________________________________________________ Déposez ou envoyez votre don au Centre social et familial de l’AGF 2 Rue Romantica 67310 Wasselonne Réduction des impôts : vous recevrez dans les meilleurs délais un reçu fiscal qui vous permettra de déduire de vos impôts 66% du montant de votre don. -

Zones PTZ 2017
Zones PTZ 2017 - Maisons Babeau Seguin Pour construire votre maison au meilleur prix, rendez-vous sur le site de Constructeur Maison Babeau Seguin Attention, le PTZ ne sera plus disponible en zone C dès la fin 2017 et la fin 2018 pour la zone B2 Région Liste Communes N° ZONE PTZ Département Commune Région Département 2017 67 Bas-Rhin Adamswiller Alsace C 67 Bas-Rhin Albé Alsace C 67 Bas-Rhin Allenwiller Alsace C 67 Bas-Rhin Alteckendorf Alsace C 67 Bas-Rhin Altenheim Alsace C 67 Bas-Rhin Altwiller Alsace C 67 Bas-Rhin Andlau Alsace C 67 Bas-Rhin Artolsheim Alsace C 67 Bas-Rhin Aschbach Alsace C 67 Bas-Rhin Asswiller Alsace C 67 Bas-Rhin Auenheim Alsace C 67 Bas-Rhin Baerendorf Alsace C 67 Bas-Rhin Balbronn Alsace C 67 Bas-Rhin Barembach Alsace C 67 Bas-Rhin Bassemberg Alsace C 67 Bas-Rhin Batzendorf Alsace C 67 Bas-Rhin Beinheim Alsace C 67 Bas-Rhin Bellefosse Alsace C 67 Bas-Rhin Belmont Alsace C 67 Bas-Rhin Berg Alsace C 67 Bas-Rhin Bergbieten Alsace C 67 Bas-Rhin Bernardvillé Alsace C 67 Bas-Rhin Berstett Alsace C 67 Bas-Rhin Berstheim Alsace C 67 Bas-Rhin Betschdorf Alsace C 67 Bas-Rhin Bettwiller Alsace C 67 Bas-Rhin Biblisheim Alsace C 67 Bas-Rhin Bietlenheim Alsace C 67 Bas-Rhin Bindernheim Alsace C 67 Bas-Rhin Birkenwald Alsace C 67 Bas-Rhin Bischholtz Alsace C 67 Bas-Rhin Bissert Alsace C 67 Bas-Rhin Bitschhoffen Alsace C 67 Bas-Rhin Blancherupt Alsace C 67 Bas-Rhin Blienschwiller Alsace C 67 Bas-Rhin Boesenbiesen Alsace C 67 Bas-Rhin Bolsenheim Alsace C 67 Bas-Rhin Boofzheim Alsace C 67 Bas-Rhin Bootzheim Alsace C 67 Bas-Rhin -

(M Supplément) Administration Générale Et Économie 1800-1870
Archives départementales du Bas-Rhin Répertoire numérique de la sous-série 15 M (M supplément) Administration générale et économie 1800-1870 Dressé en 1980 par Louis Martin Documentaliste aux Archives du Bas-Rhin Remis en forme en 2016 par Dominique Fassel sous la direction d’Adélaïde Zeyer, conservateur du patrimoine Mise à jour du 19 décembre 2019 Sous-série 15 M – Administration générale et économie, 1800-1870 (M complément) Page 2 sur 204 Sous-série 15 M – Administration générale et économie, 1800-1870 (M complément) XV. ADMINISTRATION GENERALE ET ECONOMIE COMPLEMENT Sommaire Introduction Répertoire de la sous-série 15 M Personnel administratif ........................................................................... 15 M 1-7 Elections ................................................................................................... 15 M 8-21 Police générale et administrative............................................................ 15 M 22-212 Distinctions honorifiques ........................................................................ 15 M 213 Hygiène et santé publique ....................................................................... 15 M 214-300 Divisions administratives et territoriales ............................................... 15 M 301-372 Population ................................................................................................ 15 M 373 Etat civil ................................................................................................... 15 M 374-377 Subsistances ............................................................................................ -

1 the Organ in the Protestant Church, Romanswiller, Région De
The Organ in the Protestant Church, Romanswiller, Région de Wasselone (Stiehr-Mockers, 1843) Sourced from http://perso.orange.fr/eisenberg/orgues/romanspr.htm Translated by C E Pykett, July 2007 Correspondence re website to: [email protected] © C E Pykett 2007 Photo: Nicolas Haslé Grande-orgue (I) Positif-de-dos (II) Pédale 54 notes 54 notes 27 notes Bourdon 16 Bourdon 8 Soubasse 16 Montre 8 Prestant 4 Flûte 8 Bourdon 8 Nasard 2 2/3 Prestant 4 Salicional 8 Doublette 2 Trompette 8 Octave 4 Tierce 1 3/5 Flûte 4 Cymbale 3 rgs 1/2 I/P Doublette 2 Hautbois 8 Cornet 5 rgs (D) Fourniture 3 rgs 1 Trompette (B & D) 8 II/I 1 File: RomanswillerOrgan.doc Copyright © C E Pykett 2007 This organ in its case with flat towers typifies the style of Stiehr-Mockers, and it was installed in the spring of 1843. The case itself was designed by the architect Louis Martin Zegowitz. Since then the instrument has undergone various changes, in the course of which it has virtually lost most of its authenticity. There were two organs before that of Stiehr: The first was by Georg-Friedrich Merckel. This was commissioned by the Protestant Lutheran congregations of Romanswiller and Cosswiller in 1747. The second, from a Roman Catholic church, was by Joseph Waltrin in 1735 and came from Wasselonne. It was moved to Romanswiller in December 1791. The Merckel organ was repaired by Joseph Stiehr in 1823, and in 1842, to make way for a new organ, Stiehr-Mockers again repaired it and it was re-erected at Monswiller, whence it left again for Gottenhouse. -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère De L'écologie, De L'énergie, Du
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire NOR : DEVN0908795A Arrêté du 2 7 MAl 2009 portant désignation du site Natura 2000 MASSIF DU DONON, DU SCHNEEBERG ET DU GROSSMANN (zone spéciale de conservation) Le ministre d'État, mmtstre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et la secrétaire d'État chargée de l'écologie, Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, notamment ses articles 3 et 4 et ses annexes 1 et II ; Vu la décision de la Commission des Communautés européennes du 12 décembre 2008 arrêtant, en application de la directive 92/4 3/CEE du Conseil du 21 mai 1992, la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique continentale ; Vu le code de l'environnement, notamment le 1 et le III de l'article L. 414-1, et les articles R. 414-1, R. 414-3, R. 414-4 et R. 414-7; Vu l'arrêté du 16 novembre 2001 modifié relatif à la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages qui peuvent justifier la désignation de zones spéciales de conservation au titre du réseau écologique européen Natura 2000; Vu les avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, Arrêtent: Article 1er Est désigné sous l'appellation « site Natura 2000 MASSIF DU DONON, DU SCHNEEBERG ET DU GROSSMANN » (zone spéciale de conservation FR4201801) l'espace délimité sur la carte d'assemblage au 11100000 ainsi que sur les quatre cartes au 1/25000 ci-jointes, s'étendant sur une partie du territoire des communes suivantes du département du Bas-Rhin: Balbronn, La Broque, Cosswiller, Grandfontaine, Lutzelhouse, Oberhaslach, Still, Urmatt, Wangenbourg-Engenthal, Westhoffen. -

Autour Des Registres De Prise De Nom Des Juifs : Denombrements Et Recensements Nominatifs Des Juifs E Dans Les Communes Du Bas-Rhin Au Debut Du Xix S
GUIDE DE RECHERCHE Rechercher une personne AUTOUR DES REGISTRES DE PRISE DE NOM DES JUIFS : DENOMBREMENTS ET RECENSEMENTS NOMINATIFS DES JUIFS E DANS LES COMMUNES DU BAS-RHIN AU DEBUT DU XIX S. Eric Syssau Juin 2012 (bibliographie ajoutée en mai 2019) Les registres de prise de nom des juifs de 1808 constituent une source indispensable à consulter pour tenter de remonter une généalogie juive au-delà de cette date. Ils forment bout à bout une sorte de liste nominative de la population juive, à une époque pour laquelle ce type de recensement n’est par ailleurs pas conservé pour l’ensemble de la population. Que sont-ils exactement ? Peut-on évaluer leur état de conservation et leur exhaustivité ? Quelles autres sources consulter pour les lire de façon critique ? C’est à ces questions que cherchent à répondre ces quelques notes. Synthèse fondée sur les vérifications systématiques consignées dans le tableau *.xls joint. Les registres de prise de nom des juifs (1808) Les années 1806-1808 sont marquées dans l’Empire par de nombreuses mesures concernant les juifs1. Un décret impérial en date du 20 juillet 1808, dit « décret de Bayonne », précisé par une circulaire ministérielle du 8 septembre 1808 et, dans le Bas-Rhin, par un arrêté préfectoral du 13 septembre 18082, impose notamment aux juifs, citoyens français, n’ayant alors ni nom de famille ni prénom fixe, de faire individuellement, dans un délai de trois mois, par-devant l’officier d’état civil de la commune de leur domicile, la déclaration des noms et prénoms qu’ils adoptent pour eux et leurs enfants mineurs. -

Romanswiller
8 E 408 -- Archives communales déposées de Romanswiller 8 E 408 ROMANSWILLER 1560-1884 Dépôt effectué en 1978 I. Archives anciennes 1 Décrets, ordonnances et règlements imprimés. XVIIIe s. Nomination du baron Haindel, seigneur de Romanswiller, au poste de conseiller-assesseur du Directoire de la noblesse immédiate de Basse Alsace. 1721 Impôts royaux et seigneuriaux ; contribution des juifs, établissement de Suisses dans le village ; plaintes des laboureurs et des artisans au sujet des impôts. 1643-1789 2 Rôles de l’impôt foncier. 1742-1753 Müntzzins , droit de la monnaie de Strasbourg. 1652-1653, 1662-1665 Comptes et rôles divers, impôts royaux, vingtième. 1690, 1751-1757 3 Pièces justificatives et quittances des impôts, notamment taille seigneuriale, taille due au chapitre de Saverne (avec arrêté du tribunal de Rottweil, 1603) droit du sceau dû à l'officialité de Strasbourg, taille à payer au couvent des Pénitentes de Strasbourg, et taille forestière, droit de la monnaie de Strasbourg. 1603-1735 4 Terrier ou registre des propriétaires, et censiers de leurs biens et de leur superficie, avec index des propriétaires et censiers. 1705-1710 5 Location des biens d’Anne de Mittelhausen. 1674 Extraits cadastraux biens forains. 1788, XVIII e s. Page 1 sur 7 8 E 408 -- Archives communales déposées de Romanswiller Constitutions de rentes par la commune, 4 parch. 1560-1700 Renouvellement des biens communaux, baux, adjudications et aliénations. 1730-1784 Amodiation pour trois ans des revenus seigneuriaux à François Jacquemet, négociant à Kehl. 1784 Délimitation du ban entre Romanswiller et Cosswiller, abornement avec Allenwiller. 1753, 1777-1778 Forêt, règlements, délits, exploitation, bois de construction, accord avec Westhouse-Marmoutier sur le droit de parcours et de glandée, voirie. -
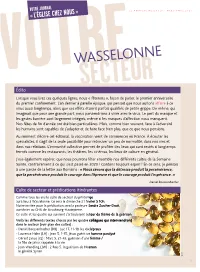
Le Nouveau Messager Mars-Avril 2021
VOTRE JOURNAL » LE NOUVEAU MESSAGER • MARS-AVRIL 2021 « L’ÉGLISE CHEZ NOUS VOTREWASSELONNESECTEUR Édito Lorsque vous lirez ces quelques lignes, nous « fêterons », façon de parler, le premier anniversaire du premier confinement. L’an dernier à pareille époque, qui pensait que nous aurions affaire à ce virus aussi longtemps, alors que ses effets étaient parfois qualifiés de petite grippe. De même, qui imaginait que pour une grande part, nous parviendrions à vivre avec le virus. Le port du masque et les gestes barrière sont largement intégrés, même si les marques d’affection nous manquent. Nos fêtes de fin d’année ont été bien particulières. Mais, comme bien souvent, face à l’adversité les humains sont capables de s’adapter et de faire face bien plus, que ce que nous pensions. Au moment d’écrire cet éditorial, la vaccination vient de commencer en France. À écouter les spécialistes, il s’agit de la seule possibilité pour retrouver un peu de normalité, dans nos vies et dans nos relations. L’immunité collective permet de profiter des lieux qui sont restés si longtemps fermés comme les restaurants, les théâtres, les cinémas, les lieux de culture en général. J’ose également espérer, que nous pourrons fêter ensemble nos différents cultes de la Semaine Sainte, contrairement à ce qui s’est passé en 2020 ! Gardons toujours espoir ! En ce sens, je pensais à une parole de la lettre aux Romains : « Nous savons que la détresse produit la persévérance, que la persévérance produit le courage dans l’épreuve et que le courage produit l’espérance. » Daniel Boessenbacher Culte de secteur et prédications itinérantes Comme tous les ans le culte de secteur du printemps aura lieu à Wasselonne. -

Pour Plus D'informations
Siège : 32a, rue du Général de Gaulle ~ 67710 Wangenbourg-Engenthal Tél. : 0033.(0)3.88.87.33.50 E-mail : [email protected] Bureau d’Accueil de Wasselonne : 13, place du Marché ~ 67310 Wasselonne Tél : 0033.(0)3.88.62.31.01 E-mail : [email protected] Pour plus d’informations : www.suisse-alsace.com HÔTELS-RESTAURANTS (*) Au Chasseur *** 7, rue de l’Église 67440 BIRKENWALD 03 88 70 61 32 (*) Les Vosges *** 15, rue du Général Leclerc 67440 BIRKENWALD 03 88 70 61 06 Le Freudeneck ** 3, route de Wangenbourg 67710 WANGENBOURG-ENGENTHAL 03 88 87 32 91 (*) Hostellerie Belle-Vue *** 16, route de Dabo 67710 WANGENBOURG-ENGENTHAL 03 88 87 32 39 (*) Le Parc Hôtel *** 39, rue du Général de Gaulle 67710 WANGENBOURG-ENGENTHAL 03 88 87 31 72 (*) Hostellerie de L’Étoile ** 1, place du Général de Gaulle 67310 WASSELONNE 03 88 87 03 02 (*) Le Relais de Wasselonne ** 4, rue des Sapins 67310 WASSELONNE 03 88 87 29 10 LOCATIONS SAISONNIERES ~ SEASONAL RENTING ~ FERIEN WOHNUNGEN Diemunsch C. - 3 épis 121, impasse de la Source 67310 BALBRONN 03 88 50 57 24 Anstotz C. - 1 épi 51, rue Balbach 67310 BALBRONN 03 88 50 30 55 (*) Farner J-C.– 2 épis 24, rue Neuve 67310 BALBRONN 03 88 50 52 84 L’Elmerforst - 1 gîte Maison Forestière Elmerforst 67310 BALBRONN 03 88 38 51 11 Wunderlich D. - Meublé 6, rue des Champs 67310 BALBRONN 03 88 50 54 83 Muhl M. - Meublé *** 1, rue de Heidekopf 67440 BIRKENWALD 03 88 03 20 78 Ring M. -

La Communaute De Communes De La Mossig Et Du Vignoble
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Département du Bas-Rhin LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE RECRUTE UN ASSISTANT EDUCATIF PETITE ENFANCE CONTRACTUEL pour remplacement suite à congé maternité de mai 2019 à février 2020 …………………………………. (poste à temps complet- 35 heures/ semaine) Date prévue de recrutement : au plus tôt Type de recrutement : catégorie C de la filière Sanitaire et sociale Cadre d’emploi: AGENT D’ANIMATION Diplôme: CAP PETITE ENFANCE ou AUXILIAIRE DE PUERICULTURE Descriptif des missions du poste : L’assistant éducatif interviendra au sein du multi accueil intercommunal « Hansel et Gretel » de Marlenheim. Il devra assister la directrice et son adjointe pour l’accueil, l‘animation et l’hygiène des très jeunes enfants. Missions permanentes : Accueil des parents et des enfants o Prendre en charge les enfants lors de leur arrivée o Prendre en considération les fiches de transmissions remplies par les parents et leur rendre compte de l’accueil au départ de l’enfant o Transmettre à la responsable les évènements survenus lors de son absence Mettre en place des activités éducatives o Proposer des activités adaptées aux enfants Prendre soin de l’enfant et de son bien être o Adapter son attitude aux particularités de l’enfant o Donner les repas et les collations en fonction de l’autonomie de l’enfant o Apporter et adapter des soins aux enfants : change, nez, lavage…. Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble 31-33- rue des Pins - 67310 WASSELONNE / Tél. 03 88 29 12 10 / www.mossigvignoble.fr / [email protected] -

Recueil Des Actes Administratifs De La Préfecture
ISSN 0299-0377 PRÉFECTURE DU BAS-RHIN RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE ANNEE 2019 N° Spécial 2 Bruche du 18 juillet RAA N° Spécial du18 juillet 2019 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE Année 2019 - N° Spécial 2 18 juillet 2019 S O M M A I R E INFORMATIONS GENERALES Les textes cités peuvent être communiqués ou consultés dans leur version intégrale sous le timbre des services concernés Le recueil des actes administratifs est consultable sur le site : http://www.bas-rhin.gouv.fr publications / publications officielles / RAA recueils des actes administratifs ACTES ADMINISTRATIFS DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - Arrêté portant limitation provisoire de certains usages de l’eau au sein de l’unité hydrographique « Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvrette » dans le département du Bas-Rhin – 18 juillet 2019… - Consultable sur le site de la préfecture du Bas-Rhin à l'adresse : http://www.bas-rhin.gouv.fr / publications / Publications officielles / RAA Recueil des actes administratifs - Dépôt légal n° 100524/06 - La Directrice de la Publication : Mme Eve KUBICKI – Secrétariat : Mme Christelle DUBUC [email protected] Annexe 1 : Liste des communes de l’unité hydrographique « Bruche, Ehn, Andlau, Giessen et Liepvrette » AEP AEP Code Code Nom S (source) Nom S (source) INSEE INSEE M (mixte) M (mixte) 67001 Achenheim 67127 Ergersheim 67003 Albé S 67128 Ernolsheim-Bruche 67004 Sommerau 67130 Erstein 67008 Altorf 67137 Fegersheim 67010 Andlau M 67139 Flexbourg 67016 Avolsheim 67143 Fouchy S 67018 Balbronn -

Bulletin Familial
BULLETIN FAMILIAL ici n° 1927 COSSWILLER Du 4 février au 17 février 2019 CRASTATT HOHENGOEFT KNOERSHEIM RANGEN ROMANSWILLER WANGEN WANGENBOURG ENGENTHAL WASSELONNE WESTHOFFEN ZEHNACKER ZEINHEIM Recueil d’informations réalisé, imprimé par l’Association Générale des Familles Centre social et familial 2, rue Romantica 67310 WASSELONNE 03 88 87 05 59 / [email protected] https://www.facebook.com/CSFWasselonne/ EDITO Débattre, échanger, donner son point de vue c’est tout à fait d’actualité. Si le temps de la discussion est nécessaire et utile pour construire son opinion, qu’en est il de concrétiser nos paroles en actes. D’ailleurs est-ce les mêmes personnes qui discutent qui doivent agir ? Et même finalement, être invité à débattre ou à s’exprimer c’est déjà agir ! Réfléchir ensemble sur des projets, des actions à mener, faire preuve « d’intelligence collective » oui mais … ! N’oublions pas la suite., l’agir. Nous pouvons cependant nous questionner : Suis-je capable de donner du temps à une cause ? Est-ce compatible avec mon emploi du temps de famille, ou ai-je envie de rendre mon emploi du temps compatible ? Est-ce que je sais où m’adresser ? Mais serai-je bien accueilli ? M’engager pour les autres oui, mais est ce que l’on s’engage pour moi ? Autant de questions qui interrogent la place donnée aux bénévoles, aux parents, aux aidants de toute nature dans les collectivités et les associations. Une place à donner, une place à valoriser. Accueillir, accompagner, valoriser et remercier, essayons à notre niveau de suivre ce parcours qui renforce le lien social et qui permet à toute les générations de Distribution du bulletin familial ICI La distribution du bulletin familial ne se fera plus par voie de boite aux lettres pour des raisons financières sauf pour quelques communes (Cosswiller, Knœrsheim, Rangen, Zeinheim, Zehnacker).