Jules Lechevalier
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Right to the Whole Produce of Labour
1RNIA SAN DIEGO THE EIGHT TO THE WHOLE PRODUCE OF LABOUR THE EIGHT TO THE WHOLE PBODUCE OF LABOUK THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF THE THEORY OF LABOUR'S CLAIM TO THE WHOLE PRODUCT OF INDUSTRY BY DK. ANTON MENGEK PROFESSOR OF JURISPRUDENCE IN THE UNIVERSITY OF VIENNA TRANSLATED BY M. E. TANNER WITH AN INTRODUCTION AND BIBLIOGRAPHY BY H. S. FOXWELL, M.A. PROFESSOR OF ECONOMICS AT UNIVERSITY COLLEGE, LONDON ; LECTURER AND LATE FELLOW OF ST. JOHN'S COLLEGE, CAMBRIDGE Hontion MACMILLAN AND CO., LIMITED NEW YORK: THE MACMILLAN COMPANY 1899 A II rights reserved INTRODUCTION DR. ANTON MENGER'S remarkable study of the cardinal Dr doctrine of revolutionary socialism, now for the first W time published in English, has long enjoyed a wide reputation on the Continent; and English students of social philosophy, whether or not they are familiar with the original, will welcome its appearance in this trans- lation. The interest and importance of the subject will not be disputed, either by the opponents or the advocates of socialism ; and those who know how exceptionally Dr. Menger is qualified for work of this kind, by his juristic eminence, and his profound know- ledge of socialistic literature, will not need to be told that it has been executed with singular vigour and ability. Hitherto, perhaps because it was not generally accessible to English readers, the book has not received in this country the notice that it has met with elsewhere. Yet there are reasons why it should be of peculiar interest to English economists. The particular method of criticism adopted by Dr. -

French Romantic Socialism and the Critique of Liberal Slave Emancipation Naomi J
Santa Clara University Scholar Commons History College of Arts & Sciences 9-2013 Breaking the Ties: French Romantic Socialism and the Critique of Liberal Slave Emancipation Naomi J. Andrews Santa Clara University, [email protected] Follow this and additional works at: http://scholarcommons.scu.edu/history Part of the European History Commons, and the Feminist, Gender, and Sexuality Studies Commons Recommended Citation Andrews, Naomi J. (2013). Breaking the Ties: French Romantic Socialism and the Critique of Liberal Slave Emancipation. The ourJ nal of Modern History, Vol. 85, No. 3 (September 2013) , pp. 489-527. Published by: The nivU ersity of Chicago Press. Article DOI: 10.1086/668500. Article Stable URL: http://www.jstor.org/stable/10.1086/668500 This Article is brought to you for free and open access by the College of Arts & Sciences at Scholar Commons. It has been accepted for inclusion in History by an authorized administrator of Scholar Commons. For more information, please contact [email protected]. Breaking the Ties: French Romantic Socialism and the Critique of Liberal Slave Emancipation* Naomi J. Andrews Santa Clara University What we especially call slavery is only the culminating and pivotal point where all of the suffering of society comes together. (Charles Dain, 1836) The principle of abolition is incontestable, but its application is difficult. (Louis Blanc, 1840) In 1846, the romantic socialist Désiré Laverdant observed that although Great Britain had rightly broken the ties binding masters and slaves, “in delivering the slave from the yoke, it has thrown him, poor brute, into isolation and abandonment. Liberal Europe thinks it has finished its work because it has divided everyone.”1 Freeing the slaves, he thus suggested, was only the beginning of emancipation. -

The Paris Diary of Albert Brisbane, American Fourierist
Syracuse University SURFACE The Courier Libraries 1997 Dreams and Expectations: The Paris Diary of Albert Brisbane, American Fourierist Abigail Mellen Follow this and additional works at: https://surface.syr.edu/libassoc Part of the Philosophy Commons Recommended Citation Mellen, Abigail. "Dreams and Expectations: The Paris Diary of Albert Brisbane, American Fourierist," The Courier 1997: 195-122. This Article is brought to you for free and open access by the Libraries at SURFACE. It has been accepted for inclusion in The Courier by an authorized administrator of SURFACE. For more information, please contact [email protected]. SYRACUSE UNIVERSITY LIBRARY ASSOCIATES COURIER VOLUME XXXII· 1997 SYRACUSE UNIVERSITY LIBRARY ASSOCIATES COURIER VOLUME XXXII 1997 Ivan Mestrovic in Syracuse, 1947-1955 By David Tatham, Professor ofFine Arts 5 Syracuse University In 1947 Chancellor William P. Tolley brought the great Croatian sculptor to Syracuse University as artist-in-residence and professor ofsculpture. Tatham discusses the his torical antecedents and the significance, for Mdtrovic and the University, ofthat eight-and-a-half-year association. Declaration ofIndependence: Mary Colum as Autobiographer By Sanford Sternlicht, Professor ofEnglish 25 Syracuse University Sternlicht describes the struggles ofMary Colum, as a woman and a writer, to achieve equality in the male-dominated literary worlds ofIreland and America. A CharlesJackson Diptych ByJohn W Crowley, Professor ofEnglish 35 Syracuse University In writings about homosexuality and alcoholism, CharlesJackson, author ofThe Lost TtVeekend, seems to have drawn on an experience he had as a freshman at Syracuse University. Mter discussingJackson's troubled life, Crowley introduces Marty Mann, founder ofthe National Council on Alcoholism. Among her papers Crowley found a CharlesJackson teleplay, about an alcoholic woman, that is here published for the first time. -

A History of the French in London Liberty, Equality, Opportunity
A history of the French in London liberty, equality, opportunity Edited by Debra Kelly and Martyn Cornick A history of the French in London liberty, equality, opportunity A history of the French in London liberty, equality, opportunity Edited by Debra Kelly and Martyn Cornick LONDON INSTITUTE OF HISTORICAL RESEARCH Published by UNIVERSITY OF LONDON SCHOOL OF ADVANCED STUDY INSTITUTE OF HISTORICAL RESEARCH Senate House, Malet Street, London WC1E 7HU First published in print in 2013. This book is published under a Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY- NCND 4.0) license. More information regarding CC licenses is available at https://creativecommons.org/licenses/ Available to download free at http://www.humanities-digital-library.org ISBN 978 1 909646 48 3 (PDF edition) ISBN 978 1 905165 86 5 (hardback edition) Contents List of contributors vii List of figures xv List of tables xxi List of maps xxiii Acknowledgements xxv Introduction The French in London: a study in time and space 1 Martyn Cornick 1. A special case? London’s French Protestants 13 Elizabeth Randall 2. Montagu House, Bloomsbury: a French household in London, 1673–1733 43 Paul Boucher and Tessa Murdoch 3. The novelty of the French émigrés in London in the 1790s 69 Kirsty Carpenter Note on French Catholics in London after 1789 91 4. Courts in exile: Bourbons, Bonapartes and Orléans in London, from George III to Edward VII 99 Philip Mansel 5. The French in London during the 1830s: multidimensional occupancy 129 Máire Cross 6. Introductory exposition: French republicans and communists in exile to 1848 155 Fabrice Bensimon 7. -
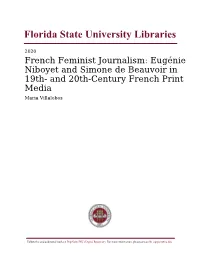
View Before Discussing Each of the Feminist Journalists’ Works
)ORULGD6WDWH8QLYHUVLW\/LEUDULHV 2020 French Feminist Journalism: Eugénie Niboyet and Simone de Beauvoir in 19th- and 20th-Century French Print Media Maria Villalobos Follow this and additional works at DigiNole: FSU's Digital Repository. For more information, please contact [email protected] THE FLORIDA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS & SCIENCES FRENCH FEMINIST JOURNALISM: EUGÉNIE NIBOYET AND SIMONE DE BEAUVOIR IN 19TH- AND 20TH-CENTURY FRENCH PRINT MEDIA By MARIA VILLALOBOS A Thesis submitted to the Department of Modern Languages and Linguistics in partial fulfillment of the requirements for graduation with Honors in the Major Degree Awarded: Spring, 2020 Th m mbers of th D fens Committ approve this th sis of Maria Villalobos defended on April 15, 2020. ______________________________ Dr. Aimé Boutin Th sis Director ______________________________ Dr. Maxine Jones Outside Committ M mber ______________________________ Dr. Micha la Hulstyn Committ M mber Doc ID: a7be883424db5bc2173f101cfa1aee58a66a44d0 Villalobos 1 Table of Contents Abstract……………………………………………………………………….2 Introduction…………………………………………………………………3-6 Section 1 – Historical context of 19th century France and Women……….7-21 Section 2 – Eugénie Niboyet’s Life and Feminist Journalism…………...22-39 Section 3 – Historical context of 20th century France and Women……...40-45 Section 4 – Simone de Beauvoir’s Life and Feminist Journalism……….46-72 Conclusion……………………………………………………………….73-75 Bibliography……………………………………………………………..76-79 Villalobos 2 Abstract Topic: Women’s studies, Journalism, French literature, French history The emergence of early feminism through the printed word — journals, magazines, pamphlets — allowed women’s political voices to be heard and for their cause to be taken with seriousness, whether positively or negatively, by French society. Women’s continuous progress in all aspects, social, political, economic, can be attributed to the collective efforts of early feminists. -

Copyright by Rondel Van Davidson 1970 ^X^''--V
Copyright by Rondel Van Davidson 1970 ^x^''--V VICTOR CONSIDERANT: FOURIERIST, LEGISLATOR, AND HUMANITARIAN by RONDEL VAN DAVIDSON, B.A., M.A. A DISSERTATION IN HISTORY Submitted to the Graduate Faculty of Texas Tech University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY December, 1970 SOI Mo.25 ACKN0V7LEDGMENTS I am deeply indebted to Professor Lowell L. Blaisdell for his direction of this dissertation and to the other members of my committee. Professors Jacquelin Collins, Kenneth Davis, Lawrence Graves, James Harper, and George Robbert, for their helpful criticism. I would also like to thank Professor Louise Robbert of the Department of History at Texas Tech University, Professor Sylvan Dunn, Director of the Southwest Collection at Texas Tech Univer sity, and Madam.e Chantal de Tourtier Bonazzi, Chief Archivist at the Archives Nationales, Paris, France, for valuable assistance. Ill CONTENTS Page ACKNOWLEDGMENTS iii CHAPTER I. BACKGROUI-ro AND EARLY LIFE, I808-I832 . II. THE ENGINEER AS A FLEDGLING IN RADICAL SOCIALIST THEORY, I832-I837 . 25 III. THE RADICAL SOCIALIST AS THEORIST, 57 1837-1848 , 100 IV. THE SOCIALIST AS ACTIVIST, l837-l848 . , V. THE HUMANIST AS POLITICIAN, FEBRUARY 138 1848-NOVEMBER l848 , VI. THE PACIFIST AS REVOLUTIONIST, NOVEMBER 1848-JUNE 1849 , 181 VII. THE EXILE AS OPTIMIST, JULY l849- 222 DECEMBER l854 , 242 VIII. THE OPTIMIST AS DEFEATIST, I855-I869 . , IX. THE FRONTIERSM-AN AS SOCIALIST SAGE, 267 1869-1893 . BIBLIOGRAPHY 288 IV CHAPTER I BACKGROUND AND EARLY LIFE, I808-I832 At noon, on December 28, I893, a funeral proces sion made its way down the Avenue de la Bourdonnais in Paris toward the cemetery at Pere-Lachaise. -

A Civil Society
Southern Illinois University Carbondale OpenSIUC Follow this and additional works at: https://opensiuc.lib.siu.edu/histcw_cs IssuedA Civil Society:under a TheCC B PublicY-NC-ND Space 4.0 license:of Freemason https:/ /creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 Women in France, 1744-1944 Creative Works A Civil Society explores the struggle to initiate women as full participants in the masonic brotherhood that shared in the rise of France’s civil society and its civic morality on behalf of 4-9-2021 women’s rights. As a vital component of the third sector during France’s modernization, Afreemasonr Civil Society:y empower Theed women Public in complex Space social of networks,Freemason contributing Women to a mor ine liberFrance,al republic, a more open society, and a more engaged public culture. The1744-1944 work shows that although women initially met with stiff resistance, their induction into the brotherhood was a significant step in the development of French civil society and its civic James Allen Southernmorality, Illinoisincluding Univ theersity pr omotionCarbondale of, [email protected]’s rights in the late nineteenth century. Pulling together the many gendered facets of masonry, Allen draws from periodicals, memoirs, and copious archival material to account for the rise of women within the masonic brotherhood in the context of rapid historical change. Thanks to women’s social networks and their attendant social capital, masonry came to play a leading role in French civil society and the rethinking of gender relations in the public sphere. “James Smith Allen presents readers with an engaging, kaleidoscopic account of the uphill and contentious struggle to include select women as full participants in the arcane brotherhood of French freemasonry.”—Karen Offen, author of Debating the Woman Question in the French Third Republic, 1870–1920 “A Civil Society is important because it connects the activism and writing of major figures in French women’s history with masonic networks and impulses. -

Downloaded From: Books at JSTOR, EBSCO, Hathi Trust, Internet Archive, OAPEN, Project MUSE, and Many Other Open Repositories
A Civil Society e Public Space of Freemason Women in France, – • James Smith Allen © by the Board of Regents of the University of Nebraska All rights reserved ISBN (hardcover) ISBN (epub) ISBN (pdf) Cover image: Jacques France [Paul Lecreux], Marianne Maçonnique (), bronze bust, Musée de la Franc-Maçonnerie, Paris, Collection du Grand Orient de France, photo P. M. is book is published as part of the Sustainable History Monograph Pilot. With the generous support of the Andrew W. Mellon Foundation, the Pilot uses cutting-edge publishing technology to produce open access digital editions of high-quality, peer-reviewed monographs from leading university presses. Free digital editions can be downloaded from: Books at JSTOR, EBSCO, Hathi Trust, Internet Archive, OAPEN, Project MUSE, and many other open repositories. While the digital edition is free to download, read, and share, the book is under copyright and covered by the following Creative Commons License: BY-NC-ND. Please consult www.creativecommons.org if you have questions about your rights to reuse the material in this book. When you cite the book, please include the following URL for its Digital Object Identier (DOI): https://doi.org/ . / We are eager to learn more about how you discovered this title and how you are using it. We hope you will spend a few minutes answering a couple of questions at this url: https://www.longleafservices.org/shmp-survey/ More information about the Sustainable History Monograph Pilot can be found at https://www.longleafservices.org. À Anne encore et toujours Sainz alexis est el ciel senz dutance ensembl’ot deu e la compaignie as angeles • od la pulcela dunt il se st si estranges • or l’at od sei ansemble sunt lur anames • ne vus sai dirre cum lur ledece est grande. -

D I a R Y 1830 – 1839
BOGDAN JANSKI D I A R Y 1830 – 1839 FOTO La scritta sotto la foto Servant of God, BOGDAN THEODORE JANSKI Founder of the Congregation of the Resurrection DNJC Apostle to the Polish Immigrants in France Died in Rome, July 2, 1840 Age 33 years B O G D A N J A N S K I D I A R Y 1830 – 1839 with footnotes Edited and arranged by ANDRZEJ JASTRZĘBSKI English translation by Fr. FRANCIS GRZECHOWIAK, C.R. ROME 2000 PRINTED WITH THE PERMISSION: Of the Superior General FR. SUTHERLAND MACDONALD, C.R. Rome, June 6, 2003. _____ * _____ All rights reserved. No part of this work may be reproduced in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording ta- ping, or any retrieval system, without the written permission of a member of the General Curia of the Congregation of the Resurrection, Via San Sebastia- nello 11, 00187 Roma, Italia. © Copyright 2003 by the Congregation of the Resurrection DNJC, Rome English translation by Fr. FRANCIS GRZECHOWIAK, C.R. The text was prepared for printing by Ms. LILIANA DRÓŻDŻ C O N T E N T S FORWARD (Fr. Sutherland MacDonald, C.R.)…………………………………………………………XI ABOUT BOGDAN JAŃSKI - THE SKETCH OF A PORTRAIT (Andrzej Jastrzębski).....................................................................................................……XIV CONCERNING BOGDAN JAŃSKI'S DIARY - EDITORIAL NOTE (Andrzej Jastrzębski) ..................................……………………………………………XXXI BOGDAN JAŃSKI, JOURNEY DIARY NOTES YEAR 1828..................................……………1 PRIVATE DIARY FOR THE YEAR 1828………………………………………….…………….13 D I A R Y 1830-1839 DIARY FOR THE YEAR 1830…………………………………………………………………….21 APPENDIX: I. FOR CLARIFICATION…………………………………………………………………..65 II. ORGANIZATION OF MY FUTURE LIFE…………………………………………….66 NOTE CONCERNING THE LIFE OF C.H. -

Crises in Early French Dictionaries and Encyclopaedias (1830-1840) Ludovic Frobert
Between progress and decline : crises in early French dictionaries and encyclopaedias (1830-1840) Ludovic Frobert To cite this version: Ludovic Frobert. Between progress and decline : crises in early French dictionaries and encyclopaedias (1830-1840). Besomi, Daniele. Crises and business cycles in economic dictionaries and encyclopaedias, Routledge, pp.167-176, 2012. halshs-00714949 HAL Id: halshs-00714949 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00714949 Submitted on 23 Jun 2017 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. XI. Between progress and decline : crises in early French dictionaries and encyclopaedias (1830-1840) Ludovic Frobert CNRS/TRIANGLE Encyclopédie du dix-neuvième siècle, répertoire universel des sciences, des lettres et des arts, avec la biographie de tous les hommes célèbres, Paris : au bureau de "l'Encyclopédie du XIXe siècle" (1836-1853). Encyclopédie des gens du monde, répertoire universel des sciences, des lettres et des arts [Texte imprimé] : avec des notices sur les principales familles historiques et sur les personnages célèbres, morts et vivans, par une société de savans, de littérateurs et d'artistes, français et étrangers, Paris : Treuttel et Würtz, 1833-1844. Dictionnaire du commerce et des marchandises contenant tout ce qui concerne le commerce de terre et de mer, Paris, Guillaumin, 1839. -
The Saint-Simonians and the Birth of Social Justice in France Adrien Lutz
The Saint-Simonians and the birth of social justice in France Adrien Lutz To cite this version: Adrien Lutz. The Saint-Simonians and the birth of social justice in France. 2018. halshs-01963236 HAL Id: halshs-01963236 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01963236 Preprint submitted on 21 Dec 2018 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. WP 1836 – December 2018 The Saint-Simonians and the birth of social justice in France Adrien Lutz Abstract: This paper concerns the birth of the idea of social justice, which in France dates to the 19th century. It argues that the idea of social justice was able to emerge in France due to particular conditions, which were met for the first time by the Saint-Simonians. We first shed light on the transition in France from a commercial system to one marked by increasing industrialization, which raised new questions regarding economic justice and the composition of ownership. The Saint-Simonians were among the first to criticize this new composition, and to seek a means to organize society on a fair basis. We then explain how the Saint-Simonians came to theorize this new organization: according to them, the value of things lies in work. -

0 De L'organisation Du Travail À L'entreprenariat Social Le Rôle De L
De l’organisation du travail à l’entreprenariat social Le rôle de l’économie sociale et solidaire dans le management et les cycles des affaires du XIXe siècle à nos jours Auteur : Olivier CHAÏBI, docteur en histoire, PRAG à l’UPEC Résumé : L’économie sociale et solidaire (ESS) est issue en grande partie de théories qualifiées d’utopiques, comme le saint-simonisme ou le fouriérisme. Ces théories et leurs partisans ont pourtant joué un rôle déterminant dans la question de l’organisation du travail et ont influencé l’entreprenariat social. Elles sont également à l’origine de méthodes de management qui prétendent apporter le bonheur à tous et notamment aux travailleurs. Nées dans un contexte de crise, les théories et pratiques de l’économie sociale ne cessent de se renouveler dans les périodes de récession. Souvent négligée par les modèles économiques dominant, l’ESS est présentée par ses partisans comme un moyen de sortir de la crise contemporaine. Après avoir exposé leurs arguments, cet article propose alors de montrer les influences de l’ESS sur le management contemporain et d’intégrer l’économie sociale aux cycles économiques issus de l’analyse schumpetérienne. Mots-clefs : Economie sociale (et solidaire) – saint-simonisme – fouriérisme – crise – innovation – management – cycle des affaires (Schumpeter) 0 « Saint-Simon, Fourier, Owen (…), se sont efforcés de résoudre la grande question de l’organisation du travail ; il suffisait de toucher à cette plaie, fût-ce même dans l’intention d’y verser un palliatif, pour éveiller l’attention ardente, irritée du corps social. Tous les trois se sont signalés par des découvertes qu’ils ont eu le tort de vouloir ériger en système et pousser à leurs dernières conséquences1.