Read Ebook {PDF EPUB} Berberes D'aujourd'hui By
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Download Download
Nisan / The Levantine Review Volume 4 Number 2 (Winter 2015) Identity and Peoples in History Speculating on Ancient Mediterranean Mysteries Mordechai Nisan* We are familiar with a philo-Semitic disposition characterizing a number of communities, including Phoenicians/Lebanese, Kabyles/Berbers, and Ismailis/Druze, raising the question of a historical foundation binding them all together. The ethnic threads began in the Galilee and Mount Lebanon and later conceivably wound themselves back there in the persona of Al-Muwahiddun [Unitarian] Druze. While DNA testing is a fascinating methodology to verify the similarity or identity of a shared gene pool among ostensibly disparate peoples, we will primarily pursue our inquiry using conventional historical materials, without however—at the end—avoiding the clues offered by modern science. Our thesis seeks to substantiate an intuition, a reading of the contours of tales emanating from the eastern Mediterranean basin, the Levantine area, to Africa and Egypt, and returning to Israel and Lebanon. The story unfolds with ancient biblical tribes of Israel in the north of their country mixing with, or becoming Lebanese Phoenicians, travelling to North Africa—Tunisia, Algeria, and Libya in particular— assimilating among Kabyle Berbers, later fusing with Shi’a Ismailis in the Maghreb, who would then migrate to Egypt, and during the Fatimid period evolve as the Druze. The latter would later flee Egypt and return to Lebanon—the place where their (biological) ancestors had once dwelt. The original core group was composed of Hebrews/Jews, toward whom various communities evince affinity and identity today with the Jewish people and the state of Israel. -

Convention on the Elimination of Racial Discrimination Alternative Report Submission Indigenous Rights Violations in Algeria
Convention on the Elimination of Racial Discrimination Alternative Report Submission Indigenous Rights Violations in Algeria Prepared for: The 94th Session of the Convention on the Elimination of Racial Discrimination Submission Date: November 2017 Submitted by: Cultural Survival 2067 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02140 Tel: 1 (617) 441 5400 [email protected] www.culturalsurvival.org I. Reporting Organization Cultural Survival is an international Indigenous rights organization with a global Indigenous leadership and consultative status with ECOSOC since 2005. Cultural Survival is located in Cambridge, Massachusetts, and is registered as a 501(c)(3) non-profit organization in the United States. Cultural Survival monitors the protection of Indigenous Peoples' rights in countries throughout the world and publishes its findings in its magazine, the Cultural Survival Quarterly, and on its website: www.cs.org. Cultural Survival also produces and distributes quality radio programs that strengthen and sustain Indigenous languages, cultures, and civil participation. II. Background Information: History, Population and Regions The total population of Algeria is estimated to be just over 41 million.1 The majority of the population — about 90% — are the Arab people living in the northern coastal regions.2 In addition, Algeria also has a nomadic or semi-nomadic population of about 1.5 million.3 Generally, the Indigenous People of Algeria are called Berbers; however, the term is regarded as a pejorative, as it comes from the word “barbarian.”4 As a result, although not officially recognized as Indigenous,5 Algeria's Indigenous Peoples self-identity as the Imazighen (plural) or Amazigh (singular).6 Due to lack of recognition, there is no official statistics or disaggregated data available on Algeria’s Indigenous population. -

French and Spanish Colonial Policy in North Africa: Revisiting the Kabyle and Berber Myth Mohand Tilmatine
French and Spanish colonial policy in North Africa: revisiting the Kabyle and Berber myth Mohand Tilmatine To cite this version: Mohand Tilmatine. French and Spanish colonial policy in North Africa: revisiting the Kabyle and Berber myth. International Journal of the Sociology of Language, De Gruyter, 2016, 2016 (239), pp.95-119. 10.1515/ijsl-2016-0006. hal-01824567 HAL Id: hal-01824567 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01824567 Submitted on 27 Jun 2018 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. IJSL 2016; 239: 95–119 Mohand Tilmatine* French and Spanish colonial policy in North Africa: revisiting the Kabyle and Berber myth DOI 10.1515/ijsl-2016-0006 Abstract: The French colonial presence in North Africa gave rise to a view that was founded on attributing certain – supposedly distinctive – qualities to the Kabyle people (Algeria) and the Berber people in general (Algeria and Morocco). This became known as “the Kabyle (or Berber) myth” and was propagated both by North African nationalists and by the academic world in order to validate their accusations against the colonial powers of practicing a “divide and conquer” policy. What’s more, from the outset, the French and Spanish colonial govern- ments, by empowering Arabic as an imperial and dominant language to the detriment of the peripheral and low prestige Berber languages, greatly contributed to the widespread acceptance of a further myth, i. -

Amazigh-State Relations in Morocco and Algeria
Calhoun: The NPS Institutional Archive Theses and Dissertations Thesis Collection 2013-06 Amazigh-state relations in Morocco and Algeria Kruse, John E.,III Monterey, California: Naval Postgraduate School http://hdl.handle.net/10945/34692 NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL MONTEREY, CALIFORNIA THESIS AMAZIGH-STATE RELATIONS IN MOROCCO AND ALGERIA by John E. Kruse III June 2013 Thesis Advisor: Mohammed Hafez Second Reader: Tristan Mabry Approved for public release; distribution is unlimited THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK REPORT DOCUMENTATION PAGE Form Approved OMB No. 0704–0188 Public reporting burden for this collection of information is estimated to average 1 hour per response, including the time for reviewing instruction, searching existing data sources, gathering and maintaining the data needed, and completing and reviewing the collection of information. Send comments regarding this burden estimate or any other aspect of this collection of information, including suggestions for reducing this burden, to Washington headquarters Services, Directorate for Information Operations and Reports, 1215 Jefferson Davis Highway, Suite 1204, Arlington, VA 22202–4302, and to the Office of Management and Budget, Paperwork Reduction Project (0704–0188) Washington, DC 20503. 1. AGENCY USE ONLY (Leave blank) 2. REPORT DATE 3. REPORT TYPE AND DATES COVERED June 2013 Master’s Thesis 4. TITLE AND SUBTITLE 5. FUNDING NUMBERS AMAZIGH-STATE RELATIONS IN MOROCCO AND ALGERIA 6. AUTHOR(S) John E. Kruse III 7. PERFORMING ORGANIZATION NAME(S) AND ADDRESS(ES) 8. PERFORMING ORGANIZATION Naval Postgraduate School REPORT NUMBER Monterey, CA 93943–5000 9. SPONSORING /MONITORING AGENCY NAME(S) AND ADDRESS(ES) 10. SPONSORING/MONITORING N/A AGENCY REPORT NUMBER 11. SUPPLEMENTARY NOTES The views expressed in this thesis are those of the author and do not reflect the official policy or position of the Department of Defense or the U.S. -

Scholarly Myths and Colonial Realities
Robert Aldrich. Greater France: A History of French Overseas Expansion (European Studies Series). New York: St. Martin's Press, 1996. x + 369 pp. $37.95, paper, ISBN 978-0-312-16000-5. Patricia M. E. Lorcin. Imperial Identities: Stereotyping, Prejudice and Race in Colonial Algeria (Society and Culture in the Modern Middle East). London: I.B. Tauris, 1995. x + 323 pp. $69.95, cloth, ISBN 978-1-85043-909-7. Reviewed by Leland Barrows Published on H-France (March, 1999) The two books being reviewed reflect to vary‐ fore or after the independence of the territories in ing degrees two intellectual currents that have which they worked. been gaining momentum since the early 1980s: a These books are of quite different genres. general interest in what is called post-colonial Robert Aldrich has written an introductory sur‐ studies and a rekindling of interest, particularly vey destined, as are all the volumes in the "Euro‐ in France, in French imperial/colonial history. The pean Studies Series" of St. Martin's Press, to be first of these currents tends to be both interna‐ read by anglophone undergraduate university tional and interdisciplinary, owing much to the students. An associate professor at the University publication of Professor Edward Said's, Oriental‐ of Sydney, Aldrich is a specialist in French history ism (New York: Vintage, 1979). The other, a more with a strong interest in the current French pres‐ discipline-based current, reflects both French nos‐ ence in the Pacific.[1] Like fellow-Australian, talgia for the former colonies and the coming to Stephen Henry Roberts,[2] in whose footsteps he maturity of numbers of French scholars with colo‐ is to a greater or lesser extent treading, he has a nial and/or Algerian backgrounds. -
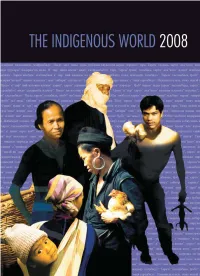
The Indigenous World 2008
THE INDIGENOUS WORLD 2008 Copenhagen 2008 THE INDIGENOUS WORLD 2008 Compilation and editing: Kathrin Wessendorf Regional editors: The Circumpolar North & North America: Kathrin Wessendorf Central and South America: Alejandro Parellada Australia and the Pacific: Kathrin Wessendorf Asia: Christian Erni and Mille Lund Africa: Marianne Wiben Jensen International Processes: Lola García-Alix Cover and typesetting: Jorge Monrás Maps: Berit Lund and Jorge Monrás English translation and proof reading: Elaine Bolton Prepress and Print: Eks-Skolens Trykkeri, Copenhagen, Denmark © The authors and The International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), 2008 - All Rights Reserved The reproduction and distribution of HURRIDOCS CIP DATA information contained in The Indige- Title: The Indigenous World 2008 nous World is welcome as long as the Edited by: Kathrin Wessendorf source is cited. However, the transla- Pages: 578 tion of articles into other languages ISSN: 1024-0217 and the reproduction of the whole ISBN: 9788791563447 BOOK is not allowed without the con- Language: English sent of IWGIA. The articles in The In- Index: 1. Indigenous Peoples – 2. Yearbook – digenous World reflect the authors’ 3. International Processes own views and opinions and not nec- Geografical area: World essarily those of IWGIA itself, nor can Publication date: April 2008 IWGIA be held responsible for the ac- curacy of their content. The Indigenous World is published Distribution in North America: annually in English and Spanish. Transaction Publishers 300 McGaw Drive Director: Lola García-Alix Edison, NJ 08837 Administrator: Anni Hammerlund www.transactionpub.com This book has been produced with financial support from the Danish Ministry of Foreign Affairs, NORAD, Sida and the Ministry for Foreign Affairs of Finland. -

El Ishaa 8 A.Indd
E Iʕãʕ Nn Is - De 2017 Tamazight an Official Language in Algeria: a Stop or a Start to Conflicts Asma Zahaf, Djillali Liabes University, Sidi Bel Abbes, Algeria. Samira Houcine Abid, CEIL, Djillali Liabes University, Sidi Bel Abbes, Algeria. ABSTRACT his paper aims at predicting the future of the language policy in Algeria Tby defining the factual vis-à-vis the official status of Tamazight, after the last constitutional amendment. This is a small attempt to reveal the authentic use of Tamazight and sketch out the origins of the Berber crisis in the country. The most relevant concepts are first examined theoretically and an overview of the Algerian linguistic situation is then provided. Historical and official documents related, to some extent, to the officialisation of Tamazight are sur- veyed here. Finally, some dimensions of this shift in the Algerian language policy are described to know whether such a decision is the right choice that might put an end to the language conflict, or is a step for new demands. Key words: Arabic – Tamazight – officialisation – constitution – Official lan- guage – language planning – language policy. العريــة – اﻷمازغيــة – ترســيم – الدســتور – لغــة رســمية – التخطيــط اللغــوي – السياســة اللغوــة . 63 E Iʕãʕ Nn Is - De 2017 1- Introduction: ‘Tamazight will never be an official language’, repeated by President A. Bouteflika, is the notion that has annulled to some extent expecting a shift in the Algerian language policy. Yet, February 07th, 2016, was a day of triumph for the Berbers, when the state declared officialising Tamazight and Benghabrit (1) called for its teaching through the national territory. A clear eu- phoria marked Kabylia, viz. -

Semiotic and Discursive Displays of Tamazight Identity on Facebook: a Sociolinguistic Analysis of Revitalization Efforts in Post-Revolutionary Tunisia
City University of New York (CUNY) CUNY Academic Works All Dissertations, Theses, and Capstone Projects Dissertations, Theses, and Capstone Projects 5-2019 Semiotic and Discursive Displays of Tamazight Identity on Facebook: A Sociolinguistic Analysis of Revitalization Efforts in Post-Revolutionary Tunisia Soubeika Bahri The Graduate Center, City University of New York How does access to this work benefit ou?y Let us know! More information about this work at: https://academicworks.cuny.edu/gc_etds/3098 Discover additional works at: https://academicworks.cuny.edu This work is made publicly available by the City University of New York (CUNY). Contact: [email protected] SEMIOTIC AND DISCURSIVE DISPLAYS OF TAMAZIGHT IDENTITY ON FACEBOOK: A SOCIOLINGUISTIC ANALYSIS OF REVITALIZATION EFFORTS IN POST-REVOLUTIONARY TUNISIA by SOUBEIKA (WAFA) BAHRI A dissertation submitted to the Graduate Faculty in Linguistics in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, The City University of New York. 2019 ©2019 SOUBEIKA (WAFA) BAHRI All Rights Reserved ii Semiotic and Discursive Displays of Tamazight Identity on Facebook: A Sociolinguistic Analysis of Revitalization Efforts in Post-Revolutionary Tunisia. by Soubeika (Wafa) Bahri This manuscript has been read and accepted for the Graduate Faculty in Linguistics in satisfaction of the dissertation requirement for the degree of Doctor of Philosophy. _________________ _________________________________________ Date Cecelia Cutler Chair of Examining Committee _________________ _________________________________________ Date Gita Martohardjono Executive Officer Supervisory Committee: Michael Newman Miki Makihara Lotfi Sayahi THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK iii ABSTRACT Semiotic and Discursive Displays of Tamazight Identity on Facebook: A Sociolinguistic Analysis of Revitalization Efforts in Post-Revolutionary Tunisia. -

Amazighs Berbers in Algeria an Ethnic Majority Yet a Linguistic Minority
Minorities, Women, and the State in North Africa/ “Amazighs in Algeria: an ethnic majority yet a 2013 linguistic minority”, by A. DOURARI, University Algiers2, CNPLET/MEN Algeria Amazighs (Berbers) in Algeria: an ethnic majority yet a linguistic minority By Abderrezak DOURARI “North Africa is like an island located between the Mediterranean and the Sahara. Waves of human encounters and interactions have swept ashore and shaped the “island’s” rich cultural and historical morphology. Accordingly, extraordinary peoples and histories have fashioned an impressive transcultural legacy” (Naylor, 2009:21) It goes without saying that one of the most obvious components of identity customarily referred to by ethnographers and anthropologists is language. If it is an unquestioned criterion for them, it is even more irresistible for the layman in multilingual societies. In fact, identities are circulated according to the languages that are spontaneously spoken. In nowadays multilingual Algeria, a citizen is said Kbayli, Chaoui, Mzabi, Targui, Chelhi, Chenoui… (Amazigh) when he speaks anyone of these corresponding varieties of Tamazight (Berber) and, correspondingly, the one who speaks Algerian Arabic is declared Arab. Moreover, people would assign identities according to regional origins: Jijelis (from Jijel, East of Algeria), Kbayli (from Kabilya), Stayfi (from Setif, East of Algeria), Sahrawi (from the Sahara regions), Wahrani (from the western regions of Algeria) and pretend they have a clear cut idea of them so well that they would be able to predict their behavior. From this point of view, the Algerians perceive their identity today as an intricate fabric mixing different languages, accents, colors, and regions, but nonetheless recognizable altogether as Algerians. -

Présentation Powerpoint
Berbers Amazighs (Berbers) are the native (autochthonous) people of North Africa, having an appropriate language, culture and history. "Amazigh" is the name that the Berbers gave to themselves and which means " free man ". The Berber word comes from the Latin " barbarus ", used by Romain to indicate the populations who did not speak their language. Then transformed by the French colonists into "Berber". The Berbers are present in North Africa since the prehistoric period, they faced several successive invasions since the 10th century before J-C: phoenician, Romain, Vandals, Byzantine, Arabic, Spanish, Italian, Ottoman, and French. Tamazight, the Berber’s language, exists since the highest antiquity. It has an original system of writing, called TIFINAGH, used and protected to this day. At present the Berber language is spoken by approximately 30 million speakers in North Africa, from the oasis of Siwa in Egypt, to Morocco including Libya, Tunisia, Algeria, Niger, Mali, the North of Burkina Faso, Mauritania and also in the Diaspora ( by berbers living in Europe and North America mainly). In Algeria, the Berber people represents approximately more than a third of the total population, 12 million individuals living mainly in the regions of Kabylia, Aurès, Chenoua, M'zab and the south extreme of the country for Tuarègues. Kabylia remains however the region which counts the largest number, 8 to 9 million people. Since the independence of Algeria in 1962 , although Algeria adopted the African Charter of human rights and people, and voted in -

Between Sectarianism and Ethnicity. Political Legalism
BETWEEN SECTARIANISM AND ETHNICITY. POLITICAL LEGALISM OF IBĀDĪ BERBERS IN CONTEMPORARY NORTH AFRICA Rafał Kobis Political stability and minority question in post-revolutionary North Africa The second decade of the twenty-first century began with an unprecedented wave of civil insurrections in the Ara- bic North Africa. The scale of the protests and uncom- promising disgruntled society surprised most analysts and researchers dealing with this region of the world1. It can be considered that the North African revolutions forced a revolution within the social sciences, because these events cast doubt on the thesis of the persistence of authoritarian regimes on the southern coast of the Med- iterranean2. The initial euphoria caused by the advent of the highly anticipated “fourth wave of democratization” quickly turned into fear of the unknown3. In most of the countries affected by the Arab Spring (Arabic ar-rabī’ al- ‘arabī), recent allies have become sworn enemies. This phenomenon is evident, especially in the informal civil war-stricken Libya, but also in post-revolutionary Egypt, where the street demonstrators overthrew in 2013 the first democratically elected president. Political situation is not better in Algeria and Morocco, the countries the least affected by social unrest. In both of them, state authori- ties must face social discontent of a large Berber commu- 177 nity. Although the Moroccan authorities have introduced changes in the constitution recognizing the Berber cul- ture as a component of national identity, for some of the most radical Berber activists they are still insufficient4. Among the community of Algerian exiles in France, the Movement for the Autonomy of Kabylie (French: Mouve- ment pour l’autonomie de la Kabylie), founded by a Berber singer and political activist Ferhat Mehenni, is gaining- increasing support. -

Languages of Algerian Diaspora in the United States of America: Comparative Study with Algerian Diaspora in France
LANGUAGES OF ALGERIAN DIASPORA IN THE UNITED STATES OF AMERICA: COMPARATIVE STUDY WITH ALGERIAN DIASPORA IN FRANCE By KHADIDJA ARFI A THESIS PRESENTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF FLORIDA IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS UNIVERSITY OF FLORIDA 2008 © 2008 Khadidja Arfi 2 To the Algerian Community in the United States 3 ACKNOWLEDGMENTS I would like to present my thanks and gratitude to my advisor Dr. Gerald Murray and my committee members Dr. Abdoulaye Kane and Dr. Maria Stoilkova for their mentoring, advice, encouragement, and positive critic throughout this project. I also extend my appreciation to my professors in the Anthropology Department at the University of Florida and Southern Illinois University for their mentoring in anthropological knowledge in general. I am grateful to the Algerian community in the US, specifically those who welcomed me in their homes and allowed me to write about their lives. I am grateful to my parents, who never stopped showing their love and compassion until they passed away. I appreciate my brothers and sisters and family-in-law for their closeness and respect. I am mostly thankful for my daughter Soumaya’s kindness, love and friendship. I am pleased for having her husband Noureddine as a son-in-law. I am the most grateful for their precious daughter, my granddaughter Mariam, a gift from God, who I hope would follow on the footsteps of her ancestors in their love for knowledge and living in harmony. Finally, my greatest thanks is for my husband Badredine’s love, respect, compassion, and companionship.