Phasages Et Déphasages. Représentations Du Temps Chez Les
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
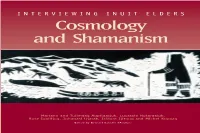
Cosmology and Shamanism and Shamanism INTERVIEWING INUIT ELDERS
6507.3 Eng Cover w/spine/bleed 5/1/06 9:23 AM Page 1 INTERVIEWINGCosmology INUIT ELDERS and Shamanism Cosmology and Shamanism INTERVIEWING INUIT ELDERS Mariano and Tulimaaq Aupilaarjuk, Lucassie Nutaraaluk, Rose Iqallijuq, Johanasi Ujarak, Isidore Ijituuq and Michel Kupaaq 4 Edited by Bernard Saladin d’Anglure 6507.5_Fre 5/1/06 9:11 AM Page 239 6507.3 English Vol.4 5/1/06 9:21 AM Page 1 INTERVIEWING INUIT ELDERS Volume 4 Cosmology and Shamanism Mariano and Tulimaaq Aupilaarjuk, Lucassie Nutaraaluk, Rose Iqallijuq, Johanasi Ujarak, Isidore Ijituuq and Michel Kupaaq Edited by Bernard Saladin d’Anglure 6507.3 English Vol.4 5/1/06 9:21 AM Page 2 Interviewing Inuit Elders Volume 4 Cosmology and Shamanism Copyright © 2001 Nunavut Arctic College, Mariano and Tulimaaq Aupilaarjuk, Bernard Saladin d’Anglure and participating students Susan Enuaraq, Aaju Peter, Bernice Kootoo, Nancy Kisa, Julia Saimayuq, Jeannie Shaimayuk, Mathieu Boki, Kim Kangok, Vera Arnatsiaq, Myna Ishulutak, and Johnny Kopak. Photos courtesy Bernard Saladin d’Anglure; Frédéric Laugrand; Alexina Kublu; Mystic Seaport Museum. Louise Ujarak; John MacDonald; Bryan Alexander. Illustrations courtesy Terry Ryan in Blodgett, ed. “North Baffin Drawings,” Art Gallery of Ontario; 1923 photo of Urulu, Fifth Thule Expedition. Cover illustration “Man and Animals” by Lydia Jaypoody. Design and production by Nortext (Iqaluit). All rights reserved. The use of any part of this publication, reproduced, transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, or stored in a retrieval system, without written consent of the publisher is an infringement of the copyright law. ISBN 1-896-204-384 Published by the Language and Culture Program of Nunavut Arctic College, Iqaluit, Nunavut with the generous support of the Pairijait Tigummivik Elders Society. -

Documenting Inuit Knowledge of Coastal Oceanography in Nunatsiavut
Respecting ontology: Documenting Inuit knowledge of coastal oceanography in Nunatsiavut By Breanna Bishop Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Marine Management at Dalhousie University Halifax, Nova Scotia December 2019 © Breanna Bishop, 2019 Table of Contents List of Tables and Figures ............................................................................................................ iv Abstract ............................................................................................................................................ v Acknowledgements ........................................................................................................................ vi Chapter 1: Introduction ............................................................................................................... 1 1.1 Management Problem ...................................................................................................................... 4 1.1.1 Research aim and objectives ........................................................................................................................ 5 Chapter 2: Context ....................................................................................................................... 7 2.1 Oceanographic context for Nunatsiavut ......................................................................................... 7 2.3 Inuit knowledge in Nunatsiavut decision making ......................................................................... -

Archaeological Excavation
An Instructor’s Guide to Archaeological Excavation in Nunavut Acknowledgments Writing by: Brendan Griebel and Tim Rast Design and layout by: Brendan Griebel Project management by: Torsten Diesel, Inuit Heritage Trust The Inuit Heritage Trust would like to extend its thanks to the following individuals and organizations for their contributions to the Nunavut Archaeology Excavation kit: • GN department of Culture and Heritage • Inuksuk High school © 2015 Inuit Heritage Trust Introduction 1-2 Archaeology: Uncovering the Past 3-4 Archaeology and Excavation 5-6 Setting up the Excavation Kit 7-9 Archaeology Kit Inventory Sheet 10 The Tools of Archaeology 11-12 Preparing the Excavation Kit 13 Excavation Layer 4 14 Excavation Layer 3 15-18 Excavation Layer 2 19-22 Excavation Layer 1 23-24 Excavation an Archaeology Unit 25-29 Interpreting Your Finds 30 Summary and Discussion 31 Making a Ground Slate Ulu 32-37 Introduction and anthropology studies after their high school Presenting the Inuit Heritage graduation. In putting together this archaeology kit, Trust archaeology kit the Inuit Heritage Trust seeks to bring the thrill and discovery of archaeological excavation to anyone who Many Nunavummiut are interested in the history wishes to learn more about Nunavut’s history. of Inuit culture and traditions. They enjoy seeing old sites on the land and listening to the stories elders tell about the past. Few people in Who is this archaeology kit Nunavut, however, know much about archaeology for? as a profession that is specifically dedicated to investigating the human past. This archaeology kit is designed to help Nunavummiut learn more The Inuit Heritage Trust archaeology kit can about what archaeology is, how it is done, and be applied in many different contexts. -

Using GPS Mapping Software to Plot Place Names and Trails in Igloolik (Nunavut) CLAUDIO APORTA1
ARCTIC VOL. 56, NO. 4 (DECEMBER 2003) P. 321–327 New Ways of Mapping: Using GPS Mapping Software to Plot Place Names and Trails in Igloolik (Nunavut) CLAUDIO APORTA1 (Received 11 July 2001; accepted in revised form 10 February 2003) ABSTRACT. The combined use of a GPS receiver and mapping software proved to be a straightforward, flexible, and inexpensive way of mapping and displaying (in digital or paper format) 400 place names and 37 trails used by Inuit of Igloolik, in the Eastern Canadian Arctic. The geographic coordinates of some of the places named had been collected in a previous toponymy project. Experienced hunters suggested the names of additional places, and these coordinates were added on location, using a GPS receiver. The database of place names thus created is now available to the community at the Igloolik Research Centre. The trails (most of them traditional, well-traveled routes used in Igloolik for generations) were mainly mapped while traveling, using the track function of a portable GPS unit. Other trails were drawn by experienced hunters, either on paper maps or electronically using Fugawi mapping software. The methods employed in this project are easy to use, making them helpful to local communities involved in toponymy and other mapping projects. The geographic data obtained with this method can be exported easily into text files for use with GIS software if further manipulation and analysis of the data are required. Key words: Inuit place names, Inuit trails, mapping, Geographic Information System, GIS, Global Positioning System, GPS, Igloolik, toponymy RÉSUMÉ. L’utilisation combinée d’un récepteur GPS et d’un logiciel de cartographie s’est révélée être une façon directe, souple et peu coûteuse de cartographier et de présenter (sous forme numérique ou imprimée) 400 lieux-dits et 37 pistes utilisés par les Inuits d’Igloolik, dans l’est de l’Arctique canadien. -

"Inuksuk: Icon of the Inuit of Nunavut"
Article "Inuksuk: Icon of the Inuit of Nunavut" Nelson Graburn Études/Inuit/Studies, vol. 28, n° 1, 2004, p. 69-82. Pour citer cet article, utiliser l'information suivante : URI: http://id.erudit.org/iderudit/012640ar DOI: 10.7202/012640ar Note : les règles d'écriture des références bibliographiques peuvent varier selon les différents domaines du savoir. Ce document est protégé par la loi sur le droit d'auteur. L'utilisation des services d'Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d'utilisation que vous pouvez consulter à l'URI https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/ Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l'Université de Montréal, l'Université Laval et l'Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. Érudit offre des services d'édition numérique de documents scientifiques depuis 1998. Pour communiquer avec les responsables d'Érudit : [email protected] Document téléchargé le 9 février 2017 07:10 Inuksuk: Icon of the Inuit of Nunavut Nelson Graburn* Résumé: L’inuksuk: icône des Inuit du Nunavut Les Inuit de l’Arctique canadien ont longtemps été connus par le biais des rapports écrits par les explorateurs, les baleiniers, les commerçants, ainsi que les missionnaires. Célèbres pour leurs igloos, traîneaux à chiens, kayaks et vêtements de peau, ils sont devenus les principaux «durs» de l’Arctique américain comme l’a montré le film «Nanook of the North». Maintenant qu’ils apparaissent sur la scène mondiale dotés de leurs moyens propres, leur singularité allégorique est aujourd’hui menacée. -

Caribou and Iglulik Inuit Kayaks
ARCTIC VOL. 47, NO. 2 (JUNE 1994) P. 193-195 Caribou and Iglulik Inuit Kayaks A century ago the Tyrrell brothers descended the Kuu the capsize victim exits his kayak and is towed hanging on (“The River” in Inuktitut, or Thelon River). As they neared around the base of the upturned stern horn of the rescue Qamani’tuaq (“The Big Broad,” or Baker Lake), elegant kayak. The overturned craft is retrieved by righting it and slender kayaks appeared and easily outpaced their voyageur-towing it with the stem horn tucked underarm. one The horns driven canoes. Evidence of kayaks in the form of broken also help secure the cross poles tied on at their bases when willow ribs discarded during bending hadalready been seen forming a catamaran. With the poles spaced well apart, well inland on Avaaliqquq (“Far Off,” orDubawnt River). normal synchronized paddling can be done. A couple of The Tyrrells were in the country of the Caribou Eskimos spoon-shaped red ornaments might be hung from the bow (so labelled by the Danish Fifth Thule Expedition, of horn tip to swing there gaily as kuviahunnihautik (“for the 1921-24), who actually comprised several distinct named joy”). After all, to kayak swiftly is elating - a high point groups. The two northern ones who lived largely inland by in the arctic summer. the later 19th centuryare called Ha’vaqtuurmiut (“Whirlpools The characteristic end horn configuration is useful, too, Aplenty People”) and Qairnirmiut (”BedrockPeople”). Their as an indicatorof possible historical connections. The jogged- kayaks were especially sleek and well made, with striking up stem is foundon prehistoric models carved of thickbark long, thin horns at theends. -

Nunavut, a Creation Story. the Inuit Movement in Canada's Newest Territory
Syracuse University SURFACE Dissertations - ALL SURFACE August 2019 Nunavut, A Creation Story. The Inuit Movement in Canada's Newest Territory Holly Ann Dobbins Syracuse University Follow this and additional works at: https://surface.syr.edu/etd Part of the Social and Behavioral Sciences Commons Recommended Citation Dobbins, Holly Ann, "Nunavut, A Creation Story. The Inuit Movement in Canada's Newest Territory" (2019). Dissertations - ALL. 1097. https://surface.syr.edu/etd/1097 This Dissertation is brought to you for free and open access by the SURFACE at SURFACE. It has been accepted for inclusion in Dissertations - ALL by an authorized administrator of SURFACE. For more information, please contact [email protected]. Abstract This is a qualitative study of the 30-year land claim negotiation process (1963-1993) through which the Inuit of Nunavut transformed themselves from being a marginalized population with few recognized rights in Canada to becoming the overwhelmingly dominant voice in a territorial government, with strong rights over their own lands and waters. In this study I view this negotiation process and all of the activities that supported it as part of a larger Inuit Movement and argue that it meets the criteria for a social movement. This study bridges several social sciences disciplines, including newly emerging areas of study in social movements, conflict resolution, and Indigenous studies, and offers important lessons about the conditions for a successful mobilization for Indigenous rights in other states. In this research I examine the extent to which Inuit values and worldviews directly informed movement emergence and continuity, leadership development and, to some extent, negotiation strategies. -

Polar Bear • Ulu Knife • Seal • Snowshoes • Igloo South / Summer
North / Winter: South / Summer: • Polar Bear • Canoe • Ulu Knife • Berry Bushes • Seal • Long House • Snowshoes • Beaver • Igloo • Lacrosse East / Spring: West / Fall: • Tepee • Totem Poll • Fiddle • Red River Cart • Maple Syrup • Kayak • Bison • Inuksuk • Drum • Sweat Lodge http://www.ainc-inac.gc.ca/arc/lr/ks/index-eng.asp Quiz Questions Level 1 1. What “sweet treat” found on many breakfast tables was first tapped by First Nations, such as the Algonquin, in Eastern Canada? 2. What special footwear help you to walk, hunt and work during the winter? 3. What type of boat was built by many First Nations to travel down rivers and lakes? 4. What tall, decorated pole are carved by First Nations, such as the Gitxsan, to tell stories and legends? 5. What one-person boat is used by Inuit hunters and fishermen? Level 2 1. What traditional building was once called home by the Iroquois? 2. What large, white animal is known as “Nanuk” by Inuit? 3. What type of house is made from snow, but is very warm inside? 4. What flat-tailed, hardworking animal was a big part of the Fur Trade? 5. What triangle-shaped home is made from animal skins and can be easily moved? Level 3 1. What animal is used by Inuit for food and summer shelter? 2. What important building is used by many First Nations for cleansing ceremonies? 3. What animal was a source of food, clothing and tools to Plains Cree and Métis? 4. What type of knife is used by Inuit women to cut meat and make clothing? 5. -

Navigating International, Interdisciplinary, and Indigenous Collaborative Inquiry Olga Ulturgasheva University of Cambridge
Journal of Community Engagement and Scholarship Volume 4 | Issue 1 Article 6 January 2011 Navigating International, Interdisciplinary, and Indigenous Collaborative Inquiry Olga Ulturgasheva University of Cambridge Lisa Wexler University of Massachusetts, Amherst Michael Kral University of Illinois James Allen University of Alaska Fairbanks Gerald V. Mohatt University of Alaska Fairbanks See next page for additional authors Follow this and additional works at: https://digitalcommons.northgeorgia.edu/jces Recommended Citation Ulturgasheva, Olga; Wexler, Lisa; Kral, Michael; Allen, James; Mohatt, Gerald V.; and Nystad, Kristine (2011) "Navigating International, Interdisciplinary, and Indigenous Collaborative Inquiry," Journal of Community Engagement and Scholarship: Vol. 4 : Iss. 1 , Article 6. Available at: https://digitalcommons.northgeorgia.edu/jces/vol4/iss1/6 This Article is brought to you for free and open access by Nighthawks Open Institutional Repository. It has been accepted for inclusion in Journal of Community Engagement and Scholarship by an authorized editor of Nighthawks Open Institutional Repository. Navigating International, Interdisciplinary, and Indigenous Collaborative Inquiry Authors Olga Ulturgasheva, Lisa Wexler, Michael Kral, James Allen, Gerald V. Mohatt, and Kristine Nystad This article is available in Journal of Community Engagement and Scholarship: https://digitalcommons.northgeorgia.edu/jces/vol4/ iss1/6 Navigating International,Ulturgasheva et al.: Navigating Interdisciplinary, International, Interdisciplinary, and Indigenous Colla and Indigenous Collaborative Inquiry Olga Ulturgasheva, Lisa Wexler, Michael Kral, James Allen, Gerald V. Mohatt, and Kristine Nystad Abstract This report describes how multiple community constituents came together with university researchers to develop a shared agenda for studying young indigenous people in five international circumpolar communities. The paper focuses on the setup and process of an initial face-to-face methodological planning workshop involving youth and adult community members and academics. -

Uqausiliriniq: Communications 12 Module 3 Oral Communication Essentials
Uqausiliriniq: Communications 12 Module 3 Oral Communication Essentials Teacher’s Manual Teacher’s Manual wo8ix3ioEp4f5 x9M4Fz5 wo8ixDtos3i3j5 wo8ix3F1k9l Wp5tC3F1u Kavamat Elihaktoliginikot Havakviat Ilihautiliuniqmut Ilihavinulu Piyittivik Department of Education Curriculum and School Services Ministère de l’Éducation Division des programmes d’études et services scolaires 2013 PILOT Uqausiliriniq: Communications 12, Module 3: Oral Communication Essentials 1 In the very first times there was no light on earth. Everything was in darkness, the lands could not be seen, the animals could not be seen. And still, both people and animals lived on the earth, but there was no difference between them… A person could become and animal, and an animal could become a human being. There were wolves, bears, and foxes but as soon as they turned into humans they were the same. They may have had different habits but all spoke the same tongue, lived in the same kind of house, and spoke and hunted in the same way. That is the way they lived here on earth in the very earliest times, times that no one can understand now. That was the time when magic words were made. A word spoken by chance would suddenly become powerful, and what people wanted to happen could happen, and nobody could explain how it was. Uqalurait: An Oral History of Nunavut, page 161. 2 Uqausiliriniq: Communications 12, Module 3: Oral Communication Essentials Acknowledgements We would like to acknowledge the work of the following people who greatly influenced the development of this course: -

WHO ARE the INUIT? a Conversation with Qauyisaq “Kowesa” Etitiq
WHO ARE THE INUIT? A conversation with Qauyisaq “Kowesa” Etitiq Elementary Teachers’ Federation of Ontario Elementary Teachers' Federation of Ontario (ETFO) 136 Isabella Street, Toronto, ON M4Y 0B5 416-962-3836 or 1-888-838-3836 etfo.ca ETFOprovincialoffice @ETFOeducators @ETFOeducators Copyright © July 2020 by ETFO ETFO EQUITY STATEMENT It is the goal of the Elementary Teachers’ Federation of Ontario to work with others to create schools, communities and a society free from all forms of individual and systemic discrimination. To further this goal, ETFO defines equity as fairness achieved through proactive measures which result in equality, promote diversity and foster respect and dignity for all. ETFO HUMAN RIGHTS STATEMENT The Elementary Teachers’ Federation of Ontario is committed to: • providing an environment for members that is free from harassment and discrimination at all provincial or local Federation sponsored activities; • fostering the goodwill and trust necessary to protect the rights of all individuals within the organization; • neither tolerating nor condoning behaviour that undermines the dignity or self-esteem of individuals or the integrity of relationships; and • promoting mutual respect, understanding and co-operation as the basis of interaction among all members. Harassment and discrimination on the basis of a prohibited ground are violations of the Ontario Human Rights Code and are illegal. The Elementary Teachers’ Federation of Ontario will not tolerate any form of harassment or discrimination, as defined by the Ontario Human Rights Code, at provincial or local Federation sponsored activities. ETFO LAND ACKNOWLEDGEMENT In the spirit of Truth and Reconciliation, the Elementary Teachers’ Federation of Ontario acknowledges that we are gathered today on the customary and traditional lands of the Indigenous Peoples of this territory. -

Borrowed Words from English
Words borrowed from English used in Inuktitut Sukaq=Sugar Tavvaaki=Tobacco Tuummaattijuq= Too much ( Tobacco ) Tii=Tea Paippaaq=Paper Palaiguuq=Ply wood Siggaliaq=Cigarette Palaugaaq=Flour Jaannuari=January Papa=Pepper Vaka=Bucket Gaasi=Gasoline Viivvuari=February Tiivii=Television Sikituuq=Ski-doo Aatami=Adam Taiviti=David Waasing Masiin=Washing Machine Jaikak=Jacket Aapu=Apple Waassi=Watch or clock Haaki=Hockey Kanuu=Canoe Aasiisikkuvik-Ashtray Kampani=HBC Paliisi=Police Kamisina=Commisioner Luuktaaq=Doctor Kapitai=Captain Sakirmiaq=Second Mate Sipiakta=Inspector Kaparu=Corporal Saajja=Sergeant Pilipuusi=Phillip Sipaakpa=Spark plug Words borrowed from Inuktitut used in English Igloo. ( iglu ) A dome shaped house made of snow or ice. Believed to be the best architecture suitable for the North. Originated by Inuit. Kayak. ( Qayaq ) One man boat, with opening on top for seating. Frame is usually made out of light wood with plastic, fiberglass, or canvas as outer layer. Outer layer is traditionally made from seal skin or caribou skin. A more modern type may have more than one opening for more passengers to sit on. Used all over the world, as sport, recreation, and for hunting, qayaq originated from the Inuit. Komatik. (Qamutiik) Wooden sled with cross boards, cross boards tied to the sled by rope. Used for hauling equipment on land, snow or ice etc. Plastic runners are used for smoother traveling.There are variety of sizes depending on the need of the sled. The sled is lead/dragged by a snowmobile, or by dogs. Anorak= From the word “Annuraaq” ( Clothing). Waterproof hooded jacket. Originated; Greenland. Umiak. (Umiaq) A flat bottom, wooden frame seal skin boat, traditionally used by women.