MEMOIRE De MAITRISE JOHARY
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Profil Bibliométrique Et Devenir Des Thèses Soutenues Dans Les Universités Publiques De Madagascar
UNIVERSITÉ D’ANTANANARIVO UNIVERSITÉ D’ANTANANARIVO ÉCOLE SUPÉRIEURE DES SCIENCES AGRONOMIQUES ÉCOLE DOCTORALE GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET DÉVELOPPEMENT ÉQUIPE D’ACCUEIL : AGRO-MANAGEMENT DÉVELOPPEMENT DURABLE ET TERRITOIRE THÈSE DE DOCTORAT EN SCIENCES AGRONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Profil bibliométrique et devenir des thèses soutenues dans les Universités publiques de Madagascar Présentée par : Nivoniaina Fahendrena RAHARIJAONA Soutenue le 24 janvier 2017 Devant le jury composé de : Président Bruno Salomon RAMAMONJISOA, Professeur Titulaire Rapporteur externe Marie Laure RAKOTOARIVELO AJORQUE, Directeur de Recherche Rapporteur interne Sylvain RAMANANARIVO, Professeur Titulaire Directeur de thèse Romaine RAMANANARIVO, Professeur Titulaire Examinateur Jules Marie RAZAFIARIJAONA, Docteur-HDR Examinateur Jean de Neupomuscène RAKOTOZANDRINY, Professeur Titulaire UNIVERSITÉ D’ANTANANARIVO UNIVERSITÉ D’ANTANANARIVO ÉCOLE SUPÉRIEURE DES SCIENCES AGRONOMIQUES ÉCOLE DOCTORALE : GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET DÉVELOPPEMENT Équipe d’accueil : Agro-Management Développement Durable et Territoire THÈSE DE DOCTORAT EN SCIENCES AGRONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Année : 2016 Profil bibliométrique et devenir des thèses soutenues dans les Universités publiques de Madagascar Présentée par : Nivoniaina Fahendrena RAHARIJAONA Date de soutenance le : 24/01/2017 Membres de Comité de thèse : Monsieur Sylvain RAMANANARIVO, Professeur Titulaire. ESSA. ED GRND/ EA AM2DT Madame Marie Laure RAKOTOARIVELO AJORQUE, Directeur de Recherche. CIDST Monsieur -

TDR Annexe7 Rapport Analyse 322 Communes OATF
ETAT DES LIEUX DES 319 COMMUNES POUR LE FINANCEMENT ADDITIONNEL DU PROJET CASEF Février 2019 TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIERES .................................................................................................................... i LISTE DES ACRONYMES ................................................................................................................ iii Liste des tableaux ......................................................................................................................... v Listes des Cartes ........................................................................................................................... v Liste des figures ............................................................................................................................vi Liste des photos ...........................................................................................................................vi I INTRODUCTION ....................................................................................................................... 1 II METHODOLOGIES .................................................................................................................... 2 II.1 CHOIX DES 322 COMMUNES OBJETS D’ENQUETE ............................................................... 2 II.2 CHOIX DES CRITERES DE SELECTION DES COMMUNES ........................................................ 5 II.3 METHODOLOGIE DE COLLECTE DE DONNEES ET ACTIVITES ................................................. 6 -

Dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfs
dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfsdfdsfdmmm REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana ----------------- HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE RESULTATS DEFINITIFS DU SECOND TOUR DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE DU 19 DECEMBRE 2018 dfggfdgffhCode BV: 330601010101 dfggfdgffhBureau de vote: EPP ALAKAMISY ITENINA SALLE 1 dfggfdgffhCommune: ALAKAMISY ITENINA dfggfdgffhDistrict: VOHIBATO dfggfdgffhRegion: HAUTE MATSIATRA dfggfdgffhProvince: FIANARANTSOA Inscrits : 405 Votants: 238 Blancs et Nuls: 2 Soit: 0,84% Suffrages exprimes: 236 Soit: 99,16% Taux de participation: 58,77% N° d'ordre Logo Photo Nom et Prenoms Candidat Voix obtenues Pourcentage 13 RAJOELINA Andry Nirina 92 38,98% 25 RAVALOMANANA Marc 144 61,02% Total voix: 236 100,00% Copyright @ HCC 2019 dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfsdfdsfdmmm REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana ----------------- HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE RESULTATS DEFINITIFS DU SECOND TOUR DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE DU 19 DECEMBRE 2018 dfggfdgffhCode BV: 330601020101 dfggfdgffhBureau de vote: EPP AMBALAFAHIBATO SALLE 1 dfggfdgffhCommune: ALAKAMISY ITENINA dfggfdgffhDistrict: VOHIBATO dfggfdgffhRegion: HAUTE MATSIATRA dfggfdgffhProvince: FIANARANTSOA Inscrits : 576 Votants: 212 Blancs et Nuls: 3 Soit: 1,42% Suffrages exprimes: 209 Soit: 98,58% Taux de participation: 36,81% N° d'ordre Logo Photo Nom et Prenoms Candidat Voix obtenues Pourcentage 13 RAJOELINA Andry Nirina 68 32,54% 25 RAVALOMANANA Marc 141 67,46% Total voix: 209 100,00% Copyright @ HCC 2019 dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfsdfdsfdmmm -

Feedback Madagascar – Ankarinomby
The Feedback Trust Scottish Charity No. SC023568 Construction of a new school for the Ankarinomby Secondary School in Madagascar (FF 441 - 01) Final report May 2019 Feedback Madagascar/Ny Tanintsika (FBM/NT) – The Eagle Foundation 1 Contents Introduction .................................................................................................................................................................. 4 Project location ......................................................................................................................................................... 4 Calendar of achievements ............................................................................................................................................ 6 Details on the project ................................................................................................................................................... 7 Difficulties encountered ............................................................................................................................................. 14 Project beneficiaries ................................................................................................................................................... 15 Expenditure summary ................................................................................................................................................ 18 Current situation........................................................................................................................................................ -
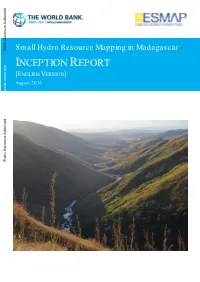
Small Hydro Resource Mapping in Madagascar
Public Disclosure Authorized Small Hydro Resource Mapping in Madagascar INCEPTION REPORT [ENGLISH VERSION] August 2014 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized This report was prepared by SHER Ingénieurs-Conseils s.a. in association with Mhylab, under contract to The World Bank. It is one of several outputs from the small hydro Renewable Energy Resource Mapping and Geospatial Planning [Project ID: P145350]. This activity is funded and supported by the Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP), a multi-donor trust fund administered by The World Bank, under a global initiative on Renewable Energy Resource Mapping. Further details on the initiative can be obtained from the ESMAP website. This document is an interim output from the above-mentioned project. Users are strongly advised to exercise caution when utilizing the information and data contained, as this has not been subject to full peer review. The final, validated, peer reviewed output from this project will be a Madagascar Small Hydro Atlas, which will be published once the project is completed. Copyright © 2014 International Bank for Reconstruction and Development / THE WORLD BANK Washington DC 20433 Telephone: +1-202-473-1000 Internet: www.worldbank.org This work is a product of the consultants listed, and not of World Bank staff. The findings, interpretations, and conclusions expressed in this work do not necessarily reflect the views of The World Bank, its Board of Executive Directors, or the governments they represent. The World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work and accept no responsibility for any consequence of their use. -

1 COAG No. 72068718CA00001
COAG No. 72068718CA00001 1 TABLE OF CONTENT I- EXECUTIVE SUMMARY .................................................................................................................................................. 6 II- INTRODUCTION ....................................................................................................................................................... 10 III- MAIN ACHIEVEMENTS DURING QUARTER 1 ........................................................................................................... 10 III.1. IR 1: Enhanced coordination among the public, nonprofit, and commercial sectors for reliable supply and distribution of quality health products ........................................................................................................................... 10 III.2. IR2: Strengthened capacity of the GOM to sustainably provide quality health products to the Malagasy people 15 III.3. IR 3: Expanded engagement of the commercial health sector to serve new health product markets, according to health needs and consumer demand ........................................................................................................ 36 III.4. IR 4: Improved sustainability of social marketing to deliver affordable, accessible health products to the Malagasy people ............................................................................................................................................................. 48 III.5. IR5: Increased demand for and use of health products among the Malagasy people -

Liste Des Communes Beneficiaires Au Financement Papsp-Fdl
LISTE DES COMMUNES BENEFICIAIRES AU FINANCEMENT PAPSP-FDL DATE Ordre de CATEG APPORT MONTANT TYPE RÉGION DISTRICT COMMUNE SOUS-PROJET MONTANT FDL MODE D'EXECUTION TYPE DE TRAVAUX SECTEUR Virement FDL vers ORIE COMMUNE TOTAL INFRASTRUCTURE TRESORS ALAOTRA MANGORO AMBATONDRAZAKA AMBANDRIKA CR 2 FANORENANA BIRAOM-POKOTANY AO AMBANIALA 15 000 000 480 15 000 480 TACHERON CONSTRUCTION GOUVERNANCE BUREAU FOKONTANY 26/04/2018 ALAOTRA MANGORO ANOSIBE AN'ALA AMBATOHARANANA CR 2 FANARENANA CEG AO AMBATOHARANANA 9 249 000 9 249 000 TACHERON REHABILITATION EDUCATION CEG 13/04/2018 ALAOTRA MANGORO ANOSIBE AN'ALA AMBATOHARANANA CR 2 FANARENANA LALANA 5 KM MAMPITOHY 5 751 000 5 751 000 HIMO/TACHERON REHABILITATION PISTE RURALE PISTE 13/04/2018 ALAOTRA MANGORO AMPARAFARAVOLA AMBATOMAINTY CR 2 FANITARANA SY FANARENANA BIRAON'NY KAOMININA 15 000 000 7 049 500 22 049 500 TACHERON REHABILITATION GOUVERNANCE BUREAU COMMUNE 13/04/2018 ALAOTRA MANGORO AMBATONDRAZAKA AMBATONDRAZAKA CU FANARENANA TRANO FIVORIAN'NY KAOMININA 15 000 000 15 000 000 TACHERON REHABILITATION GOUVERNANCE SALLE DE REUNION 28/03/2018 ALAOTRA MANGORO AMBATONDRAZAKA AMBATONDRAZAKA SUBURBAINE CR 1 FANARENANA TETEZANA TELO 15 000 000 2 TACHERON REHABILITATION PISTE RURALE PONT 13/04/2018 ALAOTRA MANGORO AMBATONDRAZAKA AMBATOSORATRA CR 2 FANORENANA LYCEE AO AMBATOSORATRA 15 000 000 15 730 900 30 730 900 TACHERON CONSTRUCTION EDUCATION LYCEE 13/04/2018 ALAOTRA MANGORO MORAMANGA AMBATOVOLA CR 2 FANARENANA CSB II AO AMBATOVOLA 15 000 000 13 018 15 013 018 TACHERON REHABILITATION SANTE CSB II 13/04/2018 -

Boissiera 71
Taxonomic treatment of Abrahamia Randrian. & Lowry, a new genus of Anacardiaceae BOISSIERA from Madagascar Armand RANDRIANASOLO, Porter P. LOWRY II & George E. SCHATZ 71 BOISSIERA vol.71 Director Pierre-André Loizeau Editor-in-chief Martin W. Callmander Guest editor of Patrick Perret this volume Graphic Design Matthieu Berthod Author instructions for www.ville-ge.ch/cjb/publications_boissiera.php manuscript submissions Boissiera 71 was published on 27 December 2017 © CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES DE LA VILLE DE GENÈVE BOISSIERA Systematic Botany Monographs vol.71 Boissiera is indexed in: BIOSIS ® ISSN 0373-2975 / ISBN 978-2-8277-0087-5 Taxonomic treatment of Abrahamia Randrian. & Lowry, a new genus of Anacardiaceae from Madagascar Armand Randrianasolo Porter P. Lowry II George E. Schatz Addresses of the authors AR William L. Brown Center, Missouri Botanical Garden, P.O. Box 299, St. Louis, MO, 63166-0299, U.S.A. [email protected] PPL Africa and Madagascar Program, Missouri Botanical Garden, P.O. Box 299, St. Louis, MO, 63166-0299, U.S.A. Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité (ISYEB), UMR 7205, Centre national de la Recherche scientifique/Muséum national d’Histoire naturelle/École pratique des Hautes Etudes, Université Pierre et Marie Curie, Sorbonne Universités, C.P. 39, 57 rue Cuvier, 75231 Paris CEDEX 05, France. GES Africa and Madagascar Program, Missouri Botanical Garden, P.O. Box 299, St. Louis, MO, 63166-0299, U.S.A. Taxonomic treatment of Abrahamia (Anacardiaceae) 7 Abstract he Malagasy endemic genus Abrahamia Randrian. & Lowry (Anacardiaceae) is T described and a taxonomic revision is presented in which 34 species are recog- nized, including 19 that are described as new. -

En Suivant Ce Lien
Coopération décentralisée entre Suivi technique et financier des gestionnaires de réseau d’eau potable dans la Haute Matsiatra RAPPORT ANNUEL RESULTATS DE L’ANNEE 2018 Avec le soutien de TABLE DES MATIERES Table des matières .................................................................................................................................................. 2 Liste des figures ................................................................................................................................................... 5 Sigles et abréviations ........................................................................................................................................... 7 En résumé… 8 1. Éléments de cadrage ..................................................................................................................................... 9 1.1. Contexte général ..................................................................................................................................... 9 1.2. Les réseaux objet du STEFI 2018 ............................................................................................................. 9 2. La méthodologie de collecte de données ................................................................................................... 15 3. Présentation des acteurs et des adductions d’eau objet du STEFI 2018 .................................................... 16 3.1. Les communes concernées ................................................................................................................... -

Hazavanahazavana Herin’Aratra Vokarina Amin’Ny Zava-Maniry Fandrehitra Electrification Rurale Décentralisée Par Combustion De Biomasse
Pierre Montagne, Mamisoa Rakotoarimanana, François Pinta et Serge Razafimahatratra Coordinateurs scientifiques HAZAVANAHAZAVANA Herin’Aratra Vokarina Amin’ny Zava-Maniry Fandrehitra Electrification Rurale Décentralisée par Combustion de Biomasse IRONNEME NV N E T L’ E T E D D E S E R F O E T R S E I T N I S M HAZAVANA Herin’Aratra Vokarina Amin’ny Zava-Maniry Fandrehitra Electrification Rurale Décentralisée par Combustion de Biomasse Expérience des projets Gesforcom et Bioenergelec à Madagascar, de 2008 à 2015 BIOENERGELEC Biomasse énergie pour la réduction de la pauvreté par l’électrification rurale décentralisée à Madagascar Pierre Montagne, Mamisoa Rakotoarimanana, François Pinta et Serge Razafimahatratra Coordinateurs scientifiques © Homme et Environnement ISBN : 978-2-9555221-0-3 L’Homme et l’Environnement Lot II M 90 Antsakaviro, Tél. +261 22 674 90 e-mail : [email protected] http ://www.madagascar-environnement.com www.bioenergelec.org Le contenu de cette publication n’engage que la responsabilité de ses auteurs et ne représente pas nécessairement l’opinion de l’Union Européenne. L’Union Européenne n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y figurent. Pierre Montagne, Mamisoa Rakotoarimanana, François Pinta et Serge Razafimahatratra Coordinateurs scientifiques HAZAVANA Herin’Aratra Vokarina Amin’ny Zava-Maniry Fandrehitra Electrification Rurale Décentralisée par Combustion de Biomasse Expérience des projets Gesforcom et Bioenergelec à Madagascar, de 2008 à 2015 Ouvrage de synthèse édité à partir -

Central Madagascar
© Lonely Planet Publications 93 Central Madagascar Driving the thousand odd kilometres between Antananarivo and Toliara on the famous Route Nationale 7 (RN7; Route du Sud) takes you straight through Central Madagascar, where the CENTRAL MADAGASCAR scenery is as stimulating and surreal as the culture. The RN7 might be Madagascar’s busiest highway (not to mention tourist trail), but to the barefoot Bara herdsmen, walking from as far as Toliara with nothing but a stick and the clothes on their back, it’s just a footpath useful for herding hundreds of zebu to market in Antananarivo. Some parts of Central Madagascar feel as far removed from the conventional vision of Africa as possible. Glassy, terraced rice paddies juxtaposed against cool, misty mountains and thick-walled red huts constructed from crimson soil, make you think you’ve been transported to Southeast Asia. Meanwhile the expanses of green rolling hills and golden fields dotted with medieval villages and tidy rows of grapes look European. Hit a city, however, and you slam back into chaotic Africa. Brightly painted pousses-pousses (rickshaws), their drivers hus- tling hard for fares, compete with zebu carts and overpacked buses for space along rutted streets where touts hawk everything from price-guns to strawberries. To really experience Central Madagascar’s chameleonlike ability to change, you’ll have to get out of your car. There is fantastic trekking through cloud forests and volcanic craters in the region’s stunning national parks, home to vegetation and animals (lots of lemurs) found nowhere else on earth. For a more cultural experience, spend three days trekking through Betsileo villages. -

Sustainable Landscapes in Eastern Madagascar Environmental And
Sustainable Landscapes in Eastern Madagascar Environmental and Social Management Plan Translation of the original French version 19 May 2016 (Updated 23 August 2016) 1 Table of Contents Acronyms ............................................................................................................................................... 7 Glossary ................................................................................................................................................. 9 Executive Summary ............................................................................................................................ 10 1 Introduction ................................................................................................................................. 17 1.1 Background and Project Objectives ...................................................................................... 17 1.2 Objectives of the ESMP ........................................................................................................ 17 1.3 Link between the ESMP and the Environmental and Social Management Tools for the COFAV and CAZ Protected Areas ........................................................................................................ 18 2 Project Overview ......................................................................................................................... 20 2.1 Description of Components, Activities, and Relevant Sectors .............................................. 20 2.2 Targets and Characteristics