Diagnostic Agricole
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Schéma De Cohérence Territoriale (SCOT) Loire-Centre
Schéma de cohérence territoriale (SCOT) Loire-centre Porter à connaissance initial de l'Etat Mars 2012 Table des matières Liste des principaux sigles ........................................................................................................... ................... 8 INTRODUCTION ...................................................................................................... ......... 9 1 - Qu'est-ce qu'un SCOT ? .......................................................................................................... .................... 9 1.1 - L'objet du SCOT ......................................................................................................................... .................. 9 1.2 - Un rôle renforcé par la loi "Grenelle 2" ........................................................................................ .................. 9 2 - Contexte de l'élaboration du SCOT Loire Centre .................................................................... .................. 10 3 - Le porter à connaissance (PAC) et le rôle de l'État dans l'élaboration du SCOT .................... ................. 11 3.1 - Le porter à connaissance (PAC) ................................................................................................ ................ 11 PARTIE I- CADRE RÈGLEMENTAIRE DU SCOT ..................................... ... 13 A- L'ENCADREMENT NORMATIF DU SCOT .......................................................... ....... 14 1 - Les principes généraux que le SCOT doit respecter .............................................................. -

Etude Des Populations D'ombre Commun Du Forez Sur L' Ance Du Nord, Le Lignon Du Forez Et L'aix
KARL--FRANZENS--UNIVERSITÄT GRAZ UNI Fédération de la Loire GRAZ pour la Pêche et la UMR CNRS 5023 Institut für Zoologie Université Claude Bernard Lyon 1 Protection du Milieu Aquatique Etude des populations d’Ombre commun du Forez sur l’ Ance du Nord, le Lignon du Forez et l’Aix Caractérisation Génétique et Dynamique des Populations Février 2006 AUTEURS : GRES Pierre 1 ; PERSAT Henri2; WEISS Steven et KOPUN Theodora 3 Avec les concours financiers de: 1 État des milieux et dynamique des populations : FDPPMA 42, Zone industrielle le Bas Rollet, 14 allée de l’Europe, 42480 la Fouillouse, Tél. 04 77 02 20 00, Mail : [email protected] 2 Génétique et dynamique des populations : Université Claude Bernard Lyon, Unité de recherche associée UMR, CNRS 5023, Laboratoire d’Ecologie des Hydroystèmes Fluviaux, Bâtiment F.A. Forel, 43 Boulevard du 11 novembre 1918, 69622 VILLEURBANNE CEDEX ,Tél. 04 72 44 84 35, Mail : [email protected] 3 Génétique : analyse biomoléculaire et traitement statistique : Karl-Franzens Universität, Graz, Autriche, contact Steven Weiss, Mail : [email protected] 2 FPPMA Loire Université de Lyon I Karl-Franzens Universität, Graz Remerciements : Cette étude n’aurait pas pu se mettre en place sans les concours financiers: ? Du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable ; ? Du Conseil Régional Rhône Alpes ; ? De l’Agence de l’Eau Loire Bretagne ; ? Du Conseil Général de la Loire en Rhône-Alpes; ? Des Fédérations de la Loire, de la Haute Loire et du Puy de Dôme pour la Pêche et la Protection -
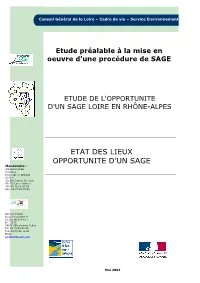
Etat Des Lieux Opportunite D'un Sage
Conseil Général de la Loire – Cadre de vie – Service Environnement Etude préalable à la mise en oeuvre d'une procédure de SAGE ETUDE DE L'OPPORTUNITE D'UN SAGE LOIRE EN RHÔNE-ALPES ETAT DES LIEUX OPPORTUNITE D’UN SAGE Mandataire : Adresse Postale : Hydratec Immeuble le Britania – Allée C 20, Bld Eugène Deruelle 69 432 Lyon Cedex 3 Tél. 04.72.61.00.63 Fax. 04.78.60.74.89 Adresse Postale : Asconit Consultants 62, bld Niels Bohr – B.P. 2132 69603 Villeurbanne Cedex Tél. 04.78.93.68.90 Fax. 04.78.94.11.98 Email : [email protected] Mai 2004 Conseil Général de la Loire Etude d’opportunité d’un SAGE Loire en Rhône-Alpes Etat des lieux TABLE DES MATIERES CHAPITRE 1 : PREAMBULE 1 1.1 Contexte et objectifs de l’étude 1 1.2 Définition du périmètre d’étude 3 1.3 Méthodologie 4 1.4 Contenu du rapport et produits de l’étude 5 1.5 Introduction 6 CHAPITRE 2 : CARACTERISTIQUES GENERALES DU BASSIN DE LA LOIRE DANS LA ZONE D’ETUDE 7 2.1 Le contexte physique 7 2.1.1 Caractéristiques physiques, géologiques et pédologiques.....................7 2.1.2 Caractéristiques climatiques............................................................8 2.1.3 Réseau hydrographique..................................................................9 L’axe Loire...............................................................................................9 Les principaux affluents ...........................................................................10 2.1.4 Ouvrages structurants.................................................................. 11 Le barrage de Grangent...........................................................................11 -

Télécharger Rapport D'activité 2019
RapportD’ACTIVITÉ Sommaire Édito 4 PORTRAIT DE TERRITOIRE 24 UN TERRITOIRE L’année 2019 a été une année de consolidation marquée par la poursuite du travail engagé depuis 6 UNE SITUATION AVANTAGEUSE ÉCO-RESPONSABLE maintenant trois ans. Nous avons continué de construire ensemble les 7 LES COMPÉTENCES DE LOIRE FOREZ 26 FAITS MARQUANTS actions à destination de la population de notre 8 LA PROXIMITÉ AU CŒUR 30 PERSPECTIVES territoire, en veillant à maintenir un dialogue DE LA GOUVERNANCE permanent pour une coopération efficace avec Nous poursuivons l’objectif l’ensemble des acteurs de l’agglomération. 9 MUTUALISER ET COOPÉRER de rendre le meilleur POUR GAGNER EN EFFICACITÉ 32 UNE AGGLOMÉRATION Nous avons notamment préparé le transfert de la STRUCTURÉE compétence eau potable, au 1er janvier 2020. service aux habitants, Ce dossier s’est révélé complexe, tant sur les aspects en cultivant la coopération. 34 FAITS MARQUANTS réglementaires, financiers, humains, que sur les 10 UN TERRITOIRE ACCUEILLANT aspects organisationnels et de gouvernance. Le Président de Loire Forez 36 PERSPECTIVES agglomération 12 FAITS MARQUANTS 38 ORGANIGRAMME Mais je crois pouvoir dire que l’Agglo et ses 16 PERSPECTIVES 87 communes ont su faire preuve de dynamisme. 39 ÉQUILIBRE FINANCIER Elles ont été capables d’évoluer et de s’adapter DU BUDGET GÉNÉRAL aux spécificités locales et à la diversité, grâce à l’engagement et à la mobilisation des élus et des 40 RÉPARTITION DES DÉPENSES 18 UN TERRITOIRE agents de chacune des collectivités. NETTES DU BUDGET GÉNÉRAL ENTREPRENANT 42 2019 EN PHOTOS C’est ce que nous essayons de faire, au quotidien, 20 FAITS MARQUANTS dans tous les domaines d’intervention de Loire Forez agglomération, pour nous renouveler sans cesse et 22 PERSPECTIVES offrir le meilleur service aux habitants. -
Site NATURA 2000 FR8201758 : « Lignon, Vizézy, Anzon Et Leurs Affluents » Document D'objectif Et Contrat De Rivière
Site NATURA 2000 FR8201758 : « Lignon, Vizézy, Anzon et leurs affluents » Document d'objectif et Contrat de Rivière Phase 1 : inventaire des habitats et espèces Identification des vulnérabilités Ref : 1256/08/09 Août 2009 Bureau d’études CESAME ZA du Parc – Secteur Gampille 42 490 FRAISSES tel : 04 77 10 12 10 E-Mail : [email protected] Syndicat SYMILAV Site Natura 2000 FR8201758 « Lignon, Vizézy, Anzon et leurs affluents » - DOCOB et Contrat de rivière Phase 1 : État initial - Diagnostic Table des matières 1. AVANT PROPOS..................................................................................................................3 2. CADRE GÉNÉRAL................................................................................................................5 2.1. LE RÉSEAU EUROPÉEN NATURA 2000................................................................................................5 2.2. LE DOCUMENT D'OBJECTIFS (DOCOB).............................................................................................7 2.3. LA POLITIQUE RIVIÈRE SUR LE BASSIN VERSANT DU LIGNON.......................................................9 3. ÉTUDES ET INVESTIGATIONS RÉALISÉES.......................................................................11 3.1. LE PÉRIMÈTRE D'ÉTUDE...................................................................................................................11 3.2. LA BIBLIOGRAPHIE...........................................................................................................................11 -

Zonagesassainissement Fiche
Fiche d’examen au cas par cas pour les zones visées par l’artt cle L2224-10 du Code Général des Collectt vités Territoriales selon le R122-17-II alinéa 4 du Code de l’Environnement Questions générales Nom de la collectivité ou de l’EPCI compétent Nom de la personne publique responsable Communauté d’Agglomération Loire-Forez 17 Boulevard de la Préfecture, 42605 Montbrison M. le Président Tél : 04 26 54 70 00 Fax : 04 26 54 70 01 Zonages concernés par la présente demande Les zones d’assainissement collectf où la collectvité compétente est tenue d’assurer la collecte des eaux usées domestques et le stockage, l’épuraton et le Oui Non rejet ou la réutlisaton de l’’ensemble des eaux collectées : Les zones relevant de l’assainissement non collectf où la collectvité compétente est tenue d’assurer le contrôle de ces installatons et, si elles le décident, le traitement des matères de vidange et, à la demande des propriétaires, l’entreten et les Oui Non travaux de réalisaton et de réhabilitaton des installatons d’assainissement non collectf : Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisaton des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de Oui Non ruissellement : Les zones où il est nécessaire de prévoir des installatons pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de Oui Non ruissellement lorsque la polluton qu’elles apportent au milieu aquatque risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositfs d’assainissement : Présentation de votre démarche et des motifs de la mise en place/révision de ce (ces) zonage(s) Le présent dossier résulte ainsi, non pas de la nécessité de mise à jour des zonages pour des raisons règlementaire ou de mise en cohérence avec les documents d’urbanisme mais bien d’une volonté de la part de la collectivité détentrice de la compétence assainissement, d’homogénéiser les zonages en cohérence avec les contraintes du territoire et les capacités d’investissement. -

Décisions Du Président Conseil Communautaire Du 15 Octobre 2019
DÉCISIONS DU PRÉSIDENT CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 OCTOBRE 2019 N°0526/2019 : subvention au profit de M. Florian DUJARDIN pour la réalisation de travaux de rénovation thermique de sa résidence principale sise 12 impasse des primevères 42600 Montbrison. Il est décidé d’attribuer une subvention d’un montant maximum de 500 € à M. Florian DUJARDIN demeurant 12 impasse des Primevères à Montbrison. N°0527/2019 : subvention au profit de M. Christian GUILLET pour la réalisation de travaux de rénovation thermique de sa résidence principale sise 7 allée des muguets 42610 St-Romain-le-Puy. Il est décidé d’attribuer une subvention d’un montant maximum de 500 € à M. Christian GUILLET demeurant 7 allée des muguets à St-Romain-le-Puy. N°0528/2019 : subvention au profit de M. Sammy PERRET pour la réalisation de travaux de rénovation thermique de sa résidence principale sise 14 chemin de lunard 42600 Lézigneux. Il est décidé d’attribuer une subvention d’un montant maximum de 500 € à M. Sammy PERRET demeurant 14 chemin de lunard à Lézigneux. N°0529/2019 : subvention au profit de M. et Mme Yves et Carole GENEBRIER pour la réalisation de travaux de rénovation thermique de leur résidence principale sise 9 impasse des Garnasses 42130 Trelins. Il est décidé d’attribuer une subvention d’un montant maximum de 500 € à M. et Mme Yves et Carole GENEBRIER demeurant 9 impasse des Garnasses à Trelins. N°0530/2019 : subvention au profit de M. Dominique FRANCOIS pour la réalisation de travaux de rénovation thermique de sa résidence principale sise 5 chemin des Préviers 42600 Montbrison. -
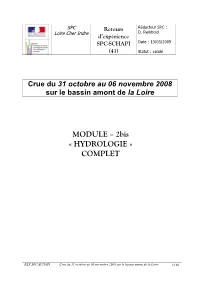
MODULE – 2Bis « HYDROLOGIE » COMPLET
SPC Retours Rédacteur SPC : Loire Cher Indre D. Reinbold d’expérience SPC-SCHAPI Date : 13/03/2009 (41) Statut : validé Crue du 31 octobre au 06 novembre 2008 sur le bassin amont de la Loire MODULE – 2bis « HYDROLOGIE » COMPLET REX SPC-SCHAPI Crue du 31 octobre au 06 novembre 2008 sur le bassin amont de la Loire 1/102 Panorama global de l’événement hydrologique Dates et heures de début et de fin des crues observées : SPC concernés : SPC Loire, Cher, Indre Bilan sommaire Cours d’eau Dates et heures Qualification Départements de début et de événement concernés fin Loire amont Du 1 er au 2 Crue de période Ardèche, Haute novembre 2008 de retour 50 ans Loire, Loire sur la Loire à Bas en Basset et Feurs Loire Du 2 au 6 Crue de période Loire, Allier, Bourguignonne novembre 2008 de retour 30 ans Saône et Loire, sur la Loire à Nièvre Digoin, 10 ans à Nevers Loire moyenne Du 4 au 9 Crue de période Nièvre, Cher, novembre 2008 de retour 5 ans à Loiret, Loir et Givry et Gien Cher, Indre et Loire REX SPC-SCHAPI Crue du 31 octobre au 06 novembre 2008 sur le bassin amont de la Loire 2/102 1 CARTOGRAPHIE DES TERRITOIRES CONCERNES 4 2 DESCRIPTIF DES CRUES OBSERVEES 5 2.1 BASSIN DE LA LOIRE A L ’AMONT DE GOUDET 15 A) CHRONOLOGIE ET DESCRIPTION DETAILLEE DE L ’EVENEMENT 15 B) IMPACTS , DUREES DE RETOUR 19 2.2 BASSIN DE LA LOIRE ENTRE GOUDET ET CHADRAC . 20 A) CHRONOLOGIE ET DESCRIPTION DETAILLEE DE L ’EVENEMENT 20 B) IMPACTS , DUREES DE RETOUR 26 2.3 BASSIN DE LA LOIRE ENTRE CHADRAC ET BAS EN BASSET 32 2.4 BASSIN DE LA LOIRE ENTRE BAS EN BASSET ET FEURS -

Décisions Du Président Conseil Communautaire Du 26 Janvier 2021
DÉCISIONS DU PRÉSIDENT CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 26 JANVIER 2021 N°0627/2020 : approbation d’une convention de partenariat entre Inter CE 42 et Loire Forez agglomération sur l’accord des tarifs préférentiels applicables aux adhérents d’Inter CE 42. Il est décidé d’approuver la convention de partenariat mise en place entre Inter CE 42 et Loire Forez agglomération et d’ainsi instaurer un tarif préférentiel aux adhérents d’Inter CE 42 pour l’année 2021 sur présentation d’un Pass imprimé par l’adhérent ou enregistré sur son smartphone. Le tarif préférentiel applicable est de 6 € TTC (tarif Inter CE42) au lieu de 8,50 € TTC (tarif public). N°0628/2020 : maintenance des installations de la médiathèque tête de réseau située sur la commune de Saint-Just Saint-Rambert. Il est décidé de conclure un marché pour la maintenance des installations de la médiathèque tête de réseau située sur la commune de Saint-Just Saint-Rambert. Concernant la partie du marché à prix forfaitaire, le montant annuel du marché est 8 980 € HT et le montant maximum du marché est de 6 000 € HT pour la partie à bons de commande. Le titulaire retenu pour ce marché est la société AXIMA CONCEPT ENGIE SOLUTIONS – 12 rue Jean Servanton 42000 Saint-Etienne. N°0629/2020 : repérage amiante et HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) dans les enrobés avant travaux. Il est décidé de conclure un marché pour le repérage amiante et HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) dans les enrobés avant travaux. Montant minimum annuel : 20 000 € HT Montant maximum annuel : 80 000 € HT Le titulaire retenu pour ce marché est la société ATYLES – 6 Rue de l’Abbaye 69440 Mornant. -

Décisions Du Président Conseil Communautaire Du 17 Septembre 2019
DÉCISIONS DU PRÉSIDENT CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 SEPTEMBRE 2019 N°0335/2019 : déclassement de la future parcelle C n°594 (partie de C 389) sise à Chalain-d’Uzore, chemin d’accès d’une unité de traitement des eaux usées. Il est décidé de constater la désaffectation de la future parcelle C 594 à Chalain-d’Uzore. Cette future parcelle n’a pas d’usage de service public assainissement. Il est également décidé de prononcer en conséquence le déclassement du domaine public de ce bien, pour le classer dans le domaine privé de Loire Forez agglomération et permettre sa rétrocession à la commune de Chalain-d’Uzore qui le classera en domaine public routier. N°0336/2019 : approbation d’un contrat avec les services de la Poste pour la distribution du dépliant « Loire Forez réunion compostage ». Il est décidé de conclure un contrat avec les services de la Poste pour la distribution du dépliant : « Loire Forez réunion compostage ». Cette prestation s’élève à un montant total de 547.86 € HT soit 657.43 € TTC. N°0337/2019 : accompagnement professionnel et personnel des agents des deux équipements nautiques de Loire Forez agglomération, la piscine du Petit Bois située à St-Just St-Rambert et la piscine Aqualude située à Montbrison. Il est décidé d’approuver une convention avec JBM management afin d’accompagner les équipes des équipements nautiques de Loire Forez agglomération, dans la définition et l’atteinte de leurs objectifs d’amélioration du service au public et de cohésion d’équipe. Cette prestation s’élève à un montant total forfaitaire de 15 000 € HT pour la mise en place de ce dispositif et des frais de déplacement plafonnés à 1 000 € HT. -

« Oiseaux » De La Plaine Du Forez
Juin 2009 Document d’objectifs Natura 2000 « OISEAUX » DE LA PLAINE DU FOREZ Juin 2009 Document d’objectifs Natura 2000 « OISEAUX » DE LA PLAINE DU FOREZ DOCUMENT D ’O BJECTIFS DU SITE FR 821 2024 « PLAINE DU FOREZ » Sommaire I.A. INTRODUCTION : contexte et objectifs ................................................................................................................... 1 I.A.1. La directive oiseaux et le réseau Natura 2000 .................................................................................. 1 I.A.2. Le document d’objectifs : une étape essentielle............................................................................... 2 I.B. METHODOLOGIE ................................................................................................................................................... 3 I.B.1. L’analyse bibliographique.................................................................................................................. 3 I.B.2. L’analyse scientifique : inventaire et cartographie des espèces d’intérêt communautaire ............. 3 I.B.3. L’analyse socio-économique et la concertation .............................................................................. 15 Chapitre II. PRESENTATION DU SITE NATURA 2000 ...................................................................................... 17 II.A. Présentation générale de la plaine du forez ........................................................................................................... 18 II.B. Le site Natura 2000 FR821 2024 de -

SAGE Loire En Rhône-Alpes : Évaluation Environnementale Validée Le 19 Juin 2012 Et Modifiée Le 25 Janvier 2013 Par La Commission Locale De L’Eau
SAGE Loire en Rhône-Alpes : Évaluation environnementale Validée le 19 juin 2012 et modifiée le 25 janvier 2013 par la Commission Locale de l’Eau http://sage.loire.fr SOMMAIRE 1. PRÉSENTATION DU SAGE LOIRE EN RHÔNE-ALPES ................................... 6 1.1. GÉNÉRALITÉS SUR LES SAGE ............................................................................................ 7 1.1.1 Généralités ............................................................................................................. 7 1.1.2 Contenu et portée juridique .................................................................................... 7 1.2. ÉLABORATION DU SAGE LOIRE EN RHÔNE -ALPES ........................................................... 9 1.2.1 Acteurs du SAGE Loire en Rhône-Alpes ................................................................ 9 1.2.2 Périmètre du SAGE Loire en Rhône-Alpes ............................................................ 9 1.2.3 Étapes d’élaboration du SAGE Loire en Rhône-Alpes .......................................... 9 1.3. OBJECTIFS ET CONTENU DU SAGE LOIRE EN RHÔNE -ALPES ........................................... 11 1.3.1 Les principaux enjeux de l’eau et des milieux aquatiques du territoire .............. 11 1.3.2 Objectifs du SAGE Loire en Rhône Alpes ............................................................ 12 2. L’ARTICULATION DU SAGE AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES .................................................................................................................... 14 2.1. DOCUMENT