Etat Des Lieux Opportunite D'un Sage
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
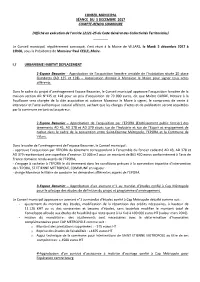
Notice Explicative De Synthese
CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 5 DECEMBRE 2017 COMPTE-RENDU SOMMAIRE (Affiché en exécution de l’article L2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales) ________ Le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni à la Mairie de VILLARS, le Mardi 5 décembre 2017 à 19h00, sous la Présidence de Monsieur Paul CELLE, Maire. I./ URBANISME HABITAT DEPLACEMENT 1-Espace Beaunier - Approbation de l’acquisition foncière amiable de l’habitation située 20 place Gambetta (AD 125 et 128) – Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer tous actes afférents. Dans le cadre du projet d’aménagement Espace Beaunier, le Conseil municipal approuve l’acquisition foncière de la maison section AD N°125 et 128 pour un prix d’acquisition de 70 000 euros, dit que Maître GARDE, Notaire à la Fouillouse sera chargée de la dite acquisition et autorise Monsieur le Maire à signer, le compromis de vente à intervenir et l’acte authentique notarié afférent, sachant que les charges d’actes et de publication seront acquittées par la commune en tant qu’acquéreur. 2.Espace Beaunier – Approbation de l’acquisition par l’EPORA (Etablissement public foncier) des tènements AD 43, AD 378 et AD 379 situés rue de l’Industrie et rue de l’Espoir et engagement de rachat dans le cadre de la convention entre Saint-Etienne Métropole, l’EPORA et la Commune de Villars. Dans le cadre de l’aménagement de l’espace Beaunier, le Conseil municipal : - approuve l’acquisition par l’EPORA du tènement correspondant à l’ensemble du foncier cadastré AD 43, AD 378 et AD 379 représentant une superficie d’environ 12 306 m2 pour un montant de 861 420 euros conformément à l’avis de France domaine rendu auprès de l’EPORA, - s’engage à racheter à l’EPORA le dit tènement dans les conditions prévues à la convention tripartite d’intervention de L’EPORA, ST ETIENNE METROPOLE, COMMUNE en vigueur. -

Diagnostic Agricole
Etudes préalables, document unique contrat de rivière/Natura 2000 (site FR8201758) Diagnostic agricole Bassin versant du Lignon du Forez SYndicat MIxte du Lignon de l’Anzon et du Vizézy, Faculté des sciences et techniques (FST), Square Savignano, université Jean-Monnet (Saint-Etienne) 42600 Savigneux 21-23, rue du Docteur-Paul-Michelon, 42023 Saint-Etienne cedex 2, Joseph Thiollier Licence Professionnelle Ingénierie Exploitation des Eaux (IEE) Stage de fin d’étude, rapport final juin 2009 Remerciements Je voudrais d’abord remercier sincèrement Xavier de Villéle, chargé de mission au SYMILAV, et Magali Gobard, directrice du pôle nature et cadre de vie de la DDEA de la Loire, qui m’ont donné ma chance dans un domaine où je désirais approfondir mes connaissances. La réalisation de cette étude n’aurait pas été possible sans la disponibilité et le soutien infaillible dont ont fait preuve ces 2 personnes à mon égard. Je remercie toute l’équipe du SYMILAV (permanente et temporaire) pour l’accueil qu’ils m’ont réservé et le temps qu’ils ont pris pour moi. A ce titre, je remercie aussi l’ensemble du Service Economie Agricole de la DDEA et tout particulièrement M. Jean Baptiste Moine, M. Gilles Fechner et M. Brice Doladille pour l’aide et les précieux conseils qu’ils m’ont apportés tout au long de mon stage. Je remercie toutes les personnes que j’ai sollicitées et qui ont pris de leur temps pour me fournir les données dont j’avais besoin (je pense notamment à Catherine Debeaurin de la DDSV, aux techniciens de la chambre d’agriculture, aux nombreux experts de terrain et aux agriculteurs qui ont accepté de me recevoir). -

Avec Saint-Étienne Métropole, AMÉLIOREZ VOTRE HABITAT !
PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) Avec Saint-Étienne Métropole, AMÉLIOREZ VOTRE HABITAT ! GUIDE DES AIDES FINANCIÈRES DE SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE L’habitat et le cadre de vie sont des programmes sont d’une durée éléments essentiels de l’attractivité d’un d’intervention de 5 ans, soit jusqu’en territoire et Saint-Étienne Métropole 2022, et permettent sous conditions aux s’investit résolument dans ces domaines propriétaires, qu’ils soient bailleurs, afin de répondre aux besoins des occupants ou en copropriété, de habitants. bénéficier d’une aide financière pour réaliser des travaux d’amélioration de Dans ce cadre, Saint-Étienne Métropole, leur(s) logement(s). avec ses 53 communes, comprend environ 170 000 logements privés dont Ce guide, qu’il s’agisse d’accession à la plus de la moitié ont été construits avant propriété, de lutte contre la précarité 1970. Aussi porte-t-elle une attention énergétique, d’adaptation de logements toute particulière à ce parc immobilier à la perte d’autonomie, de traitement de ancien, qu’il s’agit d’améliorer, de l’habitat dégradé, d’accompagnement requalifier ou encore d’adapter, par des des copropriétés fragilisées ou encore de mesures d’accompagnement et d’appui soutien à l’investissement locatif sur des aux propriétaires souhaitant s’engager secteurs ciblés, permet d’avoir une dans une telle dynamique. première approche des aides financières susceptibles d’être attribuées par les C’est la raison pour laquelle elle a mis en différents organismes concernés. Saint- place deux « Programmes d’Intérêt Étienne Métropole, pour sa part, y Général » (PIG) territorialisés et issus d’un réservera une enveloppe quinquennale partenariat volontariste. -

PASSEZ À LA VITESSE FIBRE ! Votre Territoire Investit Pour L’Internet Très Haut Débit URBISE
PASSEZ À LA VITESSE FIBRE ! Votre territoire investit pour l’Internet Très Haut Débit URBISE SAIL LES BAINS SAINT GERMAIN LA MONTAGNE SAINT MARTIN D'ESTREAUX SAINT PIERRE LA NOAILLE LA PACAUDIERE VIVANS SAINT DENIS DE CABANNE MAIZILLY LE CROZET CHARLIEU BELMONT DE LA LOIRE BELLEROCHE SAINT NIZIER SOUS CHARLIEU LA BENISSON DIEU ECOCHE MARS BRIENNON CHANDON CHANGY NOAILLY SAINT FORGEUX LESPINASSE POUILLY SOUS CHARLIEU ARCINGES SAINT BONNET DES QUARTS VILLERS CUINZIER SAINT HILAIRE SOUS CHARLIEU LE CERGNE SAINT GERMAIN LESPINASSE SEVELINGES AMBIERLE JARNOSSE THD42 NANDAX BOYER VOUGY MABLY SAINT ROMAIN LA MOTTE COUTOUVRE LA GRESLE SAINT HAON LE VIEUX SAINT RIRAND SAINT HAON LE CHATEL ROANNE RENAISON POUILLY LES NONAINS RIORGES SAINT LEGER SUR ROANNE PERREUX MONTAGNY LES NOES SAINT ANDRE D'APCHON COMBRE LE COTEAU OUCHES SAINT VINCENT DE BOISSET SAINT VICTOR SUR RHINS ARCON SAINT ALBAN LES EAUX PRADINES REGNY VILLEREST COMMELLE VERNAY LENTIGNY NOTRE DAME DE BOISSET PARIGNY VILLEMONTAIS LAY L’AMÉNAGEMENT CHERIER SAINT CYR DE FAVIERES NEAUX LA TUILIERE SAINT JEAN SAINT MAURICE SUR LOIRE SAINT SYMPHORIEN DE LAY FOURNEAUX SAINT PRIEST LA PRUGNE CORDELLE MACHEZAL BULLY SAINT PRIEST LA ROCHE VENDRANGES CROIZET SUR GAND SAINT JUST EN CHEVALET CREMEAUX CHIRASSIMONT SAINT POLGUES DANCE NEULISE CHAUSSETERRE SAINT JUST LA PENDUE SAINT CYR DE VALORGES JURE SAINT PAUL DE VEZELIN SAINT JODARD LURE SAINT ROMAIN D'URFE SOUTERNON AMIONS SAINTE COLOMBE SUR GAND SAINT MARCEL D'URFE PINAY SAINT MARCEL DE FELINES GREZOLLES VIOLAY CERVIERES LES SALLES SAINT GEORGES -

Schéma De Cohérence Territoriale (SCOT) Loire-Centre
Schéma de cohérence territoriale (SCOT) Loire-centre Porter à connaissance initial de l'Etat Mars 2012 Table des matières Liste des principaux sigles ........................................................................................................... ................... 8 INTRODUCTION ...................................................................................................... ......... 9 1 - Qu'est-ce qu'un SCOT ? .......................................................................................................... .................... 9 1.1 - L'objet du SCOT ......................................................................................................................... .................. 9 1.2 - Un rôle renforcé par la loi "Grenelle 2" ........................................................................................ .................. 9 2 - Contexte de l'élaboration du SCOT Loire Centre .................................................................... .................. 10 3 - Le porter à connaissance (PAC) et le rôle de l'État dans l'élaboration du SCOT .................... ................. 11 3.1 - Le porter à connaissance (PAC) ................................................................................................ ................ 11 PARTIE I- CADRE RÈGLEMENTAIRE DU SCOT ..................................... ... 13 A- L'ENCADREMENT NORMATIF DU SCOT .......................................................... ....... 14 1 - Les principes généraux que le SCOT doit respecter .............................................................. -

Nouvelle Carte Cantonale Finale
Nouveau découpage des cantons de la Loire Les Cantons du Département : Urbise er Sail- 1 Andrézieux-Bouthéon les-Bains e Saint- Saint-Germain- 2 Boën-sur-Lignon Martin- la-Montagne d'Estréaux La Saint- Pacaudière Vivans Pierre- Saint- e la-Noaille Denis- Maizilly 3 Charlieu de Le Crozet Charlieu Belmont- Belleroche La Saint-Nizier- Cabanne sous-Charlieu de-la-Loire Bénisson- Écoche Dieu Chandon Mars e Saint- Noailly 4 Le Coteau Changy Pouilly- Forgeux- Arcinges Saint-Bonnet- Briennon sous- Saint- Lespinasse Cuinzier Le des-Quarts Charlieu Hilaire- Villers Cergne e sous-Charlieu 5 Feurs Saint- Jarnosse Ambierle Germain- e Sevelinges Lespinasse 11 Nandax Boyer Vougy e Saint- 3 6 e Romain- Mably La Firminy Saint-Haon-le-Vieux la-Motte Coutouvre Gresle Saint- Rirand Saint-Haon-le-Châtel Roanne e Nord 7 Pouilly Saint- Montbrison Renaison les- Léger- Riorges Nonains sur- Roanne Perreux Montagny Roanne Les Noës e e Sud 9 Saint-André- Combre e d'Apchon 12 8 Le Pilat Le Saint- Ouches Saint- Arcon Coteau Vincent- Victor- Saint-Alban- de-Boisset sur-Rhins Commelle- Pradines Régny les-Eaux Notre- e Lentigny Vernay Villerest Parigny Dame- 9 Renaison Villemontais de-Boisset Lay Cherier Saint-Cyr-de- Saint-Jean- Neaux Fourneaux e La Tuilière Saint-Maurice- Favières 10 Rive-de-Gier Saint-Priest- sur-Loire Cordelle Saint-Symphorien- la-Prugne Vendranges de-Lay e Bully Saint- Machézal Cremeaux e 11 Roanne1 Saint-Just- Priest- 4 Croizet- en-Chevalet Saint- la-Roche Chirassimont Polgues Dancé sur-Gand Chausseterre Neulise e Saint- Saint- Saint-Just- Saint-Cyr- -

Territoire À Énergie Positive Saint-Étienne Métropole - Pilat
TERRITOIRE à éNERGIE POSITIVE SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE - PILAT 2015 - 2018 : trois premières années d’action collective au service de la transition énergétique Avril 2019 édito Saint-Etienne Métropole, les Communautés de Communes Les actions et dispositifs présentés ne constituent toutefois des Monts du Pilat et du Pilat Rhodanien, ainsi que le Parc pas une finalité, mais un commencement. Le dérèglement naturel régional du Pilat se sont engagés, en 2014, dans climatique qui s’accélère et les alertes répétées des une ambitieuse démarche de « Territoire à Energie scientifiques nous incitent à agir toujours plus vite et plus Positive» suite à l’appel à manifestation d’intérêt que la massivement. C’est dans cet esprit de coopération et de délégation régionale de l’ADEME (Agence De solidarité renforcées que nous souhaitons engager une l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) et la Région 2ème phase de la démarche TEPOS, pour laquelle votre Auvergne Rhône-Alpes avaient lancé. soutien sera à nouveau sollicité, dans la perspective de faire de notre territoire une force de propositions, toujours Cette démarche a su mobiliser au-delà des collectivités, plus innovant et à la pointe de la transition énergétique de nombreuses institutions, entreprises et associations et écologique. qui lui ont apporté leur soutien. Labellisé en 2015, notre territoire TEPOS a pu bénéficier de l’accompagnement proposé par l’ADEME et la Région. Ce soutien, comme celui des acteurs de notre territoire de projet, a été précieux et a permis d’aborder et Gaël PERDRIAU d’accélérer sa transition énergétique et écologique dans Président de bonnes conditions. -

Bulletin N°2 De Forez-Est
Juin 2018 Communauté de Communes de Forez-Est Roanne Saint-Cyr Saint- de-Valorges Jodard Lyon Pinay d Saint-Marcel Sainte-Colombe Clermont F de-Félines sur-Gand Violay Sainte-Agathe- Néronde en-Donzy Bussières Balbigny Montchal Nervieux Pouilly- lès-Feurs Rozier- en-Donzy Panissières Épercieux- L'édito Mizérieux Saint-Paul Cottance Civens Cleppé Salvizinet Essertines- en-Donzy Mesdames, Messieurs, Boën/Lignon Jas Saint-Martin- Lestra epuis la création de la Communauté de Communes Feurs Salt-en- er Donzy Dde Forez-Est (CCFE), le 1 janvier 2017, les élus Saint- Ste-Foy- Poncins Barthélemy- l’Argentière communautaires et les agents se sont attachés à main- Valeille Lestra tenir et développer des compétences et prestations au Chambéon service de la population et du territoire. Vous pourrez dé- Saint-Laurent- la-Conche Saint-Cyr- couvrir ou redécouvrir, au fil de ce magazine, les domaines les-Vignes dans lesquels la Communauté de Communes s'investit au Marclopt quotidien : petite enfance et jeunesse, développement du- Saint-André- le-Puy rable, économie, loisirs... Bellegarde- en-Forez Chazelles- Montrond- sur-Lyon Mais le dossier majeur est l'élaboration de notre Projet de ter- Montbrison les-Bains ritoire, qui doit à terme définir les axes de développement de la Cuzieu Communauté de Communes de Forez-Est. Saint-Médard- Bien que les communes restent l'échelon de proximité, force est Rivas en-Forez de constater que l'intercommunalité occupe une place de plus en plus importante dans la gestion des territoires. Aveizieux Veauche Cette intercommunalité est indispensable pour relever les défis à venir. Les élus communautaires ont la volonté de construire, avec l'ensemble des communes, cette nouvelle entité. -

Compte-Rendu De La Séance Du Conseil Communautaire Du 25
COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019 A 19H00 L’an deux mille dix-neuf, le vingt-cinq septembre, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de FOREZ-EST, légalement convoqué, s’est réuni en séance publique, sous la Présidence de Jean-Michel MERLE, Président, en session ordinaire, à l’hippodrome de Feurs. Conformément au CGCT, le quorum est atteint. Présents : M. Sylvain DARDOULLIER, Mme Françoise DUFOUR, M. Gilles DUPIN, M. Jacques LAFFONT, Mme Anne-Marie BRUYAS, M. Georges SUZAN, Mme Michelle DELORME, M. Jean-Paul BLANCHARD, Mme Annie CHAPUIS, Mme Jeanine RONGERE, M. Ennemond THIVILIER, M. Pierre VERICEL, M. Michel GRAND, Mme Simone COUBLE, M. Jacques DE LEMPS, Mme Armelle DESJOYAUX, M. Pascal VELUIRE, M. Christian FAURE, M. Johann CESA, Mme Mireille GIBERT, M. Claude MONDESERT, M. Henri NIGAY, M. Georges REBOUX, M. Jean-Pierre TAITE, M. Christian VILAIN, M. Marc RODRIGUE, Mme Catherine EYRAUD, M. Marcel GEAY, M. Christian DENIS, Mme Marie-Antoinette BENY, Mme Cécile DE LAGET, M. Claude GIRAUD, Mme Liliane MEA, M. Serge PERCET, M. Georges ROCHETTE, M. Gérard MONCELON, M. Jérôme BRUEL, M. Jean-Michel MERLE, M. Laurent MIOCHE, M. Christian MOLLARD, M. Henri BONADA, M. Julien DUCHE, Mme Brigitte BRATKO, M. Didier BERNE, M. Patrick DEMMELBAUER, M. Pierre SIMONE, M. Gilles CHEVRON, M. Jean-François REYNAUD, M. Dominique RORY, M. Frédéric LAFOUGERE, M. Yves GRANDRIEUX, M. Sébastien DESHAYES, M. Bruno COASSY, M. Jean-François YVOREL, M. Robert FLAMAND, M. Christophe BEGON, Mme Martine DEGOUTTE, M. Gérard DUBOIS, Mme Christine LA MARCA, Mme Suzanne LYONNET, M. Julien MAZENOD, M. Christian SAPY, Mme Véronique CHAVEROT Pouvoirs : M. -

Etude Des Populations D'ombre Commun Du Forez Sur L' Ance Du Nord, Le Lignon Du Forez Et L'aix
KARL--FRANZENS--UNIVERSITÄT GRAZ UNI Fédération de la Loire GRAZ pour la Pêche et la UMR CNRS 5023 Institut für Zoologie Université Claude Bernard Lyon 1 Protection du Milieu Aquatique Etude des populations d’Ombre commun du Forez sur l’ Ance du Nord, le Lignon du Forez et l’Aix Caractérisation Génétique et Dynamique des Populations Février 2006 AUTEURS : GRES Pierre 1 ; PERSAT Henri2; WEISS Steven et KOPUN Theodora 3 Avec les concours financiers de: 1 État des milieux et dynamique des populations : FDPPMA 42, Zone industrielle le Bas Rollet, 14 allée de l’Europe, 42480 la Fouillouse, Tél. 04 77 02 20 00, Mail : [email protected] 2 Génétique et dynamique des populations : Université Claude Bernard Lyon, Unité de recherche associée UMR, CNRS 5023, Laboratoire d’Ecologie des Hydroystèmes Fluviaux, Bâtiment F.A. Forel, 43 Boulevard du 11 novembre 1918, 69622 VILLEURBANNE CEDEX ,Tél. 04 72 44 84 35, Mail : [email protected] 3 Génétique : analyse biomoléculaire et traitement statistique : Karl-Franzens Universität, Graz, Autriche, contact Steven Weiss, Mail : [email protected] 2 FPPMA Loire Université de Lyon I Karl-Franzens Universität, Graz Remerciements : Cette étude n’aurait pas pu se mettre en place sans les concours financiers: ? Du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable ; ? Du Conseil Régional Rhône Alpes ; ? De l’Agence de l’Eau Loire Bretagne ; ? Du Conseil Général de la Loire en Rhône-Alpes; ? Des Fédérations de la Loire, de la Haute Loire et du Puy de Dôme pour la Pêche et la Protection -

Toutes Les Collectes Habituellement Effectuées Le Lundi En Semaine Paire Seront Assurées Normalement Sauf Cas Particuliers Précisés Dans Le Tableau Comme Suit
Collecte des déchets les 1er et 8 mai 2017 En raison des jours fériés du LUNDI 1er MAI et du LUNDI 8 MAI, des modifications des jours et horaires de collecte des déchets auront lieu dans certaines communes de Saint-Etienne Métropole 2 IMPACT du LUNDI 1er MAI 2017 SUR LE SERVICE DECHETS Toutes les déchèteries de Saint-Etienne Métropole sont fermées (Ouverture aux horaires habituels le dimanche 30 avril et le mardi 2 mai) Toutes les collectes habituellement effectuées le Lundi en semaine paire seront assurées normalement sauf cas particuliers précisés dans le tableau comme suit : Des variations d’horaires pourront être observées en fonction des quantités collectées. Merci de sortir les bacs un peu plus tôt que les jours habituels. 3 IMPACT du LUNDI 1er MAI 2017 SUR LE SERVICE DECHETS Pas de collecte le lundi 1er mai sur les secteurs suivants: La Gimond La collecte sélective est reportée le mardi 2 mai. Aboën, Les collectes de la semaine du 1er mai au 6 mai sont toutes décalées d’un jour Rozier-Côtes-d’Aurec, (collecte du lundi effectuée le mardi , collecte du mardi effectuée le Saint-Maurice-en-Gourgois, mercredi,…, collecte du vendredi effectuée le samedi) Saint-Nizier-de-Fornas Cellieu, Saint-Christo en Jarez, Les collectes d’ordures ménagères et sélectives seront avancées le samedi 29 Chagnon avril. Marcenod La Grand’Croix (route de Couttange, lotissement des 4 Vents, Salcigneux) Les collectes d’ordures ménagères et sélective seront avancées le samedi 29 L’Horme (route de Cellieu) avril. Lorette (quartier Charnière - Télégraphe) Dans les secteurs habituellement collectés 1 fois tous les 15 jours, 1 ou 2 fois par semaine les collectes d’ordures ménagères et sélectives sont avancées au Saint-Chamond samedi 29 avril. -

Collecte 2021 Zone a Des Emballages Et Papiers Recyclables
COLLECTE 2021 ZONE A DES EMBALLAGES ET PAPIERS RECYCLABLES COLLECTE Sortir les bacs CHANGEMENT couvercles fermés ! DU JOUR DE COLLECTE la veille au soir du jour de collecte et les rentrer LUNDIMARDIMERCREDIJEUDI VENDREDISAMEDILUNDIMARDIMERCREDIJEUDI VENDREDISAMEDI au plus tôt après le ramassage Semaines paires Semaines impaires (au plus tard AVEIZIEUX X DÉPOSEZ VOS EMBALLAGES ET PAPIERS le soir même) RECYCLABLES EN MÉLANGE, EN VRAC ET SANS BELLEGARDE-EN-FOREZ X SAC PLASTIQUE DANS VOTRE POUBELLE JAUNE. CHAMBÉON X CHAZELLES-SUR-LYON ! vert X CHAZELLES-SUR-LYON ! bleu X CIVENS X Cartons, cartonnettes CLEPPÉ X et briques alimentaires CUZIEU X FEURS X PAS BESOIN MARCLOPT X DE LAVER LE CONTENANT MONTROND-LES-BAINS X Tous les papiers PONCINS X Emballages métalliques POUILLY-LES-FEURS X RIVAS X SAINT-ANDRÉ-LE-PUY X Bouteilles et flacons en plastique SAINT-CYR-LES-VIGNES X avec les bouchons SAINT-LAURENT-LA-CONCHE X SAINT-MÉDARD-EN-FOREZ X SALT-EN-DONZY X SALVIZINET X Des communes possèdent plusieurs secteurs de collecte. VALEILLE X Pour connaître votre secteur, VEAUCHE secteur bleu X CONTACT se référer aux calendriers spécifiques (avec plans fournis) VEAUCHE secteur vert X SERVICE DÉCHETS ou consultez le site internet de la > 04 77 28 29 38 communauté de communes : ATTENTION : Tous les jours fériés sont travaillés, sauf le vendredi 1er janvier, le samedi 1er mai et www.forez-est.fr le samedi 25 décembre où la collecte est décalée au jour ouvrable suivant. COLLECTE 2021 ZONE A DES ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES COLLECTE Sortir les bacs couvercles fermés la CHANGEMENT veille au soir ! DU JOUR DE COLLECTE LUNDIMARDIMERCREDIJEUDI VENDREDISAMEDILUNDIMARDIMERCREDIJEUDI VENDREDISAMEDI du jour de collecte et les rentrer Semaines paires Semaines impaires Des communes possèdent plusieurs au plus tôt après AVEIZIEUX X secteurs de collecte.