Pentecôte Et Langues De Feu
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A Descriptive Catalogue of the Greek Manuscript Collection of Lambeth Palace Library
A Descriptive Catalogue of the Greek Manuscript Collection of Lambeth Palace Library Christopher Wright, Maria Argyrou and Charalambos Dendrinos Lambeth Palace Library Hellenic Institute Royal Holloway, University of London February 2016 Contents TABLEOFCONTENTS Preface by His Grace Justin Welby, Archbishop of Canterbury ::::::::::::::::::::::: 4 Preface by Mr Anastasios P. Leventis, the A. G. Leventis Foundation ::::::::::::::::: 5 Cataloguing the Greek Manuscripts of Lambeth Palace Library :::::::::::::::::::::: 7 Lambeth Palace Library: a brief history ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 10 Constantinople and Canterbury: contact and collaboration ::::::::::::::::::::::::: 13 Provenance and Sub-Collections ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 19 Notable features of manuscripts in the collection ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 30 List of Abbreviations:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::36 Technical notes and feedback:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::39 Editorial Conventions :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 40 Glossary of Terms Used :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 41 MS. 461 :::::::::::::::::::::::::::: 45 MS. 1194 :::::::::::::::::::::::::: 260 MS. 528 :::::::::::::::::::::::::::: 52 MS. 1195 :::::::::::::::::::::::::: 269 MS. 528 B :::::::::::::::::::::::::: 59 MS. 1196 :::::::::::::::::::::::::: 280 MS. 802 (a–b) ::::::::::::::::::::::: 63 MS. 1197 :::::::::::::::::::::::::: 298 MS. 1175 ::::::::::::::::::::::::::: -

Coptic Literature in Context (4Th-13Th Cent.): Cultural Landscape, Literary Production, and Manuscript Archaeology
PAST – Percorsi, Strumenti e Temi di Archeologia Direzione della collana Carlo Citter (Siena) Massimiliano David (Bologna) Donatella Nuzzo (Bari) Maria Carla Somma (Chieti) Francesca Romana Stasolla (Roma) Comitato scientifico Andrzej Buko (Varsavia) Neil Christie (Leichester) Francisca Feraudi-Gruénais (Heidelberg) Dale Kinney (New York) Mats Roslund (Lund) Miljenko Jurković (Zagabria) Anne Nissen (Paris) Askold Ivantchik (Mosca) This volume, which is one of the scientific outcomes of the ERC Advanced project ‘PAThs’ – ‘Tracking Papy- rus and Parchment Paths: An Archaeological Atlas of Coptic Literature. Literary Texts in their Geographical Context: Production, Copying, Usage, Dissemination and Storage’, has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 programme, grant no. 687567. I testi pubblicati nella collana sono soggetti a valutazione secondo la procedura del doppio blind referee In copertina: P. Mich. 5421 e una veduta di Karanis © Roma 2020, Edizioni Quasar di Severino Tognon S.r.l. via Ajaccio 41-43, 00198 Roma - tel 0685358444 email: [email protected] eISBN 978-88-5491-058-4 Coptic Literature in Context (4th-13th cent.): Cultural Landscape, Literary Production, and Manuscript Archaeology Proceedings of the Third Conference of the ERC Project “Tracking Papyrus and Parchment Paths: An Archaeological Atlas of Coptic Literature. Literary Texts in their Geographical Context (‘PAThs’)”. edited by Paola Buzi Edizioni Quasar Table of Contents Paola Buzi The Places of Coptic Literary Manuscripts: Real and Imaginary Landscapes. Theoretical Reflections in Guise of Introduction 7 Part I The Geography of Coptic Literature: Archaeological Contexts, Cultural Landscapes, Literary Texts, and Book Forms Jean-Luc Fournet Temples in Late Antique Egypt: Cultic Heritage between Ideology, Pragmatism, and Artistic Recycling 29 Tito Orlandi Localisation and Construction of Churches in Coptic Literature 51 Francesco Valerio Scribes and Scripts in the Library of the Monastery of the Archangel Michael at Phantoou. -

Acts - Revelation the Aramaic Peshitta & Peshitto and Greek New Testament
MESSIANIC ALEPH TAV INTERLINEAR SCRIPTURES (MATIS) INTERLINEAR VOLUME FIVE ACTS - REVELATION THE ARAMAIC PESHITTA & PESHITTO AND GREEK NEW TESTAMENT With New Testament Aramaic Lexical Dictionary (Compiled by William H. Sanford Copyright © 2017) Printed by BRPrinters The Messianic Aleph Tav Interlinear Scriptures (MATIS) FIRST EDITION Acts - Revelation Volume Five ARAMAIC - GREEK Copyright 2017 All rights reserved William H. Sanford [email protected] COPYRIGHT NOTICE The Messianic Aleph Tav Interlinear Scriptures (MATIS), Acts - Revelation, Volume Five, is the Eastern Aramaic Peshitta translated to English in Interlinear and is compared to the Greek translated to English in Interlinear originating from the 1987 King James Bible (KJV) which are both Public Domain. This work is a "Study Bible" and unique because it is the first true interlinear New Testament to combine both the John W. Etheridge Eastern Aramaic Peshitta in both Aramaic and Hebrew font compared to the Greek, word by word, in true interlinear form and therefore comes under copyright protection. This is the first time that the John W. Etheridge Eastern Aramaic Peshitta has ever been put in interlinear form, word by word. The John W. Etheridge Eastern Aramaic Peshitta English translation was provided by Lars Lindgren and incorporates his personal notes and also, the Hebrew pronunciation of the Aramaic is unique and was created and provided by Lars Lindgren and used with his permission…all of which is under copyright protection. This publication may be quoted in any form (written, visual, electronic, or audio), up to and inclusive of seventy (70) consecutive lines or verses, without express written permission of William H. -

Scribal Habits in Selected New Testament Manuscripts, Including Those with Surviving Exemplars
SCRIBAL HABITS IN SELECTED NEW TESTAMENT MANUSCRIPTS, INCLUDING THOSE WITH SURVIVING EXEMPLARS by ALAN TAYLOR FARNES A thesis submitted to The University of Birmingham for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY Institute for Textual Scholarship and Electronic Editing Department of Theology and Religion College of Arts and Law The University of Birmingham April 2017 University of Birmingham Research Archive e-theses repository This unpublished thesis/dissertation is copyright of the author and/or third parties. The intellectual property rights of the author or third parties in respect of this work are as defined by The Copyright Designs and Patents Act 1988 or as modified by any successor legislation. Any use made of information contained in this thesis/dissertation must be in accordance with that legislation and must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the permission of the copyright holder. Abstract In the first chapter of this work, I provide an introduction to the current discussion of scribal habits. In Chapter Two, I discuss Abschriften—or manuscripts with extant known exemplars—, their history in textual criticism, and how they can be used to elucidate the discussion of scribal habits. I also present a methodology for determining if a manuscript is an Abschrift. In Chapter Three, I analyze P127, which is not an Abschrift, in order that we may become familiar with determining scribal habits by singular readings. Chapters Four through Six present the scribal habits of selected proposed manuscript pairs: 0319 and 0320 as direct copies of 06 (with their Latin counterparts VL76 and VL83 as direct copies of VL75), 205 as a direct copy of 2886, and 821 as a direct copy of 0141. -
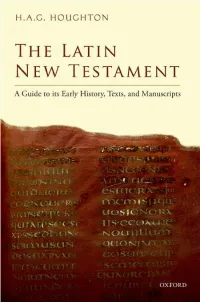
THE LATIN NEW TESTAMENT OUP CORRECTED PROOF – FINAL, 1/12/2015, Spi OUP CORRECTED PROOF – FINAL, 1/12/2015, Spi
OUP CORRECTED PROOF – FINAL, 1/12/2015, SPi THE LATIN NEW TESTAMENT OUP CORRECTED PROOF – FINAL, 1/12/2015, SPi OUP CORRECTED PROOF – FINAL, 1/12/2015, SPi The Latin New Testament A Guide to its Early History, Texts, and Manuscripts H.A.G. HOUGHTON 1 OUP CORRECTED PROOF – FINAL, 14/2/2017, SPi 3 Great Clarendon Street, Oxford, OX2 6DP, United Kingdom Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University’s objective of excellence in research, scholarship, and education by publishing worldwide. Oxford is a registered trade mark of Oxford University Press in the UK and in certain other countries © H.A.G. Houghton 2016 The moral rights of the authors have been asserted First Edition published in 2016 Impression: 1 Some rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, for commercial purposes, without the prior permission in writing of Oxford University Press, or as expressly permitted by law, by licence or under terms agreed with the appropriate reprographics rights organization. This is an open access publication, available online and unless otherwise stated distributed under the terms of a Creative Commons Attribution –Non Commercial –No Derivatives 4.0 International licence (CC BY-NC-ND 4.0), a copy of which is available at http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. Enquiries concerning reproduction outside the scope of the above should be sent to the Rights Department, Oxford University Press, at the address above Published in the United States of America by Oxford University Press 198 Madison Avenue, New York, NY 10016, United States of America British Library Cataloguing in Publication Data Data available Library of Congress Control Number: 2015946703 ISBN 978–0–19–874473–3 Printed in Great Britain by Clays Ltd, St Ives plc Links to third party websites are provided by Oxford in good faith and for information only. -
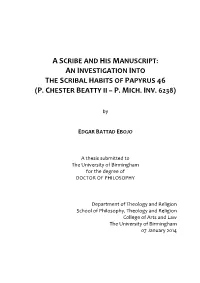
A Scribe and His Manuscript: an Investigation Into the Scribal Habits of Papyrus 46 (P
A SCRIBE AND HIS MANUSCRIPT: AN INVESTIGATION INTO THE SCRIBAL HABITS OF PAPYRUS 46 (P. CHESTER BEATTY II – P. MICH. INV. 6238) by EDGAR BATTAD EBOJO A thesis submitted to The University of Birmingham for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY Department of Theology and Religion School of Philosophy, Theology and Religion College of Arts and Law The University of Birmingham 07 January 2014 University of Birmingham Research Archive e-theses repository This unpublished thesis/dissertation is copyright of the author and/or third parties. The intellectual property rights of the author or third parties in respect of this work are as defined by The Copyright Designs and Patents Act 1988 or as modified by any successor legislation. Any use made of information contained in this thesis/dissertation must be in accordance with that legislation and must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the permission of the copyright holder. ABSTRACT This thesis is an investigation into the scribal habits of 46, attempting to enrich further the information database about the sociology of ancient book production and to explore how these habits might have affected the transmission of the texts of the New Testament in general and the corpus Paulinum in particular. Given this end, this thesis challenges the traditional methods of locating the “scribal habits” of a particular manuscript, specifically methods that are text-focused. Crucial to developing a viable methodology is articulating how the conceptual category of “scribal habits” is to be understood before we can sufficiently isolate them. Using an integrative approach (i.e., the composite employment of papyrology, codicology, palaeography, and textual criticism), this thesis proposes that “scribal habits” are to be found in everything that a particular scribe recurrently did and did not do in the manuscript, encompassing all the stages of its production and its eventual use. -
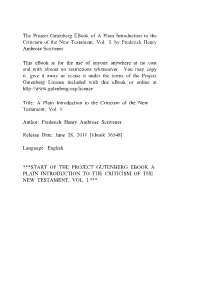
A Plain Introduction to the Criticism of the New Testament, Vol. I. by Frederick Henry Ambrose Scrivener
The Project Gutenberg EBook of A Plain Introduction to the Criticism of the New Testament, Vol. I. by Frederick Henry Ambrose Scrivener This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at http://www.gutenberg.org/license Title: A Plain Introduction to the Criticism of the New Testament, Vol. I. Author: Frederick Henry Ambrose Scrivener Release Date: June 28, 2011 [Ebook 36548] Language: English ***START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK A PLAIN INTRODUCTION TO THE CRITICISM OF THE NEW TESTAMENT, VOL. I.*** A Plain Introduction to the Criticism of the New Testament For the Use of Biblical Students By The Late Frederick Henry Ambrose Scrivener M.A., D.C.L., LL.D. Prebendary of Exeter, Vicar of Hendon Fourth Edition, Edited by The Rev. Edward Miller, M.A. Formerly Fellow and Tutor of New College, Oxford Vol. I. George Bell & Sons, York Street, Covent Garden Londo, New York, and Cambridge 1894 Contents Preface To Fourth Edition. .5 Description Of The Contents Of The Lithographed Plates. .9 Addenda Et Corrigenda. 30 Chapter I. Preliminary Considerations. 31 Chapter II. General Character Of The Greek Manuscripts Of The New Testament. 54 Chapter III. Divisions Of The Text, And Other Particulars. 98 Appendix To Chapter III. Synaxarion And Eclogadion Of The Gospels And Apostolic Writings Daily Throughout The Year. 127 Chapter IV. The Larger Uncial Manuscripts Of The Greek Testament. -

Technical Signs in Early Medieval Manuscripts Copied in Irish Minuscule
Technical signs in early medieval manuscripts copied in Irish minuscule Evina Steinová Huygens ING, KNAW In the recent decades, projects such as the one that led to the production of this volume have made us aware of the value of marginal annotations for the understanding of early medieval intellectual culture.1 Glosses, commentaries, and other marginalia receive ever increasing attention, which is best manifested in the growing number of their editions and of studies dedicated to the phenomenon of annotating the manuscript book.2 Nevertheless, some types of marginalia that can be encountered in early medieval Latin manuscripts still escape our full grasp, being difficult to describe, examine systematically, and interpret. A particularly elusive category in this regard are technical signs, marginalia that have the form of symbols rather than words or images.3 Nota monograms that will be familiar to all adept at working with medieval manuscripts are one example of such technical signs, used in the Latin-writing world at least since the fifth century to mark passages of interest, literally beseeching one to ‘pay attention’ at a certain spot.4 They also illustrate some of the problems that technical signs pose to modern scholars. Even though they allow us to identify verses or lines of text that attracted the attention of medieval readers, it is notoriously difficult to interpret their precise function in specific manuscripts.5 Was the interesting aspect that warranted the use of nota signs the sophisticated theological or philosophical argument running through the text? Or was it rather something more 1 This article came into being as a part of the NWO VIDI project Marginal Scholarship: the Practice of Learning in the Early Middle Ages supervised by prof. -
THE EARLY TEXT of the NEW TESTAMENT This Page Intentionally Left Blank the Early Text of the New Testament
THE EARLY TEXT OF THE NEW TESTAMENT This page intentionally left blank The Early Text of the New Testament Edited by CHARLESE.HILLANDMICHAELJ.KRUGER 1 1 Great Clarendon Street, Oxford, OX2 6DP United Kingdom Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University’s objective of excellence in research, scholarship, and education by publishing worldwide. Oxford is a registered trade mark of Oxford University Press in the UK and in certain other countries q Oxford University Press 2012 The moral rights of the authors have been asserted First Edition published in 2012 Impression: 1 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of Oxford University Press, or as expressly permitted by law, by licence or under terms agreed with the appropriate reprographics rights organization. Enquiries concerning reproduction outside the scope of the above should be sent to the Rights Department, Oxford University Press, at the address above You must not circulate this work in any other form and you must impose this same condition on any acquirer British Library Cataloguing in Publication Data Data available Library of Congress Cataloging in Publication Data Data available ISBN 978–0–19–956636–5 Printed in Great Britain on acid-free paper by MPG Books Group, Bodmin and King's Lynn Acknowledgements For a book such as this one, in which many have been involved, there are many who deserve our thanks. We are grateful, first of all, for the privilege of working with the extraordinary group of experts who contributed the chapters to this book. -

Downloaded from the Digital Library of the Muktabodha Indological Research Institute
One-Volume Libraries: Composite and Multiple-Text Manuscripts Studies in Manuscript Cultures Edited by Michael Friedrich Harunaga Isaacson Jörg B. Quenzer Volume 9 One-Volume Libraries: Composite and Multiple-Text Manuscripts Edited by Michael Friedrich and Cosima Schwarke ISBN 978-3-11-049693-2 e-ISBN (PDF) 978-3-11-049695-6 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-049559-1 ISSN 2365-9696 This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License. For details go to http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data A CIP catalog record for this book has been applied for at the Library of Congress. Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available on the Internet at http://dnb.dnb.de. © 2016 Michael Friedrich, Cosima Schwarke, published by Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston. The book is published with open access at degruyter.com. Printing and binding: CPI books GmbH, Leck ♾ Printed on acid-free paper Printed in Germany www.degruyter.com Contents Michael Friedrich and Cosima Schwarke Introduction – Manuscripts as Evolving Entities | 1 Marilena Maniaci The Medieval Codex as a Complex Container: The Greek and Latin Traditions | 27 Jost Gippert Mravaltavi – A Special Type of Old Georgian Multiple-Text Manuscripts | 47 Paola Buzi From Single-Text to Multiple-Text Manuscripts: Transmission Changes in Coptic Literary Tradition. Some Case-Studies from the White Monastery Library | 93 Alessandro Bausi Composite and Multiple-Text Manuscripts: The Ethiopian Evidence | 111 Alessandro Gori Some Observations on Composite and Multiple-Text Manuscripts in the Islamic Tradition of the Horn of Africa | 155 Gerhard Endress ‘One-Volume Libraries’ and the Traditions of Learning in Medieval Arabic Islamic Culture | 171 Jan Schmidt From ‘One-Volume-Libraries’ to Scrapbooks. -

Rethinking the Western Non-Interpolations: a Case for Luke Re-Editing His Gospel
Rethinking the Western Non-interpolations: A Case For Luke Re-editing His Gospel by Giuseppe Capuana BA (Mus), GradDipEd, BTheol (Hons) A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Master of Philosophy University of Divinity 2018 Abstract This thesis presents a new paradigm for understanding the Western non-interpolations. It argues that when Luke originally wrote his Gospel it did not contain 22:19b–20; 24:3b, 6a, 12, 36b, 40, 51b and 52a. However, at a later time, around the time Luke wrote Acts, he returned to his Gospel creating a second edition which contained these readings. My thesis makes the case that the paradigm of scribal interpolation is problematic. Working under this paradigm the results of external and internal evidence appear conflicting and scholars are generally forced to give greater preference to one set of evidence over the other. However, a balanced weighting of the external and internal evidence points us towards the notion that Luke was responsible for both the absence and the inclusion of 22:19b–20; 24:3b, 6a, 12, 36b, 40, 51b and 52a. Chapter one introduces the Western non-interpolations. It also makes the case that the quest for the original text of Luke’s Gospel should not be abandoned. Chapter two is on the history, theory and methodology of the Western non-interpolations. It begins with an overview of the text-critical scholarship emerging during the nineteenth century, particularly the influence of Brooke Foss Westcott and Fenton John Anthony Hort. It also covers the period after Westcott and Hort to the present. -

The Interpreting Ancient Manuscripts Web
Home Welcome to the Interpreting Ancient Manuscripts Web designed by: Timothy W. Seid, Ph.D. Associate Dean of Distributed Learning & Assistant Prof. of New Testament Studies Earlham School of Religion Richmond, Indiana Fully-accredited seminary degree programs offered Email: [email protected] through online courses and two-week intensive classes Updated 06/28/04 It all started... The Interpreting Ancient Manuscripts web is adapted from the original Hypercard version. It was developed at Brown University with the aid of an Educational Computing Grant to the Religious Studies Department. A special acknowledgement goes to the Computing in the Humanities Users Group (CHUG) for their inspiration and encouragement over the years and to the Scholarly Technology Group for their guidance and assistance. The main focus of the web is on the process used to study the ancient manuscripts upon which the New Testament is based. While the language discussed is Greek, almost everything is explained with transliterations into English and, where applicable, translations from standard English Bibles. http://www.earlham.edu/~seidti/iam/home.html (1 of 2)2006-08-01 10:38:04 Home Navigation In order to navigate the web, begin by clicking the Paleography icon in the top frame. At the bottom of each subsequent page you will be provided with the option of clicking the next page in the thread. If you should become lost, click the Index icon in the top frame to see a complete listing of the Interpreting Ancient Manuscripts Web. There are also hypertext links to related items within the web and to resources in the World Wide Web.