COLPOMENIA SINUOSA DERB. Et SOL
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

US 2019 / 0029266 A1 SAWANT ( 43 ) Pub
US 20190029266A1 ( 19) United States (12 ) Patent Application Publication ( 10) Pub . No. : US 2019 / 0029266 A1 SAWANT ( 43 ) Pub . Date : Jan . 31 , 2019 ( 54 ) NOVEL CROP FORTIFICATION , (52 ) U .S . CI. NUTRITION AND CROP PROTECTION CPC .. .. .. A01N 63/ 04 ( 2013 .01 ) ; AOIN 25 / 12 COMPOSITION ( 2013 .01 ) ; A01N 63/ 00 ( 2013 .01 ) ; C05G 3 / 02 (2013 .01 ) ; C050 9 / 00 (2013 .01 ) ; C05C 9 / 00 (71 ) Applicant: Arun Vitthal SAWANT, Mumbai ( IN ) ( 2013. 01 ) ; C05F 11/ 00 ( 2013 .01 ) ( 72 ) Inventor: Arun Vitthal SAWANT, Mumbai ( IN ) (57 ) ABSTRACT (21 ) Appl. No. : 16 /047 ,834 The invention relates to an algal granular composition . More (22 ) Filed : Jul. 27 , 2018 particularly , the invention relates to an algal granular com position comprising at least one alga, and at least one (30 ) Foreign Application Priority Data agrochemically acceptable excipients selected from one or more of surfactants , binders or disintegrant having weight Jul. 27, 2017 (IN ) .. .. .. .. 201721026745 ratio of algae to at least one of surfactant, binder or disin tegrant in the range of 99 : 1 to 1 : 99 . The algae comprise Publication Classification 0 . 1 % to 90 % by weight of the total composition . The (51 ) Int . Cl. composition has a particle size in the range of 0 . 1 microns AOIN 63 / 04 ( 2006 .01 ) to 60 microns . Furthermore , the invention relates to a AOIN 25 / 12 ( 2006 . 01 ) process of preparing the algal granular composition com A01N 63 / 00 ( 2006 . 01 ) prising at least one alga and at least one agrochemically C05F 11/ 00 ( 2006 . 01 ) acceptable excipient. The invention further relates to a C05D 9 / 00 ( 2006 .01 ) method of treating the plants , seeds, crops , plantpropagation C05C 9 /00 ( 2006 .01 ) material, locus , parts thereof or the soil with the algal C05G 3 / 02 ( 2006 .01 ) granular composition . -

The Classification of Lower Organisms
The Classification of Lower Organisms Ernst Hkinrich Haickei, in 1874 From Rolschc (1906). By permission of Macrae Smith Company. C f3 The Classification of LOWER ORGANISMS By HERBERT FAULKNER COPELAND \ PACIFIC ^.,^,kfi^..^ BOOKS PALO ALTO, CALIFORNIA Copyright 1956 by Herbert F. Copeland Library of Congress Catalog Card Number 56-7944 Published by PACIFIC BOOKS Palo Alto, California Printed and bound in the United States of America CONTENTS Chapter Page I. Introduction 1 II. An Essay on Nomenclature 6 III. Kingdom Mychota 12 Phylum Archezoa 17 Class 1. Schizophyta 18 Order 1. Schizosporea 18 Order 2. Actinomycetalea 24 Order 3. Caulobacterialea 25 Class 2. Myxoschizomycetes 27 Order 1. Myxobactralea 27 Order 2. Spirochaetalea 28 Class 3. Archiplastidea 29 Order 1. Rhodobacteria 31 Order 2. Sphaerotilalea 33 Order 3. Coccogonea 33 Order 4. Gloiophycea 33 IV. Kingdom Protoctista 37 V. Phylum Rhodophyta 40 Class 1. Bangialea 41 Order Bangiacea 41 Class 2. Heterocarpea 44 Order 1. Cryptospermea 47 Order 2. Sphaerococcoidea 47 Order 3. Gelidialea 49 Order 4. Furccllariea 50 Order 5. Coeloblastea 51 Order 6. Floridea 51 VI. Phylum Phaeophyta 53 Class 1. Heterokonta 55 Order 1. Ochromonadalea 57 Order 2. Silicoflagellata 61 Order 3. Vaucheriacea 63 Order 4. Choanoflagellata 67 Order 5. Hyphochytrialea 69 Class 2. Bacillariacea 69 Order 1. Disciformia 73 Order 2. Diatomea 74 Class 3. Oomycetes 76 Order 1. Saprolegnina 77 Order 2. Peronosporina 80 Order 3. Lagenidialea 81 Class 4. Melanophycea 82 Order 1 . Phaeozoosporea 86 Order 2. Sphacelarialea 86 Order 3. Dictyotea 86 Order 4. Sporochnoidea 87 V ly Chapter Page Orders. Cutlerialea 88 Order 6. -

Marine Algae of the Kurile Islands. ⅱ
Title MARINE ALGAE OF THE KURILE ISLANDS. Ⅱ Author(s) NAGAI, Masaji Citation Journal of the Faculty of Agriculture, Hokkaido Imperial University, 46(2), 139-310 Issue Date 1941-06-30 Doc URL http://hdl.handle.net/2115/12740 Type bulletin (article) File Information 46(2)_p139-310.pdf Instructions for use Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP MARINE ALGAE OF THE KURILE ISLANDS. II By Masaji NAGAI RHODOPHYCEAE Subclass 1. BANGIALES Family 1. Bangiaceae Key to the genera I. Fronds filamentous, consisting of a row of cells, arranged immersed within the tender gelat:nous matrix, without any typical rhizoidal cells as holdfast ........................................ : . .. Goniotrichum (1) II. Fronds expanded, membranaceous or rarely subcoriaceous, consisting of 1 or 2 layers of cells (mono- or distromatic), arranged immersed within the stiff, lamellose, gelatinous matrix with a bundle of rhizoidal cells, arising from the basal part of frond as holdfast .................. :Porphyra(2) Subfamily 1. Goniotrichieae 1. Goniotrichum KUTZING, 1843 Goniotrichum Alsidii(ZANARDINI) HOWE (PI. IV, figs. 1, 2) Mar. Alg. Peru, (1914), p. 75-INAGAKI, Mar. Red Alg. Osyoro Bay, Hokkaido, p. 12, fig. 5-TSENG, Mar. Alg. fro Amoy, p. 32, pI. IV, fig. 15- OKAMURA, Mar. AIg Jap. p. 369, fig. 175-TAYLOR, Mar. Alg. N.-E. Coast N. Amer. p. 215, pI. XXVIII, fig. 1-4. Bangia elegans CHAUVIN, in Mem. Soc. Linn. Norm. VI, (1838), p. 13- HARVEY, Phyc. Brit. III, pI. CCXLVI-ZANARDINI, Plant. in Mari Rubro, p. 87 (nomen nud.). B. A.lsidii ZANARDINI, BibL Ital. 96, (18119), p. 136. Coniotrichum elegans ZANARDINI, Not. Cell. Mar. -

Seaweeds of California Green Algae
PDF version Remove references Seaweeds of California (draft: Sun Nov 24 15:32:39 2019) This page provides current names for California seaweed species, including those whose names have changed since the publication of Marine Algae of California (Abbott & Hollenberg 1976). Both former names (1976) and current names are provided. This list is organized by group (green, brown, red algae); within each group are genera and species in alphabetical order. California seaweeds discovered or described since 1976 are indicated by an asterisk. This is a draft of an on-going project. If you have questions or comments, please contact Kathy Ann Miller, University Herbarium, University of California at Berkeley. [email protected] Green Algae Blidingia minima (Nägeli ex Kützing) Kylin Blidingia minima var. vexata (Setchell & N.L. Gardner) J.N. Norris Former name: Blidingia minima var. subsalsa (Kjellman) R.F. Scagel Current name: Blidingia subsalsa (Kjellman) R.F. Scagel et al. Kornmann, P. & Sahling, P.H. 1978. Die Blidingia-Arten von Helgoland (Ulvales, Chlorophyta). Helgoländer Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen 31: 391-413. Scagel, R.F., Gabrielson, P.W., Garbary, D.J., Golden, L., Hawkes, M.W., Lindstrom, S.C., Oliveira, J.C. & Widdowson, T.B. 1989. A synopsis of the benthic marine algae of British Columbia, southeast Alaska, Washington and Oregon. Phycological Contributions, University of British Columbia 3: vi + 532. Bolbocoleon piliferum Pringsheim Bryopsis corticulans Setchell Bryopsis hypnoides Lamouroux Former name: Bryopsis pennatula J. Agardh Current name: Bryopsis pennata var. minor J. Agardh Silva, P.C., Basson, P.W. & Moe, R.L. 1996. Catalogue of the benthic marine algae of the Indian Ocean. -

The Distribution of Certain Benthonic Algae in Queen Charlotte Strait, British Columbia, in Relation to Some Environmental Factors
The Distribution of Certain Benthonic Algae in Queen Charlotte Strait, British Columbia, in Relation to Some Environmental Factors ROBERT F. SCAGEL 1 IN COMPARISON with the progress in our knowl cially of members of the Laminariales on the edge of most groups of plants-especially con Pacific Coast of North America, on the basis of cerning their life histories and distributions latitudinal and seasonal temperature distribu the advances made in marine phycology and tions. The physical data available during this marine ecology have been relatively slow. The early period were limited, but many of the prin limited access to living material or to the facil ciples set forth by Setchell concerning the dis ities to maintain the larger marine algae in the tributions of marine algae are as sound now as living condition for a prolonged period of time, when they were first proposed. Except for more the difficulties of collection-particularly in the precise knowledge of the physical and chemical subtidal zone-and the lack of any extensive factors of the environment and the distribu direct economic importance until recent years tions of the algae concerned, much of Setchell's have all contributed to this slow progress. How ecological work can still be used as a good ever, in spite of these difficulties there has been foundation for further study. Although it was a considerable amount of interest in the marine largely a two-dimensional approach to the algae, including a number of studies of their marine environment, Setchell's work made a ecology. Although this interest has been fairly significant contributiOn to the development of widespread in a number of countries, until re marine algal ecology. -

Fatty Acid Signatures Differentiate Marine Macrophytes at Ordinal And
J. Phycol. 48, 956–965 (2012) Ó 2012 Phycological Society of America DOI: 10.1111/j.1529-8817.2012.01173.x FATTY ACID SIGNATURES DIFFERENTIATE MARINE MACROPHYTES AT ORDINAL AND FAMILY RANKS1 Aaron W. E. Galloway2 Friday Harbor Laboratories, School of Aquatic and Fishery Sciences, University of Washington, 620 University Rd., Friday Harbor, WA, 98250, USA Kevin H. Britton-Simmons, David O. Duggins Friday Harbor Laboratories, University of Washington, 620 University Rd., Friday Harbor, WA, 98250, USA Paul W. Gabrielson University of North Carolina Herbarium, CB# 3280, Coker Hall, Chapel Hill, NC, 27599-3280, USA and Michael T. Brett Civil and Environmental Engineering, University of Washington, Box 352700, Seattle, WA, 98195-2700, USA Primary productivity by plants and algae is the Abbreviations: ALA, a-linolenic acid (18:3x3); fundamental source of energy in virtually all food ARA, arachidonic acid (20:4x6); DHA, docosa- webs. Furthermore, photosynthetic organisms are hexaenoic acid (22:6x3); EFA, essential fatty the sole source for x-3 and x-6 essential fatty acids acids; EPA, eicosapentaenoic acid (20:5x3); FA, (EFA) to upper trophic levels. Because animals can- fatty acids; FAME, fatty acid methyl esters; GC, not synthesize EFA, these molecules may be useful gas chromatograph; GCMS, gas chromatography- as trophic markers for tracking sources of primary mass spectrometry; LIN, linoleic acid (18:2x6); production through food webs if different primary MSI, multiple stable isotopes; PCA, principal producer groups have different EFA signatures. We components analysis; PERMANOVA, permuta- tested the hypothesis that different marine macro- tional multivariate analysis of variance; PERM- phyte groups have distinct fatty acid (FA) signatures DISP, permutational test of multivariate by conducting a phylogenetic survey of 40 marine dispersions; SDA, stearidonic acid (18:4x3); SI, macrophytes (seaweeds and seagrasses) representing stable isotope; SJA, San Juan Archipelago 36 families, 21 orders, and four phyla in the San Juan Archipelago, WA, USA. -

Phaeophyceae, Ectocarpales) from the Seto Inland Sea, Japan
1 Supplementary Information Discovery of a novel brown algal genus and species Setoutiphycus delamareoides (Phaeophyceae, Ectocarpales) from the Seto Inland Sea, Japan Hiroshi Kawai1,*,Takeaki Hanyuda1 1Kobe University Research Center for Inland Seas, Rokkodai, Kobe 657-8501, Japan *[email protected] 2 Supplementary Information 1 Map showing the collection site of Setoutiphycus delamareoides (Suo-Oshima, Yamaguchi Pref. in the Seto Inland Sea, Japan). 3 Supplementary Information 2. Origin of specimens and sequence data used for molecular analyses of chloroplast and mitochondrial genes, including their database accession numbers. Sample codes [KU-###] correspond to KU-MACC (Kobe University Macroalgal Culture Collection) strain codes, and [KU-d###] corresponds to silica-gel dried specimens housed at Kobe University Research Center for Inland Seas. Accession codes of newly determined sequences in the present study are indicated in bold. Species Origin Locality Name of sequenced genes and their accession code cox1 cox3 atpB psaA psbA rbcL Asterocladales Asterocladon lobatum KU-1881 São Paulo, Brazil - - - - - LC603806 Asterocladon Uwai et al. (2005) Tsuyazaki, Fukuoka, Japan - - - - - AB102867 rhodochortonoides Ectocarpales Acinetosporaceae Innoshima, Hiroshima, Acinetospora asiatica Yaegashi et al. (2015) - - - - - LC060517 Japan Siemer & Pedersen Feldmannia irregularis unknown - - - - - AF207800 (only in database) Geminocarpus Peters & Ramírez unknown - - - - - AJ295830 austrogeorgiae (2001) Herponema velutinum Silberfeld et al. (2014) unknown - - - - - JF796585 Siemer & Pedersen Hincksia hincksiae unknown - - - - - AF207803 (only in database) Godthab, Greenland, Pogotrichum filiforme Siemer et al. (1998) - - - - - AF055409 Denmark Pylaiella washingtoniensis Kawai et al. (2015) San Juan I., WA, USA AB899179 AB526446 AB899197 AB899222 AB899265 AB899288 Adenocystaceae Peters & Ramírez Adenocystis utricularis unknown - - - - - AJ295823 (2001) Peters & Ramírez Caepidium antarcticum unknown - - - - - AJ295826 (2001) Chordariopsis capensis Silberfeld et al. -
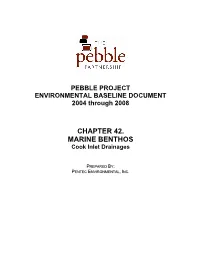
MARINE BENTHOS Cook Inlet Drainages
PEBBLE PROJECT ENVIRONMENTAL BASELINE DOCUMENT 2004 through 2008 CHAPTER 42. MARINE BENTHOS Cook Inlet Drainages PREPARED BY: PENTEC ENVIRONMENTAL, INC. MARINE BENTHOS-COOK INLET DRAINAGES TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS .......................................................................................................................... 42-i LIST OF TABLES .................................................................................................................................. 42-iii LIST OF FIGURES ................................................................................................................................ 42-iv PHOTOGRAPHS ................................................................................................................................... 42-iv LIST OF APPENDICES ......................................................................................................................... 42-iv ACRONYMS AND ABBREVIATIONS ................................................................................................ 42-v 42. MARINE BENTHOS ........................................................................................................................ 42-1 42.1 Introduction ............................................................................................................................. 42-1 42.2 Study Objectives ...................................................................................................................... 42-2 42.3 Study Area .............................................................................................................................. -

I a FLORISTIC ANALYSIS of the MARINE ALGAE and SEAGRASSES BETWEEN CAPE MENDOCINO, CALIFORNIA and CAPE BLANCO, OREGON by Simona A
A FLORISTIC ANALYSIS OF THE MARINE ALGAE AND SEAGRASSES BETWEEN CAPE MENDOCINO, CALIFORNIA AND CAPE BLANCO, OREGON By Simona Augytė A Thesis Presented to the Faculty of Humboldt State University In Partial Fulfillment Of the Requirements for the Degree Master of Arts In Biology December, 2011 [Type a quote from the [Type a quotedocument from theor the document or the summarysummary ofi ofan aninteresting point. Youinteresting can position point. the text box anywhereYou can in theposition document. Use the Textthe textBox Toolsbox tab to change theanywhere formatting in the of the pull quote textdocument. box.] Use the Text Box A FLORISTIC ANALYSIS OF THE MARINE ALGAE AND SEAGRASSES BETWEEN CAPE MENDOCINO, CALIFORNIA AND CAPE BLANCO, OREGON By Simona Augytė We certify that we have read this study and that it conforms to acceptable standards of scholarly presentation and is fully acceptable, in scope and quality, as a thesis for the degree of Master of Arts. ________________________________________________________________________ Dr. Frank J. Shaughnessy, Major Professor Date ________________________________________________________________________ Dr. Erik S. Jules, Committee Member Date ________________________________________________________________________ Dr. Sarah Goldthwait, Committee Member Date ________________________________________________________________________ Dr. Michael R. Mesler, Committee Member Date ________________________________________________________________________ Dr. Michael R. Mesler, Graduate Coordinator Date -

ID Scientific Name Common Name Invasive Marine Plants 765 Zostera Marina Pacific Eelgrass 766 Zostera Japonica Dwarf Eelgrass 2 767 Phyllospadix Surfgrass
NatureMapping Marine shoreline and Marine Plants/Algae/Seaweed Plants - Shoreline/Saltmarsh Revised: 12/2/2009 (1) Non- native, (2) ID Scientific Name Common Name Invasive Marine plants 765 Zostera marina Pacific eelgrass 766 Zostera japonica Dwarf eelgrass 2 767 Phyllospadix Surfgrass Chlorophyta Green seaweed 768 Praiola meridionalis Short sea lettuce 769 Blidingia sp. Tiny-tube sea lettuce 770 Collinsiella tuberculata Tiny green balls 771 Urospora penicilliformis Green hair 772 Cladophora sp. Sea moss 773 Chaetomorpha sp. Green excelsior 774 Ulva intestinalis Green string sea lettuce 775 Ulva linza Flat-tube sea lettuce 776 Ulva sp. Sea lettuce 777 Acrosiphonia coalita Green rope 778 Bryopsis sp. Sea fern 779 Codium fragile Staghorn seaweed 780 Codium setchellii Green spongy cushion 781 Kornmannia leptoderma Epiphitic sea lettuce Tribophyta YellowYellow-green-green algae 782 Vaucheria sp. Black felt mat Phaeophyta Brown seaweed 783 Phaeophyta sp. Brown tuft 784 Fucus gardneri Rockweed 785 Pelvetiopsis limitata Little rockweed 786 Melanosiphon intestinalis Dark sea tubes 787 Petalonia fascia Sea petals 788 Leathesia difformis Sea cauliflower 789 Colpomenia sp. Round brown bag 790 Soranthera ulvoidea Studded sea balloon 791 Analipus japonicus Bottle brush 792 Scytosiphon lomentaria Soda straws 793 Postelsia palmaeformis Sea palm 794 Hedophyllum sessile Sea cabbage 795 Egregia menziesii Feather boa kelp 796 Alaria nana Narrow-winged kelp 797 Phaeostrophion irregulare Sand-scoured false kelp 798 Ralfsia fungiformis Fungiform tar spot 799 -

Epibiont-Marine Macrophyte Assemblages Carol S
Epibionts and Basiphytes 43 3 Epibiont-Marine Macrophyte Assemblages Carol S. Thornber,1,* Emily Jones2 and Mads S. Thomsen3,4 Introduction: Ecological importance of basiphyte-epibiont interactions What is epibiont ecology? The biology and ecology of marine seagrasses and macroalgae have likely been infl uenced by the presence of epibionts for millions of years, given the evolutionary history of both groups, and the potential for co-evolution (Taylor and Wilson 2003). Epibionts are ubiquitous in marine environments, span numerous taxonomic divisions and phyla, occur on a wide taxonomic diversity of basiphytes (hosts), and can either be host-specifi c (obligate) or host non-specifi c (facultative). Their importance in ecosystem functioning has been well documented in systems ranging from estuaries to subtidal rocky reefs, as well as from tropical to polar regions (Thomsen et al. 2010). As widely recognized ecosystem engineers and foundation species, seagrasses and their associated epibionts have been widely studied (e.g., Tomas et al. 2005, Cook et al. 2011, York et al. 2012, Lobelle et al. 2013; Fig. 1). While the majority of algal epiphytes are located on older regions of seagrass leaves, epibionts can also occur 1 Dept. of Biological Sciences, University of Rhode Island, 120 Flagg Rd, Kingston, RI 02881 USA. 2 Department of Biology, San Diego State University, 5500 Campanile Dr., San Diego, CA 92182 USA. Email: [email protected] 3 Marine Ecology Research Group, School of Biological Sciences, University of Canterbury, Private Bag 4800, Christchurch, New Zealand. 4 UWA Oceans Institute and School of Plant Biology, University of Western Australia, Hackett Drive, Crawley 6009 WA, Australia. -

Dictyosiphon Foeniculaceus
HELGOL)~NDER MEERESUNTERSUCHUNGEN Helgol/inder Meeresunters, 39, 441447 (1985) On the sexual reproduction of Dictyosiphon ioeniculaceus (Phaeophyceae, Dictyosiphonales) Akira F. Peters & Dieter G. Mfiller* Fakutt~t ffir Biotogie, Universit~t Konstanz; Post[ach 55 60, D-7750 Konstanz, Federal Republic of Germany ABSTRACT: Dictyosiphon [oeniculaceus from Sweden and Newfoundland was studied in laborat- ory culture. Zoids from unilocular sporangia developed into dioecious microscopic filamentous gametophytes which produced uniseriate plurilocular gametangia in low temperatures (0 to 8 °C). Zygotes and unfused isogametes gave rise to filamentous protonemata on which parenchymatous macroscopic sporophytes were formed. Isolates from Sweden and Newfoundland were interfertile. Although formed in culture, genetically unisexual sporophytes were not detected in nature. Female gametes of D. foeniculaceus produced a sexual pheromone. It was identified as finavarrene, which is also known as the sperm attractant in Ascophyllum nodosum. INTRODUCTION Dictyosiphon foeniculaceus (Huds.) Greville is a common brown alga of the lower littoral and upper sublittoral of cold and temperate waters of the northern hemisphere (Okamura, 1932). It was the first species of brown algae with a conspicuous alternation of heteromorphic generations in which isogamy was observed (Sauvageau, 1917; Arasaki, 1949). Meiosis occurs in the unilocular sporangium (Abe, 1940). However, a recent culture study of isolates from Greenland did not confirm sexual reproduction (Pedersen, 1984). D. foeniculaceus belongs to Dictyosiphonales, an order in which sexual reproduc- tion seems to be suppressed in many species (cf. Wynne & Loiseaux, 1976), Some reports of sexual life histories are uncertain since direct observation of gamete fusions is lacking [Stictyosiphon adriaticus Ki~tz., Caram, •965; Litosiphon pusillus (Carm.) Harvey, Dangeard, 1969; Asperococcus [istulosus (Huds.) Hooker, Dangeard, 1969 (as A.