MAPE Il Nse Co
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Zones Infra : Classement Par Ordre Alphabetique De Communes
DIPER MOUVEMENT 2020 DSDEN26 ZONES INFRA : CLASSEMENT PAR ORDRE ALPHABETIQUE DE COMMUNES COMMUNES ZONE INFRA ALBON NORD DROME ALIXAN GRAND ROMANS ALLAN RHODANIEN ALLEX VALLEE DROME ANCONE RHODANIEN ANDANCETTE NORD DROME ANNEYRON NORD DROME AOUSTE SUR SYE VALLEE DROME AUBRES DROME MERIDIONALE AUREL DROME EST AUTICHAMP VALLEE DROME BARBIERES GRAND ROMANS BARSAC DROME EST BEAUFORT SUR GERVANNE VALLEE DROME BEAUMONT LES VALENCE GRAND VALENCE BEAUMONT MONTEUX GRAND VALENCE BEAUREGARD BARET GRAND ROMANS BEAUSEMBLANT NORD DROME BEAUVALLON GRAND VALENCE BELLEGARDE EN DIOIS DROME EST BESAYES GRAND ROMANS BONLIEU SUR ROUBION VALLEE DROME BOUCHET RHODANIEN BOULC DROME EST BOURDEAUX RHODANIEN BOURG DE PEAGE GRAND ROMANS BOURG LES VALENCE GRAND VALENCE BREN NORD DROME BUIS LES BARONNIES DROME MERIDIONALE CHABEUIL GRAND VALENCE CHABRILLAN VALLEE DROME CHAMARET RHODANIEN CHANOS CURSON NORD DROME CHANTEMERLE LES BLES NORD DROME CHARMES SUR L HERBASSE NORD DROME CHAROLS VALLEE DROME CHARPEY GRAND ROMANS CHATEAUDOUBLE GRAND VALENCE CHATEAUNEUF DE GALAURE NORD DROME CHATEAUNEUF DU RHONE RHODANIEN CHATEAUNEUF SUR ISERE GRAND VALENCE CHATILLON EN DIOIS DROME EST CHATILLON ST JEAN GRAND ROMANS CHATUZANGE LE GOUBET GRAND ROMANS CHAVANNES NORD DROME CLAVEYSON NORD DROME DIPER MOUVEMENT 2020 DSDEN26 COMMUNES ZONE INFRA CLEON D ANDRAN VALLEE DROME CLERIEUX GRAND ROMANS CLIOUSCLAT VALLEE DROME COBONNE VALLEE DROME COLONZELLE RHODANIEN COMBOVIN GRAND VALENCE CONDORCET DROME MERIDIONALE CREST VALLEE DROME CROZES HERMITAGE NORD DROME CURNIER DROME MERIDIONALE DIE DROME -

LES RISQUES MAJEURS DANS LA DROME Dossier Départemental Des Risques Majeurs
LES RISQUES MAJEURS DANS LA DROME Dossier Départemental des Risques Majeurs PRÉFECTURE DE LA DRÔME DOSSIER DÉPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS 2004 Éditorial Depuis de nombreuses années, en France, des disposi- Les objectifs de ce document d’information à l’échelle tifs de prévention, d'intervention et de secours ont été départementale sont triples : dresser l’inventaire des mis en place dans les zones à risques par les pouvoirs risques majeurs dans la Drôme, présenter les mesures publics. Pourtant, quelle que soit l'ampleur des efforts mises en œuvre par les pouvoirs publics pour en engagés, l'expérience nous a appris que le risque zéro réduire les effets, et donner des conseils avisés à la n'existe pas. population, en particulier, aux personnes directement Il est indispensable que les dispositifs préparés par les exposées. autorités soient complétés en favorisant le développe- Ce recueil départemental des risques majeurs est le ment d’une « culture du risque » chez les citoyens. document de référence qui sert à réaliser, dans son pro- Cette culture suppose information et connaissance du longement et selon l’urgence fixée, le Dossier risque encouru, qu’il soit technologique ou naturel, et Communal Synthétique (DCS) nécessaire à l’informa- 1 doit permettre de réduire la vulnérabilité collective et tion de la population de chaque commune concernée individuelle. par au moins un risque majeur. Cette information est devenue un droit légitime, défini Sur la base de ces deux dossiers, les maires ont la par l’article 21 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 responsabilité d’élaborer des documents d’information relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protec- communaux sur les risques majeurs (DICRIM), qui ont tion de la forêt contre l'incendie et à la prévention des pour objet de présenter les mesures communales d’a- lerte et de secours prises en fonction de l’analyse du risques majeurs. -

Carte Administrative De La Drôme
CARTE ADMINISTRATIVE DE LA DRÔME lapeyrouse- Périmètre des arrondissements 2017 mornay epinouze manthes saint-rambert- lens-lestang moras- d'albon saint-sorlin- en-valloire en-valloire le anneyron grand-serre hauterives andancette chateauneuf- Préfecture albon de-galaure montrigaud saint-martin- fay-le-clos d'aout saint-christophe- mureils et-le-laris Sous-Préfecture beausemblant tersanne la motte- saint-bonnet- laveyron de-galaure saint-avit miribel montchenu de-valclerieux saint-uze bathernay saint-laurent- d'onay Arrondissement de Valence saint-vallier ratieres crepol claveyson montmiral saint-barthelemy- charmes-sur- ponsas de-vals l'herbasse le chalon saint-michel- sur-savasse Arrondissement de Die serves- bren arthemonay sur-rhone saint-donat-sur- marges chantemerle- geyssans erome les-bles marsaz l'herbasse parnans gervans Arrondissement de Nyons larnage chavannes peyrins triors crozes- chatillon- hermitage Saint- saint-jean veaunes bardoux genissieux la baume-saint-nazaire- mercurol mours-saint- en-royans Communes transférées dans clerieux d'hostun Sainte- Saint- tain-l'hermitage eusebe Saint Thomas eulalie- julien- Chanos- saint-paul- eymeux En Royans les-romans en-royans le nouvel arrondissement curson en-vercors granges-les- romans-sur-isere La Motte beaumont Fanjas Beaumont- jaillans hostun la roche- monteux echevis saint-martin- rochechinard saint-laurent- de-glun en-vercors bourg-de-peage en-royans Pont-de- saint-jean- l'isere chatuzange-le-goubet oriol- en-royans en-royans chateauneuf-sur-isere beauregard- baret saint-martin- -

LA DRÔME EN 12 ITINÉRAIRES 12 Itineraries in the Drôme
LA DRÔME EN 12 ITINÉRAIRES 12 itineraries in the Drôme ladrometourisme.com Entre la Drôme et vous, une belle histoire commence… Cette histoire pourrait démarrer comme ceci : « Il était une fois 12 itinéraires à suivre pour découvrir les incontournables de cette terre de contrastes. Prenez le temps d’apprécier le paysage, d’échanger avec les habitants, de flâner dans les villes et villages, de visiter les monuments et musées incontournables (Palais Idéal du Facteur Cheval, Tour de Crest, châteaux de Montélimar, Grignan et Suze-la-Rousse, cité du chocolat Valrhona Musée International de la chaussure…), de savourer les produits du terroir de la Drôme, à la ferme, au détour des routes thématiques (lavande, olivier, vin…) ou sur les marchés colorés, de pratiquer toutes sortes d’activités sportives dont la randonnée pédestre, équestre, en raquettes, le ski, le vélo, le VTT, l’escalade, la via ferrata... … la Drôme vous livrera ses plus beaux secrets à travers ses paysages les plus sauvages. » La morale de cette histoire : Faîtes une pause dans la Drôme pour la découvrir plus intimement. Champ de lavande • Poët-Sigillat Between the Drôme and you, a wonderful story-line may emerge. The story could start like this: Vous aussi devenez fan de « Once upon a time there were 12 itineraries to follow to discover the key features of this land of contrasts. Take the time to appreciate the landscape, to have a chat with local people, to stroll about the towns and villages, la page Facebook de la Drôme to visit the main monuments and museums (‘Palais Idéal du Facteur Cheval’, Crest tower, the châteaux of Tourisme et racontez Montélimar, Grignan and Suze-la-Rousse, ‘cité du chocolat Valrhona’ and the ‘Musée International de la vos vacances dans la Drôme Chaussure [shoes]), to taste the products of the Drôme at the farm itself, along the themed routes (lavender, olives, wines …), on the colourful markets, to practice all kinds of sporting activity including walking, riding, rackets, skiing, cycling, mountain-biking, climbing, the via ferrata, etc. -

3B2 to Ps Tmp 1..96
1975L0271 — EN — 14.04.1998 — 014.001 — 1 This document is meant purely as a documentation tool and the institutions do not assume any liability for its contents ►B COUNCIL DIRECTIVE of 28 April 1975 concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive No 75/268/EEC (France) (75/271/EEC) (OJ L 128, 19.5.1975, p. 33) Amended by: Official Journal No page date ►M1 Council Directive 76/401/EEC of 6 April 1976 L 108 22 26.4.1976 ►M2 Council Directive 77/178/EEC of 14 February 1977 L 58 22 3.3.1977 ►M3 Commission Decision 77/3/EEC of 13 December 1976 L 3 12 5.1.1977 ►M4 Commission Decision 78/863/EEC of 9 October 1978 L 297 19 24.10.1978 ►M5 Commission Decision 81/408/EEC of 22 April 1981 L 156 56 15.6.1981 ►M6 Commission Decision 83/121/EEC of 16 March 1983 L 79 42 25.3.1983 ►M7 Commission Decision 84/266/EEC of 8 May 1984 L 131 46 17.5.1984 ►M8 Commission Decision 85/138/EEC of 29 January 1985 L 51 43 21.2.1985 ►M9 Commission Decision 85/599/EEC of 12 December 1985 L 373 46 31.12.1985 ►M10 Commission Decision 86/129/EEC of 11 March 1986 L 101 32 17.4.1986 ►M11 Commission Decision 87/348/EEC of 11 June 1987 L 189 35 9.7.1987 ►M12 Commission Decision 89/565/EEC of 16 October 1989 L 308 17 25.10.1989 ►M13 Commission Decision 93/238/EEC of 7 April 1993 L 108 134 1.5.1993 ►M14 Commission Decision 97/158/EC of 13 February 1997 L 60 64 1.3.1997 ►M15 Commission Decision 98/280/EC of 8 April 1998 L 127 29 29.4.1998 Corrected by: ►C1 Corrigendum, OJ L 288, 20.10.1976, p. -

Territoires Zéro Chômeur De Longue Durée
TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR UNE EXPÉRIMENTATION DE LONGUE DURÉE POUR SORTIR DU CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE Le principe d’un territoire zéro chômeur de longue TERRITOIRES durée est de créer des emplois et des activités non LE VAL DE DRÔME SE MOBILISE concurrentiels, par le biais d’une Entreprise à But ZÉRO CHÔMEUR d’Emploi (EBE), pour les personnes privées d’emploi depuis plus d’un an et domiciliées depuis au moins DE LONGUE DURÉE L’intercommunalité du Val de Drôme en Biovallée prépare six mois en Val de Drôme. Les emplois créés sont sa candidature au projet « territoires zéro chômeur de des CDI, à temps choisi et adaptés aux savoir-faire et longue durée ». compétences de ces personnes. Objectif : résorber le chômage de longue durée. Méthode : accompagner les personnes privées d’emploi UN CONCEPT ORIGINAL dans la création d’activités correspondant à leurs savoir- L’originalité du projet réside dans son financement. faire et répondant à des besoins non satisfaits localement. Il s’agit de réaffecter à la création d’emplois ce que coûte le chômage (environ 18 000 € par an et par LA COMMUNAUTÉ En France, près de 1 000 emplois ont ainsi été créés depuis salarié) et le compléter par le chiffre d’affaires généré DE COMMUNES le lancement en 2016 de l’expérimentation « territoires par l’EBE. zéro chômeur de longue durée », dans une dizaine de SE TENIR INFORMER DU VAL DE DRÔME territoires. Des réunions d’informations, des actions, des rendez- vous ont lieu régulièrement. EN BIOVALLÉE L’intercommunalité s’inscrit dans cette dynamique pour Retrouvez toutes les infos sur www.valdedrome.com devenir un territoire zéro chômeur de longue durée. -

ZNIEFF* De Type II N° Régional : 2615
ZNIEFF* de type II N° régional : 2615 Ancien N° régional : ENSEMBLE FONCTIONNEL DU ROUBION Départements et communes concernées en Rhône-Alpes Surface : 4 920 ha Drôme LA BEGUDE-DE-MAZENC, BONLIEU-SUR-ROUBION, BOURDEAUX, BOUVIERES, CHAROLS, CHAUDEBONNE, CLEON-D'ANDRAN, CRUPIES, FRANCILLON-SUR- ROUBION, LA LAUPIE, MANAS, MARSANNE, MONTELIMAR, MORNANS, LE POET-CELARD, PONT-DE-BARRET, SAINT-GERVAIS-SUR-ROUBION, SAINT-MARCEL-LES- SAUZET, SAOU, SAUZET, SAVASSE, SOYANS, VESC, ZNIEFF de type I concernées par cette zone 26150001,26150002 Description et intérêt du site Cette zone intègre l’ensemble fonctionnel formé par le Roubion, ses annexes fluviales et quelques-uns de ses affluents. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône-Méditerranée-Corse souligne l’importance d’une préservation des liaisons physiques existant entre la rivière et le fleuve Rhône, pour garantir le bon fonctionnement des milieux et la libre circulation des poissons. Le cas des belles populations de Bouvière et de Castor d’Europe présentes localement, et de la nécessité d’assurer la pérennité des échanges entre celles-ci est à cet égard significatif. Dans le domaine de la faune, les chauve-souris sont ainsi particulièrement bien représentées avec la Grotte de la Baume sourde, qui présente un intérêt de niveau international pour le Minioptère de Schreibers en particulier. La flore conserve des éléments remarquables, parmi les espèces inféodées aux zones humides (Samole de Valerand ou « Mouron d’eau »…), ou celles à répartition méditerranéenne (Colchique de Naples, Genévrier de Phénicie…). Le zonage de type II souligne l’interdépendance de ces cours d’eau, dont les tronçons abritant les habitats ou les espèces les plus remarquables sont retranscrits par plusieurs zones de type I au fonctionnement très fortement interdépendant. -

Ripisylve Et Lit Du Roubion (Identifiant National : 820030470)
Date d'édition : 03/06/2021 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030470 Ripisylve et lit du Roubion (Identifiant national : 820030470) (ZNIEFF Continentale de type 1) (Identifiant régional : 26150002) La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CREN (MARCELLIN S.), .- 820030470, Ripisylve et lit du Roubion. - INPN, SPN-MNHN Paris, 26 P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030470.pdf Région en charge de la zone : Rhône-Alpes Rédacteur(s) :CREN (MARCELLIN S.) Centroïde calculé : 803009°-1958062° Dates de validation régionale et nationale Date de premier avis CSRPN : 17/12/2009 Date actuelle d'avis CSRPN : 07/06/2019 Date de première diffusion INPN : Date de dernière diffusion INPN : 28/05/2021 1. DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 4 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 4 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ........................................... 4 6. HABITATS ...................................................................................................................................... 4 7. ESPECES ...................................................................................................................................... -

Notre Sélection De Randonnées À Vélo Au Départ De La Maison
Notre sélection de randonnées à vélo au départ de la maison Niveau Vert-Bleu : 5 petits circuits pour découvrir notre vallée du Haut-Roubion , avec moins de 50 kms et moins de 1.000 mètres de dénivelé. Cliquez ici pour découvrir la carte intéractive avec les 5 circuits Itinéraire Distance Dénivellé N° 1 Féline, Pont de Barret, Rochebaudin, Soyans 33 km + 460 m La plus petite balade sans dénivelé et sans voiture. Partez à la découverte du village caché de Rochebaudin, et un retour par les ruines de Soyans ! N° 2 Francillon, Vallon des Pommes , Tour de la Montagne, Retour direct 41km + 750 m Courte balade pour découvrir le tour de la Montagne en passant par le vallon des Pommes . Jolis points de vue sur la forêt de Saoû , le col de la Chaudière, et les falaises d'Eyzahut. N° 3 Francillon, Tour de la Montagne, Rochebaudin, Pont de Barret, Soyans 44 km + 772 m Un de mes préférés sur cette distance . Un condensé de nos paysages de ce coin de Drôme avec les vues sur la Forêt de Saoû, la rivière cachée de la Rimandoule pour arriver sur le village (aussi caché ) de Rochebaudin, le retour le long du Roubion et, pour finir, la route balcon de Soyans vers Saoû ! N°4 Vallon de Féline, Comps, Orcinas, Bezaudun, Bourdeaux 50km + 850 m Jolie montée du Vallon de Féline … mais cette fois-ci on pousse jusqu'à Comps, pour redescendre par Orcinas et ses très belles vues sur le col de la Chaudière. Retour par Bezaudun, puis la route de Bourdeaux avec ses belles lignes droites pour « envoyer » un peu . -

Plan Local D'urbanisme, Les Secteurs Actuellement Classés Au POS Applicable En Zones NB, NC Et ND, Une Dérogation Est Donc Requise
COMMUNE DE SAUZET Route de Crest 26740 SAUZET PLAN LOCAL D’URBANISME DIAGNOSTIC TERRITORIAL COMMUNE DE SAUZET DEPARTEMENT DE LA DROME (26) Ingénieurs conseils en aménagement durable du territoire 14 allée de la Bertrandière Tél. 04 77 92 71 47 / [email protected] 42 580 L’ETRAT www.eco-strategie.fr Etude N° A1551-R160129-v1 Maître d’ouvrage : Commune de Sauzet Bureau d’études environnement : ECO-STRATEGIE Le présent dossier est basé sur nos observations de terrain, la bibliographie, notre retour d’expérience en aménagement du territoire et les informations fournies par le porteur de projet. Il a pour objet d’assister, en toute objectivité, le maître d’ouvrage dans la définition de son projet. Le contenu de ce rapport ne pourra pas être utilisé par un tiers en tant que document contractuel. Il ne peut être utilisé de façon partielle, en isolant telle ou telle partie de son contenu. Le présent rapport est protégé par la législation sur le droit d'auteur et sur la propriété intellectuelle. Aucune publication, mention ou reproduction, même partielle, du rapport et de son contenu ne pourra être faite sans accord écrit préalable d’ECO-STRATEGIE et Sauzet. Les prises de vue présentées ont été réalisées par ECO-STRATEGIE ou par le porteur de projet. Les fonds de carte sont issus des cartes IGN, de Google Earth et de Géoportail. Les photographies prises sur le site sont précisées. Etude d’impact sur l’environnement Version provisoire 4 Rédaction : Alexandra REYMOND, Jeanne NEYRET et Cyril FORCHELET Cartographie et illustrations : Alexandra REYMOND et Julie PERONIAT Relecture et contrôle qualité : Flora SEYTRE, Anne VALLEY et Frédéric BRUYERE ECO-STRATEGIE Commune de Sauzet I. -
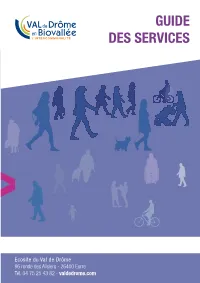
Guide Des Services
GUIDE DES SERVICES Ecosite du Val de Drôme 96 ronde des Alisiers - 26400 Eurre p.1 Tél. 04 75 25 43 82 - valdedrome.com ÉDITO Valence À l’initiative du conseil d’administration du Centre LYON : 1h30 SAINT-ETIENNE : 1h40 CLERMONT-FERRAND : 2h50 Grenoble intercommunal d’action par l’autoroute Omblèze GRENOBLE : 1h15 GENEVE : 2h40 sociale (CIAS), la CCVD réédite le par l’autoroute guide des services à l’attention D111 e N7 n D538 n a La Voulte v r de tous les habitants du territoire. sur-Rhône E Plan- e N G Ô de-Baix H la R E L Montoison Gigors et Ce guide offre des informations Lozeron Eygluy sur les services existants dans Livron Ambonil Escoulin Vaunaveys- la-Rochette Beaufort-sur- Gervanne vos communes mais également PRIVAS Le Pouzin rôme la D Allex Cobonne Eurre sur les communes voisines. la Suze D ze rô uvè Loriol me L'O L’édition de ce guide répond à Montclar-sur- D104 Gervanne Cliousclat Crest deux des objectifs de la CCVD, qui Aouste-sur-Sye Grâne sont de vous accompagner dans Chabrillan D93 Saillans Mirmande D164 vos décisions et vos démarches, Divajeu Autichamp et de vous faciliter l’accès à ces la DIE La Roche Drôme sur-Grâne l a services. R La Répara o E a Auriples n N n Ô e H R E Saou L Puy Soyans D538 St-Martin N7 Mornans Francillon sur-Roubion Responsable édition : Jean Serret Le Poët- l e Célard AVIGNON : 1h R o n Responsable de projet : Cécile Bourdel, u b i o Félines-sur MARSEILLE : 2h Rimandoule MONTPELLIER : 2h CCVD le par l’autoroute R o Montélimar u Rédaction, conception : Cécile Bourdel, D538 b i o Estelle Garnier, Leïla Esteve, CCVD. -

Département De La Drôme Zone Vulnérable Aux Nitrates 2017 Arrêté N° 17-055 Du 21/02/2017
Département de la Drôme Zone Vulnérable aux nitrates 2017 Arrêté n° 17-055 du 21/02/2017 LAPEYROUSE- Périodes d’interdiction d’épandage MORNAY EPINOUZE MANTHES LENS-LESTANG ST-RAMBERT- MORAS- en zone vulnérable Rhône-Alpes D'ALBON EN-VALLOIRE Département de la Drôme Limites communales ST-SORLIN- EN-VALLOIRE LE GRAND-SERRE ANNEYRON HAUTERIVES CHATEAUNEUF- ANDANCETTE DE-GALAURE communes classées en ALBON ZoneMONTRIGAUD Vulnérable aux nitrates 2017 FAY- ST-MARTIN- ST-CHRISTOPHE- zone vulnérable aux nitrates LE-CLOS D'AOUT ET-LE-LARIS MUREILS TERSANNE BEAUSEMBLANT Arrêté n° 17-055 du 21/02/2017 LA MOTTE- ST-BONNET- MIRIBEL DE-GALAURE ST-AVIT DE-VALCLERIEUX LAVEYRON MONTCHENU Communes classées partiellement en ST-LAURENT- Type I - C/N > 8 Type II - C/N ≤ 8 Type III ST-UZE BATHERNAY D'ONAY RATIERES ST-VALLIER LAPEYROUSE- CREPOL zone vulnérable aux nitrates ST-BARTHELEMY- CLAVEYSONMORNAY MONTMIRAL DE-VALS CHARMES- PONSAS SUR-L'HERBASSE LE CHALON EPINOUZE MANTHES ST-MICHEL- Types BREN SERVES- ARTHEMONAY SUR-SAVASSE LENS-LESTANG SUR-RHONE ST-RAMBERT- ST-DONAT-MORAS- MARGES GEYSSANS Lisiers, purins, D'ALBONEROME CHANTEMERLE- SUR-L'HERBASSEEN-VALLOIRE de fertilisants PARNANS Limites communales LES-BLES MARSAZ Fumiers ST-SORLIN- GERVANS EN-VALLOIRE LE GRAND-SERRE ANNEYRON CHAVANNES PEYRINS TRIORS fumiers CROZES- LARNAGE CHATILLON- HAUTERIVES HERMITAGE CHATEAUNEUF- ST-JEAN Autres effluents ANDANCETTE ST-BARDOUX GENISSIEUX compacts VEAUNESDE-GALAURE MOURS- LA BAUME- communes classées en ALBON CLERIEUX N 71 ST-JULIEN- MERCUROL SAINT-EUSEBE MONTRIGAUD D'HOSTUN ° et fientes Engrais azotés TAIN- ST-THOMAS EYMEUX EN-VERCORS L'HERMITAGE FAY- ST-MARTIN- ST-PAUL- ST-NAZAIRE- ST-CHRISTOPHE- -EN-ROYANS zone vulnérable aux nitrates type I LE-CLOS D'AOUT EN-ROYANS pailleux CHANOS-CURSON ROMANS- LES-ROMANS ET-LE-LARIS STE-EULALIE- MUREILS TERSANNE BEAUSEMBLANT GRANGES- SUR-ISERE LA MOTTE- EN-ROYANS Types de volailles, minéraux LA MOTTE- LES-BEAUMONT ST-BONNET- FANJAS MIRIBEL DE-GALAURE ST-AVIT DE-VALCLERIEUX LAVEYRON BEAUMONT- MONTCHENU JAILLANS et compost ROCHECHINARD ST-MARTIN- Ex.