Ahmad Daouk : Portrait D'un Acteur De L'indépendance
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
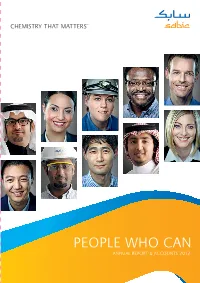
View Annual Report
CAN HO REPORT & ACCOUNTS 2012 l w E ANNUA l EOP P PEOPLE WHO CAN ANNUAl REPORT & ACCOUNTS 2012 www.sabic.com “WHEN I GET HOME FROM WORK, IT FEELS GOOD TO KNOW I HAVE SPENT THE DAY DOING SOMETHING THAT IMPROVES PEOPLE’S LIVES.” Sabic Report + Accounts 2012 1 WELCOME wE’VE ALWAYS BElIEVED THAT IT TAKES SPECIAl PEOPlE TO MAKE A DIFFERENCE. THEY NEED INGENUITY, BRIllIANCE AND THE FREEDOM TO TURN THEIR IDEAS INTO REALITY. AT SABIC, THIS IS OUR CUlTURE. wE FIND OPEN-MINDED, GIFTED AND QUESTIONING PEOPlE. THEN wE CREATE THE CONDITIONS FOR THEIR TAlENT TO FlOURISH: FUlFIllING wORK ENVIRONMENTS, STATE-OF-THE-ART TECHNOlOGY AND THE EMPOWERMENT THEY NEED. THIS wAY, SABIC PEOPlE CAN FIND THE NEw SOlUTIONS AND POSSIBIlITIES THAT ARE CHANGING THE wORlD FOR THE BETTER. EVERY DAY, THEY CAN CREATE CHEMISTRY THAT MATTERSTM. PRINCE SAUD BIN ABDULLAH BIN THenayan AL-SAUD MOHAMED AL-MADY CHAIRMAN VICE CHAIRMAN & CHIEF EXECUTIVE OFFICER Sabic Report + Accounts 2012 3 SABIC’S experts create 150 NEw products EVery YEAR THIS IS Ingenuity Sabic Report + Accounts 2012 5 CONTENTS OVERVIEW 8 this IS SABIC & STRATEGY 9 CHAIRMAN’S statement 10 VICE CHAIRMAN AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER Q&A 01 12 BOARD OF directors 14 GlOBAl operations OUR 18 CHEMICAlS BUSINESSES 24 PERFORMANCE CHEMICAlS 30 INNOVATIVE PlASTICS 36 POLYMERS 42 FERTILIZERS 02 48 METALS 54 SUPPlY CHAIN 55 MANUFACTURING 56 TECHNOlOGY & INNOVATION OUR 60 SUSTAINABILITY COMMITMENT 62 PEOPLE 64 ENVIRONMENT, HEALTH, SAFETY & SECURITY 66 CORPORATE SOCIAl 03 RESPONSIBILITY OUR 70 FINANCIAl STATEMENTS FINANCES 75 NOTES TO THE ACCOUNTS 91 OUR Manufacturing COMPANIES 04 95 GlOBAl DIRECTORY OVERVIEW & strategy WE HAVE firmly SET OUR SIGHTS ON BECOMING THE PREFERRED WORLD lEADER IN CHEMICAlS. -
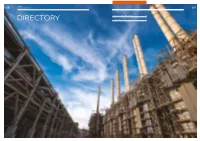
Directory Global Directory 74 Sabic 70 Annual Report 2017 Directory 71
SABIC 68 ANNUAL REPORT 2017 69 MANUFACTURING COMPANIES 70 DIRECTORY GLOBAL DIRECTORY 74 SABIC 70 ANNUAL REPORT 2017 DIRECTORY 71 Petrochemicals MANUFACTURING Agri-Nutrients Specialties COMPANIES Metals* COMPANY LOCATION PARTNERSHIP PRODUCTS COMPANY LOCATION PARTNERSHIP PRODUCTS Alba Bahrain SABIC Industrial Investments Aluminum (liquid metal, ingots, Ibn Zahr Al-Jubail, SABIC (80%), Ecofuel-Italy (10%), MTBE and polypropylene Aluminium Bahrain** Company (20.62%), Bahrain rolling slabs, and billet) Saudi European Saudi Arabia Arab Petroleum Investment Mumtalakat Holding Company Petrochemical Corporation APICORP (10%) (69.38%), others/public (10%) Company Al-Bayroni Al-Jubail, A 50/50 SABIC joint-venture Ammonia, urea, 2-ethyl hexanol, Kemya Al-Jubail, A 50/50 SABIC joint-venture Polyethylene (LDPE, LLDPE), Al-Jubail Fertilizer Saudi Arabia with Taiwan Fertilizer Company and DOP Al-Jubail Saudi Arabia with Exxon Chemical Arabia ethylene, carbon black (CB), Company Petrochemical polybutadiene rubber (PBR), Company styrene butadiene rubber Ar-Razi Al Jubail, A 50/50 joint venture Chemical-grade methanol (SBR), ethylene propylene diene Saudi Methanol Saudi Arabia with Japan Saudi Arabia monomer (EPDM), regular butyl Ccompany Methanol Company (RB) and halo butyl (HB) Cos-Mar Company Caville, A 50/50 joint venture Styrene Ma’aden Phosphate Riyadh, SABIC (30%) and Ma’aden (70%) DAP, MAP, NPS Louisiana, USA with Total Company Saudi Arabia GARMCO Bahrain SABIC (30.40%), Bahrain Aluminum sheets and can stocks Ma’aden Wa’ad Riyadh, SABIC (15%), Mosaic -

Treaty Series Recueil Des Traites
UNITED NATIONS N4ATIONS UNIES Treaty Series Treaties and internationalagreements registered or filed and recorded with the Secretariatof the United Nations VOLUME 289 Recueil des Traites Traitds et accords internationaux enregistris ou class&s et inscrits au repertoire au Secretariat de l'Organisationdes Nations Unies Treaties and internationalagreements registered or filed and recorded with the Secretariat of the United Nations VOLUME 289 1958 I. Nos. 4214-4226 TABLE OF CONTENTS I Treaties and internationalagreements registeredfrom 17 March 1958 to 19 March 1958 Page No. 4214. Argentina, Australia, Belgium, Burma, Canada, etc.: Final Act of the United Nations Maritime Conference (with annexes). Done at Geneva, on 6 March 1948 Convention on the Intergovernmental Maritime Consultative Organization. Done at Geneva, on 6 March 1948 ....... ............... 3 No. 4215. Austria, Belgium, Canada, Denmark, Finland, etc.: Protocol modifying the Convention signed at Paris on 22 November 1928 regarding international exhibitions. Signed at Paris, on 10 May 1948 111 No. 4216. Netherlands and Portugal: Exchange of notes constituting an agreement for the reciprocal abolition of visas. Lisbon, 14 December 1954 .... ................ ... 121 No. 4217. Netherlands and United States of America: Exchange of notes (with enclosures) constituting an agreement concerning United States radio equipment on Netherlands weather ships. Wash- ington, 16 and 21 March 1955 .... ................. .... 129 No. 4218. Netherlands and Italy: General Convention respecting social insurance (with Special Protocol). Signed at The Hague, on 28 October 1952 Agreement to carry into effect article 4, section 2, of the above-mentioned Convention. Signed at Rome, on 24 December 1954 General Administrative Arrangement for the application of the above- mentioned Convention. -

Commencement 2011 the Entrepreneurial Edge
Summer 2011 Vol. X, No. 4 No. X, Vol. 2011 Summer Commencement 2011 The Entrepreneurial Edge MainGateAmerican University of Beirut Quarterly Magazine Departments: Letters 2 President’s view: what the Arab Spring means for AUB Inside the Gate Views from Campus Picture this: debke meets broadway, Nahr Ibrahim before the flood, 6 Commencement 2011, Folk Dance Festival; search for the Byzantine Anastasis Church; citizen revolt in the Middle East; AUBMC’s 2020 Vision Reviews A Photographic Remembrance of Lebanon by John Waterbury; Arab Media: PGMC – Polity Global Media and Communication Series coauthored by Nabil Dajani (BA ‘57, MA ‘60) Beyond Bliss Street Legends and Legacies First Among Equals John Wortabet (1827-1908) 41 Alumni Profile 14 under 44 Fourteen young AUB entrepreneurs on the best days, 42 the worst days, and their five-year dreams Reflections Campus Constellations Before Harvard, before the Smithsonian, 46 Owen Gingerich had a jewel in Lee Observatory Alumni Happenings Reunion 2011— Renewing Our Promise 49 Class Notes Najib W. Saab (BAR ’78) jointly awarded the Zayed International Prize for 56 Environment; Susan L. Ziadeh (MA ’78) appointed ambassador to Qatar; Tarek Yamani (BS ’01) takes music from Montreux to the Betty Carter Jazz Ahead residency at the Kennedy Center In Memoriam 66 MainGate is published quarterly in Production American University of Beirut Cover Beirut by the American University Office of Communications Commencement 2011 (© Office of of Beirut for distribution to alumni, Office of Communications Communications/Ahmad El Itani) former faculty, friends, and Randa Zaiter PO Box 11–0236 supporters worldwide. Riad El Solh 1107 2020 Photography Beirut, Lebanon Editor AUB Jafet Library Archives Tel: 961-1-353228 Ada H. -

Pour Qui Sonne Le Glas Mohamed Choucair
Numéro 38 Novembre 2014 Publication «CCIA-BML» www.ccib.org.lb NEWS ECOThe Chambers Newsletter ÉDITO Pour qui sonne le glas Mohamed Choucair En dehors de ses prérogatives de La déflation, premier symptôme de Sans une politique de soutien tous sement vers la dépression n’est président de la République, sa fonc- la dépression, ne consiste pas seu- azimuts, le monde serait tombé possible. tion de représentation fait que son lement en la réduction de la masse dans un scénario catastrophe pire Il est évident que le Liban a résis- absence paralyse le pouvoir. Lors de monétaire, mais surtout des crédits qu’en 1929. té au Printemps arabe du fait de la précédente vacance de la prési- qui font partie de la masse moné- Naturellement, à chacune de ces l’expérience traumatisante qu’il a dence, on était sans conteste plus taire autant que la monnaie. Il est étapes, la majorité des décideurs a vécue entre 1975 et 1990. Grâce éloignés du «seuil de rupture» avec vrai que le crédit bancaire à l’éco- opté pour la politique efficace, mais à la démocratie, même virtuelle, une croissance de 8%. Ce n’est plus nomie a augmenté, mais il ne fait une minorité est restée attachée à de son régime qui sert de soupape le cas aujourd’hui; 1% de croissance que remplacer le crédit fournisseur ses anciens dogmes, croyant au mi- au malaise populaire. Grâce aussi à ne nous donne pas de réserves suf- qui s’est plus réduit encore avec la racle. Autant dire que le monde a sa structure confessionnelle et à la fisantes pour attendre encore des préférence absolue pour le cash. -

The UN Development Program (UNDP) in Lebanon
The UN Development Program (UNDP) in Lebanon The Ministry of Public Health December 2010 | The Lebanese banking sector 101 Alice Mogabgab Gallery - Interview issue number www.iimonthly.com • Published by Information International sal REPUBLIC OF INFORMANTS Lebanon 5,000LL | Saudi Arabia 15SR | UAE 15DHR | Jordan 2JD| Syria 75SYP | Iraq 3,500IQD | Kuwait 1.5KD | Qatar 15QR | Bahrain 2BD | Oman 2OR | Yemen 15YRI | Egypt 10EP | Europe 5Euros INDEX 4 LEADER: REPUBLIC OF INFORMANTS 7 The UN Development Program (UNDP) in Lebanon 10 The Ministry of Public Health 15 Who benefited from the foreign donations to Lebanon in 2009? 21 Immunity of the Prime Minister and Ministers 23 The Lebanese banking sector 26 Gold in the world 28 Syndicate of Gold Page 28 30 Ahlia School 32 Overweight & Obesity by Dr. Hanna Saadah 33 7 seconds between birth and death by Dr. Samar Zebian 34 “The Prince of Medicine of His Time” Acknowledges the Brain as the Seat of Page 42 Page 37 Intelligence” by Antoine Boutros 42 Hizbollah in the eyes of Christian 35 Alice Mogabgab Gallery - Interview Leaders 37 Myth #40: Green Lebanon 43 October 2010 Timeline in Lebanon 38 Must-read books: Solidere; Legislation and 46 Sexual harassment in Egypt Regulatory Texts 47 Real estate index in Lebanon- 39 Must-read children’s book: “No, I Will Not Ever October 2010 Never Eat a Tomato” 48 Food Price Index - October 2010 40 Lebanon Families: Audi families 50 Facts about Bees and Honey Making 41 Discover Lebanon: Qaaqaeiat Al-Jisr 50 Beirut Rafic Hariri International Airport - October 2010 51 Lebanon stats Editorialﹺ | 3 SQUEALERS AND BOUNCERS “The secret expenditures” of Lebanon’s intelligence services are an eye opener for the following reasons: “Secret expenditures” is a code for payoffs to informants or “human assets”. -

L'échec Des Politiques Publiques Mohamed Choucair
Numéro 35 Août 2014 Publication «CCIA-BML» www.ccib.org.lb NEWS ECOThe Chambers Newsletter ÉDITO L’échec des politiques publiques Mohamed Choucair Quel que soit le choc subi, un système ce n’est pas pour jouer un rôle poli- de civisme à tous Il est inutile de a tendance à retrouver son équilibre, tique, mais pour assumer notre res- les dirigeants de présenter encore c’est-à-dire son identité. Mais il ne ponsabilité économique. ce pays. et encore la liste la retrouve jamais intégralement. La de ce qui ne va Le pays n’a pas de président car les Une constitution LE PRÉSidENT MicHEL SlEimaN société, comme les individus, porte pas, ou des me- différents partis briguant ce poste se est faite pour du- en elle la tare des épreuves subies. A fait PREUVE, PAR SON DÉPART, sures favorables complaisent dans cette situation. Ce rer et pour gérer Parfois, cela augmente sa résistance. à une reprise. n’est pas un seul poste qui est laissé tous les conflits DE L’eNVERGURE D’uN GRAND Mais le plus souvent cela ouvre la La priorité éco- vacant, mais l’administration dans politiques. Si nous voie au déni. Rien n’est parfait en ce HommE D’État nomique est son ensemble qui est paralysée. L’es- n’appliquons pas monde, mais c’est une erreur des di- de restaurer la prit civique a disparu de la gouver- scrupuleusement rigeants de laisser grandir l’insatisfac- source première nance. Que pouvons nous attendre du Taëf, la porte sera tion jusqu’à la révolte. -
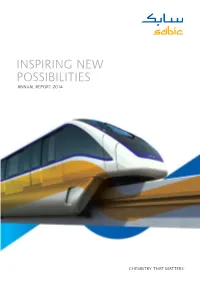
View Annual Report
INSPIRING NEW POSSIBILITIES ANNUAL REPORT 2014 A FUTURE OF CHANGE By 2050, another 2.5 billion people are expected to be living on our planet. It is the equivalent of adding twice the population of India, itself the world’s second most populous country. What’s more, two thirds of all the world’s people will be living in cities, posing unique infrastructure challenges for African and Asian countries, where most of the growth is predicted to take place. This dramatic shift presents the world with many challenges. How do we provide the food, buildings, energy and transportation that people need? How do communities provide clean and safe drinking water? What materials should we use to construct these new megacities? The answer is innovation. It is something that SABIC does every day, all around the world. With new materials, smart solutions and better ways of working, we can provide solutions that help in addressing these challenges to help create a better future for everyone. In 35 years’ time, the world will be a different place. At SABIC, we believe that despite the many challenges THE WORLD IN that society faces today, it can be a better place tomorrow. We have an unshakable faith in the power of human potential and technological innovation to create improved conditions for living. Imagine a world where precision agriculture delivers better crop yields from less land. Where high-tech materials enable clean, renewable energy to be the principal source of power for our cities and homes. 2050 Where low-cost personal transport takes you wherever you want to go, whenever you want. -

Driving Change Accelerating Growth Annual Report 2016 Sabic’S Businesses Sabic at a Glance
DRIVING CHANGE ACCELERATING GROWTH ANNUAL REPORT 2016 SABIC’S BUSINESSES SABIC AT A GLANCE PETROCHEMICALS The Petrochemicals strategic business unit is SABIC’s largest operating unit. It manufactures the essential building blocks for a wide range of chemicals, plastics, foams, and other materials used in industries from automotive to healthcare, from construction to household goods. The business’ products include olefins, oxygenates, aromatics, glycols, ethanolamines, linear alpha olefins, polyethylene, polypropylene, polyethylene terephthalate, polyvinyl chloride, polystyrene, and polycarbonate and its blends. SPECIALTIES The Specialties business provides a wide range of functional offerings, from engineering thermoplastic resins and compounds to composites, functional surfaces substrates, ethylene oxide derivatives, and additive manufacturing solutions. Specialties also offers extensive materials processing expertise, with a broad portfolio including specialty compounds, film and sheet, and a range of branded products such as NORYL™, ULTEM™, EXTEM™, and LNP™ products. NET INCOME US$ 4.8bn At SABIC we are helping our customers make the modern world AGRI-NUTRIENTS SALES US$ a better place. From planes that SABIC is a significant player in the fertilizers industry. Through its Agri-Nutrients strategic business, it are more fuel-efficient to the first supplies customers throughout the Middle East, Far 3D-printed car, our ingenuity, East, Africa, and the US with a wide variety of 35.4bn fertilizers, from general to highly specific, helping expertise, and can-do attitude are address the world’s ever growing demand for food. helping us become the preferred The business' product range includes urea, ammonia, world leader in chemicals. and a comprehensive portfolio of nitrogen-based ASSETS US$ inorganic products. -

Annual Report 2017 01
SABIC ANNUAL REPORT 2017 01 Overview and strategy Our commitment Chairman’s Statement 12 Corporate Social Responsibility 48 At SABIC, we believe in the CONTENTS Vice Chairman and CEO’s Human Capital 50 14 Statement Innovation and Business 52 Enabling Saudi Vision 2030 18 Development power of chemistry to make Compliance and Risk Management 56 Our Board of Directors 20 Environment, Health, Safety 58 Global Operations 22 and Security the world a better place. Our businesses Manufacturing 62 Supply Chain 64 Petrochemicals 26 Sustainability 66 Specialties 27 By driving performance for Agri-Nutrients 28 Directory Metals 29 Manufacturing Companies 70 customers, ensuring long-term Our core markets Global Directory 74 Transportation 32 Agri-Nutrients 34 dependability and building Construction 36 Medical Devices 38 Packaging 40 valuable relationships, we put Clean Energy 42 that power to work. We call it Electrical and Electronics 44 ‘Chemistry that matters™’. Page 05 Page 18 SABIC supports the Saudi SABIC hosts pioneering Vision 2030 drive for Human Resources Forum national economic in Riyadh transformation Page 32 SABIC innovation enables prize-winning panel for new Mini car Page 36 Applied brainpower helps architects and builders construct a better future Page 38 Page 42 Smarter materials that empower those Helping square the working to enable circle of limitless needs, better, longer lives limited resources Page64 Making our supply chain more effficient, sustainable and responsive SABIC 02 ANNUAL REPORT 2017 03 AT A GLANCE ASSETS We and our customers are working together to create a better future. Whether it’s cutting weight to save pollution or developing materials to help bring water to remote communities, the ingenuity, innovation and bn sheer dedication of our people are changing things for the better. -

Auc Taught Me the Spirit of Leadership with Care and Fairness
“AUC TAUGHT ME THE SPIRIT OF LEADERSHIP WITH CARE AND FAIRNESS. AUC GAVE ME THE DESIRE TO EXPAND MY HORIZONS BROADER THAN THE SKY. AUC GAVE ME A SENSE OF VALUES TO CONDUCT MY LIFE WITH AN APPETITE FOR LEARNING AND DISCOVERY.” — YERVANT TERZIAN ’60 PROFESSOR OF PHYSICAL SCIENCES, CORNELL UNIVERSITY AUC DISTINGUISHED ALUMNI AWARD RECIPIENT On the cover: The main staircase in AUC’s Science Building, completed in 1966 and home to the biology, chemistry, physics and mathematics departments; opposite: Built in 1974, the library on the Greek Campus serves as AUC’s academic hub PRESIDENT’S LETTER hroughout my first year as AUC’s 10th president, the pace of activity seemed to intensify as the year unfolded. From my earliest days, however, it was quite apparent that AUC’s strengths were many, including a rich heritage and an excellent reputation, thanks in large part to its distinguished alumni and its many friends and supporters. While much of the year was focused on strategic thinking and planning, due to the tremendous effort put forth by the Board of Trustees and the work of my predecessor and friend, the late John Gerhart, much of the groundwork for determining the direction AUC needs to take was in place. My mandate, as I have often stated, is to ensure that AUC evolves from being a good university to being a great university. Over the course of the year, three strategic objectives emerged.The first is the completion of our new state-of-the-art campus in New Cairo. I am happy to report that we have continued to make progress on the new campus project, completing the site preparation phase last year, which keeps the project on schedule with our relocation to the new campus scheduled for September 2007. -
No. 4215 AUSTRIA, BELGIUM, CANADA, DENMARK, FINLAND
No. 4215 AUSTRIA, BELGIUM, CANADA, DENMARK, FINLAND, etc. Protocol modifying the Convention signed at Paris on 22 November 1928 regarding international exhibitions. Signed at Paris, on 10 May 1948 Official text: French. Registered by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on 18 March 1958. AUTRICHE, BELGIQUE, CANADA, DANEMARK, FINLANDE, etc. Protocole portant modification de la Convention signée à Paris le 22 novembre 1928 concernant les expositions internationales. Signé à Paris, le 10 mai 1948 Texte officiel français. Enregistré par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord le 18 mars 1958. 1958_____ Nations Unies Recueil des Traités________113 [TRANSLATION1 TRADUCTION2] No. 4215. PROTOCOL" MODIFYING THE CONVENTION SIGNED AT PARIS ON 22 NOVEMBER 1928* REGARDING INTERNATIONAL EXHIBITIONS. SIGNED AT PARIS, ON 10 MAY 1948 The undersigned, plenipotentiaries of the Governments hereinafter named, having met in conference at Paris on 10th May, 1948, have, by common consent and subject to ratification, agreed on the following provisions : Article 1 Articles 2, 3 and 4 of the Convention of 22nd November, 1928,4 are abrogated and replaced by the following articles : 1 Translation by the Government of the United Kingdom. * Traduction du Gouvernement du Royaume-Uni. * In accordance with articles 3 and 4 of the Protocol and article 36 of the Convention, the Protocol came into force on the dates indicated as follows : a) upon deposit of the instruments of ratification with the French Government for the following signatory States : Belgium ....... 20 July 1951 Lebanon ....... 9 Septemberl953 Denmark ....... 5 May 1949 Morocco ....... 20 July 1955 Finland ....... 1 October 1953 Norway ......