Moitessier, Le Long Sillage D'un Homme Libre
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Article Mercury
Article du journal The Mercury Samedi 21 décembre 1968 HOBART FRENCH SOLO YACHTSMAN OFF BRUNY IS Mail from lone sailor LONE round-the-world sailor Bernard Moitessier made his first contact with teh outside world for at least eight weeks when he signalled a fisherman in Tasmanian waters on Wednesday morning. Moitessier (43), a Frenchman, was last reported just south of Capetown in his 42ft steel ketch Joshua. News of his contact with Snug fisherman Varley Wisby became known yesterday. Wisby, who was out fishing on Wednesday morning with his sons, Ross(20) and Robin(17) reported: • he spotted Moitessier's yacht about half way between Cape Bruny Light and Actaeon Island, about 50 miles south west of Hobart. • Moitessier signaled him to within about 12ft and threw him a “mail-box”. • The Frenchman asked about the weather, enjoyed a chat, and went on his way. Messages delivered Moitessier is chasing hard after Britain's Robin Knox-Johnston, leader of the $10,714 “Sunday Times” single-handed round-the- world yacht race. He has not been allowed to take on fuel, food or water since he left Plymouth four months ago. Yesterday, when Wisby delivered Moitessier's mail and messages to the Commodore of Tasmania (Mr J.M.Hickman) he said the yachtsman “looked in high spirits and good health”. Mr Wisby (40) was on a six-day fishing trip in his 42 ft fishing boat, Spring Bay. “It was about 6 am.”, he said. “We were about four or five miles away when we sighted the yacht. “The yacht looked as though it had stopped and was signaling to us with an aldis lamp.” he said. -

Re-Up Brunch Marks Beginning of SCOW Sailing Class Registration
The Newsletter of the Sailing Club of Washington March 2008 Re-Up Brunch Marks Beginning of SCOW Sailing Class Registration Rub-Off-the-Rust, Train-the-Trainers Sessions Set for Late March By Mike Rothenberg 2008 SCOW Training Director The Club’s Re-Up Brunch on Sunday, March 16 marks opening day for registration for SCOW sailing classes. Be sure to attend and get there early, if you want to prepare to become a Flying Scot or Cruiser Skipper by attending the first classes, which begin in April, so you can maximize your enjoyment as a skipper for Spring, Summer and Fall of 2008. The slots for all classes go fast. But, they go even faster for the April Basic Sailing and Cruiser classes. Other popular classes are the Spinnaker and Capsize courses, and don’t forget our Intermediate sailing class, which is returning to an older more inclusive format this year. In the recent past, many of the registrants for the Intermediate Class were Scot skippers, but the class is also for Cruiser skippers as well as crew for both the club’s daysailers and keelboats. Last year the class was limited to 12, but this year capacity will be 18-24 students, depending on the mix of Scot and Cruiser sailors. To see the latest schedule of classes in advance of the Re-Up Brunch, see the SCOW calendar of events online at http://www.scow.org/calendar.html Save Some Money as a Class Coordinator If you’re planning to sign up for a Basic Sailing Class or Cruiser Class and would like to save some money, the Club offers a $50 discount for one lucky person in each class, if they sign up to be the Class Coordinator. -

FF 2020-1 Pages + Covers @ A4.Indd
22020/1020/1 ® TThehe JJournalournal ooff tthehe OOceancean CCruisingruising ClubClub 1 “I am not afraid of storms for I am learning to sail my ship.” —Louisa May Alcott 2 OCC FOUNDED 1954 offi cers COMMODORE Simon Currin VICE COMMODORES Daria Blackwell Paul Furniss REAR COMMODORES Jenny Crickmore-Thompson Zdenka Griswold REGIONAL REAR COMMODORES GREAT BRITAIN Beth & Bone Bushnell IRELAND Alex Blackwell NORTH WEST EUROPE Hans Hansell NORTH EAST USA Dick & Moira Bentzel SOUTH EAST USA Bill & Lydia Strickland WEST COAST NORTH AMERICA Ian Grant HAWAII, CALIFORNIA & MEXICO Rick Whiting NORTH EAST AUSTRALIA Nick Halsey SOUTH EAST AUSTRALIA Paul & Lynn Furniss SPECIALIST (TECHNICAL) Frank Hatfull ROVING REAR COMMODORES Nicky & Reg Barker, Suzanne & David Chappell, Guy Chester, Andrew Curtain, Fergus Dunipace & Jenevora Swann, Ernie Godshalk, Bill Heaton & Grace Arnison, Alistair Hill, Barry Kennedy, Stuart & Anne Letton, Pam McBrayne & Denis Moonan, Sarah & Phil Tadd, Gareth Thomas, Sue & Andy Warman PAST COMMODORES 1954-1960 Humphrey Barton 1994-1998 Tony Vasey 1960-1968 Tim Heywood 1998-2002 Mike Pocock 1968-1975 Brian Stewart 2002-2006 Alan Taylor 1975-1982 Peter Carter-Ruck 2006-2009 Martin Thomas 1982-1988 John Foot 2009-2012 Bill McLaren 1988-1994 Mary Barton 2012-2016 John Franklin 2016-2019 Anne Hammick SECRETARY Rachelle Turk Westbourne House, 4 Vicarage Hill Dartmouth, Devon TQ6 9EW, UK Tel: (UK) +44 20 7099 2678 Tel: (USA) +1 844 696 4480 e-mail: [email protected] EDITOR, FLYING FISH Anne Hammick Tel: +44 1326 212857 e-mail: [email protected] OCC ADVERTISING Details page 252 OCC WEBSITE www.oceancruisingclub.org 1 CONTENTS PAGE Editorial 3 The 2019 Awards 4 Sailing the South Coast of Newfoundland 27 Jan Steenmeijer From the galley of .. -

Kris Larsen and Kehaar
Hall of Fame - Kris Larsen By Graham Cox Kris Larsen: 1954 - In 1898, Joshua Slocum completed the first solo circumnavigation of the world aboard Spray, his 36ft, engineless, gaff-rigged yawl. Spray was an extremely basic craft, rebuilt by Joshua from a wreck, using hand tools. He mostly worked alone, with very little capital, in a paddock under a tree. He not only made history but pioneered a way of life. This way of life took some time to develop – it was 21 years before Harry Pidgeon became the second person to circumnavigate alone aboard his home-built Islander – but the idea that people of modest means, in equally modest boats, often home-built, could live aboard and extensively voyage the oceans of the world, either solo or short-handed, took hold of the public imagination. Thus began what could be called the Slocum era of ocean voyaging, and it continued almost without change for more than 70 years. By the 1980s, this era began to rapidly disappear. Increasing bureaucracy, technological advances, marinas, and the politics of a post-colonial world all but eliminated penniless vagabonds aboard simple boats from the crossroads of the sea. The perceived wisdom today is that you need a significant amount of money to cruise, both to finance the sophisticated Kris Larsen in Kehaar yachts considered necessary, and to cover running costs. soon made English his fifth language. He studied the However, a few stalwarts of the old school remain, great poets and philosophers at university. Despite capable of living by their wits. They know that all you this, he was unwelcome wherever he went, deported really require is a strong hull, rudder and rig. -
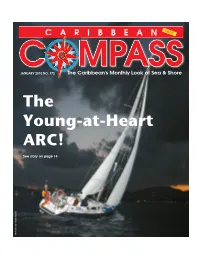
January 2010 No
C A R I B B E A N FREE C MPASS JANUARY 2010 NO. 172 The Caribbean’s Monthly Look at Sea & Shore The Young-at-Heart ARC! See story on page 14 TIM WRIGHT / WWW.PHOTOACTION.COM JANUARY 2010 CARIBBEAN COMPASS PAGE 2 JANUARY 2010 CARIBBEAN COMPASS PAGE 3 DEPARTMENTS Business Briefs .......................8 The Caribbean Sky ...............41 Regatta News........................ 12 Book Reviews ........................42 Destinations ........................... 21 Cooking with Cruisers....44 - 46 Sailors’ Hikes ........................26 Readers’ Forum .....................48 Meridian Passage .................32 What’s on My Mind ............... 49 Cruiser Profile ........................32 Monthly Calendar ................ 50 The Caribbean’s Monthly Look at Sea & Shore Fun Pages.........................38, 39 Caribbean Marketplace...... 51 Cruising Kids’ Corner ............40 Classified Ads ....................... 54 www.caribbeancompass.com Dolly’s Deep Secrets ............40 Advertisers’ Index .................54 JANUARY 2010 • NUMBER 172 Caribbean Compass is published monthly by Grenada/Carriacou/Petite Martinique: Compass Publishing Ltd., P.O. Box 175 BQ, Ad Sales & Distribution - Karen Maaroufi Bequia, St. Vincent and the Grenadines. Cell: (473) 457-2151 Office: (473) 444-3222 Security Scene ‘Our Favorite Island’ Tel: (784) 457-3409, Fax: (784) 457-3410 [email protected] Marie Galante [email protected] Martinique: Ad Sales & Distribution - Isabelle Prado Tel: Updates and tips .................. 12 chooses Grenada .. 34 www.caribbeancompass.com -

Green for Golden
ocean adventure WITH DON McINTYRE OPPOSITE The 2018 Golden Globe Race honours CLOCKWISE FROM TOP Not a Volvo RTW racer the solo circumnavigation achievement of Sir but our Tradewind 35 is a solid Southern Ocean Robin Knox-Johnston way back in 1968. If you boat nonetheless. That keel will not fall off and aren't up for that, you can join Sir Robin at Clipper will help her track steady in surfing conditions; Ventures in a fully crewed race around the world! Route of the 2018 Golden Globe Race; Jane and (pic © Clipper Ventures) me happy to be sailing our T35 for the first time. On June 14, 2018, a fleet of years ago. He will follow the though, including satellite approved for the race and up to 20 production yachts race online. tracking and can talk to race others may be considered. ranging in size from 32 to This anniversary edition headquarters on a satellite I will enter this race in Green 36ft, each skippered by a of the Golden Globe Race phone, but no-one else. my 1993 Tradewind 35, for Golden unique individual, will follow is for real sailors and Talking to family is by radio purchased last year for Robin Knox-Johnston sailing adventurers who don’t have only! $58,000. I think a Biscay 36 It’S OFFICIAL! THE SOLO ROUND-THE-WORLD 2018 GOLDEN GLOBE Suhaili across the start line $1 million. They will have The fibreglass production is probably faster and has RACE IS A Goer … SO WHAt’S STOPPING YOU FROM ENTERING? of the 2018 Golden Globe no computers on board, no yachts entered must be the advantage of a ketch rig Race, in Falmouth, England. -
Grenada's South Coast Boast
On-line OCTOBER 2007 NO. 145 The Caribbean’s Monthly Look at Sea & Shore Grenada’s South Coast Boast See story on page 24 CHRIS DOYLE OCTOBER 2007 CARIBBEAN COMPASS PAGE 2 Info& Updates Breaking News! We reported in last month’s Compass that legislation had been passed requiring The Caribbean’s Monthly Look at Sea & Shore “all” air and sea carriers — including yachts — to submit passenger information in www.caribbeancompass.com advance when arriving at, and departing from, each of ten Caribbean Common Market (CARICOM) member states. Participating countries are Jamaica, Antigua & Barbuda, St. Kitts & Nevis, Dominica, Barbados, St. Lucia, St. Vincent & the OCOTBER 2007 • NUMBER 145 Grenadines, Grenada, Trinidad & Tobago and Guyana. As this issue of Compass is ready to go to press, with articles on pages 6 and 19 about the electronic Advance Passenger Information System (APIS), the difficulties it Motoring presents for individual yachts, and its enforcement’s possible negative impact on Martinique to Margarita.........22 the Eastern Caribbean’s yachting industry as a whole, we have just received news from Sharon McIntosh, Manager of the Caribbean Marine Association. CONKLIN Sharon reports that the Director and the Compliance Manager of CARICOM’s Implementation Agency for Crime and Security will be meeting soon with officers and members of the Caribbean Marine Association to discuss the needs of the yachting community regarding APIS. WWW.WUNDERGROUND.COM We will have a report on the outcome of that meeting in the November issue of Compass. New Extension Fee for Grenada What They Did… Yachting visitors to Grenada are currently being granted an initial stay of one with Dean and Felix ........14, 15 month by Immigration, after which an extension of stay in the country must be applied for. -

'La Longue Route' 2018/19 Part 1 South Portland/Maine to Tasmania BWB Numbers 075 - 096
1 Blauwasser Briefe 'La Longue Route' 2018/19 Part 1 South Portland/Maine to Tasmania BWB numbers 075 - 096 Text and pictures © Susanne Huber-Curphey 33.043 NM, 251 days at sea, 5.49 kn (including 16.872 NM in 120 days non-stop around Antarctica, 5.83 kn) Drawing of Bernard Moitessier and 'Joshua' at the RYCT in Hobart 2 Part 1 Part 2 LISTE DER BLAUWASSERBRIEFE 75 - 96 LISTE DER BLAUWASSERBRIEFE 97 -120 2018.10.08 BWB 097 DL, Rührei fürs Weichei 2018.05.06 BWB 075 UK, Farewell to Nova Scotia 2018.10.21 BWB 098 DL, Hornisse, Bär und Fuchs 2018.06.15 BWB 076 UK, Positionreports and tracking, wl2k 2018.10.30 BWB 099 DL, Landfall in Tasmanien 2018.06.15 BWB 077 DL, Positionsmeldungen und tracking, wl2k 2018.11.05 BWB 100 DL, Das Zweite Große Kap 2018.06.17 BWB 078 DL, Ladies First, wl2k 2018.11.08 BWB 101 UK, The Second Big Cape 2018.06.24 BWB 079 DL, Mein Freund Gulfy 2018.11.14 BWB 102 DL+UK, Just a thought – Mal so nebenbei 2018.06.24 Gulfy rewritten 2018.11.23 BWB 103 DL, Der 'Stille' Ozean 2018.06.28 BWB 080 UK, My friend Gulfy 2018.12.12 BWB 104 DL, Dreimal Hoornblower 2018.07.01 BWB 081 DL, Grüße nach Horta 2018.12.14 BWB 105 UK, The Third Big Cape 2018.07.05 BWB 082 DL, Drei exzellente Wochen 2018.12.29 BWB 106 UK+DL, Happy New Year 2018.07.09 BWB 083 DL, Einmal Rund 2018.12.28 BWB 107 DL, Wieder im Südatlantik, mit Anhang 2018.07.12 BWB 084 DL, Die Wende 2019.01.12 BWB 108 DL+UK weak Pactor 2018.07.15 BWB 085 DL, Joshua – Nehaj bei 5 Grad Nord 2019.01.13 BWB 109 DL, Schon wieder Cape Agulhas 2018.07.19 BWB 086 DL, Urlaub vom Segeln 2019.01.13 BWB 110 UK, Agulhas once again 2018.07.26 BWB 087 UK, Chat w. -

2019 Yacht-Master 42
BASELWORLD 2019 oyster perpetual yacht-master 42 rolex and YACHTING Contents Oyster Perpetual Yacht-Master 42 rolex and YACHTING The watch of the open seas adventures at sea 03 10 2 Baselworld 2019 pressroom.rolex.com OYSTER PERPETUAL YACHT-MASTER 42 The watch of the open seas Rolex is extending its Yacht-Master range with a new 42 mm model, the Oyster Perpetual Yacht-Master 42. Yacht-Master sailing watches are recognizable thanks to their distinctive bidirectional rotatable bezel with a raised 60-minute gradu- ation. The Yacht-Master 42 is fitted with a Cerachrom insert in matt black ceramic that perfectly complements its black lacquer dial. Cre- ated from 18 ct white gold, this new watch heralds the arrival of this precious metal on a Yacht-Master model. The light reflections on the case sides and lugs highlight the profile of the Oyster case. Like all Rolex Professional watches, the Yacht-Master 42 offers exceptional legibility in all circumstances, and especially in the dark, thanks to its Chromalight display. The broad hands and hour markers are filled with a luminescent material emitting a long-lasting glow. This new model is equipped with calibre 3235 – at the forefront of watchmaking technology – a first for the Yacht-Master range. Like all Rolex watches, the Yacht-Master 42 carries the Superlative Chronometer certification, which ensures excellent performance on the wrist. 3 Baselworld 2019 pressroom.rolex.com oyster perpetual YACHT-MASTER 42 High-technology ceramic Rolex played a pioneering role in the development of special ceramics for monobloc bezels and monobloc bezel inserts. -
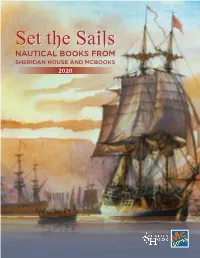
Set the Sails
SetSet thethe SailsSails NAUTICAL BOOKS FROM SHERIDAN HOUSE AND MCBOOKS 2020 --2019-807-CR Nautical Globe Catalog.indd 1 1/14/20 12:24 PM CONTENTS Nautical Catalog 2020 1-24 Sailing & Boating 24-30 Reference 31-56 Fiction 57-64 History & Military History 65-79 Lifestyle & More 80-82 Title Index How to Order (Inside Back Cover) Dear Readers, This catalog represents a stunning collection of the most prominent maritime writers from McBooks Press, Lyons Press, and Sheridan House, covering the widest-ranging and unique array of related topics no other publisher offers. I am thrilled to be a part of this initiative, calling readers down to the sea in books, whether to escape into another time or to pursue advice and information. George D. Jepson Editorial Director, McBooks Press Cover image: The Only Victor by English marine artist Geoffrey Huband. Used with permission. --2019-807-CR Nautical Globe Catalog.indd 2 1/14/20 12:24 PM Sailing & Boating DESPERATE VOYAGE By John Caldwell In May 1946 John Caldwell set out to sail from Panama to Sydney to reunite with his wife who he hadn’t seen for more than a year. Eager to reach his destination and unable to secure any other form of transport, he had to resort to singlehanded seamanship. Ahead lay a mission that was to reveal in him elements not only of astounding courage and determination, but also of incredible foolhardiness. Within 500 miles of Panama John Caldwell had already been shipwrecked once. Indefatigable, he decided to press on towards his goal. This is more than an exciting tale of sea- adventure. -

FF 2020-1 Pages + Covers @ A4.Indd for CUTTING.Indd
IN THE WAKE OF BERNARD MOITESSIER John Franklin (John shares his meeting with Susanne Huber-Curphey in Richard’s Bay, South Africa, in November 2019 – Susanne has since received the OCC Seamanship Award for 2019, see page 20. With thanks to Daria Blackwell for extracts from her treatise on Famous Women Sailors. All photos copyright Susanne Huber-Curphey.) Jenny and I recently had the privilege of meeting one of the world’s most experienced, accomplished, competent and intrepid sailors; not only that, but female and a singlehander. Not very much has been written about Susanne Huber-Curphey – she shuns publicity, doesn’t publish a blog or have a website, and is content to sail the oceans of the world enjoying an intimate bond with the sea and her beloved aluminium boat Nehaj. Nehaj is a Dick Koopmans 11∙9m long keel design, cutter-rigged and built in aluminium alloy by Koopmans Kasko’s in Sneek, The Netherlands. Her name derives from a castle fortress in Croatia meaning ‘safe, secure’. The build yard completed the alloy work in 2013. Susanne then took over the fit-out, spending another two years living aboard while she worked on the completion, doing practically all the work herself to a professional standard. Susanne aboard Nehaj. Note the watertight door at the companionway, small windows and simple deck plan. No roller furling, no sail tracks or travellers and no halyards led aft, slab reefing at the mast, no rod kicker but traditional boom gallows 93 94 Nehaj’s interior, completed by Susanne herself, is functional and bright Nehaj is a singlehander’s boat, very well equipped but fitted out simply and functionally for long-distance yet comfortable passagemaking for her owner/skipper. -
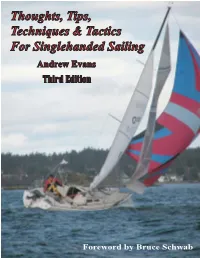
Techniques & Tactics for Singlehanded Sailing Thoughts, Tips
Thoughts, Tips, Techniques & Tactics For Singlehanded Sailing Andrew Evans ThirdThird EditionEdition Foreword by Bruce Schwab This book is only available as a free download from The Singlehanded Sailing Society at www.sfbaysss.org/tipsbook Front and back covers by Andrew Madding, club photographer for the Royal Victoria Yacht Club. The front cover represents everything it means to be a singlehanded sailor: High winds (two reefs in the main and a storm jib lashed on the bow) the tiller under my knee with the spin sheet in one hand – bracing myself with the other. The back cover represents everything else it means to be a singlehanded sailor: the afternoon nap. Foreword I met Andy when he came to help out my preparations on Ocean Planet for the 2004-2005 Vendee Globe. A nice guy and good sense of humor; after all he's Canadian. In many ways he represents all those who have become successful solo sailors on their own nickel; learning slowly from a mix of hard-earned experience, digging up obscure info, and sharing with each other. It's not like this sort of experience is falling off trees. While a lot of jabber about singlehanded sailing can be found on discussion forums and the odd magazine articles, this is the first collection of the varied aspects of the sport put together in one place. It takes thousands of hours of sailing to get the kind of knowledge contained in this book. It also takes a lot of experimentation and a willingness to be wrong nine times before getting it right on the tenth.