Évolution Historique
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Henry Fry: 19Th-Century Shipowner, Part Ii ■ 90 Years Ago: Lindbergh’S Visit to Quebec City ■ Ken Dryden at the Literary Feast
N U M B E R 5 8 ■ AUTUMN 2018 ■ $ 2 . 0 0 ■ HENRY FRY: 19TH-CENTURY SHIPOWNER, PART II ■ 90 YEARS AGO: LINDBERGH’S VISIT TO QUEBEC CITY ■ KEN DRYDEN AT THE LITERARY FEAST The Morrin Centre is managed by the Literary & Historical Society of Quebec. Society Pages is published with the assistance of Canada Post. Quebec Heritage News Subscribe Now! Quebec’s English-language heritage magazine. Popular history – Profiles of remarkable people and events – Contemporary issues in heritage conservation – Book reviews – Insightful commentary – and much more. Individual: $30 for 1 year; $75 for 3 years; $120 for 5 years Institutional: $40 for 1 year; $100 for 3 years; $160 for 5 years To pay by cheque, please mail payment to: QAHN, 400-257 rue Queen, Sherbrooke QC J1M 1K7. or pay by Paypal to: [email protected]. For more information, call (819) 564-9595 Toll free: 1-877-964-0409. EDITOR Kathleen Hulley LAYOUT Patrick Donovan PROOFREADING Hoffman Wolff NUMBER 58 ■ AUTUMN 2018 ■ PUBLISHER Literary & Historical Society of Quebec CONTENTS 44 chaussée des Écossais Quebec, Quebec G1R 4H3 PHONE 418-694-9147 Letter from the President 2 Barry Holleman GENERAL INQUIRIES [email protected] From the Executive Director 2 Barry McCullough WEBSITE www.morrin.org Transactions ■ Henry Fry: Shipowner, Part II 3 John & Henry Fry LHSQ COUNCIL Lindbergh in Quebec City 6 Charles André Nadeau [email protected] Barry Holleman, President Georges-Barthélémy Faribault 8 François Faribault Ladd Johnson, Vice-President Gina Farnell, Treasurer In Memory of Cameron MacMillan 9 Shirley Nadeau Diana Cline, Secretary Donald Fyson, Honorary Librarian Fundraising Jacob Stone, Member at Large Éric Thibault, Member at Large Marietta Freeland Fund for the Arts 10 K. -

Chapman's Bookstore 2407 St
'. , ~ ~- - - ---rom-: iii ,~-----.--- AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION Montreal Conference AT McGILL UNIVERSITY JUNE 6 TO I2, I900 Programnle and Guide ISSUED BY THE LOCAL COMMITTEE MONTREAL THE HERALD PRESS eont~nts History of Montreal Description McGill University Montreal Libraries Sunday Services Summary of Points of Interest in and about Montreal Programme of Local Elltertainment Local Committee Wheelmen's Favorite Routes Map of Montreal Advertisers Published for the I,oca\ Committee By F. E. PHELAN, 2331 St. Catherine Street, lVIontreal HISTORY HE history of Montreal as a centre of population commences with the visit of Jacques Cartier to the Indians of the town of Hochelaga in 1535. The place was situated close to T Mount Royal, on a site a short distance from the front of the McGill College Grounds, and all within less than a block below Sherbrooke Street, at Mansfie1.d Street. It was a circular palisaded Huron-Iroquois strong hold, which had been in existence for seyeral generations and had been founded by a party which had broken off in some manner from the Huron nations at Lake Huron, at a period estimated to be somewhere about 1400. It was at that time the dominant town of the entire Lower St. Lawrence Valley, and apparently also of Lake Champlain, in both of which quarters numerous settlements of the same race had sprung from it as a centre. Cartier describes how he found it in the following words: " And in the midst of those fields is situated and fixed the said town of Hochelaga, near and joining a mountain which is in its neighbour hood, well tilled and exceedingly fertile; therefrom one sees very far. -

La Pratique Antiquaire De Jacques Viger Nathalie Hamel
Document generated on 09/28/2021 4:43 p.m. Revue d'histoire de l'Amérique française Collectionner les « monuments » du passé La pratique antiquaire de Jacques Viger Nathalie Hamel Volume 59, Number 1-2, été–automne 2005 Article abstract Jacques Viger, the first mayor of Montreal, is known above all for his erudite URI: https://id.erudit.org/iderudit/012720ar activities. He spent a large part of his life collecting historical documents, DOI: https://doi.org/10.7202/012720ar which he copied, analyzed and commented. Through the accumulation of this wealth of documentation, he found himself at the centre of a network for the See table of contents exchange of historical and literary information. A study of his work reveals three practices associated with the work of an antiquarian during the first half of the nineteenth century : collecting, corresponding and copying. These Publisher(s) practices will be analyzed here by drawing on the entire corpus of Jacques Viger’s work, including his most well-known work, Ma Saberdache. Institut d'histoire de l'Amérique française ISSN 0035-2357 (print) 1492-1383 (digital) Explore this journal Cite this article Hamel, N. (2005). Collectionner les « monuments » du passé : la pratique antiquaire de Jacques Viger. Revue d'histoire de l'Amérique française, 59(1-2), 73–94. https://doi.org/10.7202/012720ar Tous droits réservés © Institut d'histoire de l'Amérique française, 2005 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit (including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be viewed online. https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/ This article is disseminated and preserved by Érudit. -

A Thesi S Submitted Ta the Facul Ty of Graduate Studies and Research in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts
FARM LEASES AND AGRICULTURE ON THE ISLAND OF MONTREAL, 1780-1820 A thesi s submitted ta the Facul ty of Graduate Studies and Research in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts by ( JENNIFER L. WAYWELL OEPARTMENT OF HISTORY MCGILL UNIVERSITY, MONTREAL SEPTEMBER 1989 o Jenni fer L. Waywell 1989 r ( ABSTRACT Based primarily on notari zed farm l eases, th i s thes i s exami nes approaches to agriculture on the island of Montreal from 1780 to 1820. Thi s source permits us to establ ish the crucial rel ationship between people and farms and to then link them to differences in capital invest ment, production and farming techniques. By understanding the common, day-to-day farming operations, we can address ourselves to the larger questions of what contributed to the state of Lower Canadian agricul ture, a subject of contentious debate in Quebec historiography. The island of Montreal, already favoured by the geographic cir cumstances of c1imate, soi1 and location, was also a crucible for two profound changes which were occurring in Quebec society during this period -- the beginning of a wave of Eng1 ish-speaking immigrants who wou1d permanently alter the ethnie composition of the province's population, and the deve10pment of a significant urban market. In the 564 notarized farm leases passed in this forty-year period, half of the lessors were merchants and professionals, most of whom I~sided in the city and suburbs of Montreal. The farms of the urban bourgeoisie were on average larger and better-stocked than the farms of habitants, art i sans and other proprietors. -

The Montreal/Lake Ontario Section of the Seaway
THE MONTREAL/LAKE ONTARIO SECTION OF THE SEAWAY he St. Lawrence Seaway, in its broadest of the deep waterway, the St. Lawrence Seaway sense, is a deep waterway extending some proper extends from Montreal to Lake Erie. 3,700 km (2,340 miles) from the Atlantic T The Montreal/Lake Ontario section Ocean to the head of the Great Lakes, at the encompasses a series of 7 locks from Montreal heart of North America. Strictly speaking, how- (Quebec) to Iroquois (Ontario) enabling ships to ever, within the meaning of the legislation which navigate between the lower St. Lawrence River provided for the construction and maintenance and Lake Ontario. Laker under Mercier Bridge 1 HISTORY he opening of the Seaway, in April of 1959, The building of the Erie Canal, in the marked the full realization of a 400 year-old United States, early in the 19th century, provided T dream. In the early part of the 16th century, the incentive for the construction of additional and Jacques Cartier, the French explorer, was turned deeper canals and locks along the St. Lawrence. back by the rushing waters of the Lachine Rapids, The American waterway, which offered a fast, just west of what is now Montreal, and thus denied uninterrupted link between the growing industrial his dream of finding the Northwest Passage and the heartland of North America and the Atlantic Ocean route to the East. At various times during the inter- through New York posed a serious threat to vening 300 years, canals have been dug and locks Canadian shipping and, in particular, to the develop- built around the natural barriers to navigation in the ment of the City of Montreal as a major port. -
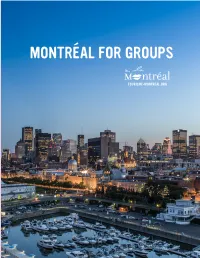
Montréal for Groups Contents
MONTRÉAL FOR GROUPS CONTENTS RESTAURANTS ...........................................2 TOURIST ATTRACTIONS ............................17 ACTIVITIES AND ENTERTAINMENT ............43 CHARTERED BUS SERVICES .......................61 GUIDED TOURS ...........................................63 PERFORMANCE VENUES ............................73 CONTACT ...................................................83 RESTAURANTS RESTAURANTS TOURISME MONTRÉAL RESTAURANTS THE FOLLOWING RESTAURANTS WELCOME GROUPS. To view additional restaurants that suit your needs, please refer to our website: www.tourisme-montreal.org/Cuisine/restaurants FRANCE ESPACE LA FONTAINE 3933 du Parc-La Fontaine Avenue Plateau Mont-Royal and Mile End Suzanne Vadnais 514 280-2525 Tel.: 514 280-2525 ÇSherbrooke Email: [email protected] www.espacelafontaine.com In a pleasant family atmosphere, the cultural bistro Espace La Fontaine, in the heart of Parc La Fontaine, offers healthy, affordable meals prepared with quality products by chef Bernard Beaudoin. Featured: smoked salmon, tartar, catch of the day, bavette. The brunch menu is served on weekends to satisfy breakfast enthusiasts: pancakes, eggs benedict. Possibility of using a catering service in addition to a rental space for groups of 25 people or more. Within this enchanting framework, Espace La Fontaine offers temporary exhibitions of renowned artists: visual arts, photographs, books, arts and crafts, and cultural programming for the general public. Open: open year round. Consult the schedule on the Espace La Fontaine website. Reservations required for groups of 25 or more. Services • menu for groups • breakfast and brunch • terrace • dinner show • off the grill • gluten free • specialty: desserts • specialty: vegetarian dishes • Wifi LE BOURLINGUEUR 363 Saint-François-Xavier Street Old Montréal and Old Port 514 845-3646 ÇPlace-d’Armes www.lebourlingueur.ca Close to the St. Lawrence River is Le Bourlingueur with its menu of seafood specialties, in particular poached salmon. -

Irish-French Relations in Lower Canada
CCHA Historical Studies, 52(1985), 35-49 Irish-French Relations in Lower Canada Mary FINNEGAN Montreal, Que. Movements for political reform were a world-wide phenomenon in the 1820’s. On both sides of the Atlantic two British territories, Ireland and Lower Canada, fought the established political order in an effort to gain control of their own affairs. An ever-increasing number of Irish arrived in Quebec and Montreal during this period as a result of Britain’s policy of resettling her surplus population in her North American colonies. It did not take long for some of the Irish immigrants and the French Canadians to realize that a political affiliation could be mutually beneficial. The relationship was based primarily on both groups being Catholic and sharing a history of conquest by England. Catholics in Lower Canada had enjoyed relative religious freedom since 1763 as well as exemption from the penal restrictions that affected Irish Catholics, but both groups felt that their religion and nationality militated against them in the selection of government offices and appointment to positions of power. English domination of the Irish was centuries old. More than three-quarters of the Irish population was Catholic, yet, unlike Catholics in Lower Canada, the mere fact of being Catholic made them ineligible to sit in Parliament or hold any government office. Essential also was the contemporary British movement for internal constitutional reform, especially that of Catholic Emancipation. Daniel O’Connell, the Irishman in Westminster responsible for securing this victory in 1829, added the cause of oppressed Catholics in Lower Canada to his continued struggle for parliamentary reform. -

The Montreal Hub the Historic City Centre, Old Port and Railway Station District
THE MONTREAL HUB THE HISTORIC CITY CENTRE, OLD PORT AND RAILWAY STATION DISTRICT Analysis of a group of Montreal heritage sites by an expert committee PDF document drawn from a presentation on the Old Montreal Website www.old.montreal.qc.ca February 2003 Rights reserved – Société de développement de Montréal 1 Outline of the presentation THE MONTREAL HUB .................................................................... 3 A DECISIVE BREAKPOINT .............................................................. 5 OVERVIEW OF THE SITES ............................................................ 10 MONTREAL’S HISTORIC CITY CENTRE .........................................................10 WAREHOUSE-SHOWROOMS ......................................................................................................................13 A HISTORIC CITY CENTRE ..........................................................................................................................16 THE OLD PORT AND THE ENTRANCE TO THE LACHINE CANAL .....................19 THE GRAIN ELEVATORS .............................................................................................................................23 HABITAT ’67................................................................................................................................................26 THE RAILWAY STATION DISTRICT ................................................................28 WINDSOR STATION AND ITS VICTORIAN SURROUNDINGS........................................................................30 -

Early Encounters with Mount Royal: Part One
R IOTS :G AVAZZIANDTHEONETHATWASN ’ T $5 Quebec VOL 5, NO. 8 MAR-APR 2010 HeritageNews Montreal Mosaic Online snapshots of today’s urban anglos Tall Tales Surveys of historic Mount Royal and the Monteregian Hotspots The Gavazzi Riot Sectarian violence on the Haymarket, 1853 QUEBEC HERITAGE NEWS Quebec CONTENTS eritageNews H DITOR E Editor’s Desk 3 ROD MACLEOD The Reasonable Revolution Rod MacLeod PRODUCTION DAN PINESE Timelines 5 PUBLISHER Montreal Mosaic : Snapshots of urban anglos Rita Legault THE QUEBEC ANGLOPHONE The Mosaic revisited Rod MacLeod HERITAGE NETWORK How to be a tile Tyler Wood 400-257 QUEEN STREET SHERBROOKE (LENNOXVILLE) Reviews QUEBEC Uncle Louis et al 8 J1M 1K7 Jewish Painters of Montreal Rod MacLeod PHONE The Truth about Tracey 10 1-877-964-0409 The Riot That Never Was Nick Fonda (819) 564-9595 FAX (819) 564-6872 Sectarian violence on the Haymarket 13 CORRESPONDENCE The Gavazzi riot of 1853 Robert N Wilkins [email protected] “A very conspicuous object” 18 WEBSITE The early history of Mount Royal, Part I Rod MacLeod WWW.QAHN.ORG Monteregian Hotspots 22 The other mountains, Part I Sandra Stock Quebec Family History Society 26 PRESIDENT KEVIN O’DONNELL Part IV: Online databases Robert Dunn EXECUTIVE DIRECTOR If you want to know who we are... 27 DWANE WILKIN MWOS’s Multicultural Mikado Rod MacLeod HERITAGE PORTAL COORDINATOR MATTHEW FARFAN OFFICE MANAGER Hindsight 29 KATHY TEASDALE A childhood in the Montreal West Operatic Society Janet Allingham Community Listings 31 Quebec Heritage Magazine is produced six times yearly by the Quebec Anglophone Heritage Network (QAHN) with the support of The Department of Canadian Heritage and Quebec’s Ministere de la Culture et Cover image: “Gavazzi Riot, Haymarket Square, Montreal, 1853” (Anonymous). -

The Notre-Dame Street Overpass Sidewalk: from Bill Vazan's
Palimpsest III: The Dialectics of Montreal’s Public Spaces Department of Art History, Concordia University The Notre-Dame Street Overpass Sidewalk: From Bill Vazan’s Highway #37 to Today Philippe Guillaume September 2010 Cynthia I. Hammond, and Anja Bock, eds. Palimpsest III: The Dialectics of Montreal’s Public Spaces An already-made geography sets the stage, while the willful making of history dictates the action …1 The sidewalk plays a fundamental role as a place of transit in the modern city, as well as being a space of sensorial experience. A specific walkway can represent aesthetic change across generations while, nonetheless, eliciting sensory experiences where the pedestrian’s feeling of safety is axiomatic. Such a space is seen in a photograph that is part of Montreal artist Bill Vazan’s conceptual project Highway #37, created in 1970. Detail 151 (Fig. 1), a black and white photograph, illustrates an eastward view of Notre-Dame Street taken from the southern sidewalk along the Notre-Dame Street overpass, a viaduct that spans over the old Dalhousie and Viger stations rail-yards. This is a historic locus linked to travel: this epic street exits Old Montreal towards the eastern part of the island. On today’s maps it spans between Berry and St-Christophe streets. When viewed through Vazan’s framing, this cityscape still serves as a striking palimpsest of the city’s modernist past, where, formally, the sidewalk encompasses all the elements associated with a safe space for pedestrian travel. A comparative view of the landscape seen in Vazan’s photograph between the time it was made and the present further enriches the narrative of this place, which nowadays sits on the cusp of the city’s salient tourist space, Old Montreal. -

Notre-Dame-De-Grâce
CHRONIQUES IMMOBILIÈRES VOLUME 2 SEPT. 2013 NOTRE-DAME-DE-GRÂCE JACQUES VIGER VENDRE OU ACHETER La propriété et les conjoints et l’église UNE MAISON PAR SOI-MÊME : de fait : MYTHES VERSUS/ Notre-Dame-de-Grâce est-ce une bonne idée? OU RÉALITÉ Should You SELL OR BUY Home Ownership and Common JACQUES VIGER A HOME ON YOUR OWN? Law Spouses: FACT VS. MYTH and the Church of Notre-Dame-de-Grace Le HOME STAGING Programme achat en 5 temps ! AVEC RÉNOVATIONS The 5 Golden Rules Purchase Plus MONKLANDS of HOME STAGING! IMPROVEMENTS PROGRAM À la tête des élus, Jacques Viger est choisi pour However, Viger’s legacy would not be linked primarily to his military assurer le rôle de maire. service. Today, he is best known as Montreal’s first mayor, elected in 1833. His rise to the mayoralty was due, in part, by ensuring a majority CHERS RÉSIDENTS DEAR RESIDENTS Viger accède à la mairie de Montréal dans of French-Canadian land owners could vote in the 1833 election: le climat trouble qui précède les rébellions de through his cousins Louis-Joseph Papineau and Denis-Benjamin DU QUARTIER OF NOTRE-DAME-DE- 1837. Les tensions entre Canadiens français et Viger, (both members of the House of Assembly of Lower Canada), NOTRE-DAME-DE-GRÂCE, GRÂCE, Britanniques sont de plus en plus palpables. Les he may have been able to influence the setting of boundaries for the liens de parenté entre le nouveau maire et Louis- wards of the town and reduction of the property qualification for voting C’est avec plaisir que nous vous présentons It is with great pleasure that we present Joseph Papineau, chef de file du mouvement the second issue of our Info-Quartier for to ensure the majority of small owners could vote. -

Heritage Preservation and the Lachine Canal Revitalization Project by Mark London
Heritage Preservation and the Lachine Canal Revitalization Project by Mark London Summary Between 1997 and 2002, the City of Montreal and the Government of Canada invested $ I 00 million to reopen the Lachine Canal to recreational boating and to catalyze the revitalization of the adjacent working-class neighbourhoods, in decline since the canal closed in I 970. The canal's historic infrastructure was largely restored. The design of newly landscaped public spaces focused on helping visitors understand the past of this cradle of Canadian industrialization. However, the rapid response of the private sector's $350 million worth of projects already leads to concern about the impact of real estate development on the privately owned industrial heritage of the area. Sommaire Entre 1997 et 2002, la Ville de Montreal et le gouvernement du Canada ont investi I 00 millions de dollars af,n de rouvrir le canal de Lachine a la navigation de plaisance et de catalyser la revitalisation des quartiers populaires adjacents, en dee/in depuis la fermeture du canal en 1970. L'infrastructure historique du canal a ete en grande partie restauree. L'amenagement des nouveaux espaces publics visait a aider /es visiteurs a comprendre l'histoire de ce berceau de /'industrialisation manufacturiere canadienne. Neanmoins, la rapidite de la reponse du secteur prive - deja des projets d'une valeur de 350 millions de dollars - sou/eve des craintes quant a /'impact du developpement immobilier sur le patrimoine industriel prive de la region. he Lachine Canal Revitalization TProject is one of the largest heritage restoration/waterfront revitalization projects in Canada in recent years.