Irréalisme Et Art Moderne ,
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Paul Gauguin 8 February to 28 June 2015
Media Release Paul Gauguin 8 February to 28 June 2015 With Paul Gauguin (1848-1903), the Fondation Beyeler presents one of the most important and fascinating artists in history. As one of the great European cultural highlights in the year 2015, the exhibition at the Fondation Beyeler brings together over fifty masterpieces by Gauguin from leading international museums and private collections. This is the most dazzling exhibition of masterpieces by this exceptional, groundbreaking French artist that has been held in Switzerland for sixty years; the last major retrospective in neighbouring countries dates back around ten years. Over six years in the making, the show is the most elaborate exhibition project in the Fondation Beyeler’s history. The museum is consequently expecting a record number of visitors. The exhibition features Gauguin’s multifaceted self-portraits as well as the visionary, spiritual paintings from his time in Brittany, but it mainly focuses on the world-famous paintings he created in Tahiti. In them, the artist celebrates his ideal of an unspoilt exotic world, harmoniously combining nature and culture, mysticism and eroticism, dream and reality. In addition to paintings, the exhibition includes a selection of Gauguin’s enigmatic sculptures that evoke the art of the South Seas that had by then already largely vanished. There is no art museum in the world exclusively devoted to Gauguin’s work, so the precious loans come from 13 countries: Switzerland, Germany, France, Spain, Belgium, Great Britain (England and Scotland), -

Paul Gauguin L'aventurier Des Arts
PAUL GAUGUIN L’Aventurier des arts Texte Géraldine PUIREUX lu par Julien ALLOUF translated by Marguerite STORM read by Stephanie MATARD © Éditions Thélème, Paris, 2020 CONTENTS SOMMAIRE 6 6 1848-1903 L’apostrophe du maître de la pose et de la prose 1848-1903 The master of pose and prose salute 1848-1864 Une mythologie familiale fondatrice d’un charisme personnel 1848-1864 Family mythology generating personal charisma 1865-1871 Un jeune marin du bout du monde 1865-1871 A far-flung young sailor 1872-1874 L’agent de change donnant le change en société devient très artiste 1872-1874 The stockbroker becomes a code-broker artist 8 8 1874-1886 Tirer son épingle du jeu avec les Impressionnistes 1874-1886 Playing ball with the Impressionists 1886-1887 Le chef de file de l’École de Pont-Aven 1886-1887 The leader of the Pont-Aven School 1887-1888 L’aventure au Panama et la révélation de la Martinique 1887-1888 Adventure in Panama and a revelation in Martinique 1888-1889 L’atelier du Midi à Arles chez van Gogh : un séjour à pinceaux tirés 1888-1889 Van Gogh’s atelier du Midi in Arles: a stay hammered with paintbrushes 1889-1890 Vivre et s’exposer, avec ou sans étiquette, avec ou sans les autres 1889-1890 Living and exhibiting, with or without label, with or without others 46 46 1891-1892 Un dandy tiré à quatre épingles, itinérant et sauvage 1891-1892 A wild, dressed-to-the-teeth travelling dandy 1893-1894 En peignant la Javanaise : Coup de Jarnac à Concarneau 1893-1894 Painting Javanaise Woman: Jarnac blow in Concarneau 1895 Le retour à Pont-Aven -

Paul Gauguin's Genesis of a Picture: a Painter's Manifesto and Self-Analysis
Dario Gamboni Paul Gauguin's Genesis of a Picture: A Painter's Manifesto and Self-Analysis Nineteenth-Century Art Worldwide 2, no. 3 (Autumn 2003) Citation: Dario Gamboni, “Paul Gauguin's Genesis of a Picture: A Painter's Manifesto and Self- Analysis,” Nineteenth-Century Art Worldwide 2, no. 3 (Autumn 2003), http://www.19thc- artworldwide.org/autumn03/274-paul-gauguins-genesis-of-a-picture-a-painters-manifesto- and-self-analysis. Published by: Association of Historians of Nineteenth-Century Art Notes: This PDF is provided for reference purposes only and may not contain all the functionality or features of the original, online publication. ©2003 Nineteenth-Century Art Worldwide Gamboni: Paul Gauguin‘s Genesis of a Picture: A Painter‘s Manifesto and Self-Analysis Nineteenth-Century Art Worldwide 2, no. 3 (Autumn 2003) Paul Gauguin's Genesis of a Picture: A Painter's Manifesto and Self-Analysis by Dario Gamboni Introduction There is an element of contradiction in the art historian's approach to interpreting the creative process. While artistic creativity is seen as stemming from the psychology of the creator, there is a tendency to deny the artist possession of direct or rational access to its understanding. Both attitudes have their roots in romantic art theory. These attitudes imply, on the one hand, that the artist's psyche is the locus of creation, and, on the other, that intuition and the unconscious play the major roles. Such ideas remained prevalent in the twentieth century, as attested, for example, by the famous talk given in April 1957 by Marcel Duchamp under the title "The Creative Act," which defined the artist as a "mediumistic being."[1] This element of contradiction explains the frequently ambivalent treatment of artists' accounts of their own creation: although we recognize that they possess a privileged and even unique position, we tend to dismiss their explanations as "rationalizations" and to prefer independent material evidence of the genesis of their works, such as studies or traces of earlier stages. -
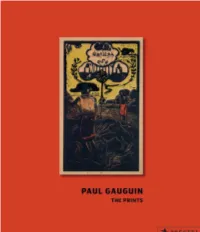
PAUL GAUGUIN the PRINTS PAULGAUGUIN Tobia Bezzola Elizabeth Prelinger THEPRINTS
5243_Gauguin_001-160_ENGLISCH 26.09.12 11:10 Seite 2 PAUUL GAUGUIN THE PRINTS 5243_Gauguin_001-160_ENGLISCH 26.09.12 11:10 Seite 3 PAUL GAUGUIN THE PRINTS PAULGAUGUIN Tobia Bezzola Elizabeth Prelinger THEPRINTS PRESTEL Munich · London · New York 5243_Gauguin_001-160_ENGLISCH 26.09.12 11:10 Seite 4 5243_Gauguin_001-160_ENGLISCH 26.09.12 11:10 Seite 5 Foreword and Thanks 10 Christoph Becker Running Wild as Theme and Method 13 Tobia Bezzola CATALOGUE 18 Elizabeth Prelinger Savage Poetry – The Graphic Art of Paul Gauguin 20 The ‘Suite Volpini’ 29 The Portrait of Stéphane Mallarmé 51 The ‘Noa Noa Suite’ 59 ‘Manao Tupapau’ (She Thinks of the Spirit/The Spirit Thinks of Her) 87 ‘A Fisherman Drinking Beside His Canoe’ (Le Pêcheur buvant auprès de sa pirogue) 91 ‘Oviri’ (Savage) 95 The ‘Vollard Suite’ 103 ‘Le Sourire’ 131 APPENDIX 140 List of Works 143 Bibliography 153 Imprint 157 5243_Gauguin_001-160_ENGLISCH 26.09.12 11:10 Seite 6 5243_Gauguin_001-160_ENGLISCH 26.09.12 11:10 Seite 7 5243_Gauguin_001-160_ENGLISCH 26.09.12 11:10 Seite 8 5243_Gauguin_001-160_ENGLISCH 26.09.12 11:10 Seite 9 5243_Gauguin_001-160_ENGLISCH 26.09.12 11:10 Seite 10 10 Foreword and Thanks Christoph Becker The prints and drawings made by Paul Gauguin (b. June 7, 1848, in Paris; d. May 8, 1903, in Atuona on Hiva Oa, the Marquesas Islands) in the 1880s and 1890s were groundbreaking works of art. Gauguin is to be placed, as a painter, at modernism’s outset; and he became one of the most renowned artists of the era. His works on paper are a crucial element of his art and, more than this, it is impossible to fully understand Paul Gauguin the artist without paying due attention to them. -

ACICS Other Report RNU Draft Exhibits Part 25
6TH Citation Narrative The faculty grievance policy has been revised. This revision has been approved by the Board of Directors on November 4, 2019. 3-1-202(d) The policy was included in the Faculty Handbook (p. 17) and signed Acknowledgement and Receipts from faculty teaching ofcurrent term (fall quadmester) are attached. Acknowledgment and Receipt of Revised (10/16/2019) Faculty Handbook Including Grievance Procedure It is my responsibility to be aware of the contents of the handbook regarding University Policies and Procedures. I further acknowledge my responsibility to attend an Adjunct and Faculty meeting each year of my employment. I understand this receipt will be placed in my personnel file. This signed Acknowledgment form of the University-wide Faculty Handbook is a condition of employment for all RNU faculty. Employee's Signature Employee's Name (Print) Date ~ Reagan National University Faculty Handbook 59 Revised I I /5/20 19 Acknowledgment and Receipt of Revised (10/16/2019) Faculty Handbook Including Grievance Procedure It is my responsibility to be aware of the contents of the handbook regarding University Policies and Procedures. I further acknowledge my responsibility to attend an Adjunct and Faculty meeting each year of my employment. I understand this receipt will be placed in my personnel file. This signed Acknowledgment form of the University-wide Faculty Handbook is a condition of employment for all RNU faculty. Employee's Signature Employee's Name (Print) Reagan National Uni versity Fac ulty Handbook S9 Revised I I /S/20 19 Acknowledgment and Receipt of Revised (10/16/2019) Faculty Handbook Including Grievance Procedure It is my responsibility to be aware of the contents of the handbook regarding University Policies and Procedures. -

The Museum of Modern Art, New York Exhibition Checklist Gauguin: Metamorphoses March 8-June 8, 2014
The Museum of Modern Art, New York Exhibition Checklist Gauguin: Metamorphoses March 8-June 8, 2014 Paul Gauguin, French, 1848–1903 Vase Decorated with Breton Scenes, 1886–1887 Glazed stoneware (thrown by Ernest Chaplet) with gold highlights 11 5/16 x 4 3/4" (28.8 x 12 cm) Royal Museums of Art and History, Brussels Paul Gauguin, French, 1848–1903 Cup Decorated with the Figure of a Bathing Girl, 1887–1888 Glazed stoneware 11 7/16 x 11 7/16" (29 x 29 cm) Dame Jillian Sackler Paul Gauguin, French, 1848–1903 Vase with the Figure of a Girl Bathing Under the Trees, c. 1887–1888 Glazed stoneware with gold highlights 7 1/2 x 5" (19.1 x 12.7 cm) The Kelton Foundation, Los Angeles Paul Gauguin, French, 1848–1903 Leda (Design for a China Plate). Cover illustration for the Volpini Suite, 1889 Zincograph with watercolor and gouache additions on yellow paper Composition: 8 1/16 x 8 1/16" (20.4 x 20.4 cm) Sheet: 11 15/16 x 10 1/4" (30.3 x 26 cm) The Metropolitan Museum of Art, New York. Rogers Fund 03/11/2014 11:44 AM Gauguin: Metamorphoses Page 1 of 43 Gauguin: Metamorphoses Paul Gauguin, French, 1848–1903 Bathers in Brittany from the Volpini Suite, 1889 Zincograph on yellow paper Composition: 9 11/16 x 7 7/8" (24.6 x 20 cm) Sheet: 18 7/8 x 13 3/8" (47.9 x 34 cm) The Metropolitan Museum of Art, New York. Rogers Fund Paul Gauguin, French, 1848–1903 Edward Ancourt, Paris Breton Women Beside a Fence from the Volpini Suite, 1889 Zincograph on yellow paper Composition: 6 9/16 x 8 7/16" (16.7 x 21.4 cm) Sheet: 18 13/16 x 13 3/8" (47.8 x 34 cm) The Metropolitan Museum of Art, New York. -

Paul Gauguin: Monotypes
Paul Gauguin: Monotypes Paul Gauguin: Monotypes BY RICHARD S. FIELD published on the occasion of the exhibition at the Philadelphia Museum of Art March 23 to May 13, 1973 PHILADELPHIA MUSEUM OF ART Cover: Two Marquesans, c. 1902, traced monotype (no. 87) Philadelphia Museum of Art Purchased, Alice Newton Osborn Fund Frontispiece: Parau no Varna, 1894, watercolor monotype (no. 9) Collection Mr. Harold Diamond, New York Copyright 1973 by the Philadelphia Museum of Art Library of Congress Catalog Card Number: 73-77306 Printed in the United States of America by Lebanon Valley Offset Company Designed by Joseph Bourke Del Valle Photographic Credits Roger Chuzeville, Paris, 85, 99, 104; Cliche des Musees Nationaux, Paris, 3, 20, 65-69, 81, 89, 95, 97, 100, 101, 105, 124-128; Druet, 132; Jean Dubout, 57-59; Joseph Klima, Jr., Detroit, 26; Courtesy M. Knoedler & Co., Inc., 18; Koch, Frankfurt-am-Main, 71, 96; Joseph Marchetti, North Hills, Pa., Plate 7; Sydney W. Newbery, London, 62; Routhier, Paris, 13; B. Saltel, Toulouse, 135; Charles Seely, Dedham, 16; Soichi Sunami, New York, 137; Ron Vickers Ltd., Toronto, 39; Courtesy Wildenstein & Co., Inc., 92; A. J. Wyatt, Staff Photographer, Philadelphia Museum of Art, Frontispiece, 9, 11, 60, 87, 106-123. Contents Lenders to the Exhibition 6 Preface 7 Acknowledgments 8 Chronology 10 Introduction 12 The Monotype 13 The Watercolor Transfer Monotypes of 1894 15 The Traced Monotypes of 1899-1903 19 DOCUMENTATION 19 TECHNIQUES 21 GROUPING THE TRACED MONOTYPES 22 A. "Documents Tahiti: 1891-1892-1893" and Other Small Monotypes 24 B. Caricatures 27 C. The Ten Major Monotypes Sent to Vollard 28 D. -

PALETTES Collection January 2013
PALETTES Collection January 2013 > 5 CLASSICAL ART > 6 PALETTES AUTHOR From the canvass itself to the type of brush used by the artist, Alain JAUBERT DIRECTOR from the historical, political or individual context of the painting to Alain JAUBERT the personality of the characters displayed in its features, Palette COPRODUCERS uncovers the endless secrets a work of art can hide. ARTE FRANCE, REUNION DES MUSEES NATIONAUX ET DU GRAND PALAIS DES Using the finest techniques (infrared, X rays, video animation...), Alain Jaubert dissects CHAMPS-ELYSEES, MUSEE DU LOUVRE the paintings to their most intimate levels, leading an investigation worthy of History's - SERVICE CULTUREL - PRODUCTIONS AUDIOVISUELLES, PALETTE PRODUCTION greatest detectives. DVD released by ARTE Video FORMAT AWARDS : 48 x 30 ', 2 x 60 ', 2003 Several awards among which "FIPA d'Argent" for Palettes Véronèse, 1989. AVAILABLE RIGHTS TV - DVD - Non-theatrical rights VERSIONS English - Spanish - German - French TERRITORY(IES) WORLDWIDE LIST OF EPISODES ANDY WARHOL [1928-1987] BACON [1909-1992] BONNARD [1867-1947] CEZANNE [1839-1906] CHARDIN [1699-1779] COURBET [1819-1877] DAME A LA LICORNE (LA) DAVID [1748-1825] DE LA TOUR [1593-1652] DELACROIX [1798-1863] DUCHAMP [1887-1968] EUPHRONIOS [~ 510 BEFORE CHRIST] FAYOUM [~ 117-138 BEFORE CHRIST] FRAGONARD [1732-1806] GAUGUIN [1848 - 1903] GERICAULT [1791-1824] GOYA [1746-1828] INGRES [1780-1867] GRUNEWALD [~ 1475-1528] HOKUSAI [1760-1849] KANDINSKY [1866-1944] KLEIN [1928-1962] LASCAUX LE CARAVAGE [1571-1610] LE LORRAIN [~ 1602-1682] -
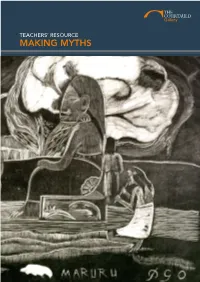
Making Myths Contents
TEACHERS’ RESOURCE MAKING MYTHS CONTENTS 1: MAKING MYTHS: THE STORIES TOLD BY ARTISTS, CURATORS, COLLECTORS AND CONSERVATORS 2: COLLECTING GAUGUIN: CURATOR’S QUESTIONS 3: RE-INVENTING MYTH: FORM AND FUNCTION IN SOME EARLY MODERN ‘MYTHOLOGICAL’ WORKS FROM THE COURTAULD GALLERY 4: MANET, DEGAS, RENOIR AND THE THEATRE OF EVERYDAY LIFE 5: TAKEN AT FACE VALUE? SELF-STAGING AND MYTH-MAKING IN THE WORK OF GAUGUIN AND VAN GOGH 6: THE MATERIAL LANGUAGE OF PAINTINGS: CONSERVATION AND TECHNICAL ART HISTORY 7: REGARDE! FRENCH LANGUAGE RESOURCE: GAUGUIN ET LA POLYNÉSIE 8: GLOSSARY 9: SUGGESTIONS FOR RESEARCH AND PRACTICAL ACTIVITIES IN THE CLASSROOM 10: TEACHING RESOURCE IMAGE CD Compiled and produced by Carolin Levitt and Sarah Green Design by JWDesigns SUGGESTED CURRICULUM LINKS FOR EACH ESSAY ARE MARKED IN RED TERMS REFERRED TO IN THE GLOSSARY ARE MARKED IN BLUE To book a visit to the gallery or to discuss any of the education projects at The Courtauld Gallery please contact: e: [email protected] t: 0207 848 1058 WELCOME The Courtauld Institute of Art runs an exceptional programme of activities suitable for young people, school teachers and members of the public, whatever their age or background. We offer resources which contribute to the understanding, knowledge and enjoyment of art history based upon the world-renowned art collection and the expertise of our students and scholars. I hope the material will prove to be both useful and inspiring. Henrietta Hine Head of Public Programmes The Courtauld Institute of Art This resource offers teachers and their students an opportunity to explore the wealth of The Courtauld Gallery’s permanent collection by expanding on a key idea drawn from our exhibition programme. -

DEATH and the AFTERLIFE: POST-IMPRESSIONISM (Vincent Van Gogh and Paul Gauguin) VINCENT VAN GOGH and PAUL GAUGUIN
DEATH and the AFTERLIFE: POST-IMPRESSIONISM (Vincent Van Gogh and Paul Gauguin) VINCENT VAN GOGH and PAUL GAUGUIN Online Links: MetMuseum - Vincent Van Gogh Power of Art - Van Gogh – YouTube Van Gogh's Sunflowers - Private Life of a Masterpiece Great Artists - Vincent van Gogh - YouTube Van Gogh's Starry Night - Smarthistory (No Video) Van Gogh's Bedroom – Smarthistory Van Gogh's True Palette Revealed - New York Times Gauguin's Jacob Wrestling with the Angel – Smarthistory Gauguin's Spirit of the Dead Watching - Smarthistory (No Video) VINCENT VAN GOGH and PAUL GAUGUIN Online Links: Vincent van Gogh- Wikipedia Paul Gauguin - Wikipedia Gauguin's Nevermore – Smarthistory Gauguin's Last Testament - Vanity Fair Gauguin's Bid for Glory - Smithsonian.com Gauguin's erotic Tahiti idyll exposed as a Sham - The Guardian Works by Paul Gauguin – MOMA The Art of Paul Gauguin – YouTube The Cypress Trees in the Starry Night, a college paper by Jessica Caldarone Vincent van Gogh. Self-Portrait with a Straw Hat, 1887, oil on canvas Vincent van Gogh (1853-1890) the eldest son of a Dutch Reformed minister and a bookseller's daughter, pursued various vocations, including that of an art dealer and clergyman, before deciding to become an artist at the age of twenty-seven. Over the course of his decade- long career (1880–90), he produced nearly 900 paintings and more than 1,100 works on paper. Ironically, in 1890, he modestly assessed his artistic legacy as of "very secondary" importance. Vincent van Gogh. The Sower (after Millet), 1881, pen and wash heightened with green and white Largely self-taught, Van Gogh gained his footing as an artist by zealously copying prints and studying nineteenth-century drawing manuals and lesson books, such as Charles Bargue's Exercises au fusain and cours de dessin. -

Le Parti De L'impressionnisme
Le Parti de l’Impressionnisme AVANT-PROPOS bernard arnault, fondation louis vuitton/lvmh lord browne, the courtauld institute of art PRÉFACE suzanne pagé, fondation louis vuitton ernst vegelin, la courtauld gallery 1. INTRODUCTION: SAMUEL COURTAULD ET SA COLLECTION karen serres 2. L’HISTOIRE DE LA FAMILLE COURTAULD ET SES CONTENTS ENTREPRISES, DE L’ARGENTERIE AU TEXTILE alexandra gerstein 3. LA RÉCEPTION DE L’ART MODERNE FRANCAIS EN ANGLETERRE AVANT SAMUEL COURTAULD barnaby wright 4. PERCY MOORE TURNER ET L’INDEPENDENT GALLERY, LE CONSEILLER LE PLUS PROCHE DE SAMUEL COURTAULD dimitri salmon 5. SEURAT DANS LA COLLECTION PRIVÉE DE SAMUEL COURTAULD: UNE HISTOIRE DES ACHATS sébastien chauffour 6. SAMUEL COURTAULD À LA NATIONAL GALLERY anne robbins 7. SAMUEL COURTAULD, AU-DELÀ DE LA COLLECTION ernst vegelin 8. REGARDS CROISÉS: BRIDGET RILEY, RICHARD SERRA ET JEFF WALL angéline scherf CATALOGUE Honoré Daumier | Édouard Manet | Constantin Guys | Edgar Degas | Camille Pissarro | Claude Monet | Pierre-Auguste Renoir | Alfred Sisley | Eugène Boudin | Paul Cézanne | Paul Gauguin | Georges Seurat | Vincent Van Gogh | Henri (le Douanier) Rousseau | Henri de Toulouse-Lautrec | Auguste Rodin | Édouard Vuillard | Pierre Bonnard | Amedeo Modigliani | Henri Matisse | Pablo Picasso ANNEXES 6 7 PAUL CÉZANNE 1839–1906 8 paul cézanne 44 APPLES, BOTTLE AND CHAIRBACK c. 1904–06 Graphite and watercolour on wove paper, 46.2 x 60.4 cm provenance In his studio in Les Lauves, in the hills north of Aix-en-Provence, Cézanne Purchased by Samuel Courtauld from Wildenstein & Co., produced an important group of still-life watercolours, of which this London, September 1937, for £ 3,500; Courtauld Bequest, drawing is among the most magnificent. -

Gauguin (Masters of Art) by Robert Goldwater, Eugène Henri Paul
Gauguin (Masters Of Art) By Eugène Henri Paul Gauguin, Robert Goldwater Do you enjoy reading or your need a lot of educational materials for your work? These days it has become a lot easier to get books and manuals online as opposed to searching for them in the stores or libraries. At the same time, it should be mentioned that a lot of book sites are far from perfect and they offer only a very limited number of books, which means that you end up wasting your time while searching for them. Here, we are focused on bringing you a large selection of books for download so that you can save your time and effort. If you have visited this website and you are looking to get Gauguin (Masters Of Art) pdf, you have definitely come to the right place. Once you click the link, the download process will start, and you will have the book you need in no more than several minutes. In such a way, you don’t need to do any extensive research to find the needed ebook or handbook, as all the options you may need are right here. Our database that includes txt, DjVu, ePub, PDF formats is carefully organized, which allows you to browse through different choices and select the ones that you need very quickly. Some time ago the only way to get books besides buying them was to go to the libraries, which can be quite a time-consuming experience. Fortunately, you no longer have to set aside any special time when you need a book, as you can download Gauguin (Masters Of Art) By Eugène Henri Paul Gauguin, Robert Goldwater pdf from our website and start reading immediately.