PRO FRIBOURG Novembre 1997 Trimestriel N" 117
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

10 Mars 2016 • 66E Année (N° 3128) Ja 1610 Oron-La-Ville 1.80
VOTRE HEBDOMADAIRE DU JEUDI CHF JOURNAL DU DISTRICT DE LAVAUX-ORON N° 10 DU JEUDI 10 MARS 2016 • 66E ANNÉE (N° 3128) JA 1610 ORON-LA-VILLE 1.80 A côté de la plaque Festival « Hors limites » pour de magnifi ques concerts Il y a des moments comme ça dans la vie où l’on n’est pas dans son assiette, la vie passe à côté de nous et, incrédules, nous ne parvenons pas à prendre le train en marche… Fata- litas ! Dépourvus de nos moyens, ce n’est ni la volonté, ni la force qui manquent, ce n’est que l’absence de cette petite étincelle de départ qui nous fait caler à l’allumage. EDITORIAL ARVID ELLEFSPLASS 24 juin au 3 juillet 2016 Etre à côté de la plaque, dans un sens actif, voudrait dire se tromper, mais pour cela il aura fallu au préa- lable faire un choix et… agir. Se sentir à côté de la plaque, par contre, prend un sens bien plus passif, à savoir, que l’on subit – éberlué – ce qui se passe en constatant que notre réac- tion est absente; un état contemplatif devant l’inat- tendu ou l’ampleur de la chose qui nous tombe des- sus. Que l’on parle d’un simple état grippal person- nel ou de la situation bien plus grave d’un proche, le monde des possibles s’ar- par Colette Ramsauer rête soudain, et nous laisse sur le bord de la route: simple spectateur… La sensibilité de cha- cun dictera l’ampleur du désordre qu’il faudra pour le fi ger, mais assurément, 3 tout le monde a un jour été scotché. -

Groupement Des Commerçants Et Artisans D’Attalens - Gcaa
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE VEVEYSE DIVERS Les membres du 9, ch. des Crêts, Châtel-St-Denis 021 948 64 14 Cabane SDA (Mont Vuarat) 079 654 47 17 GROUPEMENT DES COMMERÇANTS Horaires: Secrétariat 021 948 78 24 ET ARTISANS, ATTALENS mardi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 17 h Piscine Châtel-St-Denis 021 948 81 25 ALIMENTATION ÉLECTRICITÉ IMPRIMERIE mercredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 21 h Ludothèque Papayou 021 947 51 03 Chez Vilma Sàrl 021 947 41 19 Marcel Jacquiard, Realec SA 021 947 45 56 Printways Sàrl, 021 947 55 55 jeudi de 14 h à 17 h (bât. scol. « Les Blés » abris PC) [email protected] M.Cédric Perroud 079 505 93 55 Light Tech SA 021 947 39 02 vendredi de 13 h à 16 h lundi de 15 h 30 à 18 h (sauf vac. scol.) [email protected] [email protected] ARCHITECTE PAYSAGISTE André Aebischer 079 217 56 51 samedi de 8 h 30 à 11 h 30 Groupe Scout de la Veveyse 079 521 28 39 SOAP Sandrine Oppliger Sàrl 021 947 38 38 LOCATION VÉHICULES UTILITAIRES, Vacances scolaires Passepartout Veveyse 021 948 11 22 www.so-ap.ch myLED Sàrl, Cyrille Colliard 021 566 17 51 [email protected] NETTOYAGES ET ENTRETIENS ouvert mercredi de 14 h à 21 h Susyloc.ch S. et N. Gabriel 079 353 80 58 ASSÈCHEMENT [email protected] et samedi matin de 8 h 30 à 11 h 30 Ramassage des ordures ménagères: AMS Assèchement SA ELECTROMÉNAGER lundi de chaque semaine dès 6 h 30 [email protected] 021 903 51 51 Guignard Electromenager 079 370 47 64 MACHINES AGRICOLES TRANSPORTS PUBLICS Lionel Guignard ET ESPACES VERTS ASSURANCES [email protected] Bosson Frères SA, Corcelles TPF gare Châtel-St-Denis 021 948 70 15 Helvetia, Michel Gramont 021 947 40 03 [email protected] 021 947 41 27 Gare de Palézieux 0900 300 300 Déchetterie: au ch. -

Bulletin 2014
1 Bulletin 2014 ATTENTION! A lire en priorité et en respectant les délais: Page 20 : Convocation à l’Assemblée générale du mercredi 14 mai 2014 Afin de faciliter l’organisation de l’AG, nous vous demandons de vous inscrire avant le 1er mai 2014 Page 66 : Paiement de la cotisation annuelle 2014 L’ACCO recherche des bénévoles pour 2015, lire en page 30 CHATEAU d’ORON - MODE D’EMPLOI Distant de 20 km de Lausanne en direction de Fribourg, le château est situé à 2 Oron-le-Châtel. Accès: En voiture: par la RN9, à 10 km de la sortie de Chexbres, par la RN12, à 13 km de la sortie de Vaulruz ou à 10 km de la sortie de Châtel-St-Denis. Parking pour environ 200 voitures. En train: Sur la ligne Lausanne - Berne, gare d’Oron ou gare de Palézieux-Gare et bus jusqu’à Oron-le-Châtel Visites du Château: Du 1er avril au 30 septembre Le samedi (14h, 15h, 16h) et le dimanche (14h, 15h, 16h, 17h) Les groupes peuvent visiter toute l’année à d’autres heures sur rendez-vous préalable auprès des guides. En semaine, à partir de 4 personnes, il est possible de visiter le château. Prendre rendez-vous: Guides: 021 907 90 51, mail [email protected] Intendant: M. Marcel Sunier ([email protected]) 079 776 40 52 Tarifs des visites: a) par personne adulte Fr. 10.– b) étudiants, rentiers AVS Fr. 8.– c) enfants jusqu’à 16 ans Fr. 5.– d) écoles: par enfant ou accompagnant Fr. 5.– e) groupes, jusqu’à 19 personnes: Fr. -

Le Messager La Fondue Olympique Du Tivoli
Vendredi 13 juillet 2012 sports Le Messager 7 GASTRONOMIE CHÂTEL-ST-DENIS COURT TIR DES COMMUNES I CHÂTEL-ST-DENIS ET REMAUFENS Une trentaine de tireurs se sont af - La fondue olympique du Tivoli frontés lors du tir des communes de Châtel-St-Denis et de Remaufens, dis - puté en deux séances les 6 et 13 juin. Marlène Perroud, cheffe au Le classement, un peu particulier, est Tivoli, s’envole aujourd’hui défini de la manière suivante: le clas - même pour Londres et les sement pair se fait à l’addition des JO. Au restaurant de la 10 coups de la passe, alors que le Maison de la Suisse, elle classement impair se fait sur la base du coup profond enregistré sera la responsable de la à 100 points. Le classement général préparation des fondues et est établi par l’addition des deux raclettes. passes. Résultats: 1. Alex Pilloud 192 points (91 + 91); 2. Maurice Ber - algré la non-qualification de thoud 179 points (93 + 86); 3. David MChristophe Grenard en cyclisme Feusi 176 points (89 + 87), et Tilann ou d’Alexandre Curchod au tir à l’arc, le Kehren (90 + 86); 4. Jean-Marie Bro - chef-lieu veveysan sera quand même dard 173 points (83 + 90); 5. Eric Villard représenté cet été aux JO de Londres, 171 points (89 + 82); 6. Valérie Genoud grâce à Marlène Perroud, cheffe cuisi - 170 points (86 + 84); 7. Robert Colliard nière du Tivoli. Son terrain de jeu? Le res - 167 points (83 + 84), Bernard Genoud taurant de la Maison de la Suisse, sur les (83 + 84), Charly Villard (84 + 83); bords de la Tamise, dirigé par Anton 8. -

10.216 Vevey - Jongny - Attalens - Bossonnens État: 7
ANNÉE HORAIRE 2020 10.216 Vevey - Jongny - Attalens - Bossonnens État: 7. Novembre 2019 Lundi–vendredi sauf fêtes générales 16003 16007 16009 16011 16013 16015 16017 16019 Lausanne dép. 5 45 6 42 7 42 8 42 9 42 Montreux dép. 5 48 6 48 7 48 8 48 9 48 Vevey, gare 5 20 6 04 7 04 8 02 9 02 10 02 Vevey, Bergère 5 21 6 05 7 05 8 03 9 03 10 03 Vevey, funiculaire 5 22 6 06 7 06 8 04 9 04 10 04 Corseaux, Délassement 5 23 6 07 7 07 8 05 9 05 10 05 Corsier-Vevey, Cure d'Attalens 5 25 6 09 7 09 8 07 9 07 10 07 Corsier-sur-Vevey, Châtillon 5 28 6 12 7 12 8 10 9 10 10 10 Chardonne 5 29 6 14 7 14 8 11 9 11 10 11 Jongny, village 5 31 6 16 7 16 8 13 9 13 10 13 Jongny, Reposoir 5 32 6 17 7 17 8 14 9 14 10 14 Jongny, Combette 5 33 6 18 7 18 8 15 9 15 10 15 Monts-de-Corsier, La Chaux 5 35 6 20 7 20 8 17 9 17 10 17 Monts-de-Corsier, La Chaux 5 35 6 00 6 21 7 00 7 21 8 17 9 17 10 17 Jongny, Chaudette 5 37 6 02 6 23 7 02 7 23 8 19 9 19 10 19 Attalens, Perrey 5 38 6 03 6 24 7 03 7 24 8 20 9 20 10 20 Attalens, La Fin 5 40 6 05 6 26 7 05 7 26 8 22 9 22 10 22 Attalens, village 5 41 6 06 6 27 7 06 7 27 8 23 9 23 10 23 Attalens, Corcelles 5 42 6 07 6 28 7 07 7 28 8 24 9 24 10 24 Attalens, Fin du Clos 5 43 6 08 6 29 7 08 7 29 8 25 9 25 10 25 Bossonnens, village 5 44 6 10 6 31 7 10 7 31 8 26 9 26 10 26 Bossonnens, gare 5 46 6 12 6 33 7 12 7 33 8 28 9 28 10 28 Bulle arr. -

Communes De La Glâne
Communes de la Glâne Commune Nom du restaurant Adresse Code postal N° de tél. Service proposé Plats à l'emporter sur réservation Le Châtelard Café du Lion d'Or Route de Grangettes 3-1689 1689 Le Châtelard 026 651 76 54 De 11h30 à 12h15 / de 18h30 à 19h15 Massonnens L'Auberge de l'Union "Chez Betty" Au village 2 1692 Massonnnens 026 653 11 56 Plats à l'emporter 026 565 29 69 Plats à l'emporter tous les midis Romont Hôtel-Restaurant de la Belle Croix Route d'Arrufens 2 1680 Romont 078 974 74 00 du lundi au vendredi de 12:00 à 13:30 Plats à l'emporter Romont Pizzeria La Perrausa Route d'Arrufens 36 1680 Romont 026 652 00 62 fermé le le dimache et lundi soir Romont Auberge du Lion d'Or - Restaurant Shalimar Grand-Rue 38 1680 Romont 026 652 22 96 Plats à l'emporter Romont Restaurant le Pinnochio Rue de l'Eglise 92 1680 Romont 026 652 82 09 Plats à l'emporter Romont Café-Restaurant de la Poularde Route de Fribourg 28 1680 Romont 026 652 27 21 Plats à l'emporter Romont China House Rue de l'eglise 84 1680 Romont 026 652 22 09 Plats à l'emporter Romont Restaurant de la Couronne Place Saint-Jacques 59 1680 Romont 026 652 20 98 Plats à l'emporter Romont Café du Buffet de la Gare Route de la Gare 1 1680 Romont 026 651 76 63 Plats à l'emporter Romont Mega-Pizza Grand-Rue 21/25 1680 Romont 026 558 84 10 Plats à l'emporter et livraison Romont Grill Pizza La Casa Grand-Rue 16 1680 Romont 026 652 80 45 Plats à l'emporter Romont Pizzaphone Romont Rue de l'Eglise 77 1680 Romont 026 652 82 82 Plats à l'emporter et livraison Romont Café des remparts Grand-Rue -
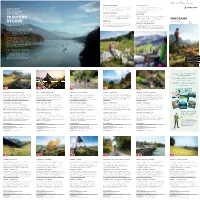
FACE TEXTES.Indd
LA GRUYÈRE SCHWARZSEE ROMONT LES PACCOTS FRIBOURG ESTAVAYER-LE-LAC MURTEN/MORAT RANDONNÉES EN FAMILLE GITES ET BUVETTES Fribourg Région regorge d’aventures et de divertissements originaux Les chalets d’alpages ornent les Préalpes fribourgeoises et se pour petits et grands. Frissonner de plaisir en tyrolienne ou respirer caractérisent par une activité agricole bien vivante. Certains proposent BIENVENUE profondément la tête dans les nuages, tout est possible, la nature est d’assister à la fabrication du Gruyère AOP, d’autres o rent le gîte, à portée de main. www.fribourgregion.ch/famille un grand nombre permettent de goûter aux spécialités du terroir. WILLKOMMEN www.fribourgregion.ch/gites FAMILIENWANDERUNGEN BERGHÜTTEN WELCOME In der Region Freiburg warten viele spannende Abenteuer und originelle Aktivitäten auf Klein und Gross. Adrenalingeladene Action auf einer In den Alp-Chalets der Freiburger Voralpen werden landwirtschaftliche Seilrutsche oder einfach mal tief durchatmen und neue Kraft schöpfen Traditionen gelebt. Einige bieten Besuchern die Möglichkeit, FRIBOURG – in der Natur ist alles möglich. www.fribourgregion.ch/familie bei der Herstellung von Le Gruyère AOP mitzuhelfen, andere haben Gästezimmer und in vielen kann man regionale Spezialitäten PANORAMA REGION FAMILY WALKS verkosten. www.fribourgregion.ch/alphuetten CARTE / KARTE / MAP Fribourg Region is full of adventures and unusual entertainments ALPINE HUTS AND RESTAURANTS for young and old alike. Anything is possible, from the thrill of a zip line En randonnée à pied, en VTT ou à vélo dans les to taking a deep breath with your head in the clouds, all with nature Alpine chalets are dotted all over the Fribourg Pre-Alps and refl ect paysages de Fribourg Région, l’instant présent at your fi ngertips. -

Décembre 2010 362
DÉCEMBRE 2010 362 EXPOSE DES MOTIFS ET PROJET DE DECRET sur la fusion des communes de Bussigny-sur-Oron, Châtillens, Chesalles-sur-Oron, Ecoteaux, Les Tavernes, Les Thioleyres, Oron-la-Ville, Oron-le-Châtel, Palézieux et Vuibroye 1 PREAMBULE Les dix communes de Bussigny-sur-Oron, Châtillens, Chesalles-sur-Oron, Ecoteaux, Les Tavernes, Les Thioleyres, Oron-la-Ville, Oron-le-Châtel, Palézieux et Vuibroye ont décidé de ne former, à partir du 1 erjanvier 2012, plus qu’une seule et unique commune portant le nom de Oron. 2 QUELQUES CHIFFRES 3 BREF HISTORIQUE Sources : Armorial des communes vaudoises, Lausanne, 1972. Les communes vaudoises et leurs armoiries, Chapelle-sur-Moudon, 1995. Sites internet des communes de la région d’Oron. La plus ancienne mention connue du village date de 1433, sous la forme proche de Bussignye. Bussigny-sur-Oron fit autrefois partie de la seigneurie d’Oron avant d’être intégré, en 1557, au bailliage bernois du même nom. Avant la réforme, ses habitants étaient paroissiens de Saint-Martin (Fribourg). Puis, ils furent rattachés à la paroisse protestante d’Oron-Châtillens. Une tentative d’exploitation de filons de charbon et de schiste charbonneux fut menée sans grand succès entre 1918 et 1920. Le village de Châtillens est très ancien. Il appartenait primitivement à l'abbaye de Saint-Maurice, qui au 12ème siècle en céda le tiers au couvent de Hautcrêt. Ce couvent de l'ordre de Cîteaux, fondé en 1134, sur le territoire des Tavernes, recevra en 1154 toute la terre de Châtillens, donation confirmée par Amédée évêque de Lausanne. Dès lors, l'église sera desservie par les religieux de l'abbaye de Notre-Dame à Hautcrêt. -
Les Paccots Châtel-St-Denis Et La Région Informations Touristiques Touristische Informationen Tourist Information
LES PACCOTS HAUTE BASSE HIVER CHÂTEL-ST-DENIS VEVEYSE VEVEYSE 2018 - 2019 LES PACCOTS CHÂTEL-ST-DENIS ET LA RÉGION INFORMATIONS TOURISTIQUES TOURISTISCHE INFORMATIONEN TOURIST INFORMATION Jamais la montagne n’a été si près Zwei Schritte ins Glück Two steps to happiness www.les-paccots.ch 2 Les Paccots et la Région Jamais la montagne n’a été si près Un havre de paix et un bain de nature et de traditions à portée de main. Découvrez dans cette brochure les activités hivernales à pratiquer en famille, entre amis ou individuellement! De nombreuses animations et manifestations ainsi que notre gastronomie chaleureuse contribueront à rendre votre séjour agréable. Nous nous réjouissons de vous renseigner et de vous accueillir. Les Paccots und Region Zwei Schritte ins Glück Hier leben Natur und Traditionen nebeneinander. Mit diesem Prospekt präsentieren wir Ihnen unsere Winter-Aktivitäten. Haben Sie Spass, sei es mit der Familie, mit Freunden oder alleine! Kulturelle und sportliche Veranstaltun- gen sowie unsere herzliche Küche werden zum Erfolg Ihres Aufenthaltes beitragen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Les Paccots and Region Two steps to happiness A haven of peace, a dose of nature and tradition close at hand. Discover in this brochure our various winter activities to enjoy with your family, your20130905_annonceLS_depliantRegionChatel.pdf friends or alone! Many fun, cultural or sports1 9/5/2013 activities 9:21:45 and AM events, as well as our typical food will make your stay exciting! We are looking forward to helping and welcoming you. C M J CM Laurastar est la référence et le leader mondial en MJ matière de systèmes de repassage innovants et de haute CJ qualité. -
Themakart SFSO Cartography Competence Centre Products and Services
00 Basic statistical data and overviews 1588-1500 ThemaKart SFSO cartography competence centre Products and services Neuchâtel 2015 ThemaKart Today maps are a key element of publications as part of the statistical information mandate of the Swiss Confederation. They are used in general and special-topic publications, in press- releases in the Swiss Statistics portal and in atlases to address a wide range of statistical questions associated with topology and geography. Complex statistical matter is visually depicted so that it is clear and understandable for a wide audience. Under the name of ThemaKart, the SFSO has maintained a compe- tence centre for cartographic services and information within the Office and for its clients since 1989. What we offer: Consultation and training with regard to spatial visualisation, particularly statistical maps and atlases. Production of statistical atlases Provision of individual thematic maps and cartographic applications in all media Management of the FSO regional database Provision of interactive regional and country portraits Training of junior staff in geomatics, specialising in cartography ThemaKart is part of the Dissemination and Publications Section, Resources and International Affairs Division. Individual maps Print Long-lasting, high resolution thematic maps for all print publications and PDF publications. They summarise the most important spatial statistical findings about the population, society, government, eco- nomy and environment. Most topics are shown at commune, district and canton -

Bulletin D'informations 2020-2021
Etablissement primaire et secondaire de Corsier-sur-Vevey et environs Bulletin d’informations 2020- 2021 Ecoles de Corsier, Corseaux, Chardonne et Jongny TABLE DES MATIÈRES Abréviations .................................................................................................................. 27 Accidents survenant à des élèves ................................................................................. 26 Activités diverses .......................................................................................................... 19 APE ............................................................................................................................... 11 Arrivées tardives ........................................................................................................... 15 Aide et soutien aux devoirs (ASD) ................................................................................ 17 Bibliothèques scolaires.................................................................................................. 11 Cahier de communication et agenda de l’élève ............................................................ 15 Camps, activités hors-cadre et voyages d’étude ........................................................... 14 Cérémonie des promotions 11S .................................................................................... 14 Conciergerie des bâtiments scolaires ........................................................................... 11 Conseil d’Etablissement ............................................................................................... -

Ppe Le Tilleul Remaufens – Fr
2798 _VERSION ONLINE SUR LA PLATEFORME WWW.ARCHITECTES.CH PPE LE TILLEUL REMAUFENS – FR MAÎTRE D’OUVRAGE PPE Le Tilleul Famille Mossier ENTREPRISE GÉNÉRALE Coquoz Constructions SA Route de l’Industrie 6 1615 Bossonnens CHEFS DE PROJET Dominique Savoy Paolo Fabbiani ARCHITECTES Abadia SA L. Marciquet et K. Maovene Grand-Rue 96 1627 Vaulruz COLLABORATEUR Didier Charrière INGÉNIEURS CIVILS Bosson ingénieurs-conseils SA Route du Poyet 5 1680 Romont FR BUREAUX TECHNIQUES CVS A. Rosselet SA Route des Artisans 50 1618 Châtel-St-Denis IMMEUBLES DE LOGEMENTS ÉLECTRICITÉ Millasson Electricité SA MESA HISTORIQUE / SITUATION > À l’extrême Sud du can- trouvent qu’à quelques minutes en voiture et les sites de Route de Châtel 136 ton de Fribourg, au centre du village de Remaufens, loisirs comme les pistes de ski des Paccots sont proches. 1609 St-Martin FR l’ensemble PPE le Tilleul a vu le jour sur un terrain alors Le Maître d’ouvrage, PPE le Tilleul, famille Mossier, a man- GÉOTECHNIQUE occupé par un tilleul centenaire qui sera replanté après daté en 2015 les architectes d’Abadia SA et l’Entreprise ABA-GEOL SA travaux. Situé dans le district de la Veveyse, Remaufens Générale Coquoz Constructions SA pour la réalisation route du Grand-Pré 26 se glisse entre les communes fribourgeoises de Châ- de deux immeubles de logements sur un terrain de 5 095 1700 Fribourg tel-Saint-Denis, Semsales et Attalens et les communes mètres carrés. Commencés en 2017, les travaux se sont vaudoises d’Ecoteaux, Maracon et les Monts-de-Corsier. terminés en 2018. GÉOMÈTRE Geosud SA Veveyse Jouissant d’une situation confortable puisque les villes avenue de la Gare 40 comme Vevey, Lausanne ou Fribourg peuvent être jointes PROGRAMME > Selon les souhaits du Maître d’ouvrage, 1618 Châtel-St-Denis en dix, vingt ou trente minutes par l’autoroute, la com- les bâtiments se devaient de sortir de l’ordinaire, tout en mune de Remaufens, desservie aussi par les chemins étant modernes et fonctionnels.