I – Les Relations Extérieures Du Canada Hélène Galarneau
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Canada's Continuing Support of US Linkage Regulations For
Marquette Intellectual Property Law Review Volume 15 | Issue 1 Article 1 I'm Still Your Baby: Canada's Continuing Support of U.S. Linkage Regulations for Pharmaceuticals Ron A. Bouchard University of Manitoba, Canada Follow this and additional works at: http://scholarship.law.marquette.edu/iplr Part of the Intellectual Property Commons Repository Citation Ron A. Bouchard, I'm Still Your Baby: Canada's Continuing Support of U.S. Linkage Regulations for Pharmaceuticals, 15 Intellectual Property L. Rev. 71 (2011). Available at: http://scholarship.law.marquette.edu/iplr/vol15/iss1/1 This Article is brought to you for free and open access by the Journals at Marquette Law Scholarly Commons. It has been accepted for inclusion in Marquette Intellectual Property Law Review by an authorized administrator of Marquette Law Scholarly Commons. For more information, please contact [email protected]. I’M STILL YOUR BABY: CANADA’S CONTINUING SUPPORT OF U.S. LINKAGE REGULATIONS FOR PHARMACEUTICALS RON A. BOUCHARD∗ ABSTRACT ...................................................................................................... 72 INTRODUCTION ............................................................................................. 73 I. REVIEW OF EMPIRICAL STUDIES............................................................ 77 A. Study 1 ........................................................................................... 77 B. Study 2 ............................................................................................ 83 C. Study -
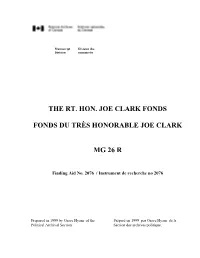
Complete Fa.Wpd
Manuscript Division des Division manuscrits THE RT. HON. JOE CLARK FONDS FONDS DU TRÈS HONORABLE JOE CLARK MG 26 R Finding Aid No. 2076 / Instrument de recherche no 2076 Prepared in 1999 by Grace Hyam of the Préparé en 1999 par Grace Hyam de la Political Archival Section. Section des archives politique. Table of Contents File lists, by series and sub-series: Pages R 1 MEMBER OF PARLIAMENT SERIES R 1-1 Member of Parliament, 1972-1976, Correspondence Sub-series .......... 1-22 R 1-2 Member of Parliament, 1972-1976, Subject files Sub-series ............ 23-45 R 1-3 Member of Parliament, 1983-1984, Sub-series ....................... 46-51 R 2 LEADER OF THE OPPOSITION, 1976-1979, SERIES R 2-1 Correspondence Sub-series ............................... 52-264 R 2-2 Subject Files Sub-series................................. 265-282 R 2-3 Staff - Jim Hawkes Sub-series............................ 283-294 R 2-4 Joe Clark Personal Sub-series ............................ 295-296 R 2-5 Staff - Ian Green Sub-series.............................. 297-301 R 2-6 Staff - Bill Neville Sub-series ............................ 302-304 R 3 PRIME MINISTER’S OFFICE SERIES R 3-1 PMO Correspondence Sub-series ......................... 305-321 R 3-2 PMO Correspondence - Indexes Sub-series ................. 322-323 R 3-3 PMO Subject files Sub-series ............................ 324-331 R 3-4 PMO Staff - Lorne Fox Sub-series ........................ 332-335 R 3-5 PMO Staff - Adèle Desjardins Sub-series................... 336-338 R 3-6 PMO Staff - Marjory LeBreton Sub-series .................. 339-341 R 3-7 PMO Communications Sub-series......................... 342-348 R 4 LEADER OF THE OPPOSITION, 1980-1983, SERIES R 4-1 Correspondence Sub-series ............................. -

Alberta Hansard
Province of Alberta The 28th Legislature First Session Alberta Hansard Tuesday afternoon, October 23, 2012 Issue 7 The Honourable Gene Zwozdesky, Speaker Legislative Assembly of Alberta The 28th Legislature First Session Zwozdesky, Hon. Gene, Edmonton-Mill Creek (PC), Speaker Rogers, George, Leduc-Beaumont (PC), Deputy Speaker and Chair of Committees Jablonski, Mary Anne, Red Deer-North (PC), Deputy Chair of Committees Allen, Mike, Fort McMurray-Wood Buffalo (PC) Khan, Hon. Stephen, St. Albert (PC) Amery, Moe, Calgary-East (PC) Klimchuk, Hon. Heather, Edmonton-Glenora (PC) Anderson, Rob, Airdrie (W), Kubinec, Maureen, Barrhead-Morinville-Westlock (PC) Official Opposition House Leader Lemke, Ken, Stony Plain (PC) Anglin, Joe, Rimbey-Rocky Mountain House-Sundre (W) Leskiw, Genia, Bonnyville-Cold Lake (PC) Barnes, Drew, Cypress-Medicine Hat (W) Luan, Jason, Calgary-Hawkwood (PC) Bhardwaj, Naresh, Edmonton-Ellerslie (PC) Lukaszuk, Hon. Thomas A., Edmonton-Castle Downs (PC) Bhullar, Hon. Manmeet Singh, Calgary-Greenway (PC) Mason, Brian, Edmonton-Highlands-Norwood (ND), Bikman, Gary, Cardston-Taber-Warner (W) Leader of the New Democrat Opposition Bilous, Deron, Edmonton-Beverly-Clareview (ND) McAllister, Bruce, Chestermere-Rocky View (W), Blakeman, Laurie, Edmonton-Centre (AL), Official Opposition Deputy Whip Liberal Opposition House Leader McDonald, Everett, Grande Prairie-Smoky (PC) Brown, Dr. Neil, QC, Calgary-Mackay-Nose Hill (PC) McIver, Hon. Ric, Calgary-Hays (PC), Calahasen, Pearl, Lesser Slave Lake (PC) Deputy Government House Leader Campbell, Hon. Robin, West Yellowhead (PC), McQueen, Hon. Diana, Drayton Valley-Devon (PC) Deputy Government House Leader Notley, Rachel, Edmonton-Strathcona (ND), Cao, Wayne C.N., Calgary-Fort (PC) New Democrat Opposition House Leader Casey, Ron, Banff-Cochrane (PC) Oberle, Hon. -

The Constitution
fC u C3 Speaking for Canadians The Constitution ~,?';)C The NDP-Lberal rejection of the Crosbie 'There are times when a govemment pro- 'XD, budget made way for the return of disastrous poses to act against the essential interest of C ' 1-Lberal economic policies, and eliminated the the Nation. At such a time, the role of the opportunity to implement Progressive Conser- Opposition Leader is not to submit to the vative initiatives which would have restored govemment, but to fight for the larger confidence in the Canadian economy and interests of Canada. II helped get this country back to work. Rt. Hon. Joe Clark October 2, 1980 'It was a nonsense motion, but it served the Grits. They regained power, brought high interest rates, high taxes and a recession, along with soaring energy prices and a budget that (NDP'er) Rae himself despises. II Charles Lynch, Southam March 3, 1982 As a result of the "nonsense motion", Cana- dians' needs were ignored and the PC Plan was shelved. • an economic strategy which encouraged Canadians to invest in Canada. • mortgage interest and property tax credits. • the Small BU$inessDevelopment Bond. • the energy tax credit for low-income workers. • freedom of information legislation. • much-needed parliamentary reform. "Clark has played a role of historic What the Liberals have given you: importance. When the constitutional • a high interest rate policy, resulting in package was unveiled in October, 1980, record-high mortgage rates and depression- after the failure of the September federal/ level unemployment. provincial conference to produce agree- ment, Clark had a very brief period in which • a national energy policy which contributed directly to the collapse of the Alsands, Cold Lake and Alaska Pipeline megaproJects. -

Ties the Knot for the First Time
Lubicon's Olympic Boycott Cartoon centre of controversy By Lesley Crossingham Indians along the torch route should they attempt CALGARY - A city to put up a blockade." committee chairman has Bear Robe adds that accused the Calgary Herald according to a recent arti- of inciting violence against cle by Ombudsman Jim the Lubicon Lake band and Scott, the Herald had any Indian person attempt- admitted that Lubicon ing to blockade the Olym- Lake Chief Bernard Omi- pic torch relay. niyak had never made a Andrew Bear Robe, a direct threat to blockade Blackfoot band member, the Olympic torch relay but and chairman of the city's was merely responding to a Native Urban Affairs question posed by reporters. Committee charges that "Therefore Mr. Rode - the Herald's depiction of walt's cartoon went far Indian people in editorial beyond the circumstantial cartoons are "morally facts and is in very poor reprehensible, slanted, and taste." stereotypical." In future, "Mr. Rodewalt In a letter to Herald pub- should stick to the reported lisher, J. Patrick O'Cal facts and not blow his edi- DRAMATIC VISION laghan, a copy of which has torial fictions out of accep- been obtained by Winds - table proportions," adds "Visions," was the title of a live theatrical play by dmonton, April 24. The peaker, Bear Robe corn - Bear Robe. Windspeaker camera was there to capture this image of actress, Rhonda C nel. plains that a cartoon drawn The letter was read at the - Photo by Jerome Bear by Vance Rodewalt, pub- regularly scheduled Native lished March 15, "goes Urban Affairs committee / beyond public decency, meeting April 16 and political impartiality and received unanimous sup- objective comment." port. -

History of the Business Development Bank of Canada
History of the Business Development Bank of Canada The FBDB period (1975-1995) Donald Layne For the men and women who worked and work at Canada’s business development bank, FBDB and BDC Bibliothèque et Archives nationales du Québec and Library and Archives Canada Title: History of the Business Development Bank of Canada: The FBDB period (1975-1995) Issued also in French under title: Histoire de la Banque de développement du Canada : La période BFD (1975-1995) ISBN 978-0-9953184-4-1 Published by the Business Development Bank of Canada (BDC). All rights reserved. Printed in Canada. Also available in electronic format. In the event of any discrepancies between the English and French versions, the English version shall prevail. Legal deposit – Library and Archives Canada, 2016 Cover picture: Stock Exchange Tower, Montreal. BDC’s Head Office was located here from 1969 to 1997. Table of Contents Preface 06 Chapter 1 The genesis 09 Chapter 2 Creating FBDB 15 Chapter 3 Early days at FBDB 23 Chapter 4 On the eve of the great recession 40 Chapter 5 Cost recovery Part I 45 Chapter 6 SBFR & a new mandate for FBDB 58 Chapter 7 Cost recovery Part II 71 Chapter 8 Rock bottom 82 Chapter 9 Rebuilding 94 Chapter 10 Working with government 114 Chapter 11 Treasury ops 126 Chapter 12 Shocks to the system 138 Chapter 13 Another recession 149 Chapter 14 Information technology @ FBDB/BDC 169 Chapter 15 Start of a new era 190 Chapter 16 The BDC act 207 Chapter 17 Mandate change begets culture change 215 Appendix 1 Members of the boards of directors 234 Appendix 2 Contributors 236 6 Preface This book provides a history of the Business Development Bank of Canada during the period 1975 to 1995. -
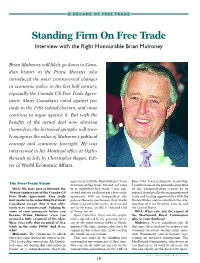
Standing Firm on Free Trade Interview with the Right Honourable Brian Mulroney
A DECADE OF FREE TRADE Standing Firm On Free Trade Interview with the Right Honourable Brian Mulroney Brian Mulroney will likely go down in Cana- dian history as the Prime Minister who introduced the most controversial changes in economic policy in the last half century, especially the Canada-US Free Trade Agree- ment. Many Canadians voted against free trade in the 1988 federal election, and some continue to argue against it. But with the benefits of the actual deal now showing themselves, the historical epitaphs will sure- ly recognise the value of Mulroney’s political courage and economic foresight. He was interviewed in his Montreal office at Ogilvy Renault in July by Christopher Ragan, Edi- tor of World Economic Affairs. agreement with the United States. I was June 1983. I was seeking the leadership. The Free-Trade Vision in favour of free trade, but not, as I refer I said that one of the principle objectives WEA: We have just celebrated the to it, unfettered free trade. I was con- of my administration would be to 10-year anniversary of the Canada-US cerned that we could not get a free-trade expand dramatically the management of Free Trade Agreement. Free trade agreement with an independent dis- trade and trading opportunities with the now seems to be something that most pute-settlement mechanism that would United States and to refurbish the rela- Canadians accept. But it was obvi- allow us to even the scales. As it turned tionship of trust between Canada and ously very controversial. Judging by out in the event, we did. -
![LEGISLATIVE ASSEMBLY of ALBERTA [The House Met at 2:30 P.M.] PRAYERS [Mr. Speaker in the Chair] Head: PRESENTING PETITIONS MR. P](https://docslib.b-cdn.net/cover/5639/legislative-assembly-of-alberta-the-house-met-at-2-30-p-m-prayers-mr-speaker-in-the-chair-head-presenting-petitions-mr-p-3895639.webp)
LEGISLATIVE ASSEMBLY of ALBERTA [The House Met at 2:30 P.M.] PRAYERS [Mr. Speaker in the Chair] Head: PRESENTING PETITIONS MR. P
April 15, 1985 ALBERTA HANSARD 361 LEGISLATIVE ASSEMBLY OF ALBERTA [Leave granted; Bill 33 read a first time] Bill 23 Title: Monday, April 15, 1985 2:30 p.m. Industrial Wages Security Amendment Act, 1985 [The House met at 2:30 p.m.] MR. KOWALSKI: Mr. Speaker. I request leave to introduce Bill 23, the Industrial Wages Security Amendment Act, 1985. PRAYERS The purpose of this Bill is to remove the requirement for employers in the coal mining industry to post security pursuant to this Act. However, the provisions of the Employ• [Mr. Speaker in the Chair] ment Standards Act will continue to apply to coal mining. The Bill provides for flexibility in establishing the amount of security required to be posted by an employer in a head: PRESENTING PETITIONS designated industry, based on each individual company's circumstances. Finally, the Bill streamlines and simplifies MR. PAPROSKI: Mr. Speaker, I am pleased to present to administration procedures. this Assembly a petition sponsored by the Society for the Retired and Semi-Retired, signed by 1,374 citizens of the [Leave granted; Bill 23 read a first time] province of Alberta. The essence of this petition is to urge the government to amend the Individual's Rights Protection MR. CRAWFORD: Mr. Speaker. I move that Bills 22 and Act by changing the definition of the protected age, which 23 be placed on the Order Paper under Government Bills is now 45 to 64 years inclusive, to age 18 and over. and Orders. [Motion carried] head: INTRODUCTION OF BILLS Bill 22 head: TABLING RETURNS AND REPORTS Employment Standards Amendment Act, 1985 MR. -

Download The
THE STATIST IMPULSE THE CASE OF PETRO-CANADA by BRIAN J. LAWSON B.A. (Hons.), Queen's University, 1977 A. THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF . MASTER OF ARTS in THE DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE We -accept this,thesis as conforming to the required standard THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA 1981 © Brian J. Lawson, 1981 In presenting this thesis in partial fulfilment of the requirements for an advanced degree at the University of British Columbia, I agree that the Library shall make it freely available for reference and study. I further agree that permission for extensive copying of this thesis for scholarly purposes may be granted by the head of my department or by his or her representatives. It is understood that copying or publication of this thesis for financial gain shall not be allowed without my written permission. Department of The University of British Columbia 2075 Wesbrook Place Vancouver, Canada V6T 1W5 Date DE-6 (2/79) i Abstract The Statist Impulse: The Case of Petro-Canada seeks to find cause for the establishment and phenomenal growth of Canada's National Petroleum Corporation. The study argues that Petro-Canada is part and parcel of an historically constituted statist dynamic common to all advanced capitalist countries. Utilizing Marxist theory, the thesis contends that statism sen ves to resolve the problems or failures of capitalist economies, and is an essential prerequisite for the growth of capital. Such was the case with Petro-Canada. The international oil crisis of the early seventies, which resulted in so much economic disorder and concern about future energy security, caused governments to increasingly turn to state enterprise, in the hope of filling their national petroleum needs. -

Archived Content Contenu Archivé
ARCHIVED - Archiving Content ARCHIVÉE - Contenu archivé Archived Content Contenu archivé Information identified as archived is provided for L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée reference, research or recordkeeping purposes. It est fournie à des fins de référence, de recherche is not subject to the Government of Canada Web ou de tenue de documents. Elle n’est pas Standards and has not been altered or updated assujettie aux normes Web du gouvernement du since it was archived. Please contact us to request Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour a format other than those available. depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous. This document is archival in nature and is intended Le présent document a une valeur archivistique et for those who wish to consult archival documents fait partie des documents d’archives rendus made available from the collection of Public Safety disponibles par Sécurité publique Canada à ceux Canada. qui souhaitent consulter ces documents issus de sa collection. Some of these documents are available in only one official language. Translation, to be provided Certains de ces documents ne sont disponibles by Public Safety Canada, is available upon que dans une langue officielle. Sécurité publique request. Canada fournira une traduction sur demande. I NO. 70 l ederal Députés Members fédéraux I of avec des Parliament installations I with du I C.S.C. S.C.C. Facilities I HV 9507 F45 1981 July 1981 L I ^ Correctional Service Service correctionnel -

Download Download
Pat Carney and the Dismantling of the National Energy Program TammyNemeth* ABSTRACT: The Progressive Conservative energy policy initiative of 1984-1985 represented a distinct change not only in how policy was formulated but also in the party's vision of Canada. The Tories endeavoured to decentralize government, encourage cooperative federal-provincial relations, and develop an energy policy outside the bureaucracy through consultation with the oil industry. Patricia Carney played a vital role first as opposition energy critic and then as minister of Energy, Mines and Resources. She emphasized consultation and cooperation with industry and the provinces and accepted most of their input uncritically. These developments are explored through an examination of the policy-making process developed by the Conservatives in opposition, and then put into practice after they took power in 1984. Tuesday, 4 September 1984 ushered in a dramatic change in Canadian politics when the Progressive Conservative party (or pcs), headed by Brian Mulroney, won an overwhelming majority in the federal election. The pcs captured 211 seats out of a possible 282 with 58 of those seats located in Western Canada.1 Although the pcs did not make energy the focus of the 1984 election campaign, energy policy was certainly a priority before, during and after the election. While in opposition from 1980 to 1984 most of the strong and consistent Conservative support was from Western Canada, representing 52 out ofthe total 101 pc seats. Western Canadians believed that the Liberal party's National Energy Program (nep) discriminated against them, and the oil and gas industry viewed the nep as an unnecessary government intrusion into their business: both interests wanted the nep dismantled.2 After Mulroney was elected as leader of the opposition in the spring of 1983, he appointed Patricia (Pat) Carney as opposition Past Imperfect. -

Yukon Chronology 1897-1999
THE YUKON'S CONSTITUTIONAL FOUNDATIONS VOLUME 1 THE YUKON CHRONOLOGY (1897 - 1999) The Yukon Chronology (Second Edition) Copyright ©Steven Smyth, 1991, 1999 ALL RIGHTS RESERVED ISBN 0-9698723-1-3 Printed in Canada Published by Clairedge Press Whitehorse, Yukon 1999 © ALL RIGHTS RESERVED Cover design and artwork Douglas Bell and Mary Prudden DEDICATION To my parents, Ronald and Evelyn Smyth, without whom this book would not be possible. Steven Smytll Contents Forward Patrick L. Michael, Clerk of the Yukon v. Legislative Assembly Preface vi. Introd uction Steven Smyth 1. Code 3. Prelude 4. Chronology 5. Selected Bibliography 278. The Author: Biographical Note 281. v FORWARD It was my privilege, in 1991, to pen the foreword to the two-volume set of the Tile Yukon's Constih,tional Foundations. I said of the set "There is little doubt that it will stand as an essential reference source for anyone with an interest in the Yukon's constitution al past, present, or future." And it has. A wide variety of people from both inside and outside the Yukon, including scholars, politicians, students, history buffs and reporters, have sought and found the information they were looking for in this work. Steven Smyth has now done us the additional service of updating and revising his Yukon CllronologJJ which was first published as Volume 1 of TlIJ! Yukon's Constitutional Foundations. The corrections and additions to the original chronology are, of course, encouraged and appreciated. The greatest commendation, however, is reserved for the effort to extend its coverage from December of 1990 to June of 1999.