Petit Tour De Suisse Des Eaux Transfrontières
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Download (9MB)
Beiträge zur Hydrologie der Schweiz Nr. 39 Herausgegeben von der Schweizerischen Gesellschaft für Hydrologie und Limnologie (SGHL) und der Schweizerischen Hydrologischen Kommission (CHy) Daniel Viviroli und Rolf Weingartner Prozessbasierte Hochwasserabschätzung für mesoskalige Einzugsgebiete Grundlagen und Interpretationshilfe zum Verfahren PREVAH-regHQ | downloaded: 23.9.2021 Bern, Juni 2012 https://doi.org/10.48350/39262 source: Hintergrund Dieser Bericht fasst die Ergebnisse des Projektes „Ein prozessorientiertes Modellsystem zur Ermitt- lung seltener Hochwasserabflüsse für beliebige Einzugsgebiete der Schweiz – Grundlagenbereit- stellung für die Hochwasserabschätzung“ zusammen, welches im Auftrag des Bundesamtes für Um- welt (BAFU) am Geographischen Institut der Universität Bern (GIUB) ausgearbeitet wurde. Das Pro- jekt wurde auf Seiten des BAFU von Prof. Dr. Manfred Spreafico und Dr. Dominique Bérod begleitet. Für die Bereitstellung umfangreicher Messdaten danken wir dem BAFU, den zuständigen Ämtern der Kantone sowie dem Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz). Daten Die im Bericht beschriebenen Daten und Resultate können unter der folgenden Adresse bezogen werden: http://www.hydrologie.unibe.ch/projekte/PREVAHregHQ.html. Weitere Informationen erhält man bei [email protected]. Druck Publikation Digital AG Bezug des Bandes Hydrologische Kommission (CHy) der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (scnat) c/o Geographisches Institut der Universität Bern Hallerstrasse 12, 3012 Bern http://chy.scnatweb.ch Zitiervorschlag -

Internationales Bearbeitungsgebiet Hochrhein Bericht Zur
Internationale Flussgebietseinheit Rhein Internationales Bearbeitungsgebiet Hochrhein Bericht zur Bestandsaufnahme; Teil B Bearbeitungsstand: 8. März 2005 Federführung der internationalen Koordinierung: Ministerium für Umwelt und Verkehr (UVM) Baden-Württemberg (BW) Zuständige Behörden: Ministerium für Umwelt und Verkehr (UVM) Baden-Württemberg (BW) Préfet Coordonnateur de Bassin (PCB) Rhin-Meuse Direction Régionale de l´Environment (DIREN) Alsace Für die Koordinierung im Bearbeitungsgebiet: BW : Regierungspräsidium Freiburg CH: Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Bern F : DIREN Alsace, Strasbourg WRRL BG Hochrhein Stand: 08.03.05 S. 2 Inhaltsverzeichnis Kartenverzeichnis .................................................................................................... 4 Einführung und wichtige Fragen der Wasserbewirtschaftung im Bearbeitungsgebiet Hochrhein.......................................................................... 6 Französische Anteile des Bearbeitungsgebietes Hochrhein ............................... 8 1 Allgemeine Beschreibung des Bearbeitungsgebietes .................................. 10 1.1 Übersicht und Basisinformationen .................................................................................... 10 1.2 Lage und Grenzen............................................................................................................. 11 1.3 Raumplanung und Landnutzung ....................................................................................... 11 1.4 Naturräume ...................................................................................................................... -

The 1356 Basel Earthquake: an Interdisciplinary Revision
Research Collection Journal Article The 1356 Basel earthquake An interdisciplinary revision Author(s): Fäh, Donat; Gisler, Monika; Jaggi, Bernard; Kästli, Philipp; Lutz, Thomas; Masciadri, Virgilio; Matt, Christoph; Mayer-Rosa, Dieter; Rippmann, Dorothee; Schwarz-Zanetti, Gabriela; Tauber, Juerg; Wenk, Thomas Publication Date: 2009 Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-b-000021256 Originally published in: Geophysical Journal International 178(1), http://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2009.04130.x Rights / License: In Copyright - Non-Commercial Use Permitted This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection. For more information please consult the Terms of use. ETH Library Geophys. J. Int. (2009) 178, 351–374 doi: 10.1111/j.1365-246X.2009.04130.x The 1356 Basel earthquake: an interdisciplinary revision Donat Fah,¨ 1 Monika Gisler,1 Bernard Jaggi,2 Philipp Kastli,¨ 1 Thomas Lutz,2 Virgilio Masciadri,3 Christoph Matt,4 Dieter Mayer-Rosa,5 Dorothee Rippmann,6 Gabriela Schwarz-Zanetti,1 Jurg¨ Tauber7 and Thomas Wenk8 1Swiss Seismological Service, ETH Zurich, CH-8092 Zurich, Switzerland. E-mail: [email protected] 2Basler Denkmalpflege, Unterer Rheinweg 26, CH-4058 Basel, Switzerland 3Klassisch-Philologisches Seminar, Universitat¨ Zurich, Ramistr.¨ 68, CH-8001 Zurich, Switzerland 4Archaologische¨ Bodenforschung des Kantons Basel-Stadt, Petersgraben 11, CH-4001 Basel, Switzerland 5Schwandenholzstrasse 260, 8046 Zurich, Switzerland 6Historisches Seminar, Universitat¨ Zurich, Karl Schmid-Strasse 4, CH-8006 Zurich, Switzerland 7Archaologie¨ und Museum Baselland, Amtshausgasse 7, CH-4410 Liestal, Switzerland 8Wenk Erdbebeningenieurwesen und Baudynamik GmbH, Postfach 6063, CH-8023 Zurich, Switzerland Accepted 2009 January 26. Received 2009 January 26; in original form 2007 April 25 SUMMARY Within historical times one of the most damaging events in intra-plate Europe was the 1356 Basel earthquake. -
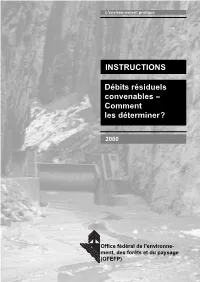
Débits Résiduels Convenables -- Comment Les Déterminer?
L'environnement pratique INSTRUCTIONS Débits résiduels convenables -- Comment les déterminer? 2000 Office fédéral de l'environne- ment, des forêts et du paysage (OFEFP) L'environnement pratique INSTRUCTIONS Débits résiduels convenables -- Comment les déterminer? 2000 Publié par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) Auteurs R. Estoppey, OFEFP, Berne Dr. B. Kiefer, Kiefer & Partners AG, Zurich M. Kummer, OFEFP, Berne S. Lagger, OFEFP, Berne H. Aschwanden, SHGN, Berne (chap. 7) Traduction B. Bressoud, Ardon Commande Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage Documentation 3003 Berne Fax + 41 (0)31 324 02 16 E-mail: [email protected] Internet: http://www.admin.ch/buwal/publikat/f/ Numéro de commande VU-2701-F © OFEFP 2000 Table des matières 3 TABLE DES MATIÈRES $9$17352326 ,1752'8&7,21 1.1 GÉNÉRALITÉS..................................................................................................................................7 1.2 OBJECTIF ET PRINCIPES DE LA FIXATION DE DÉBITS RÉSIDUELS CONVENABLES ......8 1.3 BASES LÉGALES..............................................................................................................................8 1.4 LE SYSTÈME DES DISPOSITIONS DE LA LEAUX SUR LES DÉBITS RÉSIDUELS................10 /¶$8725,6$7,21'(35e/Ê9(0(17'¶($8 2.1 PRÉLÈVEMENTS D’EAU SOUMIS À AUTORISATION ............................................................13 2.2 CONDITIONS POUR L’OCTROI DE L’AUTORISATION ...........................................................19 -

Zur Geschichte Des Gewässerschutzes Am Ober- Und Hochrhein - Eine Fallstudie Zur Umwelt- Und Biologiegeschichte
Zur Geschichte des Gewässerschutzes am Ober- und Hochrhein - Eine Fallstudie zur Umwelt- und Biologiegeschichte - Inauguraldissertation zur Erlangung der Doktorwürde an der Fakultät für Biologie der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg vorgelegt von Jörg Lange aus Darmstadt August 2002 Dekan: Prof. Dr. H. Kleinig Leiter der Arbeit: Prof. Dr. J. Schwoerbel Referent: Prof. Dr. J. Schwoerbel / Prof. Dr. Rothaupt (Erstgutachten) Koreferent: Prof. Dr. N. Sander Promotionsausschuss- vorsitzender: Prof. Dr. K.F. Fischbach Tag der Verkündigung des Prüfungsergebnisses:11.12.2002 „Außerdem haben wir uns dem globalen Wasserproblem zu spät intensiv gewidmet. Die Frage, wie wir auf der Welt mit dem Wasser umgehen, wird an vielen Orten über Krieg und Frieden mitentscheiden. Daß wir Wasser immer noch als Trans- portmittel für Fäkalien und Industrieabwasser benutzen, um sie nachher aufwendig und unter hohem Energieverbrauch in der Kläranlage wieder herauszuholen, ist doch keine zukunftsfähige Lösung. Das kann kein Modell für Megastädte in den Entwicklungsländern mit 20 Millionen Einwohner sein.“ Der ehemalige Rheindurchschwimmer Klaus Töpfer in einem Interview in der FR v. 26.1.98 anläßlich seines Wechsels zum Umweltprogramm der Vereinten Nationen (Unep) Vorwort Der Arbeit „Geschichte des Gewässerschutzes am Hoch- und Oberrhein“ liegen folgende Beweggründe des Bearbeiters zugrunde: • Begeisterung für das Element Wasser und Gewässerlandschaften in all ihren Erscheinungsformen. • Die Hoffnung, daß man noch zu meinen Lebzeiten ohne jede Bedenken im Verlauf des gesamten Rheins baden gehen kann. • Die persönliche Erfahrung, durch die Auseinandersetzung mit Ge- schichte Anregung für gegenwärtige Probleme zu finden („zu lernen“). • Die Freude an der Erkenntnis von Zusammenhängen. • Die Vermutung, daß zukünftige Generationen ohne eine ressourcen- schonende Kreislaufwirtschaft kein sozial- und wirtschaftlich angemes- senes Leben werden führen können. -

Jahresbericht 2014 Der Archäologischen Bodenforschung Basel-Stadt 20 14 Bodenforschung Basel-Stadt Jahresbericht Derarchäologischen Inhalt
20 14Jahresbericht der Archäologischen Bodenforschung Basel-Stadt Jahresbericht 2014 der Archäologischen Bodenforschung Basel-Stadt Bodenforschung 2014 der Archäologischen Jahresbericht inhalt t ätiGkeitsbericht für das Jahr 2014 Guido lassau 21 Jahresbericht 2014 4 | 5 tätiGkeitsbericht fundchronik coverstory GeoarchäoLoGischer für das Jahr 2014 ausGrabunGen und von fischen und fischern report funde im Jahr 2014 eine kurze Geschichte Guido lassau ichthyoarchäologische Unter des rheins Marco bernasconi suchungen zu Gewässerökologie 21 Marta imbach und Fischkonsum im Mittelalt er Geologische und Philippe rentzel und der neuzeit archäologische till scholz impressionen aus basel norbert spichtig simone häberle christine Pümpin Philippe rentzel 73 christine Pümpin 33 David brönnimann 109 EinE kurzE GEschichtE dEs rhEins Jahrb Es Ericht 2014 108 | 10 9 GeoarchäoloGischer report eine kurze Geschichte des rheins Geologische und archäologische impressionen aus basel Philippe rentzel christine Pümpin david brönnimann EinE kurzE GEschichtE dEs rhEins Jahresbericht 2014 110 | 111 Die Stadt Basel und der Rhein gehören untrennbar zusammen. Nicht von unge fähr ist die offizielle Hymne «z’Basel am mym Rhy» dem die Stadt prägenden Fluss gewidmet, und auch in der Aussenwahrnehmung ist Basel – zumin dest im schweizerischen Kontext – die Rheinstadt resp. die Stadt am Rhein. Tat sächlich bildet der Fluss seit je die Lebensader nicht nur der Stadt Basel, son dern auch ihrer ur und frühgeschichtlichen Vorgängersiedlungen. Archäologie in Basel und der -

Kartierungsbericht 2014/2015
Bericht Laichgrubenkartierung 2014/2015 Bericht Laichgrubenkartierung 2014/15 Über 30 Personen haben während der letzten Laichzeit! Ausschau nach laichenden Forellen gehalten und ihre Beobachtungen der FIBER gemeldet. Insgesamt wurden 35 Gewässer untersucht und 544 Laichplätze gezählt. Abbildung 1 Weisse Punkte sind Gewässer mit vollständigen Kartierungen, inkl. exakter Angabe zur Länge der untersuchten Strecken und zur Anzahl Laichplätze. Gelbe Punkte sind Gewässer mit relevanten Beobachtungen, ohne Detailangaben über Streckenlän- gen und Anzahl Laichplätzen. 1) Drize 2) Versoix 3) Venoge 4) Grande Eau 5) Chräbsbach 6) Mungaukanal 7) Lüssel 8) Lützel 9) Ibach 10) Chastelbach 11) Birsig 12) Pfaffneren 13) Tych 14) Himmelbach Laichgruben kartieren – worum geht es? 15) Töss 16) Rhein 2014 hat die Fischereiberatung Fiber den Workshop «Laichzeit! Laichgruben von Forel- 17) Biber 18) Hermishoferbach len erkennen, kartieren und vermessen» zum vierten Mal durchgeführt. In diesem Kurs 19) Jona (zwei Kartierungen) wird Interessantes rund um die Biologie und die Fortpflanzung der Forellen vermittelt 20) Lattenbach und im Feld wird gelernt, wie Laichgruben erkannt und kartiert werden. In der Laich- 21) Hinterrhein 22) Ragn da Ferrera zeit! 13/14 wurde begonnen, mit Hilfe von Kursteilnehmern und anderen Interessierten 23) Val Niemeter Bach Informationen über die Laichaktivitäten von Forellen zu sammeln. Dabei werden die 24) Averserrhein 25) Madrischerrhein Laichgruben gezählt, welche die Fische zur Laichzeit in den Kies der Gewässersoh- 26) Russen le schlagen, um ihre Eier zu vergraben. Während des Grabens der Grube reinigt das 27) Pfynkanal Weibchen den Kies von pflanzlichem Aufwuchs und feinen Sedimenten und so können Ab Seite 28 Laichgruben oft als helle Flecken auf dem dunkleren Gewässergrund erkannt werden 28) Hinterbach 29) Erusbach (Abbildung 2). -

Merovingian Mortuary Archaeology and the Making of the Early Middl
Merovingian Mortuary Archaeology and the Making of the Early Middl... http://content.cdlib.org/xtf/view?docId=kt967nd088&chunk.id=0&doc.... Preferred Citation: Effros, Bonnie. Merovingian Mortuary Archaeology and the Making of the Early Middle Ages. Berkeley: University of California Press, c2003 2003. http://ark.cdlib.org/ark:/13030/kt967nd088/ Merovingian Mortuary Archaeology and the Making of the Early Middle Ages BONNIE EFFROS University of California Press BERKELEY LOS ANGELES LONDON 2003 ― ― [Dedication] To my parents, Gail Hochman Effros and Richard Matthew Effros Preferred Citation: Effros, Bonnie. Merovingian Mortuary Archaeology and the Making of the Early Middle Ages. Berkeley: University of California Press, c2003 2003. http://ark.cdlib.org/ark:/13030/kt967nd088/ ― ― [Dedication] To my parents, Gail Hochman Effros and Richard Matthew Effros ― ― [Epigraph] It is as though worldly stability had become transparent in the permanence of art so that a premonition of immortality, not the immortality of the soul or of life but of something immortal achieved by mortal hands, has become tangibly present, to shine and to be seen, to sound and to be heard, to speak and to be read. HANNAH ARENDT, The Human Condition 1 of 193 7/22/2006 1:55 AM Merovingian Mortuary Archaeology and the Making of the Early Middl... http://content.cdlib.org/xtf/view?docId=kt967nd088&chunk.id=0&doc.... ― ― Contents List of Illustrations xi Acknowledgments xiii List of Abbreviations xvii INTRODUCTION 1 ANTIQUARIES, HISTORIANS, AND ARCHAEOLOGISTS: CREATING A CULTURAL CONTEXT FOR 1. 12 EARLY MEDIEVAL GRAVES 2. MODERN ASSESSMENTS OF MEROVINGIAN BURIAL 71 3. GRAVE GOODS AND THE RITUAL EXPRESSION OF IDENTITY 119 4. -

Die Kultur Des Frühen Mittelalters
Die Kultur des frühen Mittelalters Objekttyp: Group Zeitschrift: Jahresbericht der Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte (Société suisse de préhistoire) Band (Jahr): 23 (1931) PDF erstellt am: 04.10.2021 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch VIL Die Kultur des frühen Mittelalters. In „Heimat-Klänge", der Sonntagsbeilage zu den Zuger Nachrichten, 17. Jan. 1932, befaßt sich Saladin mit den Namen für vorgeschichtliche Grabhügel, namentlich Löbern, Lebern, Leh, Lee und die unzähligen Zusammensetzungen mit Leu, wie Leubühl, Toteleue, Leuistuhl usw. Es ist zwar nicht Sache des Prähistorikers, Sprachgeschichte zu treiben, daß aber der Prähistoriker die Mitwirkung des Linguisten immer gerne gesehen und nie behindert hat, ist eine Erfahrungstatsache, die gerade bei dieser Gelegenheit mit aller Deutlichkeit hervorgehoben werden darf. -

Bulletin Municipal Annee 2020
BULLETIN MUNICIPAL ANNEE 2020 Biederthal vu autrement Le Mot de Mme le Maire C’est avec un grand plaisir que je m’adresse à vous aujourd’hui à l’occasion de la parution de ce nouveau bulletin municipal. Les élections municipales ont eu lieu le 15 mars 2020 et le nouveau Conseil Municipal a été installé le 25 mai dernier. Je vous remercie tous de la confiance que vous nous avez témoignée. La nouvelle équipe et moi-même travaillons activement au sein des différentes commissions. Certains dossiers ont été finalisés, d’autres sont en cours, et de nouveaux projets vont être lancés, à savoir : - la fibre est arrivée en fin d’année 2019, la Communauté de Communes du Sundgau et la Commune de Biederthal ont pris les travaux à leurs charges respectivement répartis à 50 % soit un total de 175 Euros par maison, - un diagnostic de sécurité « traversée de la commune » sur la RD23, a été réalisé l’été dernier et s’est achevé début 2020. La situation de cette année pas comme les autres ne nous a pas encore permis de travailler avec le département sur ce dossier pour concrétiser les différentes solutions envisageables (zone 30, chicane et dos d’âne dans le lotissement), - les travaux de la mise aux normes de la salle polyvalente « BIRSIG » ont pu s’achever début d’année et nous avons pu organiser l’inauguration qui a eu lieu le 22 février 2020, - au cimetière des travaux ont été réalisés sur les allées centrales pour faciliter l’entretien, - la pose de nouveaux garde-corps le long de la rivière Rue de Burg du 14 septembre au 30 octobre 2020 financés par le Conseil Départemental et effectué par l’entreprise SAERT de Cernay. -

The Largest Floods in the High Rhine Basin Since
This article was downloaded by: [oliver wetter] On: 12 July 2011, At: 12:38 Publisher: Taylor & Francis Informa Ltd Registered in England and Wales Registered Number: 1072954 Registered office: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London W1T 3JH, UK Hydrological Sciences Journal Publication details, including instructions for authors and subscription information: http://www.tandfonline.com/loi/thsj20 The largest floods in the High Rhine basin since 1268 assessed from documentary and instrumental evidence Oliver Wetter a b , Christian Pfister a b , Rolf Weingartner b c , Jürg Luterbacher d , Tom Reist b c & Jürg Trösch e a Institute of History, Section of Economic, Social and Environmental History (WSU), University of Bern, CH-3012, Bern, Switzerland b Oeschger Centre for Climate Change Research, University of Bern, CH-3012, Bern, Switzerland c Institute of Geography, Hallerstrasse 12, CH-3012, Bern, Switzerland d Department of Geography; Climatology, Climate Dynamics and Climate Change, Justus Liebig University of Giessen, Giessen, Germany e TK Consult AG, Seefeldstrasse 287, CH-8008, Zürich, Switzerland Available online: 12 Jul 2011 To cite this article: Oliver Wetter, Christian Pfister, Rolf Weingartner, Jürg Luterbacher, Tom Reist & Jürg Trösch (2011): The largest floods in the High Rhine basin since 1268 assessed from documentary and instrumental evidence, Hydrological Sciences Journal, 56:5, 733-758 To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/02626667.2011.583613 PLEASE SCROLL DOWN FOR ARTICLE Full terms and conditions of use: http://www.tandfonline.com/page/terms-and-conditions This article may be used for research, teaching and private study purposes. Any substantial or systematic reproduction, re-distribution, re-selling, loan, sub-licensing, systematic supply or distribution in any form to anyone is expressly forbidden. -

Nachhaltiges Fliessgewässer- Management Im Einzugsgebiet Der Birs Und Des Birsigs
Aurelia Kuster, Lukas Guyer, Daniel Andersen, Samira Amos, Fabian Bättig (Hrsg.) Nachhaltiges Fliessgewässer- management im Einzugsgebiet der Birs und des Birsigs Falldossier zur Lehrveranstaltung Umweltproblemlösen 2018/2019 USYSDepartment of EnvironmentalTd SystemsLa Scienceb Transdisciplinarity Lab · Science-Society Interface Abkürzungen ARA Abwasserreinigungsanalgage ARP Amt für Raumplanung, Kanton Basel-Landschaft AUE Amt für Umwelt und Energie, Kanton Basel-Landschaft BAFU Bundesamt für Umwelt BFF Biodiversitätsförderfläche BGF Bundesgesetz über die Fischerei BL Basel-Landschaft BLW Bundesamt für Landwirtschaft BV Bundesverfassung BVBB Bauernverband beider Basel EnG Energiegesetz EZG Einzugsgebiet GSchG Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer GSchV Gewässerschutzverordnung HEV Hauseigentümerverband KEV Kostendeckende Einspeisevergütung KFVBB Kantonaler Fischereiverband beider Basel kGSchG kantonales Gewässerschutzgesetz KWKW Kleinwasserkraftwerke MRWM Mindestrestwassermenge NGH Natur- und Heimatschutzgesetz NGO Non-governmental Organization NHV Nachhaltigkeitsverordnung Wika Wirtschaftskammer Baselland WKW Wasserkraftwerke USG Umweltschutzgesetz Nachhaltiges Fliessgewässermanagement im Einzugsgebiet der Birs und des Birsigs 1 Inhalt Abbildungs- und Tabellenverzeichnis ........................................................................................ 2 Vorwort ........................................................................................................................................ 3 1 Einleitung ................................................................................................................................