Débits Résiduels Convenables -- Comment Les Déterminer?
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

9 Rhein Traverse Wolfgang Schirmer
475 INQUA 1995 Quaternary field trips in Central Europe Wolfgang Schirmer (ed.) 9 Rhein Traverse Wolfgang Schirmer with contributions by H. Berendsen, R. Bersezio, A. Bini, F. Bittmann, G. Crosta, W. de Gans, T. de Groot, D. Ellwanger, H. Graf, A. Ikinger, O. Keller, U. Schirmer, M. W. van den Berg, G. Waldmann, L. Wick 9. Rhein Traverse, W. Schirmer. — In: W. Schirmer (ed.): Quaternary field trips hl Central Europe, vo1.1, p. 475-558 ©1995 by Verlag Dr. Friedrich Pfeil, Munchen, Germany ISBN 3-923871-91-0 (complete edition) —ISBN 3-923871-92-9 (volume 1) 476 external border of maximum glaciation Fig.1 All Stops (1 61) of excursion 9. Larger setting in Fig. 2. Detailed maps Figs. 8 and 48 marked as insets 477 Contents Foreword 479 The headwaters of the Rhein 497 Introductory survey to the Rhein traverse Stop 9: Via Mala 498 (W. ScI-~uvtER) 480 Stop 10: Zillis. Romanesque church 1. Brief earth history of the excursion area 480 of St. Martin 499 2. History of the Rhein catchment 485 The Flims-Tamins rockslide area 3. History of valley-shaping in the uplands 486 (W. SCHIItMER) 499 4. Alpine and Northern glaciation 486 Stop 11: Domat/Ems. Panoramic view of the rockslide area 500 5. Shape of the Rhein course 486 Stop 12: Gravel pit of the `Kieswerk Po plain and Southern Alps Reichenau, Calanda Beton AG' 500 (R. BERSEZIO) 488 Stop 13: Ruinaulta, the Vorderrhein gorge The Po plain subsurface 488 piercing the Flims rockslide 501 The Southern Alps 488 Retreat Stades of the Würmian glaciation The Periadriatic Lineament (O. -

Erläuterungen Zum Verzeichnis Der Schutzgebiete
Erläuterungen zum Verzeichnis der Schutzgebiete Aktualisierung 2015 zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Baden-Württemberg Erläuterungen zum Verzeichnis der Schutzgebiete Aktualisierung 2015 zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Baden-Württemberg HERAUSGEBER LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg Postfach 100163, 76231 Karlsruhe Referat 41 – Gewässerschutz BEARBEITUNG Auf Grundlage des LUBW-Hintergrundpapiers mit Stand Dezember 2008 erfolgt eine Aktualisierung. Christian Haile Büro Jürgen Schmeißer Unter Beteiligung von: Referat 24 – Flächenschutz, Fachdienst Naturschutz Referat 25 – Artenschutz, Landschaftsplanung Referat 42 – Grundwasser Referat 53 – UIS-Fachsysteme STAND Dezember 2015 Nachdruck- auch auszugsweise- ist nur mit Zustimmung der LUBW unter Quellenangabe und Überlassung von Belegexemplaren gestattet. 1 EINFÜHRUNG 4 2 GEBIETE ZUR ENTNAHME VON WASSER FÜR DEN MENSCHLICHEN GEBRAUCH 6 3 WASSERSCHUTZGEBIETE 8 4 HEILQUELLENSCHUTZGEBIETE 10 5 GEBIETE ZUM SCHUTZ WIRTSCHAFTLICH BEDEUTENDER ARTEN 12 6 BADEGEWÄSSER 14 7 NÄHRSTOFFSENSIBLE GEBIETE - GEBIETE NACH KOMMUNALABWASSERRICHTLINIE UND NACH NITRATRICHTLINIE 16 8 WASSERABHÄNGIGE NATURA-2000-GEBIETE 18 8.1 WASSERABHÄNGIGE FFH-GEBIETE 19 8.2 EG-VOGELSCHUTZGEBIETE 24 9 GRUNDWASSERABHÄNGIGE LANDÖKOSYSTEME 28 10 LITERATURVERZEICHNIS 29 11 ANHANG 31 1 Einführung Gemäß Artikel 6 der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL [1]) ist ein flussgebietsbezogenes Verzeichnis aller Gebiete zu erstellen, für die zum Schutz der Oberflächengewässer und -
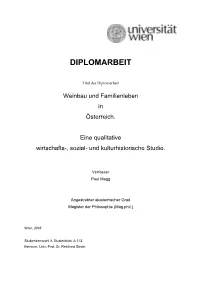
Dip Arbeit Fertig4
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Weinbau und Familienleben in Österreich. Eine qualitative wirtschafts-, sozial- und kulturhistorische Studie. Verfasser Paul Magg Angestrebter akademischer Grad Magister der Philosophie (Mag.phil.) Wien, 2008 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 312 Betreuer: Univ.-Prof. Dr. Reinhard Sieder INHALTSVERZEICHNIS Vorwort Einleitung………………………………………………………………………………...…….5 ALLGEMEINER HISTORIOGRAPHISCHER TEIL Die Geschichte des Weinbaus in Österreich……………………...……………………………8 Die Grundlagen der österreichischen Weinwirtschaft……………………..............................37 Die Weinbauregionen in Österreich………………………………..............................39 Die Rebsorten und ihre Geschichte…………………………………………………...44 Die Qualitätsstufen des Österreichischen Wein……………………………………. 75 Das Jahr im Weingarten und die Weinbereitung ……………………………………. 80 2 SPEZIELLER ASPEKTE - TEIL Die Geschichte des Weinbaus im Burgenland………………………………………….... 108 Das Weinbaugebiet Neusiedl am See……………………………………………….…..... 123 Das Klima und die Lage………………………………………………………….. 126 Die Geschichte des Weinbaus in Weiden am See………………………………………... 127 Der Fall Millner: Analyse der Familiengeschichte einer Winzerfamilie in Weiden am See………………………………………..………..... 131 Zusammenfassung……………………………………………………………………….. 150 Literaturverzeichnis……………………………………………………………………… 156 Bild und Grafiknachweis…………………………………………………………………. 161 Anhang…………………………………………………………………………………… 168 Transkripotionen der geführten Interviews………………………………………. 169 Abstract…………………………………………………………………………… 333 Lebenslauf………………………………………………………………………… -

Chapter the Influence of Nutrients and Non-CO2 Greenhouse Gas Emissions on the Ecological Footprint of Products
Quantifying effects of physical, chemical and biological stressors in life cycle assessment Hanafiah, M.M (2013). Quantifying the effects of physical, chemical and biological stressors in life cycle assessment. PhD thesis, Radboud University Nijmegen, the Netherlands. © 2013 Marlia Mohd Hanafiah, all rights reserved. Layout: Samsul Fathan Mashor & Marlia Mohd Hanafiah Printed by: S&T Photocopy Center, Bangi Quantifying the effects of physical, chemical and biological stressors in life cycle assessment Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen op gezag van de rector magnificus prof. mr. S.C.J.J. Kortmann volgens besluit van het college van decanen in het openbaar te verdedigen op dinsdag 2 April 2013 om 15:30 uur precies door Marlia Mohd Hanafiah geboren op 5 September 1980 te Negeri Sembilan, Maleisië Promotoren Prof. dr. ir. A.J. Hendriks Prof. dr. M.A.J. Huijbregts Co-promotor Dr. R.S.E.W. Leuven Manuscriptcommissie Prof. dr. A.M. Breure Prof. dr. A.J.M. Smits Prof. dr. H.C. Moll (Rijksuniversiteit Groningen) Paranimfen Samsul Fathan Mashor Anastasia Fedorenkova Aan Samsul, Sophia en Sarra Table of Contents Chapter 1 Introduction 7 Chapter 2 The influence of nutrients and non-CO2 23 greenhouse gas emissions on the ecological footprint of products Chapter 3 Comparing the ecological footprint with the 48 biodiversity footprint of products Chapter 4 Characterization factors for thermal pollution 69 in freshwater aquatic environments Chapter 5 Characterization factors for water consumption -

Why Do We Have So Many Different Hydrological Models?
Why do we have so many different hydrological models? A review based on the case of Switzerland Pascal Horton*1, Bettina Schaefli1, and Martina Kauzlaric1 1Institute of Geography & Oeschger Centre for Climate Change Research, University of Bern, Bern, Switzerland ([email protected]) This is a preprint of a manuscript submitted to WIREs Water. 1 Abstract Hydrology plays a central role in applied as well as fundamental environmental sciences, but it is well known to suffer from an overwhelming diversity of models, in particular to simulate streamflow. Based on Switzerland's example, we discuss here in detail how such diversity did arise even at the scale of such a small country. The case study's relevance stems from the fact that Switzerland shows a relatively high density of academic and research institutes active in the field of hydrology, which led to an evolution of hydrological models that stands exemplarily for the diversification that arose at a larger scale. Our analysis summarizes the main driving forces behind this evolution, discusses drawbacks and advantages of model diversity and depicts possible future evolutions. Although convenience seems to be the main driver so far, we see potential change in the future with the advent of facilitated collaboration through open sourcing and code sharing platforms. We anticipate that this review, in particular, helps researchers from other fields to understand better why hydrologists have so many different models. 1 Introduction Hydrological models are essential tools for hydrologists, be it for operational flood forecasting, water resource management or the assessment of land use and climate change impacts. -

Download (9MB)
Beiträge zur Hydrologie der Schweiz Nr. 39 Herausgegeben von der Schweizerischen Gesellschaft für Hydrologie und Limnologie (SGHL) und der Schweizerischen Hydrologischen Kommission (CHy) Daniel Viviroli und Rolf Weingartner Prozessbasierte Hochwasserabschätzung für mesoskalige Einzugsgebiete Grundlagen und Interpretationshilfe zum Verfahren PREVAH-regHQ | downloaded: 23.9.2021 Bern, Juni 2012 https://doi.org/10.48350/39262 source: Hintergrund Dieser Bericht fasst die Ergebnisse des Projektes „Ein prozessorientiertes Modellsystem zur Ermitt- lung seltener Hochwasserabflüsse für beliebige Einzugsgebiete der Schweiz – Grundlagenbereit- stellung für die Hochwasserabschätzung“ zusammen, welches im Auftrag des Bundesamtes für Um- welt (BAFU) am Geographischen Institut der Universität Bern (GIUB) ausgearbeitet wurde. Das Pro- jekt wurde auf Seiten des BAFU von Prof. Dr. Manfred Spreafico und Dr. Dominique Bérod begleitet. Für die Bereitstellung umfangreicher Messdaten danken wir dem BAFU, den zuständigen Ämtern der Kantone sowie dem Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz). Daten Die im Bericht beschriebenen Daten und Resultate können unter der folgenden Adresse bezogen werden: http://www.hydrologie.unibe.ch/projekte/PREVAHregHQ.html. Weitere Informationen erhält man bei [email protected]. Druck Publikation Digital AG Bezug des Bandes Hydrologische Kommission (CHy) der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (scnat) c/o Geographisches Institut der Universität Bern Hallerstrasse 12, 3012 Bern http://chy.scnatweb.ch Zitiervorschlag -

Contribution À L'étude Géomophologique Et Géophysique Des Environnements Périglaciaires Des Alpes Tessinoises Orientales
Photos de couverture A gauche, du haut vers le bas : Prospection géoélectrique sur l’éboulis de Sasso di Luzzone ; le glacier rocheux de Gana Bianca ; fenêtres de fonte du manteau neigeux sur l’éboulis de Sasso di Luzzone. A droite : La partie frontale du glacier rocheux de Sceru I. Sauf mention contraire, toutes les photos sont de l’auteur. A mes parents Ai miei genitori Table des matières -V- Table des matières Résumé_________________________________________________________________________ XI Abréviations_____________________________________________________________________XII Remerciements__________________________________________________________________ XIII 1ÈRE PARTIE : INTRODUCTION ET NOTIONS GÉNÉRALES 1. Introduction générale 05 1.1 Contexte de l’étude 05 1.2 Question générale 07 1.3 Historique et état des connaissances 07 1.3.1 Recherches sur les environnements périglaciaires au Tessin et en Mesolcina 08 1.3.2 Recherches sur les environnements périglaciaires dans les A. Centrales ital. 09 1.3.2.1 Distribution des glaciers rocheux et (paléo)climat dans les A. Centrales ital. 10 1.3.2.2 Distribution des glaciers rocheux dans le Massif de l’Adamello – Presanella 11 1.3.3 Synthèse 12 1.4 Plan de la recherche 13 2. Problématique 17 2.1 Problématique géographique 17 2.1.1 Problématique générale 17 2.1.2 Hypothèses de travail 18 2.2 Problématique méthodologique 19 2.2.1 Problématique générale 19 2.2.2 Hypothèses de travail 21 2.3 Synthèse 22 3. Les environnements périglaciaires : cadre théorique 25 3.1 Le domaine périglaciaire 25 3.1.1 -

LP NVK Anhang (PDF, 7.39
Landschaftsplan 2030 Nachbarschaftsverband Karlsruhe 30.11.2019 ANHANG HHP HAGE+HOPPENSTEDT PARTNER INHALT 1 ANHANG ZU KAP. 2.1 – DER RAUM ........................................................... 1 1.1 Schutzgebiete ................................................................................................................. 1 1.1.1 Naturschutzgebiete ................................................................................... 1 1.1.2 Landschaftsschutzgebiete ........................................................................ 2 1.1.3 Wasserschutzgebiete .................................................................................. 4 1.1.4 Überschwemmungsgebiete ...................................................................... 5 1.1.5 Waldschutzgebiete ...................................................................................... 5 1.1.6 Naturdenkmale – Einzelgebilde ................................................................ 6 1.1.7 Flächenhaftes Naturdenkmal .................................................................... 10 1.1.8 Schutzgebiete NATURA 2000 .................................................................... 11 1.1.8.1 FFH – Gebiete 11 1.1.8.2 Vogelschutzgebiete (SPA-Gebiete) 12 2 ANHANG ZU KAP. 2.2 – GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN DER MENSCHEN ..................... 13 3 ANHANG ZU KAP. 2.4 - LANDSCHAFT ..................................................... 16 3.1 Landschaftsbeurteilung ............................................................................................... -

Gographie Illustre De La Suisse L'usage Des Coles Et Des Familles;
LIBRARY OF CONGRESS. -7^^ @]^t..V.... inîojrig^ :|n Shelf-_-.W_'^... UNITED STATES OF AMERICA. i i k mmmw umm DE LA SUISSE À l'usage DES ÉCOLES ET DES FAMILLES M. WASER PROFESSEUR À l'ÉCOLE NORMALE DE SCHWYTZ TRADUCTION FRANÇAISE PAR LE mxmim scmeuwly DIRECTEUR DES ECOLES A FRIBOURG ,3^ y il/ il i , . EINSIEDELN, NEW-YORK, CINCINNATI & ST. LOUIS CHAELES & NICOLAS BENZIGER FRERES ÉDITEURS- IMPRIMEURS 1882. Copyright 1882 by Benziger Brothers. „AU rights reserued." ^%% ^ PRÉFACE DU TMDIICTEIR. feur la demande de M. M. Benziger, libraires-éditeurs à Einsiedeln, nous avons traduit en français le Manuel illustré de la Géographie de la Suisse que M"". Waser, professeur à Fécole normale de Schwytz, vient de publier en langue allemande. *) Nous sommes persuadé qu^un accueil bienveillant lui est réservé dans les différents établissements d'instruction publique de la Suisse française ainsi que dans les familles. Les manuels de Géographie ne font certes pas défaut dans nos écoles, mais aucun, peut-être, ne répond aussi bien aux exigences de cette branche de renseignement. La description des différentes armoiries, un petit aperçu historique de la Suisse et de chaque canton, de nombreuses et intéressantes vignettes donnent à cet ouvrage un caractère tout particulier que nous ne trouvons pas dans les autres ma- nuels de géographie. Aussi nous n'hésitons pas à déclarer que M"". Waser en élaborant ce travail, et les M. M. Benziger en l'éditant, ont rendu un grand service aux écoles de la Suisse, et nous devons leur en témoigner notre reconnaissance. Fribourg en Juin 188L J. S. -

Fischerei 2000
Amt für Jagd und Fischerei Graubünden Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni Uffizi da chatscha e pestga dal Grischun Loëstrasse 14, 7001 Chur Tel: 081 257 38 92, Fax: 081 257 21 89, E-Mail: [email protected], Internet: www.jagd-fischerei.gr.ch Chur, 14.03.2006 Ergänzt: 07.04.2009 + FISCHEREI 2000 KONZEPT ZUR ERHALTUNG UND FÖRDERUNG DER FISCHFAUNA UND DEREN LEBENSRÄUME IM KANTON GRAUBÜNDEN SOWIE ZUR GEWÄHRLEISTUNG EINER NACHHALTIGEN NUTZUNG DES FISCHBESTANDES DURCH DIE BÜNDNER ANGELFISCHEREI Y:\Daten\WINWORD\MM\BEWIRTSCHAFTUNG\Konzept2000+\Fischereikonzept\Konzept_2000+.docx Fischerei 2000+ INHALT 1. Ausgangslage ............................................................................................................ 3 + 2. Das Konzept „Fischerei 2000 “ ................................................................................ 3 2.1 Bewirtschaftung ................................................................................................... 3 a) Grundsätze ........................................................................................................... 3 b) Grundlagenbeschaffung ....................................................................................... 5 c) Entscheidungsfindung .......................................................................................... 5 d) Erfolgskontrollen .................................................................................................. 6 e) Besatz mit einheimischen Fischarten .................................................................. -

Internationales Bearbeitungsgebiet Hochrhein Bericht Zur
Internationale Flussgebietseinheit Rhein Internationales Bearbeitungsgebiet Hochrhein Bericht zur Bestandsaufnahme; Teil B Bearbeitungsstand: 8. März 2005 Federführung der internationalen Koordinierung: Ministerium für Umwelt und Verkehr (UVM) Baden-Württemberg (BW) Zuständige Behörden: Ministerium für Umwelt und Verkehr (UVM) Baden-Württemberg (BW) Préfet Coordonnateur de Bassin (PCB) Rhin-Meuse Direction Régionale de l´Environment (DIREN) Alsace Für die Koordinierung im Bearbeitungsgebiet: BW : Regierungspräsidium Freiburg CH: Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Bern F : DIREN Alsace, Strasbourg WRRL BG Hochrhein Stand: 08.03.05 S. 2 Inhaltsverzeichnis Kartenverzeichnis .................................................................................................... 4 Einführung und wichtige Fragen der Wasserbewirtschaftung im Bearbeitungsgebiet Hochrhein.......................................................................... 6 Französische Anteile des Bearbeitungsgebietes Hochrhein ............................... 8 1 Allgemeine Beschreibung des Bearbeitungsgebietes .................................. 10 1.1 Übersicht und Basisinformationen .................................................................................... 10 1.2 Lage und Grenzen............................................................................................................. 11 1.3 Raumplanung und Landnutzung ....................................................................................... 11 1.4 Naturräume ...................................................................................................................... -

Contrasting Sediment Flux in Val Lumnezia
1661-8726/09/020211-12 Swiss J. Geosci. 102 (2009) 211–222 DOI 10.1007/s00015-009-1320-6 Birkhäuser Verlag, Basel, 2009 Contrasting sediment flux in Val Lumnezia (Graubünden, Eastern Swiss Alps), and implications for landscape development MARCO SCHWAB 1, 2, FRITZ SCHLUNEGGER 1, HEINZ SCHNEIDER 1, GREGOR STÖCKLI 1, 3 & DIRK RIEKE-ZAPP 1 Key words: landslide, Alps, monitoring, geomorphology, drainage basin development ABSTRACT This paper presents qualitative estimates of sediment discharge from opposite magnitudes of sediment discharge on the eastern tributaries than on the west- valley flanks in the S–N-oriented Val Lumnezia, eastern Swiss Alps, and re- ern valley side, where landsliding has been the predominant erosional process. lates inferred differences in sediment flux to the litho-tectonic architecture of These differences are interpreted to be controlled by the dip-slope situation of bedrock. The valley flank on the western side hosts the deep-seated Lumnezia bedrock on the western side that favours down-slope slip of material. landslide where an area of ca. 30 km2 has experienced slip rates of several Morphometric investigations reveal that the western valley side is char- centimetres per year, potentially resulting in high sediment discharge to the acterized by a low topographic roughness because this valley flank has not trunk stream (i.e. the Glogn River). High slip rates have resulted in topo- been dissected by a channel network. It appears that high sediment discharge graphic changes that are detectable on aerial photographs and measurable of the Lumnezia landslide has inhibited the establishment of a stable channel with geodetic tools.