Notice Historique De Montbarrey
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

N° 7-2 Juillet 2009
N° 7-2 PREFECTURE DU JURA JUILLET 2009 I.S.S.N. 0753 - 4787 Papier écologique 8 RUE DE LA PREFECTURE - 39030 LONS LE SAUNIER CEDEX - : 03 84 86 84 00 - TELECOPIE : 03 84 43 42 86 - INTERNET : www.jura.pref.gouv.fr 566 DIRECTION REGIONALE DE L’INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L’ENVIRONNEMENT DE FRANCHE-COMTE .........................................................................................................................................................................................................................567 Arrêté n° 09-123 du 13 juillet 2009 portant subdélégation de signature ................................................................................................567 DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AGRICULTURE .....................................................................569 Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage - Formation spécialisée dégâts de gibier - Compte rendu de la réunion du 10 juillet 2009 .....................................................................................................................................................................................569 Arrêté préfectoral n° 2009/472 du 29 juin 2009 portant création d’une réserve de chasse et de faune sauvage sur le territoire de l’ACCA de VILLERS ROBERT ................................................................................................................................................................570 Arrêté préfectoral n° 2009/473 du 29 juin 2009 portant création d’une -

La Savoureuse Lettre Du Comté Février 2010
CIGC Page 1 of 6 La savoureuse Lettre du Comté Février 2010 Evénement > Evénement : La 14ème Percée du Vin Jaune à Poligny La 14ème Percée du Vin > Idée recette > Conseil dégustation Jaune à Poligny > Un petit tour sur les Routes du Comté en dehors de la Percée... C'est le chanteur Pierre Perret qui parrainera les 6 et 7 > 4 crèmeries au top février prochain la désormais traditionnelle Percée du Vin > A visiter pendant les vacances Jaune. La 14ème édition de la première fête viticole d’hiver existant actuellement en France se déroulera à Poligny, Capitale du Comté, à l'endroit même où elle a été créée > Un autre moyen de découvrir le en 1996. 40 000 personnes y sont attendues, et plusieurs pôles Comté seront à leur disposition pour y Comté dans les Montagnes du découvrir le 1er fromage AOP de France… Jura > Enneigez-vous de plaisir dans > L’Avenue de la Résistance, où se trouvent la Maison du l'Ain ! Comté et le siège de l’Interprofession, sera rebaptisée «Rue > L'agenda de février 2010 du Comté». La Maison du Comté sera bien entendu ouverte les 2 jours. Des visites guidées de 45 min environ (avec dégustation de Comté des fruitières de Tourmont-Saint-Lothain et de Plasne-Barretaine) sont programmées toutes les heures à 14h00, 15h00, 16h00 et 17h00 le samedi, et à 10h00, 11h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00 et 17h00 le dimanche. > Au coeur du Comté L’entrée adulte est fixée à 2 €, et à 1 € pour les enfants. Ce tarif représente une réduction de 50% sur le tarif habituel. -

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2021
Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Arrondissements - cantons - communes 39 JURA INSEE - décembre 2020 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Arrondissements - cantons - communes 39 - JURA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 39-V 88 avenue Verdier CS 70058 92541 Montrouge cedex Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 39-1 Tél. : 01 87 69 50 00 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 39-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 39-3 INSEE - décembre 2020 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune, -
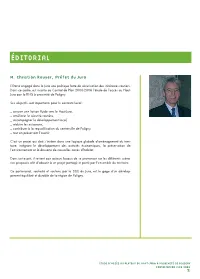
Exe Pages Int. Poligny
ÉDITORIAL M. Christian Rouyer, Préfet du Jura L’Etat a engagé dans le Jura une politique forte de sécurisation des itinéraires routiers. Dans ce cadre, est inscrite au Contrat de Plan 2000-2006 l’étude de l’accès au Haut- Jura par la RN5 à proximité de Poligny. Ses objectifs sont importants pour le contexte local : _ assurer une liaison fluide vers le Haut-Jura, _ améliorer la sécurité routière, _ accompagner le développement local, _ réduire les nuisances, _ contribuer à la requalification du centre-ville de Poligny, _ tout en préservant l’avenir. C’est un projet qui doit s’insérer dans une logique globale d’aménagement du terri- toire, intégrant le développement des activités économiques, la préservation de l’environnement et la desserte de nouvelles zones d’habitat. Dans cet esprit, il revient aux acteurs locaux de se prononcer sur les différents scéna- rios proposés afin d’aboutir à un projet partagé et porté par l’ensemble du territoire. Ce partenariat, souhaité et soutenu par la DDE du Jura, est le gage d’un dévelop- pement équilibré et durable de la région de Poligny. ETUDE D’ACCÈS AU PLATEAU DU HAUT-JURA À PROXIMITÉ DE POLIGNY CONSULTATION JUIN 2006 3| ÉDITORIAUX M. Raymond Forni, Président de la Région Franche-Comté Dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région 2000-2006, la desserte du massif du Jura et les relations franco-suisses ont été identifiées comme deux axes d’intervention majeurs pour la Région Franche Comté. L’objectif que nous poursuivons consiste à réaliser des infrastructures qui permettront à la fois de désenclaver notre région – ce qui est indispen- sable à l’économie – et d’améliorer les liaisons de proximité, offrant ainsi un accès plus aisé à chacune des parties du territoire régional. -

Principaux Résultats Floristiques Des Prospections Des Cours D'eau Et Des
Les Nouvelles Archives de la Flore jurassienne, 5, 2007 – Société Botanique de Franche-Comté Principaux résultats floristiques des prospections des cours d’eau et des zones humides des vallées du Doubs et de la Loue par Marc Vuillemenot M. Vuillemenot, Conservatoire Botanique National de Franche-Comté, Porte Rivotte, 25000 Besançon. Courriel : [email protected] Résumé – La prospection de 340 kilomètres de rivières et d’annexes hydrauliques sur la vallée du Doubs et quelques-uns de ses affluents, destinée principalement à établir la typologie phytosociologique des végétations aquatiques, amphibies et rivulaires, a permis simultanément de réaliser de nombreuses obser- vations botaniques. Le présent article aborde ainsi la distribution et l’écologie de 80 taxons répertoriés sur ce territoire, dont 24 taxons de la liste rouge de Franche-Comté et 28 taxons considérés comme inva- sifs ou potentiellement invasifs dans la région. Mots-clés : inventaire floristique, plantes patrimoniales, plantes invasives, Doubs, Loue. Introduction taines observations botaniques réa- versant de 7 550 kilomètres carrés. lisées durant cette étude. L’essentiel Quatre grandes unités morpholo- et article reprend les prin- des descriptions est extrait du rap- giques sont classiquement définies cipaux résultats floristiques port de synthèse (Vuillemenot et de l’amont vers l’aval (Citterio, d’une étude réalisée en Hans, 2007), mais certaines ont Rollet et Piégay, 2003) : C2005 et 2006 par le Conservatoire pu être complétées par de nouvel- Botanique National de Franche- les données de la base Taxa©sbfc/ – le Doubs supérieur, ou Doubs de Comté (CBNFC), dans le cadre du cbfc et 24 taxons ont été nouvel- la Haute Chaîne, des sources à la programme « Avenir du Territoire lement commentés. -

Le Réseau MOBIGO Dans Le Jura
Le réseau MOBIGO dans le Jura conditions de circulation Dernière mise à jour : 4/4/19 8:40 P = circuit Primaire, retard ou Ne circule Ligne transporteur Origine / destination normale Observations Type de circuit S = circuit Secondaire, perturbée pas (P / S / LR) LR = ligne structurante TOTAUX 286 1 7 100 TRANSDEV / ARBOIS TOURISME Navettes DOLE 1 160 TRANSDEV TAXENNE - GENDREY 1 161 TRANSDEV La BARRE-La BRETENIERE-ORCHAMPS Primaire 1 162 TRANSDEV RPI SERMANGE - GENDREY 1 163 TRANSDEV Ecole Concordia RANCHOT 1 164 TRANSDEV RPI PAGNEY - OUGNEY - VITREUX primaires 1 165 TRANSDEV BRANS - THERVAY - Gpe Sco DAMMARTIN 1 166 TRANSDEV CHAMPAGNEY - RPI Scolaire Dammartin 1 167 TRANSDEV RPI MONTMIREY-OFFLANGES - MOISSEY 1 168 TRANSDEV RPI PEINTRE MONTMIREY 1 169 TRANSDEV RPI PLUMONT - ETREPRIGNEY 1 170 TRANSDEV Pt MERCEY-DAMPIERRE-FRAISANS Prim/Collèg 1 172 TRANSDEV ORCHAMPS - FRAISANS Collège 1 173 TRANSDEV LA BARRE - FRAISANS Collège 1 174 TRANSDEV DAMPIERRE-FRAISANS Prim et collège 1 175 TRANSDEV MONTEPLAIN - ORCHAMPS 1 176 TRANSDEV OFFLANGES - PESMES Collège 1 177 TRANSDEV PAGNEY - PESMES Collège 1 178 TRANSDEV DAMMARTIN Champagnolot - PESMES Collège 1 179 TRANSDEV OUR - FRAISANS Collège 1 180 TRANSDEV RANS - ORCHAMPS 1 210 KMJ FROIDEVILLE - LONS LE SAUNIER 1 211 KMJ MOLAY - TAVAUX Collège 1 212 KMJ ST GERMAIN LES ARLAY - BLETTERANS Collèg 1 213 KMJ CHAPELLE-VOLAND - BLETTERANS Collège 1 214 KMJ FONTAINEBRUX-BLETTERANS Collège 1 215 KMJ BOIS DE GAND - BLETTERANS 1 216 KMJ COSGES - BLETTERANS 1 217 ARBOIS TOURISME BALIASEAUX - CHAUSSIN Collège -

LE TRÈS HAUT DÉBIT S'installe Dans Le Jura
COMMUNAUTÉ de COMMUNES Arbois Poligny Salins www.studiolautrec.fr - 2017 www.studiolautrec.fr CONCEPTION/ LE TRÈS HAUT DÉBIT S’INSTALLE ©Conseil Départemental du Jura - DGS - SIG/SAN - juin 2017 - IGN - Plan France Très Haut débit Très - juin 2017 IGN Plan France - DGS SIG/SAN du Jura ©Conseil Départemental dans le Jura CARTE/ Fotolia©leungchopan Fotolia©leungchopan PHOTO/ PHOTO/ LE DÉPARTEMENT DU JURA AVEC LE CŒUR DU JURA Le réseau Le réseau AUJOURD’HUI DE DEMAIN NIVEAU DE DÉBIT INTERNET CALENDRIER LISTE DES COMMUNES 100 mbit/s et plus PRÉVISIONNEL DU PROJET 30 à 100 mbit/s 8 à 30 mbit/s Les opérations de Montée en Fibre (Ftth) 3 à 8 mbit/s Débit s’effectueront de 2018 à Montée en débit moins de 3 mbit/s fin 2019. LA CHAPELLE Les opérations FTTH s’effectue- LA CHAPELLE ARBOIS SURFURIEUSE ront du second semestre 2018 à SURFURIEUSE SAINTTHIEBAUD la fin 2021, selon une priorisation SAINTTHIEBAUD ARESCHES SAIZENAY SAIZENAY SAINTCYR AIGLEPIERRE SALINS SAINTCYR SALINS MONTMALIN GERAISE donnée par la Communauté de AIGLEPIERRE GERAISE BERSAILLIN LES ASURES LESBAINS MONTMALIN MOLAMBOZ CLUCY Communes d’Arbois, Poligny, LES ASURES LESBAINS MONTIGNY MARNOZ MOLAMBOZ MARNOZ CLUCY VADANS MONTIGNY BESAIN LA FERTE LESASURES CERNAN Salins, Cœur du Jura. VADANS CERNAN PRETIN DOURNON LA FERTE LESASURES PRETIN DOURNON VILLERS MATHENAY VILLETTE BRACON VILLETTE LESARBOIS VILLERS MATHENAY BRACON BIEFMORIN LESBOIS ABERGEMENTLESTHESY LESBOIS LESARBOIS AUMONT ABERGEMENTLEGRAND AUMONT ABERGEMENTLESTHESY IVORY THESY ABERGEMENTLEGRAND IVORY BRACON OUSSIERES ABERGEMENT -

LISTE Des CLUBS
LISTING des COORDONNEES des CLUBS AIGLEPIERRE FC. ROUGE ET BLEU 533581 [email protected] CORRESPONDANT (Bureau) CORNU LAURENT PRESIDENT (Bureau) CORNU LAURENT Responsable Jeunes CORNU SEBASTIEN Responsable U11 - U10 MERCET LUDOVIC [email protected] 9 CHEMIN DU RELAIS 39110 AIGLEPIERRE Responsable U13 - U12 PESEUX MICKAEL 0608335975 [email protected] 8 CHEMIN DES ROSSETS 39110 AIGLEPIERRE Responsable U15 - U14 CORNU OLIVIER 689580541 [email protected] 11 RUE DU CHAUVENT 39600 VILLETTE LES ARBOIS Responsable U7 - U6 CORNU LAURENT Responsable U9 - U8 FEVRE LOIC 07 89 48 53 27 [email protected] 49 RUE DES ORCIERES 39110 AIGLEPIERRE Référent Arbitre CORNU LAURENT Référent Football Féminin CORNU SEBASTIEN TRESORIER (Bureau) CORNU SEBASTIEN ANGILLON RC ROUGE et NOIR 560112 [email protected] CORRESPONDANT (Bureau) LUCAS MICKAEL 671623574 [email protected] 66 RUE DU CHATEAU D'EAU 39300 VERS EN MONTAGNE PRESIDENT (Bureau) COMTE ANTHONY 675869768 [email protected] 8 ROUTE DE SALINS 39380 MONT SOUS VAUDREY Responsable Jeunes LUCAS MICKAEL 671623574 [email protected] 66 RUE DU CHATEAU D'EAU 39300 VERS EN MONTAGNE Responsable Seniors F COMTE ANTHONY 675869768 [email protected] 8 ROUTE DE SALINS 39380 MONT SOUS VAUDREY Responsable U11 - U10 PERNET SYLVAIN 677779986 [email protected] 8 RUE DES JONQUILLES 39300 VERS EN MONTAGNE Responsable U13 - U12 LUCAS MICKAEL 671623574 [email protected] 66 RUE DU CHATEAU D'EAU 39300 VERS EN MONTAGNE Responsable -

Commune De LA BRETENIERE (39076) Cartographie Du Risque « Inondation » (Pprn Du Doubs)
PREFECTURE DU JURA Commune de LA BRETENIERE (39076) Cartographie du risque « inondation » (PPRn du Doubs) A/ DESCRIPTION SOMMAIRE DU RISQUE Le Doubs prend sa source dans le Haut-Jura, traverse le département du Doubs puis celui du Jura avant de se jeter dans la Saône. La partie jurassienne, longue de 50 km, se décompose en deux tronçons : la Moyenne vallée de Salans jusqu’à la confluence avec la Loue, son principal affluent, et la Basse vallée qui s’étend de cette confluence jusqu’à Annoire, en limite de la Saône-et-Loire. La Moyenne Vallée se caractérise par un lit majeur assez large avec des resserrements ponctuels (Ranchot et Dole). Les villages sont situés en bordure du champ d’inondations, en pied de coteau. La Basse vallée est constituée d’une vaste plaine inondable qui servait de champs d’expansion naturel. A partir de Gevry, le lit moyen a été progressivement endigué pour la protection des villages de la plaine. Toutefois, des ruptures de digues se sont produites lors des très grandes crues. 3. Nature et caractéristiques des crues Le Doubs a connu de nombreuses crues au cours du siècle écoulé : on peut citer celles de 1910, 1950, 1953, 1955, 1957, 1983 et 1990. Elles surviennent en général en hiver suite à des épisodes de pluies océaniques, souvent aggravés par la fonte des neiges sur les parties vosgienne (par l’intermédiaire de l’Allan) et jurassienne (la Loue) de son bassin versant. La montée des eaux est relativement lente, ce qui permet de qualifier ces crues de « crues de plaine ». -

Le Réseau MOBIGO Dans Le Doubs Conditions De Circulation Dernière Mise À Jour : 2/10/19 7:48
Le réseau MOBIGO dans le Doubs conditions de circulation Dernière mise à jour : 2/10/19 7:48 retard ou Ne circule Ligne transporteur Origine / destination normale Observations Type de circuit perturbée pas Choisir dans la TOTAUX 501 - 1 liste 0002RPI01 DOUX VOYAGES RPI Adam les Passavant - Passavant 1 Scolaire 0004RPI01 MOUCHET RPI Appenans - Mancenans 1 Scolaire 0005RPI01H JEANNERET Villers-s/s-Chalamont - Arc-s/s-Montenot 1 Scolaire 0012RPI01 MBFC MOBILITES BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE RPI Dompierre - Bulle - Bannans 1 Scolaire 0012RPI02 MBFC MOBILITES BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE RPI Dompierre - Bulle - Bannans 1 Scolaire 0012RPI03 MBFC MOBILITES BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE RPI Dompierre - Bulle - Bannans 1 Scolaire 0013RPI01 GTV GROSPERRIN TOURISME VOYAGES RPI Berthelange - Corcondray - Corcelles 1 Scolaire 0016RPI01 KEOLIS MONTS JURA RPI Bonnevaux - Vaux-et-Chantegrue 1 Scolaire 0018RPI01 MOUCHET RPI Abbenans - Fallon 1 Scolaire 0019RPI01 MBFC MOBILITES BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE RPI Longevilles - Rochejean 1 Scolaire 0020RPI01H KEOLIS MONTS JURA RPI Bugny - La-Chaux-de-Gilley 1 Scolaire 0021RPI01 KEOLIS MONTS JURA RPI Franey - Burgille - Recologne 1 Scolaire 0021RPI02 KEOLIS MONTS JURA RPI Franey - Burgille - Recologne 1 Scolaire 0021RPI03 KEOLIS MONTS JURA RPI Franey - Burgille - Recologne 1 Scolaire 0022RPI01 MARON RPI Montécheroux - Chamesol 1 Scolaire 0028RPI01 DOUX VOYAGES RPI vandoncourt - Montbouton 1 Scolaire 0031RPI01 KEOLIS MONTS JURA RPI Indevillers - Courtefontaine 1 Scolaire 0031RPI02 KEOLIS MONTS JURA RPI Indevillers - Courtefontaine -

Contrat De Riviere Bassin Versant De L'orain
CONTRAT DE RIVIERE BASSIN VERSANT DE L'ORAIN DOSSIER DEFINITIF DE CANDIDATURE TOME I : Etat des lieux en collaboration avec les Communautés de Dossier réalisé par : Communes et les Syndicats Intercommunaux d'Aménagements Avec l'appui technique et financier de : - Février 2011 - SOMMAIRE CHAPITRE 1 : PRESENTATION DU BASSIN VERSANT 10 1.1 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 10 1.2 DEMOGRAPHIE 11 1.3 OCCUPATION DES SOLS 12 1.3.1 OCCUPATION DU SOL A L’ECHELLE DU BASSIN VERSANT 12 1.3.2 AMENAGEMENTS FONCIERS 13 1.4 ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE 13 1.4.1 LES COMMUNAUTES DE COMMUNES DU BASSIN VERSANT ET LEURS COMPETENCES 13 1.4.2 LES SYNDICATS D'AMENAGEMENT ET DE TRAVAUX EN RIVIERE 14 1.5 ACTIVITES ECONOMIQUES 16 1.5.1 SECTEUR INDUSTRIEL 16 1.5.2 SECTEUR AGRICOLE 18 1.6 POTENTIALITES TOURISTIQUES 22 1.6.1 GENERALITES 22 1.6.2 LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL 23 1.6.3 LES ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS 24 CHAPITRE 2 : CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU BASSIN VERSANT 26 2.1 GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE 26 2.1.1 LE PREMIER PLATEAU (MES "D0_140") 27 2.1.2 LA ZONE DU VIGNOBLE (MES "D0_516") 27 2.1.3 LA BRESSE (MES "D0_505") 27 2.2 RESEAU HYDROGRAPHIQUE 28 2.2.1 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 28 2.2.2 LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE AU SENS DE LA DIRECTIVE CADRE SUR L'EAU (DCE) 29 2.3 DELIMITATION DES SOUS-BASSINS VERSANTS 30 2.4 HYDROLOGIE 30 2.4.1 CLIMATOLOGIE ET PLUVIOMETRIE 30 2.4.2 DEBITS DE REFERENCE 32 2.4.3 ANALYSE HISTORIQUE DES DEBITS DE LA STATION HYDROMETRIQUE LOCALISEE AU DESCHAUX 33 CHAPITRE 3 : FONCTIONNEMENT MORPHODYNAMIQUE DE L'ORAIN ET DE SES AFFLUENTS -

Région Territoire De Vie-Santé Commune Code Département Code Commune Bourgogne-Franche-Comté Aillant-Sur-Tholon Aillant-Sur
Code Code Région Territoire de vie-santé Commune département commune Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Aillant-sur-Tholon 89 89003 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Beauvoir 89 89033 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Chassy 89 89088 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Égleny 89 89150 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon La Ferté-Loupière 89 89163 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Fleury-la-Vallée 89 89167 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Guerchy 89 89196 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Laduz 89 89213 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Neuilly 89 89275 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Les Ormes 89 89281 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Poilly-sur-Tholon 89 89304 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Saint-Aubin-Château-Neuf 89 89334 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Saint-Maurice-le-Vieil 89 89360 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Saint-Maurice-Thizouaille 89 89361 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Senan 89 89384 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Sommecaise 89 89397 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Villiers-sur-Tholon 89 89473 Bourgogne-Franche-Comté Aillant-sur-Tholon Volgré 89 89484 Bourgogne-Franche-Comté Aix-en-Othe Bagneaux 89 89027 Bourgogne-Franche-Comté Aix-en-Othe Boeurs-en-Othe 89 89048 Bourgogne-Franche-Comté Aix-en-Othe Cérilly 89 89065 Bourgogne-Franche-Comté Aix-en-Othe Coulours 89 89120 Bourgogne-Franche-Comté Aix-en-Othe Courgenay 89 89122 Bourgogne-Franche-Comté Aix-en-Othe